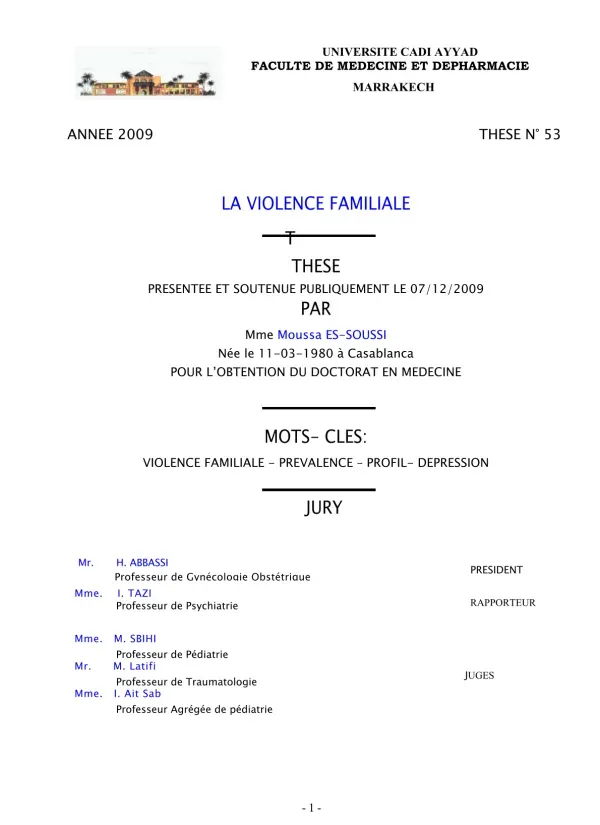
Thèse sur la Violence Familiale et ses Impacts Psychologiques
Informations sur le document
| Auteur | Mme Moussa Es-Soussi |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Casablanca |
| Type de document | thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 3.93 MB |
- violence familiale
- santé mentale
- thèse de médecine
Résumé
I.La Violence Familiale au Maroc Ampleur et Conséquences
Cette étude épidémiologique, menée à Marrakech auprès de 265 femmes, explore l'ampleur de la violence familiale au Maroc. Elle révèle une prévalence importante de la violence conjugale, avec 74% des femmes interrogées déclarant en avoir été victimes (rapport de juin 2007). Parmi celles-ci, 30,4% ont subi des violences physiques. L'étude souligne également le manque de données sur ce fléau au Maroc et met en lumière les conséquences graves sur la santé physique et mentale des femmes et des enfants, contribuant à une régénération de la violence au sein de la famille et de la société. Les données montrent une corrélation entre violence familiale et conséquences comme la dépression et les traumatismes physiques. Des études internationales montrent une prévalence variable de la violence physique commise par le partenaire intime, oscillant entre 13% et 61% selon l'OMS.
1. Prévalence de la violence familiale au Maroc
L'étude souligne le manque de données précises sur la violence familiale au Maroc. Cependant, les chiffres disponibles, provenant du réseau national des centres d’écoute des femmes victimes de violence, indiquent une prévalence élevée de la violence conjugale, atteignant 74% selon un rapport de juin 2007. Parmi ces cas de violence conjugale, 30,4% sont des violences physiques. Ces statistiques mettent en évidence un problème majeur de santé publique au Maroc, nécessitant davantage de recherches et de données pour une meilleure compréhension de l'ampleur du phénomène. La rareté des études sur ce sujet au Maroc empêche une évaluation complète de l’impact de la violence familiale sur la société marocaine. L'étude insiste sur la nécessité de collecter davantage de données pour mieux appréhender la réalité de la violence familiale et planifier des interventions appropriées. Il est également important de noter que les chiffres disponibles représentent probablement une sous-estimation de la réalité, de nombreuses victimes ne déclarant pas les violences subies. La violence familiale, bien que moins médiatisée que d'autres types de violence, est un problème préoccupant qui touche la santé et les droits humains.
2. Conséquences de la violence familiale sur les individus et la société
La violence familiale, causée par des inégalités de pouvoir au sein de la cellule familiale, a des conséquences désastreuses sur les individus et la société. Elle engendre un déséquilibre des valeurs et des comportements, particulièrement chez les enfants, contribuant à un cercle vicieux de violence intergénérationnelle. L'OMS inclut intentionnellement tous les actes violents, qu'ils aient des conséquences immédiates ou non, en excluant seulement les actes accidentels. Sa définition englobe la force physique, les menaces et les intimidations, dans le cadre d’une relation de pouvoir. Les victimes subissent des souffrances physiques, psychologiques et/ou sexuelles. La menace de violence, la contrainte, ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée, sont également prises en compte. Au niveau sociétal, cette violence a des répercussions profondes, impactant l’harmonie familiale, la stabilité sociale et contribuant à la reproduction de modèles de comportements violents au sein des générations futures. L'étude met en évidence le caractère très destructeur d'un climat de violence à long terme sur la femme, quel que soit la gravité apparente des signes cliniques.
3. Données comparatives internationales sur la violence familiale
L'étude cite des données internationales pour contextualiser la situation au Maroc. Une étude en Syrie (2002) révèle que 21,8% des femmes ont subi des violences familiales, dont la moitié étaient des violences physiques. En France (2000), 8% des femmes ont déclaré avoir subi du harcèlement psychologique et 2,5% des agressions physiques au cours des 12 derniers mois. Des études de l'OMS dans 71 pays montrent une prévalence de la violence physique par un partenaire intime variant entre 13% et 61% au cours de la vie d’une femme, et entre 23% et 49% pour la plupart des pays. Au Canada (1993), 25% des femmes ont été victimes de violence depuis l'âge de 16 ans, et 3% sur les 12 derniers mois. Au Maroc (2006), un rapport sur la violence basée sur le genre, concernant 864 femmes, indique que 91,7% ont été agressées par leur mari, avec 26,2% de violences physiques et 18,7% de violences psychologiques. En France (ENVEFF 2000), le taux de femmes victimes de violence très grave est plus élevé chez les cadres supérieurs (6,1%) que chez les femmes totalement inactives et chômeuses (2,8%). Ces données internationales soulignent la nature universelle du problème et la nécessité d’une action globale pour lutter contre la violence familiale.
II.Types de Violence et Profils des Victimes et Auteurs
L'étude identifie différents types de violence: physique, psychologique et sexuelle. La violence psychologique, incluant menaces, harcèlement et privation de liberté, est aussi fréquente. Le profil des victimes montre une prédominance de femmes sans profession ou ayant abandonné leur activité, bien que des femmes actives puissent aussi être concernées. Concernant les auteurs de violence conjugale, l’étude révèle qu’un tiers sont des ouvriers (35%), tandis que selon d’autres études, une forte proportion de cadres supérieurs (67%) et de professionnels de santé (25%) sont impliqués. L'impact sur les enfants est également significatif, avec une majorité (63,6%) ayant assisté aux agressions, et 75% étant victimes elles-mêmes. Des études en France et à l’international confirment ces observations sur le rôle des enfants comme témoins et victimes de la violence familiale.
1. Types de violence familiale
Le document identifie plusieurs types de violence familiale. La violence physique est explicitement mentionnée, avec des exemples de lésions corporelles (contusions, plaies, fractures). La violence psychologique est également abordée, englobant les menaces, la contrainte, le harcèlement, la discrimination, l’humiliation, l’insulte et la privation de liberté. Ces actes, même sans menace immédiate, constituent des formes de violence par leur accumulation. Enfin, la violence sexuelle est définie comme des actes sexuels imposés par la force, allant de la contrainte au viol. L'étude souligne que la violence familiale peut prendre différentes formes et que l'impact sur la victime est souvent multidimensionnel, combinant des souffrances physiques et psychologiques profondes. La violence familiale n'est pas limitée à la violence physique directe, mais englobe également des formes subtiles mais destructrices de manipulation et de contrôle psychologique. La notion de rapport de force est cruciale : la personne la plus forte structurellement au sein de la famille exerce la violence, comme le souligne Buchler (1998).
2. Profil des victimes de violence familiale
Le document indique que la majorité des femmes victimes de violence familiale sont sans profession ou ont abandonné leur activité professionnelle. Cependant, il précise que même les femmes actives et disposant de ressources personnelles peuvent être victimes de l’emprise d’un conjoint violent. L’âge est un facteur de risque, les femmes plus jeunes étant potentiellement plus vulnérables, en partie du fait d'un effet de génération; les femmes plus âgées n'ayant pas la même perception des comportements autoritaires d'un homme épousé dans un contexte patriarcal comparé à des femmes mariées dans un contexte plus égalitaire. La peur, la honte, les représailles, l’absence d’aide économique, l’inquiétude pour les enfants et le manque de soutien familial sont des facteurs qui maintiennent les femmes dans des relations violentes. Malgré ces obstacles, beaucoup finissent par quitter leur partenaire violent, ce processus s’étalant dans le temps et incluant des périodes de déni, de culpabilité et de souffrance. Le document souligne le caractère non passif de la plupart des victimes, qui mettent en place des stratégies pour se protéger et protéger leurs enfants.
3. Profil des auteurs de violence familiale
L'étude révèle que dans son échantillon, plus d'un tiers des conjoints violents sont des ouvriers (35%). Cependant, d'autres études, comme celle du Dr Henrion (1999), indiquent une forte proportion de cadres supérieurs (67%) et de professionnels de santé (25%) parmi les auteurs de violences. Cela suggère que la violence familiale traverse toutes les classes socio-économiques. L'étude souligne que l'accès à un certain pouvoir, lié à la fonction professionnelle, peut être un facteur aggravant dans le phénomène de violence conjugale. Le document ne fournit pas de données exhaustives sur le profil complet des auteurs, mais souligne la diversité des contextes socioprofessionnels dans lesquels se manifeste la violence familiale. Le contexte familial de l’enfance joue aussi un rôle : des études françaises montrent qu'une corrélation existe entre le fait d'avoir subi des violences dans l'enfance et le fait d'être victime de violences à l'âge adulte. Les enfants sont également des victimes directes dans de nombreux cas (75% dans l'étude).
4. L enfant témoin et victime de violence familiale
L'étude met en lumière la vulnérabilité des enfants confrontés à la violence familiale. Dans 63,6% des cas étudiés, les enfants ont assisté à des agressions contre leur mère, et dans 75% des cas, ils ont été eux-mêmes victimes de violences. Une étude française (ENVEFF 2000) rapporte que 35% des femmes ont indiqué que leurs enfants avaient assisté à des scènes de violence entre elles et leur père. Être témoin de violence a le même impact négatif sur un enfant que d’en être la victime directe. Les réactions des enfants peuvent varier (fuite, observation silencieuse, intervention), mais ils développent souvent un sentiment de culpabilité, accentuée si le père les utilise comme moyen de pression. Le risque de reproduction de la violence à l’âge adulte est accru chez ces enfants, la violence étant leur unique modèle relationnel appris. Des études en Irlande (64%) et au Mexique (50%) confirment l'impact significatif sur les enfants témoins de violences conjugales.
III.Le Rôle des Professionnels de Santé dans le Dépistage et la Prise en Charge
Les professionnels de santé jouent un rôle crucial dans le dépistage de la violence familiale. Ils doivent être attentifs aux signes physiques, mais aussi aux troubles psychologiques et somatiques qui peuvent masquer la violence. Le dépistage systématique est essentiel, même en l'absence de signes évocateurs, bien que de nombreuses femmes hésitent à parler de leurs expériences. L'évaluation de la gravité inclut l'analyse des lésions physiques (contusions, plaies, fractures) et les conséquences psychologiques (dépression, anxiété, tentatives de suicide). Les professionnels de santé doivent fournir des soins médicaux, un soutien psychologique et orienter les victimes vers des ressources d'aide, tout en respectant le secret professionnel.
1. Le dépistage de la violence familiale par les professionnels de santé
Les professionnels de santé, souvent les premiers points de contact, jouent un rôle clé dans le dépistage de la violence familiale. Le dépistage est facilité par la présence de lésions visibles, surtout si elles sont multiples et d'âges différents. Cependant, il est plus complexe lorsque la femme consulte pour des troubles psychosomatiques (digestifs, gynécologiques, psychiatriques). Le médecin doit alors faire preuve de perspicacité et poser des questions ciblées. En l’absence de signes évocateurs, le dépistage systématique est crucial, même si la majorité des femmes ne parlent pas spontanément de leurs expériences (seulement 25% le feraient spontanément selon des études canadiennes). Des questions directes et sensibles peuvent être posées, par exemple : « De nombreuses patientes nous disent avoir été plus ou moins maltraitées par quelqu’un de proche. Est-ce que cela vous est arrivé ? » ou « Êtes-vous effrayée par le comportement de quelqu’un à votre domicile ? » Une réponse affirmative doit mener à un approfondissement de la situation par des questions complémentaires. L'approche du professionnel de santé est donc déterminante pour le repérage de la violence.
2. L évaluation de la gravité de la violence familiale
L'évaluation de la gravité de la violence familiale nécessite une appréciation des conséquences somatiques des lésions traumatiques et gynécologiques (en cas de rapports sexuels forcés). Il faut également évaluer l’impact psychologique, qui peut inclure des manifestations anxieuses, phobiques, des épisodes dépressifs, des tentatives de suicide, et des comportements addictifs. Il est important de ne pas sous-estimer les conséquences d'un climat de violence à long terme, même en l’absence de signes cliniques graves. Des éléments contextuels, tels qu'un conjoint sans emploi ou une situation de précarité, aggravent la situation. Le comportement de la femme (peur, apathie, irritation) et de l’homme (trop prévenant, répondant à la place de sa femme) lors de la consultation doit alerter le professionnel de santé. Il est même conseillé d’écarter l'accompagnateur sous un prétexte. La patiente peut consulter pour des raisons non directement liées à la violence (certificat médical, renouvellement de traitement...). Même si la femme ne souhaite pas parler, le médecin doit lui laisser la possibilité de revenir et lui fournir des contacts utiles.
3. Prise en charge médicale et orientation des victimes
La prise en charge médicale inclut le traitement des lésions physiques et la gestion des manifestations douloureuses immédiates ainsi que du retentissement psychologique (insomnie, anxiété, dépression). L’établissement d'un certificat médical, obligatoire, peut être différé, mais tous les éléments recueillis (début, fréquence, type de violences, contexte déclenchant, lésions, impact psychologique, violence envers d’autres membres de la famille) doivent être consignés dans le dossier médical. En cas de risque élevé, une hospitalisation d'urgence, un éloignement temporaire ou le dépôt de plainte peuvent être conseillés. L’orientation vers des associations d'aide aux victimes est essentielle. L’analyse de cas d’homicides montre que la prise en compte des signes d'alerte par les professionnels de santé et de justice aurait pu éviter des drames. La réticence des femmes à parler est fréquente; fatigue physique, dépression, volonté de préserver l’unité familiale, peur des représailles, difficultés matérielles, appréhension du système judiciaire, crainte des conséquences d'un départ du domicile conjugal sont autant de facteurs explicatifs. L’évaluation des conséquences fonctionnelles des blessures, incluant l’ITT (incapacité totale de travail), est importante pour l’appréciation du préjudice subi et la fixation de la peine.
4. Information et orientation de la patiente
L'information et l'orientation des victimes sont des missions essentielles des professionnels de santé. Les réponses claires et l'aide offerte influencent directement la capacité de la femme à mettre fin à la situation. Le médecin peut fournir des informations sur les ressources d'aide existantes et les outils pour se soustraire aux situations de violence. La gravité de la situation, l'état de réceptivité de la patiente et ses désirs influencent la stratégie d'intervention. Le rôle du professionnel de santé ne se limite pas au traitement des lésions physiques, mais englobe le soutien psychologique, l’orientation et la mise en relation avec des structures appropriées pour une prise en charge globale de la situation. L’objectif est de donner à la victime les outils et le soutien nécessaires pour qu’elle puisse reprendre le contrôle sur sa vie.
IV. Prévention de la Violence Familiale au Maroc Défis et Objectifs
La prévention de la violence familiale est essentielle et nécessite une approche multisectorielle. Il s’agit d’agir sur les causes profondes de la violence en modifiant les valeurs et les comportements sociétaux. Des actions de prévention primaire, secondaire et tertiaire ciblent les victimes, les auteurs et les enfants. L'objectif est de réduire la tolérance envers la violence, d’empêcher la récidive chez les auteurs et de briser le cycle de la violence intergénérationnelle. La collaboration entre acteurs de la santé, de la justice et des associations est indispensable pour mettre en place des stratégies de prévention efficaces.
1. Définition et principes de la prévention de la violence familiale
La prévention de la violence familiale vise à réduire la probabilité d'apparition de ce phénomène en s'attaquant à ses causes et facteurs associés. Elle est essentielle pour diminuer la fréquence de la violence, mais des activités de promotion à long terme sont également nécessaires pour modifier la culture et les valeurs qui favorisent la violence. La promotion consiste à modifier les contextes politique, social, économique, culturel, environnemental et biologique pour améliorer le bien-être des individus et des populations, encourageant la responsabilisation des personnes quant à leur santé. La prévention implique une compréhension commune du phénomène pour développer des moyens cohérents et des outils efficaces. Des priorités d'action doivent être établies et des moyens mis en œuvre en fonction des objectifs poursuivis. Les intervenants doivent être clairement identifiés et mobilisés, et les ressources nécessaires engagées. Le succès repose sur une intervention massive, concertée, complémentaire et cohérente. La prévention doit englober des actions à la fois préventives et curatives pour interrompre le cycle de la violence.
2. Stratégies de prévention ciblées
La prévention de la violence familiale doit cibler différents groupes: les femmes victimes, les enfants et les conjoints violents. Pour les victimes, il s’agit de réduire leur tolérance à la violence et de les aider à s’en extraire. Pour les auteurs, la prévention tertiaire vise à empêcher la récidive par des interventions socio-judiciaires et correctionnelles appropriées. Une attention particulière doit être portée aux enfants afin d’éviter que les filles ne deviennent des victimes et les garçons des agresseurs. La prévention nécessite une connaissance des causes et des facteurs favorisant l’émergence de la violence. Pour les victimes, il s’agit de les informer sur les ressources d’aide et de leur fournir les outils pour quitter des situations de violence. Pour les enfants, l’objectif est de les aider à construire des relations plus saines et égalitaires que celles qu’ils ont observées dans leur famille. Il est donc essentiel d’agir sur différents niveaux, de la prévention primaire (modification des valeurs) à la prévention tertiaire (réinsertion des auteurs).
V.Aspects Juridiques et Déontologiques au Maroc
Le Code pénal marocain, amendé en 2003, pénalise sévèrement la violence conjugale. L’article 1-503 prévoit des peines d'emprisonnement de 1 à 2 ans et des amendes de 5 000 à 50 000 dirhams. Cependant, un conflit existe entre l'obligation du secret professionnel des médecins et leur devoir de porter secours aux victimes en danger. Le code de déontologie médicale doit être interprété avec discernement dans les situations de violence familiale. La responsabilité du médecin est de trouver un équilibre entre ces deux obligations, en tenant compte de la gravité de la situation et du risque encouru par la victime.
1. Sanctions pénales marocaines contre la violence familiale
Le Code pénal marocain punit l'usage de la violence contre les conjoints. Son amendement en 2003 a renforcé les sanctions contre les hommes qui violent leurs épouses. L’article 404, initialement axé sur la violence envers les parents et ascendants (depuis 1962), a été modifié pour inclure la violence conjugale. Les peines sont proportionnelles à la gravité des actes. L’article 1-503 condamne l’agresseur à une peine d’emprisonnement de 1 à 2 ans et une amende de 5 000 à 50 000 dirhams. La loi assure la protection de la femme victime de violence, à la fois au sein du domicile conjugal et à l'extérieur. Les sanctions sont plus sévères lorsque l'agresseur est le mari ou un parent, et ceci est valable également pour les filles mineures. Le code pénal vise à dissuader les auteurs de violence et à protéger les victimes. La modification du code pénal de 2003 montre une volonté d'adaptation de la législation face à l'ampleur du problème de la violence familiale.
2. Conflits déontologiques pour les professionnels de santé
Le document met en lumière le conflit potentiel entre l’intérêt du patient et l’obligation du secret professionnel pour les médecins confrontés à des cas de violence familiale. L’article 3 du code de déontologie médicale stipule l’obligation de porter secours en cas d’urgence immédiate, même si cela implique de briser le secret médical. Cependant, l’article 446 du même code prévoit des sanctions pour la révélation de secrets médicaux. L’article 431 du code pénal pénalise également l’omission de porter secours à une personne en péril. L’article 4 du code de déontologie rappelle quant à lui le devoir de secret absolu envers le patient. Le document souligne que la décision du médecin doit reposer sur le sens de la responsabilité et la conscience professionnelle, un équilibre délicat entre le devoir de secret et le devoir de protection des victimes, en particulier quand la vie de la personne est en danger. La responsabilité individuelle du médecin est donc mise en avant face à ce dilemme éthique.
