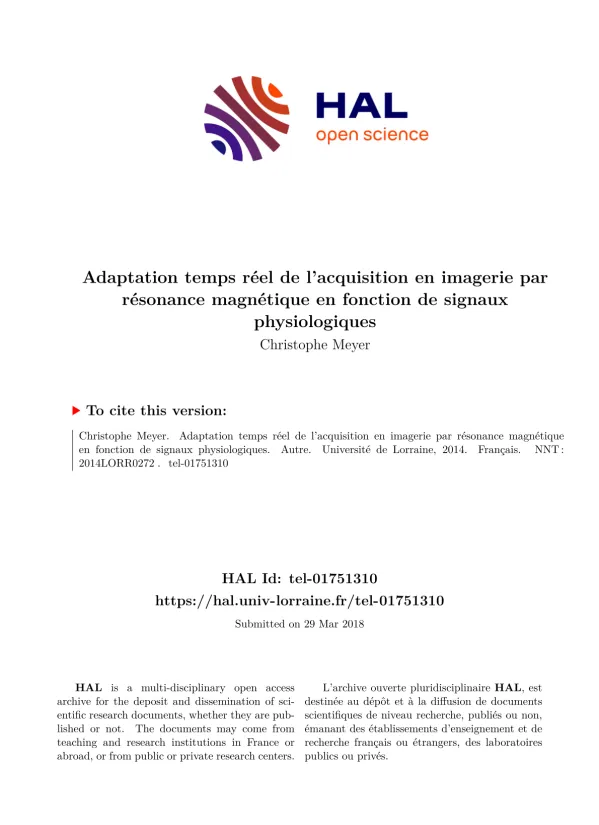
Adaptation en temps réel de l'acquisition en imagerie par résonance magnétique
Informations sur le document
| Auteur | Christophe Meyer |
| École | Université de Lorraine |
| Spécialité | Informatique Automatique Electronique Mathématiques |
| Type de document | Thèse |
| Lieu | Nancy |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 6.13 MB |
- Imagerie par résonance magnétique
- Signaux physiologiques
- Doctorat
Résumé
I.Mesure de vitesse du tissu cardiaque par IRM à contraste de phase Amélioration de la résolution temporelle
Cette étude explore la mesure de la vitesse du tissu cardiaque via IRM à contraste de phase. L'objectif principal est d'améliorer la résolution temporelle pour obtenir des résultats comparables à l'échocardiographie Doppler, la référence clinique. Le défi réside dans la lenteur intrinsèque de l'IRM. L'approche consiste à allonger la durée d'acquisition en respiration libre, gérant ainsi le mouvement respiratoire par moyennage puis par compensation de mouvement avec Cine-GRICS. Des comparaisons avec des mesures échographiques (système Vivid 7, General Electric) sont effectuées pour valider la précision des mesures IRM. L'étude met en évidence l'importance de la résolution temporelle (200 images/s suffisantes contre 30 insuffisantes) pour des mesures précises des pics de vitesse (ondes E, A, S, I). Les résultats sont analysés avec des tests statistiques (test Z de Pearson, ANOVA, méthode de Bland et Altman).
1. Mesure de vitesse cardiaque par IRM à contraste de phase Problématique de la résolution temporelle
Cette section aborde la difficulté d'obtenir une haute résolution temporelle lors de la mesure de la vitesse du tissu cardiaque par IRM à contraste de phase. L'IRM, intrinsèquement lente, est confrontée à la rapidité des mouvements cardiaques et respiratoires. L'apnée, bien qu'elle puisse solutionner les problèmes liés à la respiration, est insuffisante pour atteindre la haute résolution temporelle nécessaire à l'évaluation précise des vitesses tissulaires. Ceci nécessite donc une acquisition plus longue que la durée d'apnée permise. Le texte soulève ainsi le besoin de stratégies pour gérer efficacement ces mouvements, cardiaques et respiratoires, et atteindre une résolution temporelle optimale pour une mesure précise des vitesses. La difficulté principale est la longueur d'acquisition nécessaire pour une résolution temporelle suffisante. Différentes solutions pour pallier le problème sont évoquées: le respiratory gating, des techniques d'accélération (remplissage intelligent de l'espace k, imagerie parallèle), l'encodage de vitesse sur battements cardiaques séparés, et la combinaison vitesse/tagging. L’étude se focalise sur la vérification de la précision de mesures de vitesse longitudinale, en respiration libre avec simple moyennage, utilisant l'échocardiographie Doppler comme référence.
2. Protocole d échographie Doppler et acquisition IRM
Le protocole d'échographie cardiaque Doppler détaille l'utilisation d'un échographe Vivid 7 (General Electric Vingmed Ultrasound) par un cardiologue expérimenté, à l'insu des résultats IRM (en aveugle). L'échographie Doppler en vue 4 cavités est acquise simultanément à un ECG. L'orientation de la vue est optimisée pour des mesures précises de vitesse, conformément aux recommandations cliniques. Le volume de mesure est positionné à 1 cm du bord d'insertion latéral de la valve, couvrant le déplacement longitudinal des anneaux auriculaires-ventriculaires. La moyenne de 3 cycles cardiaques consécutifs est utilisée. La résolution temporelle de l'échographie, environ 200 images/s, sert de référence pour la comparaison avec les données IRM. Le logiciel EchoPAC (General Electric Vingmed Ultrasound) est employé pour le post-traitement. Les ondes E, A, S et I sont identifiées, et la valeur de vitesse pour chaque onde est déterminée à partir du maximum du pic de vitesse sur la courbe, en suivant les recommandations cliniques. L’acquisition IRM est synchronisée avec l’ECG via un système MagLife (Schiller). Les paramètres choisis mènent à une résolution temporelle de 18.8 ms en respiration libre contre 94 ms en apnée. L’analyse IRM utilise le logiciel FLOW 3.3 (Medic medical image system). Deux ROIs sont définies manuellement sur les ventricules gauche et droit sur les 200 images reconstruites. Le logiciel calcule la courbe de vitesse avec moyenne et écart-type, permettant l'identification des pics de vitesse. La valeur finale de vitesse est déterminée en utilisant le minimum entre la vitesse maximale et la moyenne plus deux fois l'écart-type. Cette approche vise à imiter la manière dont les cardiologues mesurent les vitesses à l'échographie.
3. Analyse statistique et discussion des résultats
L'analyse statistique comprend l'utilisation de la méthode de Bland et Altman pour évaluer la concordance entre les mesures échographiques (reproductibilité intra-observateur) et les mesures IRM, ainsi que les tests ANOVA, le Z-test de corrélation de Pearson et la régression linéaire. Le logiciel R est utilisé pour les analyses statistiques. Les résultats montrent que des séquences IRM à contraste de phase peuvent produire des mesures correctes de pics de vitesse à condition d'avoir une haute résolution temporelle (200 images/s suffisantes, 30 insuffisantes). La méthode, basée sur le moyennage de plusieurs excitations en respiration libre, est simple à implémenter en clinique, mais longue et nécessite un positionnement manuel des ROIs. Le processus de mesure IRM imite celui de l'échographie, ne considérant que le maximum de vitesse et rejetant les données aberrantes. La discussion aborde les limitations: positionnement manuel des ROIs (coûteux en temps), biais possible dû à l'effet de volume partiel et au mouvement respiratoire, et l’opportunité d'un algorithme de recalage pour propager la ROI sur le cycle cardiaque entier. La conclusion souligne l’importance d'une haute résolution temporelle pour des mesures précises, et que la méthode proposée, bien que simple à implémenter, est longue et pourrait bénéficier d'améliorations pour la segmentation des ROIs.
II.Adaptation de GRICS à l IRM à contraste de phase et acquisition en respiration libre
L'adaptation de l'algorithme GRICS à l'IRM à contraste de phase est détaillée. L'objectif est de permettre l'acquisition en respiration libre sans moyennage, minimisant les artefacts spatiaux. Des tests sont réalisés sur un fantôme de flux puis sur des volontaires sains. L'utilisation d'antennes multi-éléments et le calcul auto-calibré des cartes de sensibilité sont abordés pour améliorer la précision des mesures de vélocité. Les résultats de cette partie ont donné lieu à des présentations à des congrès internationaux (SCMR/ISMRM Workshop Flow and Motion 2012) et français (SFRMBM 2012, Journées Françaises de Radiologie).
1. Adaptation de GRICS à l IRM à contraste de phase
Cette partie détaille l'adaptation de l'algorithme GRICS (Generalized Reconstruction by Inversion of Coupled Systems) à l'IRM à contraste de phase. L'objectif principal est de permettre l'acquisition d'images en respiration libre, sans recourir au moyennage de plusieurs excitations, une technique qui introduit des artefacts spatiaux. L'algorithme GRICS, initialement conçu pour la compensation du mouvement respiratoire, est étendu afin d'inclure également la compensation du mouvement cardiaque. Ceci est crucial pour l'imagerie cardiaque, car le cœur est un organe en mouvement constant. L'intégration de GRICS dans le processus d'acquisition IRM permet une meilleure gestion des mouvements physiologiques du cœur, réduisant ainsi l'impact négatif des artefacts de mouvement sur la qualité des images. Le texte mentionne que le choix du nombre de phases cardiaques et la durée de chaque phase sont laissés libres, avec la possibilité de chevauchement pour augmenter la quantité de données. Cine-GRICS ajoute une compensation du mouvement cardiaque en plus de la compensation respiratoire déjà gérée par GRICS dans sa version originale. L'utilisation d'un signal de mouvement cardiaque approximé, basé sur l'ECG, comme contrainte pour GRICS est mentionnée. L'intégration de GRICS dans le workflow d'imagerie cardiaque permet donc d'obtenir des images de meilleure qualité, plus précises et plus fiables, en gérant efficacement les mouvements cardiaques et respiratoires.
2. Tests et validation de l adaptation de GRICS
La section décrit les tests effectués pour valider l'adaptation de GRICS à l'IRM à contraste de phase et à l'acquisition en respiration libre. Des essais préliminaires ont été réalisés sur un fantôme de flux connecté à une pompe à eau, permettant de simuler un flux contrôlé et de valider le bon fonctionnement de l'algorithme dans des conditions reproductibles. Des tests ont ensuite été menés sur des volontaires sains, en se concentrant sur l'aorte et le tissu cardiaque. L'utilisation d'antennes à multiples éléments pour l'acquisition du signal est abordée, soulignant l'importance du calcul auto-calibré des cartes de sensibilité pour éviter des erreurs de mesure de vélocité. Le texte précise que GRICS gère les antennes multi-éléments et calcule les cartes de sensibilité en interne, mais l'algorithme a été modifié pour permettre la lecture de ces cartes à partir d'un fichier externe. Ceci permet un contrôle et une validation plus précis du processus de traitement du signal. Les résultats des tests et validations effectués ont été présentés lors de plusieurs conférences, aussi bien internationales (SCMR/ISMRM Workshop Flow and Motion 2012) que françaises (SFRMBM 2012, Journées Françaises de Radiologie). La participation de l'auteur à la conception des études, le développement informatique, la fabrication du fantôme, l’acquisition IRM, l’analyse statistique et la rédaction des communications est mentionnée.
III.Modèle cardiaque personnalisé pour l IRM Cine Acquisition temps réel et visualisation des signaux DARTS
Pour améliorer la reconstruction Cine IRM, un modèle cardiaque adapté au patient est proposé. Une séquence IRM à contraste de phase en temps réel (RTPC) et le système DARTS sont utilisés pour acquérir des courbes de vélocité sur plusieurs cycles cardiaques. Ces données permettent de créer un modèle personnalisé, améliorant la précision des reconstructions. Une IRM 3T (Signa HDxt, General Electric) est utilisée, avec une antenne cardiaque à 8 éléments et une séquence FGRE. L'analyse se concentre sur l'aorte ascendante. Le système DARTS utilise la librairie FFTW 3 et Qt4. La durée de la systole est calculée. L'impact de ce modèle est comparé à des modèles existants (Weissler, modèle linéaire) et les résultats ont été soumis pour publication.
1. Nécessité d un modèle cardiaque personnalisé et présentation du système DARTS
Cette section introduit la problématique de la reconstruction Cine IRM et la nécessité d'un modèle cardiaque personnalisé pour améliorer la résolution temporelle. Les modèles cardiaques existants, basés sur des données anciennes, ne prennent pas en compte la variabilité du rythme cardiaque entre les individus et au cours du temps. Pour pallier cela, une approche en temps réel est proposée, utilisant un système nommé DARTS (pour Direct Acquisition Real Time System, bien que le nom ne soit pas explicitement défini comme tel dans ce passage) pour l’acquisition et le traitement des données IRM. Le but est d'obtenir des courbes de vélocité cardiaque à haute résolution temporelle sur plusieurs cycles cardiaques, permettant une adaptation du modèle cardiaque à chaque patient. Ce système permet un retour constant des informations, réduisant le temps d'attente utilisateur. L'acquisition en temps réel est cruciale pour capturer les variations du rythme cardiaque et construire un modèle plus précis et adapté à chaque patient, améliorant ainsi la qualité de la reconstruction Cine IRM. L'objectif est de surmonter les limitations des modèles existants, basés sur des moyennes populationnelles, qui ne capturent pas les variations inter-individuelles et intra-individuelles du rythme cardiaque. Le système DARTS est présenté comme un outil permettant une reconstruction plus précise et adaptée à chaque patient.
2. Méthode d acquisition et traitement des données avec DARTS
La méthode d'acquisition utilise une IRM 3T (Signa HDxt, General Electric) avec une antenne cardiaque à 8 éléments et une séquence en écho de gradient 2D cartésienne (FGRE). Les données brutes, obtenues directement des canaux d'antenne, sont traitées en temps réel par le système DARTS. Pour cela, la séquence IRM a été modifiée pour envoyer les trajectoires de remplissage de l'espace k à chaque TR via Ethernet. La communication entre le contrôleur de la séquence et DARTS s'effectue via des paquets TCP/IP. DARTS utilise des threads distincts pour l'acquisition et la mémorisation des données dans des queues en mémoire. Seules les données associées à une trajectoire sont utilisées pour reconstruire l'image. La librairie Fastest Fourier Transform in the West (FFTW) 3 est utilisée pour la transformation de Fourier, et Qt4 pour l'affichage. Le nombre de vues par transfert contrôle la fréquence de rafraîchissement de l'affichage. Le système DARTS est donc conçu pour traiter efficacement les données brutes en temps réel, générant des images et des visualisations rapides et dynamiques. Cette approche en temps réel est essentielle pour l'adaptation du modèle cardiaque au patient.
3. Reconstruction des données RTPC et détermination de la durée de la systole
Cette section décrit la reconstruction des données issues de la séquence RTPC (Real Time Phase Contrast). Une transformée de Fourier 1D est appliquée pour obtenir une image 2D dans l'espace «1D + temps». Pour réduire le temps de traitement et le bruit, seuls les pixels centraux du champ de vue sont conservés (50%, soit 128 pixels). Seuls les canaux 1 et 2 de l'antenne sont utilisés pour éviter le bruit des canaux moins sensibles. La vélocité est calculée en soustrayant deux échos consécutifs, obtenant une résolution temporelle de 1 TR grâce à l'encodage de vélocité partagée. Les cartes de vitesse finales sont obtenues par une somme pondérée en magnitude des cartes de vélocité de chaque canal. La durée de la systole est déterminée à partir du délai entre le déclenchement ECG (onde R) et la fin de la vélocité systolique positive. Pour minimiser la variabilité de la détection de l'onde R, une forme d'onde QRS moyenne est calculée et utilisée pour repositionner les détections. Les cycles cardiaques avec une durée de systole non physiologique (moins de 100 ms ou plus de 500 ms) sont éliminés de l'analyse. Cette étape de calcul de la durée de la systole est essentielle pour la création du modèle cardiaque personnalisé, qui sera ensuite utilisé pour les reconstructions Cine IRM. La précision de cette mesure est critique pour la qualité du modèle.
IV.Validation du modèle cardiaque et mesure de l Indice de Performance Myocardique MPI par IRM
La validation du modèle cardiaque personnalisé est effectuée en comparant les reconstructions IRM Cine obtenues avec le nouveau modèle à celles réalisées avec des modèles existants. L'étude explore également la possibilité de mesurer l'Indice de Performance Myocardique (MPI) ou indice de Tei directement par IRM, en utilisant la séquence RTPC. Les résultats ont été présentés au congrès international SCMR 2014 et sont publiés.
1. Validation du modèle cardiaque personnalisé par comparaison avec des modèles existants
Cette section se concentre sur la validation du modèle cardiaque personnalisé développé pour améliorer les reconstructions Cine IRM. La validation se fait par comparaison avec des modèles existants, notamment un modèle linéaire et le modèle de Weissler, soulignant les limites des approches traditionnelles. Le modèle de Weissler, basé sur des données de plus de 45 ans, ne tient pas compte des variations inter et intra-individuelles du rythme cardiaque. Il prédit la durée de la systole et de la diastole pour une population générale, sans considérer les variations liées aux maladies, aux rythmes circadiens ou aux traitements médicamenteux. La comparaison vise à démontrer la supériorité du modèle personnalisé en termes de précision et d’adaptation aux variations physiologiques individuelles. L'étude souligne les différences entre hommes et femmes, et les variations de la durée d'éjection du ventricule gauche en fonction de l'âge et du rythme cardiaque, que les modèles standard ne considèrent pas. Le modèle personnalisé, issu d'une acquisition IRM à haute résolution temporelle et en temps réel, est calibré pour chaque sujet individuellement. L'analyse des résultats met en évidence l'amélioration des reconstructions Cine IRM grâce à l'utilisation du modèle cardiaque personnalisé, notamment la visibilité de la phase rapide de contraction isovolumique, difficilement observable avec les modèles standards.
2. Vers une mesure de l Indice de Performance Myocardique MPI par IRM
Cette section explore la possibilité de mesurer l'Indice de Performance Myocardique (MPI), aussi appelé indice de Tei, à l'aide de l'IRM. L'MPI est un indice clinique courant, mesuré par échographie cardiaque pour évaluer rapidement l'état du cœur. L'étude utilise la séquence RTPC (Real Time Phase Contrast) développée précédemment pour acquérir des tracés de vélocité du tissu cardiaque en temps réel, de manière similaire à l'échocardiographie Doppler. L'avantage de la mesure en temps réel réside dans la possibilité d'obtenir des mesures rapides et non moyennées sur plusieurs battements cardiaques. Ceci permet une évaluation plus précise de la fonction cardiaque, sans les artefacts liés au moyennage. L'acquisition en temps réel rend possible des mesures non moyennées sur plusieurs cycles cardiaques, conduisant à des mesures plus précises. Cette approche est présentée comme une alternative à l'échographie, permettant de s'affranchir de ses limitations. La section évoque également les cas d'échec et les difficultés liées à la présence de vaisseaux dans le plan de coupe, la possibilité d'une segmentation automatique défaillante, et le bruit dans les signaux. La robustesse de l’algorithme de segmentation et de nouveaux algorithmes sont à étudier. Malgré les limitations, cette méthode, basée sur l'acquisition en temps réel, représente une avancée significative pour la mesure de l'MPI par IRM, permettant une évaluation rapide et précise de la fonction cardiaque.
V.Séquence cardiaque à large bande passante et auto naviguée
Ce chapitre détaille le développement d'une séquence IRM cardiaque à large bande passante pour l'imagerie à haut champ, visant à réduire les artefacts liés aux inhomogénéités du champ magnétique. La séquence utilise une approche alternant TR longs et courts. L'intégration d'un navigateur IRM intrinsèque pour la compensation du mouvement respiratoire et cardiaque est étudiée. Les tests sont menés sur une IRM 3T (Signa HDx, General Electric) avec antenne corps et antenne cardiaque à 8 éléments. Des travaux ont été réalisés au General Electric Global Research Center à Munich.
1. Développement d une séquence cardiaque à large bande passante
Cette section détaille la création d'une séquence d'IRM cardiaque à large bande passante pour l'imagerie à haut champ (3T). La séquence vise à réduire la sensibilité aux inhomogénéités locales du champ magnétique, un problème courant avec les séquences Balanced SSFP utilisées en clinique. L'approche choisie est une séquence Wideband SSFP, utilisant une alternance de TR longs et courts. Le TR court, initialement sans acquisition de données pour minimiser sa durée, est exploré pour acquérir des informations, servant potentiellement de navigateur IRM. Le texte mentionne une modification du code source pour que les valeurs des caractéristiques des gradients soient lues à partir de la configuration du système plutôt que d'être fixées. Ceci permet une optimisation et une réduction de la durée minimale des TR. La séquence a été testée sur une IRM 3T (Signa HDx, General Electric) avec une antenne corps et une antenne cardiaque à 8 éléments, ainsi qu’un fantôme uniforme sphérique. Les tests ont mis en évidence la réduction des artefacts de bande et l'amélioration de la bande passante. Le temps limité et des problèmes techniques n'ont pas permis une étude plus approfondie de la réduction des artefacts. L'optimisation des gradients et l'amélioration de la bande passante sont les objectifs principaux de ce développement. Le travail a été effectué en partie au General Electric Global Research Center à Munich.
2. Intégration d un navigateur IRM intrinsèque et gestion des artefacts
Cette partie discute de l'intégration d'un navigateur IRM intrinsèque à la séquence à large bande passante. L'objectif est d'extraire des signaux physiologiques, respiratoire et cardiaque, pour améliorer la compensation du mouvement pendant l'acquisition. Le principe d'une séquence cardiaque auto-naviguée avec navigateur respiratoire est décrit, basé sur la répétition de l'acquisition de la ligne centrale et le calcul de corrélation croisée. Une résolution temporelle de 25 ms a été atteinte, mais seul un navigateur respiratoire a été extrait. L'extraction des signaux cardiaque et respiratoire permettrait de contourner les difficultés de détection du complexe QRS sur l'ECG à haut champ. Une bonne résolution temporelle est importante pour le signal cardiaque en raison de la variabilité du rythme cardiaque. Le texte mentionne plusieurs points importants : la gestion des courants de Foucault, la réduction de l’artéfact de ligne centrale par la modification du gradient de rephasage de la sélection de coupe. Mais la réduction de la surface de rephasage entraine une diminution de la bande passante. La séquence est basée sur la séquence basic.e du cours EPIC (General Electric) et les modifications apportées ne sont pas clairement tracées dans le gestionnaire de versions ClearCase.
VI.Gain de SNR par compensation de mouvement sur petit animal
L'étude porte sur l'amélioration du rapport signal sur bruit (SNR) en IRM Cine chez le petit animal en utilisant Cine-GRICS. L'écho navigateur Bruker IntraGate sert de signal physiologique pour la correction du mouvement cardio-respiratoire. Les données proviennent de la plateforme PICTUR de Rouen (INSERM U1096). L'amélioration du SNR et la précision des mesures sont évaluées. Les résultats ont été présentés au congrès international ESMRMB 2013.
1. Amélioration du SNR en IRM Cine chez le petit animal problématique et approche proposée
Cette section introduit la problématique de l'acquisition IRM Cine chez le petit animal, où le faible rapport signal sur bruit (SNR) est un défi majeur en raison de la petite taille de l'animal. L'acquisition est souvent longue et réalisée en respiration libre, conduisant à des artefacts de mouvement qui dégradent la qualité des images. La technique de gating, qui ne conserve que les données acquises pendant les phases respiratoires stables, réduit encore davantage le SNR. Pour améliorer le SNR, l'étude propose d'utiliser Cine-GRICS, une méthode de reconstruction itérative capable de corriger les mouvements cardio-respiratoires. Cine-GRICS est adapté pour utiliser l'écho navigateur Bruker IntraGate comme signal physiologique de contrainte. L'approche est de corriger à la fois le mouvement respiratoire et le mouvement cardiaque à l'intérieur de chaque phase cardiaque. Ceci permet d'utiliser toutes les données acquises, améliorant ainsi le SNR. La plateforme PICTUR de Rouen (INSERM U1096) a fourni les données expérimentales, issues d'acquisition chez le rat. Deux stratégies principales de compensation du mouvement sont comparées : l’imagerie temps réel avec recalage non-rigide, et GRICS. La première est difficilement applicable chez le petit animal, la seconde, théoriquement applicable, n’avait pas encore été testée avant cette étude.
2. Adaptation de Cine GRICS et résultats
Cette partie détaille l'adaptation de Cine-GRICS au format de données de l'écho navigateur Bruker IntraGate. L'adaptation permet la correction simultanée des mouvements respiratoire et cardiaque. L'utilisation de Cine-GRICS permet d'augmenter la largeur des fenêtres temporelles cardiaques, ce qui améliore le SNR car un plus grand nombre de données sont utilisées pour chaque image. Les résultats montrent un gain significatif de SNR grâce à la compensation du mouvement cardio-respiratoire. Le gain en SNR est quantifié et illustré graphiquement. L'étude précise que des fenêtres cardiaques de moins de 20 ms ne sont pas rapportées en raison d’artéfacts importants ou d’échecs de reconstruction, tandis que des fenêtres de plus de 80 ms sont considérées comme trop lissées temporellement. L'utilisation de Cine-GRICS dans le cadre de cette étude permet d'obtenir une meilleure définition des contours cardiaques grâce à la compensation des mouvements. L'étude conclut que la technique de correction de mouvement par Cine-GRICS est efficace pour augmenter le SNR dans la reconstruction des images Cine cardiaque chez le petit animal, en traitant efficacement le mouvement cardiaque et respiratoire. Les résultats ont été présentés à un congrès international (ESMRMB 2013) et soumis à un journal (MRM 2014). Les données utilisées provenaient de la plateforme PICTUR de Rouen (INSERM U1096) et concernaient 10 rats (n=110 coupes).
