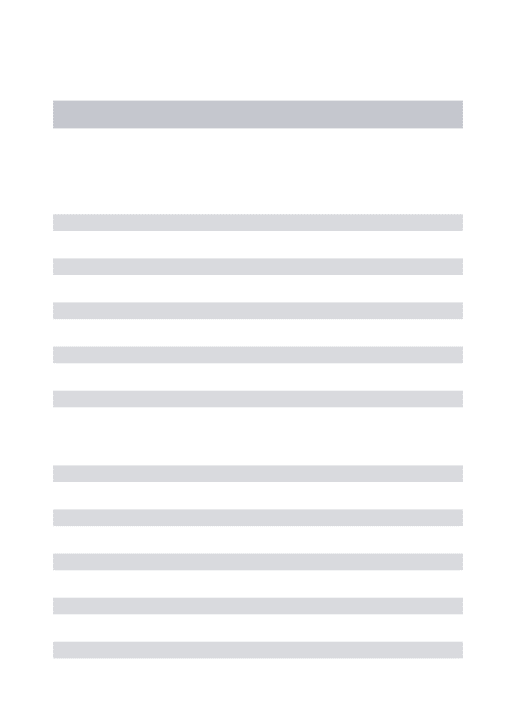
Étude de l'Oxydation et de la Pyrolyse du Dibenzofurane pour la Réduction des Émissions de Dioxines
Informations sur le document
| Auteur | Audrey Tritz |
| École | Université de Lorraine, ENSIC-Nancy |
| Spécialité | Génie des Procédés et des Produits |
| Lieu | Nancy |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 7.91 MB |
- Oxydation
- Pyrolyse
- Dioxines
Résumé
I.Sources et Impact des Dioxines PCDD F
Les dioxines (PCDD/F : polychlorodibenzodioxines/furanes), des polluants organiques persistants (POPs), sont émises dans l'environnement par divers procédés industriels, notamment l'incinération des déchets (UIOM). L'accident de Seveso en 1976 (Italie), ayant libéré environ 2 kg de TCDD (2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine), et l'intoxication de Viktor Iouchtchenko en 2004 illustrent la toxicité de ces composés et leur impact sur la santé humaine. La contamination se retrouve dans le sol, l'eau et la chaîne alimentaire. Des réglementations européennes (directive 2000/76/CE) fixent des valeurs limites pour les émissions de dioxines dans les fumées des incinérateurs.
1. Définition et Présence des Dioxines
Le document introduit les dioxines (PCDD/F) comme des polluants organiques persistants (POPs) émis en faibles quantités dans l'environnement. Elles sont omniprésentes, se retrouvant dans l'air, le sol, l'eau et les sédiments. Leur origine principale est industrielle, résultant de procédés de combustion. Dans les usines d'incinération d'ordures ménagères (UIOM), les dioxines sont capturées sur des adsorbants en sortie d'incinérateur, respectant ainsi les limites réglementaires. Cependant, cette méthode ne détruit pas les polluants mais les transfère vers un adsorbant stocké en décharge. La réduction des émissions à la source est présentée comme une approche plus durable et souhaitable pour minimiser l'impact environnemental des dioxines. Le document souligne que la gestion des déchets est un problème majeur de notre société de consommation, l'enfouissement étant la moins bonne solution en raison de son coût, des risques de contamination et de la non-exploitation du potentiel énergétique des déchets. L'incinération avec récupération d'énergie, bien que réduisant le volume des déchets et produisant de l'énergie, pose toujours des problèmes environnementaux dus aux résidus ultimes et à l'émission de polluants gazeux.
2. Impacts Sanitaires et Environnementaux Majeurs
L'étude cite des exemples concrets des conséquences néfastes des dioxines. L'accident industriel de Seveso (Italie) en 1976 a libéré environ 2 kg de TCDD (2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine), contaminant une zone de 15 kilomètres carrés et affectant 37 000 habitants. Les effets à long terme sur la santé de cette population sont toujours étudiés. Un autre exemple marquant est l'intoxication du président ukrainien Viktor Iouchtchenko en 2004, ayant causé une chloracné sévère. La même année, aux Pays-Bas, une contamination du lait par les dioxines, liée à une argile puis à de la graisse contaminée utilisées dans l'alimentation animale, est relevée, démontrant ainsi la présence des dioxines dans la chaîne alimentaire. La toxicité des dioxines est expliquée par leur structure coplanaire (atomes de chlore en position 2,3,7,8) leur conférant une affinité pour certains récepteurs biologiques. Leur stabilité chimique (durée de demi-vie de l'ordre de 10 ans), leur faible solubilité dans l'eau (hydrophobie) et leur caractère lipophile provoquent leur concentration dans les chaînes alimentaires, avec l'Homme au sommet. Le document met en évidence la persistance de ces polluants et leur bioaccumulation dans les organismes vivants, ainsi que leur présence dans divers milieux, les concentrations les plus importantes étant détectées dans le sol et certains aliments comme les produits laitiers, la viande, les crustacés et les poissons.
3. Sources d Émissions de Dioxines et Réglementation
Les dioxines proviennent principalement des processus industriels, mais peuvent aussi être générées par des phénomènes naturels comme les éruptions volcaniques et les incendies de forêts. Les incinérateurs de déchets ménagers, l'industrie métallurgique et sidérurgique et l'écobuage sont les sources principales, représentant plus de 50% des émissions. D'autres sources sont mentionnées, telles que le blanchiment au chlore des pâtes à papier et la production de pesticides. La présence des dioxines est globale. En 2011, les émissions de PCDD/Fs en France métropolitaine étaient estimées à 92 g TEQ. La directive 2000/76/CE du Parlement Européen fixe des valeurs limites pour les émissions de dioxines dans les fumées des installations d'incinération, variant selon le type de déchets incinérés: 0.1 ng TEQ/m³ pour plus de trois tonnes de déchets municipaux solides par heure, 0.5 ng TEQ/m³ pour plus d'une tonne de déchets médicaux par heure et 0.2 ng TEQ/m³ pour plus d'une tonne de déchets dangereux par heure. Ces réglementations européennes témoignent de la préoccupation concernant les émissions de ces polluants persistants et toxiques. Le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etude de la Pollution Atmosphérique) est cité comme source d'informations sur les émissions de POPs d'origine humaine en France en 2007.
II.Formation des Dioxines Mécanismes et Synthèse de Novo
La formation de dioxines résulte de combustions incomplètes. Des études ont exploré les voies de formation, notamment via l'oxydation et la pyrolyse de précurseurs comme les chlorophénols. La synthèse de Novo décrit la formation de PCDD/F à partir de carbone inorganique, de chlore et d'oxygène, souvent dans les cendres volantes des incinérateurs. Des métaux de transition, comme le cuivre (CuCl₂), agissent comme catalyseurs. Des travaux de recherche (Cypres & Bettens 1974, Briois 2002, Weber & Hagenmaier 1997, etc.) ont apporté des éclaircissements sur ces mécanismes complexes.
1. Mécanismes de Formation des Dioxines Etudes Précédentes
La formation des dioxines (PCDD/F) est un processus complexe lié aux combustions incomplètes. Le document cite plusieurs études antérieures qui ont contribué à la compréhension de ces mécanismes. Cypres et Bettens (1974) ont étudié la formation de dibenzofurane par craquage thermique du phénol et de crésols, identifiant l'élimination de monoxyde de carbone comme étape clé. Briois (2002) a analysé l'oxydation thermique du 2-chlorophénol, quantifiant les espèces moléculaires formées (chlorobenzène, phénol, hydroquinone, dibenzofurane, benzofurane, dibenzodioxine) en fonction de la température et du temps de séjour. Ces travaux ont démontré que la décomposition thermique du 2-chlorophénol était totale à des températures supérieures à 815°C. D'autres recherches de Weber & Hagenmaier (1997) sur l'oxydation des chlorophénols ont montré que la formation de PCDDs et PCDF dépendait de la température (au-delà de 350°C pour les PCDF) et du degré de chloration du phénol. L’influence de la taille des particules et de la nature de la surface catalytique a également été étudiée par Fangmark et al. (1995), mettant en avant le rôle des cendres volantes et des suies dans les incinérateurs. Visez (2005) a étudié l'impact de différents oxydes (Al₂O₃, MgO, SiO₂) sur la formation de dioxines en présence de CuClx, observant une inhibition variable selon l'oxyde utilisé. Ces études antérieures fournissent des bases importantes pour la compréhension des mécanismes de formation des dioxines, ouvrant la voie à une meilleure maîtrise de leur production.
2. La Synthèse de Novo Formation à partir de Carbone Inorganique
La synthèse de Novo, décrite par Vogg & Stieglitz (1986), est un mécanisme de formation de PCDD/F à partir d'une source de carbone inorganique, de chlore et d'oxygène. Ce processus implique des échanges de surface solide-solide et solide-gaz, utilisant des précurseurs carbonés non extractibles par les méthodes classiques, présents dans les cendres volantes. La formation des dioxines se produit majoritairement lors du refroidissement des fumées dans les zones de postcombustion, comme indiqué par Shaub & Tsang (1983). De nombreuses études, dont celles d'Addink & Olie (1995) et Ryan & Altwicker (2000), ont montré que le charbon actif est un bon précurseur carboné pour la synthèse des dibenzodioxines et dibenzofuranes chlorés. La nature du carbone influence cependant le rendement. La présence de catalyseurs, souvent des composés de métaux de transition ou alcalins/alcalino-terreux (CuCl₂, cuivre, fer, étain, manganèse…), est cruciale pour la synthèse de Novo. Des études de Jay & Stieglitz (1991), Schwarz & Stieglitz (1992) et Dickson et al. (1992) ont démontré l'importance de ces catalyseurs, notamment le cuivre(II) et le fer(III), dans la formation simultanée de PCDD/F à partir de précurseurs organiques et de carbone. L’étude de Visez (2005) a confirmé la nécessité du CuCl₂ dans la synthèse de Novo, aucune trace de PCDD/F n'étant détectée en son absence. La surface catalytique, à base d'alumine, de silice ou d'aluminosilicates, joue aussi un rôle important, en présence de carbone et de sels métalliques comme KCl ou CuCl₂ (Schoonenboom et al. 1992).
3. Oxydation de la Dibenzodioxine et Minimisation des Emissions
Des travaux plus récents de Summoogum et al. (2012) sur l'oxydation de la dibenzodioxine (DBD) ont identifié les premières étapes de la réaction, impliquant la formation d'oxygène singulet, la production de radicaux OH et l'addition d'oxygène sur le site radicalaire. Deux voies réactionnelles principales conduisant à la formation de 2-méthylbenzofurane et de 3-hydro-2-méthylènebenzofurane ont été mises en évidence. Pour minimiser les émissions de dioxines, la réduction de leur production à la source est essentielle. Dans les UIOM, une homogénéisation des déchets et une température d'au moins 850°C maintenue pendant au moins 2 secondes sont nécessaires. Un refroidissement rapide des fumées devrait limiter la synthèse de Novo. L'étude précise qu'une meilleure compréhension du mécanisme réactionnel est nécessaire, surtout aux très faibles concentrations de dioxines rencontrées dans les UIOM (de l'ordre de 1 ppm). Les travaux d'Altarawneh et al. (2006) et Wörner (1997) sur l'oxydation du radical dibenzofuranyl sont comparés, soulignant des divergences dans l'interprétation des résultats. L'étude de Altarawneh et al. suggère un réarrangement comme voie de décomposition la plus probable du radical dibenzofuranyl peroxy, contrairement aux conclusions de Wörner. Le travail de Benson (1996) sur la cinétique de l'oxydation des hydrocarbures insaturés est cité comme référence. Des travaux de Da Costa et al. (2003) et Bounaceur et al. (2005) sur l’oxydation du benzène et du toluène sont mentionnés comme exemples de modélisation de l'oxydation de composés aromatiques.
III.Etude de l Oxydation et de la Pyrolyse du Dibenzofurane DBF
Cette thèse étudie l'oxydation et la pyrolyse du dibenzofurane (DBF), molécule modèle des PCDF, à très faibles concentrations (~2 ppm) dans un réacteur parfaitement agité entre 500°C et 950°C avec un temps de passage de 3 à 5 secondes. L'analyse par GC/MS et TD/GC/FID a permis d'identifier et de quantifier les produits intermédiaires, notamment des dérivés du benzofurane et des hydrocarbures polyaromatiques. L'objectif est de mieux comprendre les mécanismes de dégradation des dioxines afin de contribuer à la réduction des émissions à la source.
1. Protocole Expérimental Oxydation et Pyrolyse du DBF
L'étude porte sur l'oxydation et la pyrolyse du dibenzofurane (DBF), molécule modèle représentant les polychlorodibenzofuranes (PCDF), composant des dioxines. Le choix du DBF permet une approche simplifiée pour comprendre les mécanismes de dégradation de ces polluants organiques persistants. L'expérience est réalisée à très faible concentration de DBF (~2 ppm), simulant les conditions des incinérateurs d'ordures ménagères (UIOM) où les teneurs en dioxines sont très faibles. Un réacteur parfaitement agité (RPA) est utilisé pour assurer une homogénéité du mélange réactionnel et un contrôle précis des paramètres opératoires. La température est variable entre 500°C et 950°C, et le temps de passage est de l'ordre de 3 à 5 secondes. Un dynacalibrator, système fonctionnant à température constante, permet de générer un débit gazeux stable et précis de DBF à partir de sa forme solide initiale. L'octane a d'abord été utilisé pour optimiser le protocole avant de l'appliquer au DBF afin d’éviter des problèmes de condensation dans les lignes de transfert chauffées. Le mélange gazeux (DBF, hélium, oxygène) pénètre dans le réacteur, et les produits de réaction sont collectés sur des cartouches d'adsorbant. L'analyse des produits est réalisée par chromatographie en phase gazeuse (CPG) couplée à un spectromètre de masse (GC/MS), après thermodésorption pour les composés accumulés sur les cartouches. Des régulateurs de débit massique contrôlent précisément les flux de gaz. Le choix du réacteur parfaitement agité est justifié par sa capacité à atteindre facilement un mélange idéal et un contrôle de température efficace pour les réactions relativement rapides.
2. Analyse des Produits de Réaction et Méthodes Analytiques
L'analyse des produits de réaction, issus de l'oxydation et de la pyrolyse du DBF, présente des défis analytiques. La complexité du mélange réactionnel nécessite des méthodes analytiques sophistiquées, capables de séparer et de quantifier les différentes espèces, malgré des concentrations très faibles. Les produits sont analysés par chromatographie en phase gazeuse (CPG), souvent couplée à un spectromètre de masse (GC/MS) et à un détecteur à ionisation de flamme (FID). Deux types de produits sont distingués: les produits 'lourds' (principalement des dérivés de benzofurane et des hydrocarbures polyaromatiques) et les produits 'légers' (moins de C7), dont l'analyse n'est pas complètement résolue dans cette étude, limitant l'établissement d'un bilan matière complet. L'accumulation des produits de réaction sur des cartouches d'adsorbant facilite leur analyse. L'utilisation d'une colonne capillaire HP-5 (Agilent) pour la GC-MS est spécifiée. Pour l'analyse des produits condensables, un piège refroidi à l'azote liquide est employé, suivi d'une dissolution dans l'acétone avant l'analyse GC/MS avec une colonne DB5-MS (Agilent). La sensibilité de l'analyse est un facteur limitant, la sélectivité étant parfois inférieure à un pour cent, ce qui est courant lors de l'analyse de traces de composés organiques. Les difficultés expérimentales sont liées à la faible concentration du réactif (2 ppm), un domaine de travail qualifié de 'non conventionnel' dans le document.
3. Résultats Expérimentaux et Interprétation
Les résultats expérimentaux montrent que la conversion du DBF varie en fonction de la température et de la présence ou non d'oxygène (oxydation vs pyrolyse). Une forte conversion (proche de 100%) est observée aux alentours de 750°C pour l'oxydation et 950°C pour la pyrolyse. A basses températures (500-650°C), la conversion est faible, mais la présence de nombreux produits intermédiaires en faibles quantités indique que l'oxydation est amorcée dès ces températures, en accord avec l'étude de Summoogum (2012). La pyrolyse requiert des températures plus élevées que l'oxydation pour atteindre des conversions similaires. Les quantités des différents composés suivent une évolution en forme de gaussienne, croissant, atteignant un maximum puis diminuant avec l'augmentation de la température. Cet aspect en 'cloche' indique que ces composés sont des intermédiaires de réaction, avec une compétition entre leur formation et leur décomposition. La pyrolyse favorise la formation d'hydrocarbures (poly)aromatiques, tandis que l'oxydation favorise la formation de composés oxygénés. Les fractions molaires des produits lourds dosés vont de 10⁻¹⁰ à 10⁻⁸ pour les hydrocarbures (poly)aromatiques et les composés oxygénés. L'augmentation de la fraction molaire d'oxygène n'influence pas significativement la conversion du DBF, mais favorise la décomposition des produits intermédiaires. L'analyse des produits 'légers' reste à faire et nécessitera l’adaptation du protocole analytique (utilisant par exemple du Tenax TA/Carbograph 1TD/Carboxen 1003 et une colonne capillaire de type PLOT).
IV.Modélisation Cinétique de la Dégradation du DBF
Un modèle cinétique détaillé de l'oxydation et de la pyrolyse du DBF a été développé pour simuler les quantités de produits formés. La comparaison des résultats expérimentaux et des simulations permet de valider le mécanisme réactionnel et d'identifier les voies de formation des produits intermédiaires. L’utilisation de logiciels comme Thergas (Muller et al. 1995) pour déterminer les propriétés thermodynamiques des espèces est mentionnée. Des travaux futurs pourraient améliorer le modèle en incluant les produits légers et en étendant l'étude à la dibenzodioxine.
1. Développement d un Modèle Cinétique Détaillé
Cette section détaille le développement d'un modèle cinétique pour simuler les réactions d'oxydation et de pyrolyse du dibenzofurane (DBF). L'objectif est de créer un modèle capable de reproduire les quantités de produits formés dans les mêmes conditions expérimentales. La validation du modèle repose sur la comparaison entre les résultats expérimentaux et les simulations. Une bonne adéquation entre les deux permettra de valider le mécanisme réactionnel proposé et d'identifier les chemins réactionnels menant aux produits observés expérimentalement. Le modèle permettra également de simuler la conversion du DBF dans des conditions opératoires différentes de celles utilisées dans l'étude. Les propriétés thermodynamiques des espèces moléculaires et radicalaires sont obtenues à partir de tables (JANAF Thermodynamical Tables 1971) ou estimées grâce au logiciel Thergas (Muller et al. 1995), basé sur les méthodes de contribution de groupe et la mécanique statistique (Benson 1976, Yoneda 1979). En absence de données thermodynamiques, les réactions sont considérées comme irréversibles. Le modèle cinétique vise à fournir une description précise des processus chimiques impliqués dans la dégradation du DBF, une étape cruciale pour la compréhension et la prédiction du comportement du DBF en conditions réelles.
2. Analyse des Résultats de la Modélisation et Limites du Modèle
Le modèle cinétique développé rend compte de manière qualitative des résultats expérimentaux, aussi bien pour la pyrolyse que pour l'oxydation. Les profils en « cloche » observés expérimentalement, caractéristiques d'une compétition formation-décomposition, sont retrouvés dans la simulation. Quantitativement, un bon accord est obtenu pour les conversions et l'ordre de grandeur de certaines espèces, tandis que d'autres sont sur- ou sous-estimées, ou décalées en température. Les écarts entre expérience et simulation peuvent être attribués à l'absence de certaines réactions dans le mécanisme réactionnel ou à des estimations incorrectes de certaines constantes cinétiques. Le mécanisme proposé décrit qualitativement la formation des produits intermédiaires aromatiques (dérivés du dibenzofurane et du benzofurane, hydrocarbures aromatiques substitués et polyaromatiques, aromatiques oxygénés). Cependant, le modèle n'est validé que sur les produits intermédiaires aromatiques, les produits légers n'étant pas encore quantifiés. La présence de quinone, suspectée initialement, n'a pu être confirmée par GC/MS, la molécule n’étant pas référencée dans la bibliothèque de spectres NIST. Le modèle est basé sur un modèle initial de Wörner (1997) adapté aux conditions expérimentales de cette thèse (concentration en DBF de l'ordre de 2 ppm contre 1000 ppm dans l'étude de Wörner), incluant de nouveaux amorçages pour la pyrolyse et des réactions d'ipso-additions.
3. Conclusions et Perspectives
L'étude de la modélisation cinétique de la pyrolyse et de l'oxydation du dibenzofurane conduit à plusieurs conclusions. Le mécanisme proposé rend bien compte des résultats expérimentaux d'un point de vue qualitatif, mais des différences quantitatives subsistent pour certaines espèces. Le modèle n'est validé que pour les produits intermédiaires aromatiques. L'amélioration du modèle nécessite la quantification des produits légers et un ajustement des paramètres cinétiques. Ce mécanisme est une base pour de futures études sur la dibenzodioxine, dont le mécanisme de décomposition thermique devrait être similaire. Les perspectives incluent l'étude expérimentale des produits légers et l'extension de l'étude à la dibenzodioxine, nécessitant l'ajout de nouvelles réactions (amorçages, ipso-additions, métathèses) au mécanisme réactionnel. L'influence des paramètres opératoires de la zone de postcombustion (température, temps de passage, teneur en oxygène, teneur en COV, ajout d'hydrocarbures) devra aussi être approfondie. Ce travail contribue à une meilleure compréhension des mécanismes de dégradation du DBF, un modèle important pour la réduction des émissions de dioxines dans les UIOM.
