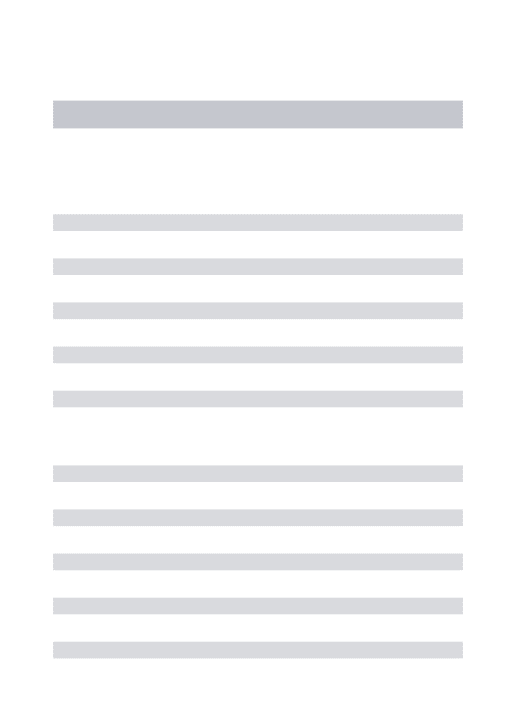
Défenses antitoxiques Gammarus roeseli
Informations sur le document
| Auteur | Éric Gismondi |
| school/university | Université de Lorraine |
| subject/major | Ecotoxicologie et Biodiversité |
| Type de document | Thèse |
| city_where_the_document_was_published | Metz |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 5.96 MB |
Résumé
I.Impact des parasites sur les biomarqueurs de Gammarus roeseli
Cette thèse étudie l'influence du parasite Polymorphus minutus sur les biomarqueurs de défense antitoxiques et les réserves énergétiques de l'amphipode d'eau douce Gammarus roeseli. L'étude porte sur des paramètres comme le glutathion réduit, l'activité de la γ-glutamylcystéine ligase, les métallothionéines, les caroténoïdes, les niveaux de lipides, de glycogène et de malondialdéhyde (MDA). L'objectif est de comprendre comment l'infection parasitaire affecte la capacité de G. roeseli à faire face au stress environnemental, notamment la pollution au cadmium.
1. Biomarqueurs de défense antitoxiques et énergétiques
L'étude se concentre sur l'impact du parasite Polymorphus minutus sur les capacités de défense antitoxiques et les réserves énergétiques de Gammarus roeseli. Plusieurs biomarqueurs sont analysés pour évaluer ces aspects. Concernant les défenses antitoxiques, l'étude mesure la concentration de glutathion réduit (GSH), un tripeptide jouant un rôle central dans le système antioxydant en piégeant les radicaux libres et servant de substrat à des enzymes antioxydantes. L'activité de la γ-glutamylcystéine ligase (GCL), enzyme limitant la synthèse du GSH, est également évaluée. De plus, les concentrations de métallothionéines et de caroténoïdes, impliqués dans la détoxication, sont mesurées. Pour les réserves énergétiques, les teneurs en protéines, lipides totaux et glycogène sont déterminées. Enfin, le malondialdéhyde (MDA), produit de dégradation des lipides membranaires, sert de biomarqueur des effets toxiques. Cette approche multi-biomarqueurs permet une évaluation globale des effets du parasitisme sur la physiologie du Gammarus roeseli.
2. Définition et intérêt des biomarqueurs
Avant d'aborder les résultats, le document définit clairement le concept de biomarqueur. Il cite la définition initiale du National Research Council (NRC) de 1987, axée sur la santé humaine, puis l'adaptation d'Adams (1990) au domaine environnemental. La définition adoptée pour cette thèse est celle de Lagadic et al. (1997), qui définit un biomarqueur comme un changement observable et/ou mesurable au niveau moléculaire, physiologique ou comportemental révélant une exposition passée ou présente à une substance chimique polluante. L'importance du facteur temps dans l'interprétation des réponses d'un biomarqueur est soulignée. L'intérêt d'un biomarqueur réside dans sa capacité à être précoce et prédictif de changements à l'échelle de la population (Vasseur et Cossu-Leguille, 2003). Van der Oost et al. (2003) mettent en évidence la difficulté de choisir des biomarqueurs pertinents, notamment la distinction entre les réponses précoces à l'échelle individuelle et leur pertinence écologique à l'échelle de la population. Des paramètres biochimiques liés à la reproduction, tels que les hormones et les composants énergétiques, sont considérés comme des indicateurs d'impact au niveau populationnel (Lagadic, 2002).
3. Le parasitisme comme facteur confondant
Le document souligne l'importance croissante du parasitisme comme facteur confondant dans l'interprétation des réponses des biomarqueurs. De nombreuses études ont démontré l'influence des parasites sur le comportement et la fitness de leur hôte, souvent des sous-produits de l'infection avec une dimension adaptative pour le parasite. Des exemples sont donnés, tels que Diplostomum spathaceum affectant la vision de la truite arc-en-ciel ou Polymorphus minutus modifiant le géotactisme de Gammarus roeseli. La présence de parasites influence donc les réponses des biomarqueurs chez les organismes sentinelles utilisés pour l'évaluation de la qualité des milieux. Le document souligne que si la maîtrise de facteurs abiotiques comme la température ou le pH est relativement aisée en laboratoire, la présence de parasites, surtout ceux invisibles à l’œil nu, est plus difficile à contrôler, nécessitant des outils biomoléculaires ou histologiques. L'étude de l'influence des parasites sur les biomarqueurs est donc une nouvelle difficulté dans l'utilisation des biomarqueurs comme outils de diagnostic des perturbations anthropiques.
II.Influence du sexe et de la saison sur le Gammarus roeseli
Une première partie de la recherche examine l'impact du sexe et de la saison sur la concentration en glutathion réduit et l'activité de la γ-glutamylcystéine ligase chez Gammarus roeseli. L'étude, réalisée sur la rivière Nied (Laquenexy, France, 49°05’ N et 6°16’ E) entre octobre 2008 et septembre 2009, montre une corrélation inverse entre la concentration en glutathion et la température de l'eau. Les femelles présentent des concentrations plus élevées de glutathion et des réserves énergétiques (lipides, glycogène) supérieures aux mâles, probablement liées à leur reproduction.
1. Échantillonnage et maintien de Gammarus roeseli
Des spécimens mâles et femelles de Gammarus roeseli ont été prélevés mensuellement de octobre 2008 à septembre 2009 dans la rivière Nied (Laquenexy, Nord-Est de la France, 49°05’ N et 6°16’ E). Des paramètres de l'eau (température, pH, conductivité, oxygène dissous et saturation en oxygène) ont été mesurés sur le terrain à chaque prélèvement. Le sexage des gammares a été effectué sur place en fonction de la taille des gnathopodes, un caractère dimorphique sexuel. Les gammares ont ensuite été transportés au laboratoire dans de l'eau de rivière, où des groupes de sept mâles et de dix femelles ont été constitués pour les mesures des biomarqueurs et des réserves énergétiques. Avant l'analyse, le sexe des G. roeseli a été vérifié en observant les papilles génitales, présentes uniquement chez les mâles, sur le 7ème segment ventral. Cette méthodologie rigoureuse d'échantillonnage et de maintien des organismes vise à minimiser les variations environnementales et assurer la fiabilité des résultats.
2. Glutathion réduit GCL et réserves énergétiques
L'étude s'est concentrée sur l'influence du sexe et de la saison sur la concentration en glutathion réduit (GSH) et l'activité de la γ-glutamylcystéine ligase (GCL), enzyme limitant la synthèse du GSH, chez Gammarus roeseli. Le GSH, un élément central du système de détoxication, neutralise directement les xénobiotiques grâce à sa fonction thiol et sert de substrat à des enzymes antioxydantes comme les glutathion peroxydases et les glutathion-S-transférases. Les réserves énergétiques (lipides totaux et glycogène) ont également été étudiées, étant donné le coût énergétique des systèmes de défense. Le malondialdéhyde (MDA), produit de dégradation des lipides membranaires, a été mesuré comme biomarqueur d'effets toxiques. Les résultats montrent une corrélation inverse entre les concentrations de GSH et la température de l'eau, les femelles ayant des concentrations plus élevées que les mâles en toute saison. Les teneurs en lipides et en glycogène sont également plus élevées chez les femelles, ce qui leur permet de couvrir les besoins énergétiques de la reproduction et de maintenir des concentrations élevées de GSH pour les processus de détoxication.
3. Interprétation des résultats et facteurs confondants
La diminution des concentrations de GSH observée en été est attribuée à l'augmentation de la température, entraînant une consommation d'oxygène accrue et la formation d'espèces réactives de l'oxygène (ROS) (Krog, 1954; Issartel et al., 2005; Verlecar et al., 2007). Le GSH serait alors utilisé pour la détoxication, ce qui explique sa diminution. L'activité de la GCL est plus élevée en été, reflétant une production accrue de GSH. Chez les femelles, les teneurs en lipides et en glycogène sont les plus élevées de mars à mai, période de maturation liée à l'oogénèse. Ces réserves énergétiques sont nécessaires à la production de vitellus (Rosa et Nunes, 2002; Oliveira et al., 2007) et aux battements des pléopodes (Dick et al., 1998; Sparkes et al., 1996). Les femelles possédant une activité plus élevée des enzymes antitoxiques dépendantes du GSH (Sroda et Cossu-Leguille, 2011a), leurs besoins en GSH sont plus importants. La synthèse du GSH, étant un processus ATP-dépendant, consomme de l'énergie provenant de la dégradation des lipides et du glycogène. En conclusion, les femelles ont des teneurs en lipides plus élevées pour soutenir la reproduction et maintenir des concentrations élevées de GSH pour les processus de détoxication.
III.Effets combinés de Polymorphus minutus et du cadmium sur Gammarus roeseli
Une autre partie de l'étude explore les conséquences de l'infection par P. minutus sur la résistance au cadmium chez G. roeseli. Des tests de CL50 (concentration létale 50) à 96h révèlent une résistance accrue au cadmium chez les mâles infectés, tandis que les femelles infectées sont plus sensibles. La bioaccumulation du cadmium est également étudiée, montrant une absorption du métal par le parasite lui-même. La présence de microsporidies chez les femelles est un facteur aggravant.
1. Impact de l infection par Polymorphus minutus sur les réserves énergétiques de Gammarus roeseli
Cette partie de l'étude examine l'influence du parasite Polymorphus minutus sur les réserves énergétiques de son hôte intermédiaire, Gammarus roeseli, en l'absence de stress chimique. Des individus mâles et femelles, parasités ou non, ont été échantillonnés en mai, juin et août 2009, période de forte prévalence du parasite. Les réserves énergétiques ont été évaluées en mesurant les concentrations de protéines, de lipides totaux et de glycogène. Les résultats montrent que chez les G. roeseli infectés, indépendamment du sexe et du mois d'échantillonnage, les teneurs en protéines et en lipides sont plus faibles, tandis que la teneur en glycogène est plus élevée. Cette observation suggère que le parasite détourne une partie de l'énergie de l'hôte pour son propre développement. De plus, les concentrations de glutathion réduit et l'activité de la γ-glutamylcystéine ligase sont plus faibles chez les individus infectés, ce qui pourrait indiquer une diminution des défenses antitoxiques. En l'absence de stress chimique, la faible concentration de malondialdéhyde (MDA), biomarqueur d'effets toxiques, chez les gammares infectés pourrait suggérer un effet protecteur potentiel du parasite. Cependant, cette observation appelle à une analyse plus approfondie compte tenu des implications pour la survie de l'hôte face à des stress additionnels.
2. Résistance au cadmium chez Gammarus roeseli infecté par Polymorphus minutus
L'étude a ensuite évalué l'influence de P. minutus sur la capacité de G. roeseli à résister à une exposition au cadmium. La concentration létale 50 (CL50) à 96 heures a été déterminée pour les gammares parasités et non parasités, ainsi que la bioaccumulation du cadmium chez l'hôte et le parasite. Les résultats montrent que les mâles infectés présentent une résistance accrue au cadmium par rapport aux mâles non infectés, tandis que les femelles infectées sont plus sensibles. Cette différence de résistance pourrait être expliquée par un facteur de bioconcentration (BCF) plus faible chez les mâles infectés, lié à l'absorption du cadmium par le parasite. Chez les femelles, malgré un BCF plus faible et une concentration de cadmium plus basse dans le corps, la présence de P. minutus n'a pas induit une mortalité inférieure à celle des femelles non infectées. Au contraire, leur sensibilité au cadmium est augmentée. Ces résultats suggèrent que l'influence du parasite sur la résistance au cadmium est sexuellement dimorphique, et que d'autres facteurs, comme la présence d'autres parasites, pourraient être impliqués dans la réponse des femelles au stress combiné du parasitisme et de l'exposition au cadmium.
3. Bioaccumulation du cadmium chez l hôte et le parasite
L'étude détaille la bioaccumulation du cadmium chez Gammarus roeseli et Polymorphus minutus après une exposition de 96 heures. Les gammares infectés accumulent moins de cadmium dans leur corps que les individus non infectés, conduisant à un BCF plus faible chez les gammares parasités. Ceci est en accord avec des études antérieures montrant une bioaccumulation plus faible chez des individus infectés par d’autres parasites. Cependant, P. minutus accumule lui-même du cadmium, résultat corroboré par des études précédentes sur d'autres acanthocéphales. La présence du cystacanthe de P. minutus dans l'hémolymphe de G. roeseli, milieu contenant des métaux toxiques lors d'une exposition à des polluants, explique en partie cette absorption du cadmium par le parasite. L'impact différentiel observé entre les mâles et les femelles suggère une interaction complexe entre le parasitisme, la bioaccumulation du cadmium, et la réponse physiologique de l'hôte. L'hypothèse de la présence de microsporidies chez les femelles, accentuant le stress oxydatif et augmentant les dommages cellulaires (Gismondi et al., 2012), est avancée pour expliquer la plus grande sensibilité des femelles infectées au cadmium.
IV. Gammarus roeseli comme modèle en écotoxicologie
L'amphipode Gammarus roeseli, originaire des Balkans mais naturalisé en Europe de l'Ouest, est utilisé comme organisme sentinelle en écotoxicologie. Son utilisation comme modèle biologique permet d'étudier les effets de divers facteurs abiotiques (température, oxygénation) et biotiques (parasitisme) sur ses mécanismes de défense et sa survie. Les travaux citent de nombreuses études utilisant G. roeseli pour des recherches en écotoxicologie.
1. Origine et statut de Gammarus roeseli
Gammarus roeseli, originaire des Balkans (Karaman et Pinkster, 1977), a été considéré longtemps comme une espèce exotique invasive en Europe de l'Ouest. Jażdżewski et Roux (1988) ont suggéré que sa colonisation des eaux françaises provient du système danubien, favorisée par des interventions humaines telles que le transport de végétation aquatique ou la construction d'un canal reliant le Danube et le Rhin en 1845. Cependant, la première observation de G. roeseli en France remonte à 1835 près de Paris (Jażdżewski, 1980), ce qui conduit à le qualifier aujourd'hui d'espèce naturalisée. Cette information contextuelle est importante pour comprendre l'utilisation de G. roeseli comme modèle dans des études écotoxicologiques, car son histoire d'invasion a pu influencer ses traits d'histoire de vie et ses mécanismes de réponse au stress environnemental. L'étude de G. roeseli, au-delà de son intérêt intrinsèque, permet donc de comparer les réponses d'une espèce naturalisée par rapport à des espèces invasives dans des contextes de contamination.
2. Gammarus roeseli un modèle d étude en écotoxicologie
L'amphipode Gammarus roeseli a été utilisé comme modèle biologique dans plusieurs études. Des recherches ont porté sur ses traits d'histoire de vie (croissance, alimentation, mue) en comparaison avec G. fossarum (Pöckl, 1995; Pöckl et al., 2003). Son ancien statut invasif a motivé des études sur son comportement anti-prédateur, influencé par la présence de prédateurs ou de signaux chimiques (Starry et al., 1998; Baumgärtner et al., 2003). La morphologie de G. roeseli, notamment ses spicules dorsaux, a été étudiée pour son rôle dans la protection contre la prédation (Bollache et al., 2006). De plus, G. roeseli a servi à étudier l'influence de facteurs abiotiques sur l'activité d'enzymes antioxydantes (Sroda et Cossu-Leguille, 2011b), l'impact d'une contamination au cuivre (en comparaison avec une espèce invasive, Dikérogammarus villosus) (Sroda et Cossu-Leguille, 2011a), et l'effet de la salinité sur l'activité ventilatoire et la locomotion (Sornom et al., 2010). Cette utilisation diversifiée de G. roeseli témoigne de sa pertinence comme modèle pour étudier les réponses des organismes aux contraintes environnementales.
