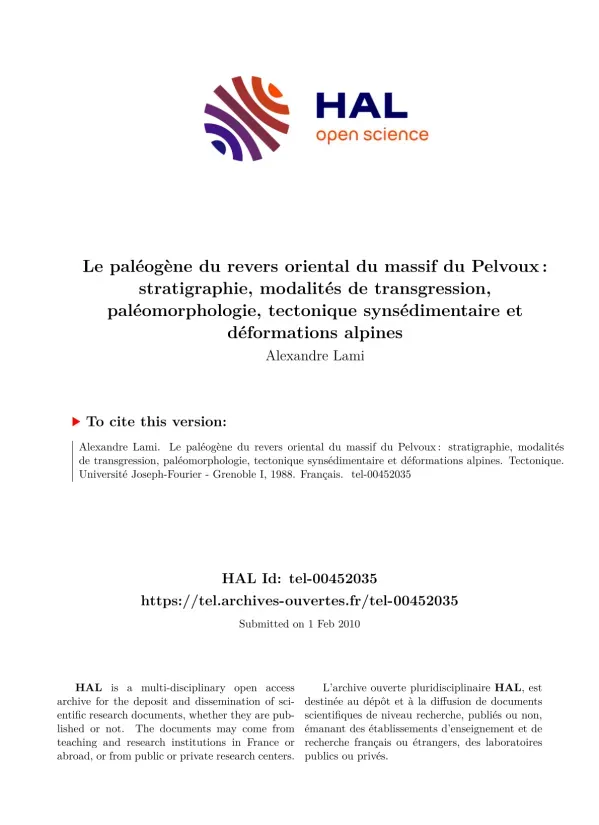
Étude du Paléogène et de la Tectonique du Massif du Pelvoux
Informations sur le document
| Auteur | Alexandre Lami |
| instructor/editor | Maurice Gidon |
| École | Université Joseph Fourier |
| subject/major | Géologie Appliquée |
| Type de document | Thèse |
| Lieu | Grenoble |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 72.92 MB |
- Géologie
- Paléogène
- Tectonique
Résumé
I.Étude Stratigraphique et Tectonique du Nummulitique du Massif du Pelvoux
Cette étude se concentre sur la stratigraphie et la tectonique du Nummulitique dans le Massif du Pelvoux, sud-est de la France. L'analyse des formations nummulitiques (calcaires nummulitiques, marnes nummulitiques, Flysch) révèle une transgression diachronique, progressant du sud au nord et de l'est à l'ouest. Des failles synsédimentaires, notamment l'accident d'Ailefroide, ont joué un rôle majeur dans la paléogéographie du bassin cénozoïque. La présence omniprésente de détritus témoigne de l'existence d'un Pelvoux embryonnaire anténummulitique et de la proximité des nappes internes. Des olistolites sont associés à des failles N170. Une microfaune bartonienne a été découverte dans la partie sud-est. Des figures clés incluent Maurice Gidon et Jean-Louis Pairis de l'Institut Dolomieu à Grenoble, ainsi que Michel Bonhomme (radiochronologie).
1. Introduction et Méthodologie
L'étude stratigraphique et tectonique du Nummulitique du Massif du Pelvoux, menée dans le sud-est de la France, est présentée. Elle s'appuie sur une collaboration avec l'équipe de l'Institut Dolomieu à Grenoble, notamment avec Maurice Gidon qui a initialement confié le sujet, et Jean-Louis Pairis qui a pris en charge la direction du travail. L'étude a bénéficié de plusieurs excursions et discussions avec des experts, comme Raymond Combemorel (géochimie des argiles et datations K/Ar) et Michel Bonhomme (Laboratoire de radiochronologie de l'Institut Dolomieu). La contribution de Pierre Fabre et Claude Kerckhove (reconnaissances aériennes) pour la compréhension du contexte géologique est également soulignée. Enfin, Thierry Grand a réalisé l'étude microstructurale et le traitement des données. L'étude s'appuie sur des travaux antérieurs, notamment ceux de J. Vernet, qui a proposé des schémas de comportement ductile des roches et attribué de nombreuses structures à des phases tectoniques anténummulitiques.
2. Transgression Nummulitique et Paléogéographie
L'étude détaille l'envahissement progressif du Massif du Pelvoux par la transgression marine, impactant l'apparition des différentes formations. La disposition des couches infranummulitiques en petites flaques indique un Pelvoux émergé. L'Assise détritique, polluant les sédiments sur une longue période, signale les secteurs en relief, les derniers envahis par la sédimentation carbonatée. La transgression est particulièrement nette pour les formations calcaires. Les Marnes nummulitiques marquent la submersion des secteurs méridionaux, et le Flysch transgresse complètement le Pelvoux. Un niveau de brèches (membre 2b) est un excellent marqueur lithostratigraphique autour du Pelvoux, utile pour le repérage de la polarité stratigraphique et les corrélations lithostratigraphiques, permettant de cerner la paléogéographie. Localement, ce membre est attribué au Bartonien, bien qu'aucun indice ne permette de déterminer un âge précis.
3. Analyse des Formations Nummulitiques
L'étude porte sur l'extension et les lithofaciès des calcaires à nummulites, présents dans les secteurs à pentes faibles permettant des dépôts mécaniquement stables (environ 10° d'inclinaison maximum). C'est le faciès le plus représenté. L'épaisseur est variable. Le lithofaciès montre des calcaires peu argileux avec des nummulites, parfois altérées par dissolution ou usure. Les déformations post-nummulitiques ont modifié l'épaisseur de la série. L'analyse des Marnes nummulitiques indique une dissolution des carbonates, expliquant la faible quantité de microfaune. L'absence ou la rareté de marqueurs paléobiologiques est aussi attribuée au métamorphisme (limite anchizone-épizone). La présence d'olistolites et la forme des corps sédimentaires, notamment du Flysch, suggèrent un paléorelief complexe, le Rocher de Guerre étant un point haut relatif. L'identification d'olistolites dans le Nummulitique pose la question d'un chevauchement anté ou post-nummulitique, point essentiel de l'étude.
II.Les Calcaires Nummulitiques Extension et Lithofaciès
Les calcaires nummulitiques, faciès dominant, se sont déposés sur des pentes inférieures à 10°. Leur extension est variable, et l'épaisseur de la formation est très irrégulière. Les lithofaciès montrent des nummulites parfois altérées par des dissolutions ou l'usure due au transport. Des déformations post-nummulitiques ont affecté l'épaisseur de la série. La présence de niveaux de brèches (membre 2b) constitue un bon marqueur lithostratigraphique.
1. Extension des Calcaires Nummulitiques
L'étude géographique des calcaires nummulitiques montre une présence significative dans les secteurs où la pente au moment de la sédimentation était suffisamment faible pour permettre la formation de dépôts mécaniquement stables. Des observations de paléostructures ont permis d'estimer une inclinaison maximale d'environ une dizaine de degrés pour l'installation de ces calcaires. Ils constituent le faciès le plus répandu dans la région étudiée. Cependant, leur épaisseur est variable et leur extension géographique irrégulière, se présentant souvent sous forme de petites flaques isolées entre le Col des Bouchiers et La Blanche. Cette répartition sporadique rend difficile la détermination précise de leur extension réelle. De plus, on observe que ces faciès ne gagnent pas les secteurs septentrionaux, et leur présence n'est pas systématique même en direction du sud.
2. Lithofaciès des Calcaires Nummulitiques
Les calcaires nummulitiques se caractérisent par un faible taux d'argile. On y trouve des nummulites, soit regroupées en niveaux bien définis, soit réparties de façon aléatoire dans la masse calcaire. Les tests des nummulites sont généralement bien conservés, mais parfois abîmés par des dissolutions ou une usure liée au transport avant le dépôt. L'analyse de dissolutions le long de joints stylolithiques obliques à des coupes longitudinales de nummulites révèle une diminution d'épaisseur locale pouvant atteindre 33%, observée sur une lame mince. Bien que non représentative de l'ensemble de la barre calcaire, cette observation souligne l'impact non négligeable des déformations post-nummulitiques sur la modification de l'épaisseur de la série. La présence d'un niveau de brèches (membre 2b) est quasi omniprésente et constitue un bon marqueur lithostratigraphique dans le pourtour du Pelvoux, utile pour les corrélations et la reconstitution paléogéographique.
III.Les Marnes Nummulitiques et le Flysch Relations Stratigraphiques et Tectoniques
Les marnes nummulitiques, souvent pauvres en microfaune à cause de la dissolution des carbonates, surmontent les calcaires nummulitiques. Le Flysch est transgressive sur l'ensemble du massif. L'étude analyse les relations entre les formations et les structures tectoniques, notamment le chevauchement pennique. L'absence ou la rareté de marqueurs paléobiologiques est liée au métamorphisme (limite anchizone-épizone). La présence d'importants olistolites dans le Flysch et des lames cristallines plurihectométriques (Rocher de l'Yret) témoignent d'une tectonique active.
1. Les Marnes Nummulitiques Caractéristiques et Microfaune
Les marnes nummulitiques constituent une formation sus-jacente aux calcaires nummulitiques. La profondeur atteinte par ces marnes sous le chevauchement pennique a induit une dissolution des carbonates dans toute la série tertiaire, expliquant la faible quantité de microfaune observée. L'absence ou la rareté de microflore peut être due à son absence initiale (hypothèse improbable), à une dilution excessive dans les apports sédimentaires, ou à une destruction complète lors des déformations. L'absence de marqueurs paléobiologiques est en grande partie liée au degré de métamorphisme (limite anchizone-épizone) qui affecte la région. Certaines marnes grises semblent modifiées par la tectonisation, induite par le glissement de bancs compétents, comme observé au Fournel, où le Flysch a subi un transport important vers le sud-ouest, et où la semelle du chevauchement se situe dans les marnes nummulitiques elles-mêmes.
2. Le Flysch Géométrie et Relations Tectoniques
La forme des corps sédimentaires, en particulier celle du Flysch, indique que le Rocher de Guerre était un point haut relatif. L’observation de biseaux stratigraphiques appuyés sur des pentes nord-est, sud, et nord-ouest près du sommet suggère une topographie complexe. L'étude de ces biseaux est essentielle pour déterminer si le chevauchement est anté ou post-nummulitique. Si post-nummulitique, certains blocs de cristallin et de Trias sous les dépôts tertiaires pourraient être des olistolites inclus dans des sédiments nummulitiques, mais leur datation précise reste impossible faute d'éléments dans les marnes autres que les derniers évènements métamorphiques. Des lames cristallines plurihectométriques, comme celles de l’Yret, sont interprétées comme des lambeaux de socle inclus tectoniquement dans la série tertiaire, autour desquels les calcaires nummulitiques sont enroulés, formant des têtes anticlinales extrêmement étirées. Cette hypothèse est renforcée par la position du Rocher de l'Yret au-dessus d'une flexure du socle, agissant comme un môle résistant.
3. Interprétation Tectonique et Synthèse
La pile sédimentaire contient des olistolites de taille modeste. L'absence de détritus grossiers jusqu'au pied du paléorelief de l'Yret, et l'amincissement du Flysch de part et d'autre de ce rocher, sont des éléments importants de l'analyse. Les marnes nummulitiques ennoyent finalement le relief préexistant jusqu'au début du dépôt du Flysch. La présence d'olistolites dans le Flysch, notamment dans les secteurs où le Cristallin chevauchant s'amincit (front du chevauchement apparent), est cohérente. Les lambeaux de socle seraient plus fragiles là où leur épaisseur est faible. Certains blocs près du Col de l'Yret et dans la falaise occidentale du Rocher de l'Yret pourraient avoir été arrachés au front du chevauchement pendant le Nummulitique et repris tectoniquement après le Paléogène lors de l'avancée des nappes penniques. La base de la coupe de Chambran, finement gréseuse, présente une faible épaisseur de brèches, indiquant une distance suffisante d'un relief et des pentes avoisinantes.
IV.Paléotopographie et Sédimentation Influence du Massif Cristallin
La paléotopographie a influencé la sédimentation. Le Massif du Pelvoux a joué un rôle important en contrôlant la distribution des faciès. Des variations dans la richesse en faune benthique reflètent la proximité de la plate-forme. L'Assise détritique basale, souvent bréchique, contient des éléments arrachés au socle. L'épaississement de cette assise et la présence d'olistolites marquent une position plus distale par rapport au Pelvoux. Les coupes de Cibouit, de l'Yret, et des Bouchiers illustrent la complexité de la sédimentation et de la tectonique.
1. Paléotopographie et Influence du Massif Cristallin
La paléotopographie, difficile à reconstituer précisément en raison de l'érosion, a fortement influencé la sédimentation. L'étude souligne la régularité et l'homogénéité des sédiments à un même niveau, notamment à La Blanche. L'abondance de petits foraminifères benthiques (Miliolidae) suggère un environnement de sédimentation plus interne, plus côtier que dans les secteurs précédemment étudiés. Cependant, la détermination précise des pentes paléotopographiques reste incertaine, les faciès à algues pouvant se développer aussi bien sur des côtes abruptes que sur des zones subhorizontales. L'absence de détritus abondant et varié à La Blanche, contrairement aux secteurs voisins où la paléotopographie était plus accidentée, suggère plutôt l'existence d'un platier. Le Tertiaire est limité par une érosion importante, décapant la série jusqu'aux calcaires à discocyclines.
2. Sédimentation et Détritus Exemples de Coupes
La coupe caractéristique (fig. 31), présentant la plus grande épaisseur de calcaires (80 m), est constituée essentiellement de calcaires algaires non remaniés, à l'exception de deux petits bancs. Vers le sommet apparaissent des calcaires à nummulites puis des lumachelles à discocyclines (environ 4 m). Plusieurs fractures dans le cristallin périphérique ne peuvent être datées. Des fractures N165-175, injectées de matériel volcanique, pourraient être d'origine triasique (comme les filons spilitiques du Pelvoux) ou liées au volcanisme calco-alcalin tertiaire (Grès du Champsaur). À la Croix de Chastelet, une succession complète des formations est observée, tandis qu'aux Grésourières, l'Assise détritique basale s'épaissit, avec de nombreux olistolites de taille modeste et des biseaux stratigraphiques dans le Flysch, dont l'épaisseur diminue vers le nord-ouest. La coupe du Col des Bouchiers, reposant sur le Cristallin et le Mésozoïque, débute par un conglomérat grossier, suivi de calcaires nummulitiques peu épais et de marnes graveleuses, faciès rare dans la région.
3. L Assise Détritique Basale et la Plateforme Nummulitique
L’Assise détritique basale, à l’aspect de poudingue bréchique, indique une position distale par rapport au Pelvoux. Les coupes sont plus riches en benthos, traduisant l'influence d'une plate-forme proche, contrairement aux secteurs septentrionaux où la plate-forme nummulitique n'a vraisemblablement pas pu s'installer en raison de la rapidité de la transgression et de la paléogéographie accidentée. Une sédimentation « tranquille » est brutalement recouverte, avec une épaisseur de l’Assise détritique basale exceptionnelle et un détritus abondant. La sédimentation marneuse masque des niveaux olistolitiques. Au moins quatre niveaux olistolitiques sont relevés dans les marnes liasiques. La coupe la plus épaisse de l’ensemble anté-flysch est analysée. Le Cristallin apparait à la base, surmonté d'un calcaire algaire métrique, dépourvu de quartz, contrairement au reste de la série où un abondant détritisme masque les sédiments calcaires. Il est possible que ces dépôts soient du Crétacé, mais l'incertitude persiste du fait de l’altération des orbitolines.
V.Structuration Anté et Post Nummulitique Analyse des Failles et Déformations
L'étude met en évidence deux phases de déformation: une phase anté-nummulitique avec réactivation de fractures préexistantes (accident d'Ailefroide) et une phase post-nummulitique liée à l'avancée des nappes penniques. L'analyse microstructurale, en collaboration avec T. Grand, a permis d'individualiser deux étapes de déformation orientées SE-NW dans le Cristallin. Des directions de raccourcissement E-W, ont pu être déviées vers le N au contact de l'accident d'Ailefroide. Les travaux de Gamond (1980) et Tricart (1980) sont mentionnés et comparés.
1. Structuration Anté nummulitique L Accident d Ailefroide
L'analyse tectonique met en évidence une structuration antérieure au Nummulitique. L'accident d'Ailefroide, structure ancienne et pérenne au moins depuis le Lias, a déterminé une limite paléogéographique majeure durant le Tertiaire. Son activité a varié au cours des temps. Sa position oblique par rapport aux directions de raccourcissement post-jurassiques supposées (Gamond, 1980; Bartolini et al., 1974; Tricart et al., 1977; Pairis et al., 1986) lui a permis de rejouer lors de mouvements affectant le Massif du Pelvoux. Les étapes de déformation anté-nummulitiques ont réactivé des fractures dans le Pelvoux. L'accident d'Ailefroide, oblique durant le serrage néocrétacé subméridien, a pu agir comme rampe frontale, les fractures préexistantes du revers est du massif jouant en rampes latérales (accident de l'écaille de la Croix de Cibouit). Alternativement, les serrages paléocènes pourraient être responsables de la création ou de la réactivation d'accidents en failles couchées ou autres chevauchements. De grands accidents subméridiens, comme celui du Rocher de l'Yret, sont antérieurs au Nummulitique.
2. Structuration Post nummulitique et Déformations
La position du Rocher de l'Yret au front du Massif du Pelvoux a permis son écaillage après le dépôt des sédiments tertiaires. Au sud-est, on observe la reprise dextre de fractures N50-60, le faisceau des Grésourières s'engageant dans l'accident d'Ailefroide (N30-40). Le jeu décrochant permet le chevauchement du Sirac vers le WSW sur le synclinal de Morges. Ces déformations s'accompagnent de plis dans les Grès du Champsaur, d'une schistosité de flux, et d'un étirement des Marnes nummulitiques. Une étude microstructurale dans le secteur où interfèrent les directions N170 et N30 a été réalisée en collaboration avec T. Grand (Lami et al., 1986). L’analyse des plans de faille scellés par le Tertiaire et les stries associées, par la méthode des dièdres droits, a permis d’identifier deux étapes de déformation orientées SE-NW. Ces résultats, bien que locaux, établissent des relations entre l’histoire de la sédimentation et le socle, confirmant l’influence d’une structuration anté-nummulitique.
3. Comparaison avec d autres Études et Conclusion
Les résultats diffèrent légèrement de ceux de Gamond (1980) et Tricart (1980), qui proposent des directions de déplacement respectivement vers le sud-ouest et l'ouest-nord-ouest. Ces différences sont probablement dues à la proximité de l'accident d'Ailefroide, qui a pu dévier la direction de raccourcissement initialement E-W vers le nord, induisant une rotation horaire. Dans le secteur du Combeynot, une famille d'accidents N110, à jeu senestre, décale le Nummulitique, mais la direction des strates nummulitiques reste NNW-SSE. En conclusion, la structuration de la région est le résultat d'une histoire tectonique complexe impliquant des phases anté- et post-nummulitiques, avec une influence majeure de l'accident d'Ailefroide et la réactivation de fractures préexistantes. Les analyses confirment l'importance de considérer à la fois l'histoire sédimentaire et la tectonique du socle pour comprendre la géologie du Massif du Pelvoux.
