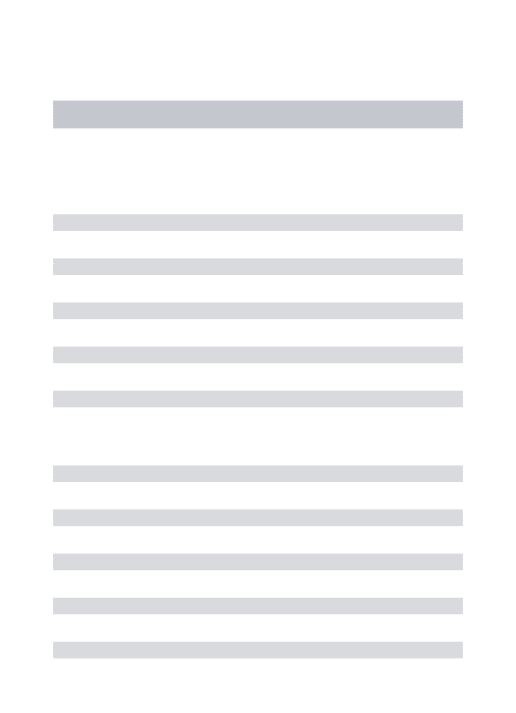
Couplage croissance bactérienne et polluant
Informations sur le document
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 3.05 MB |
Résumé
I.Problématique des biofilms et Biofouling
Cette étude se concentre sur la problématique des biofilms, notamment leur impact négatif sur les procédés industriels, causant du biofouling. Les biofilms, définis comme des communautés microbiennes sessiles enveloppées dans une matrice de substances polymériques extracellulaires (EPS), sont un réservoir important de bactéries pathogènes et destructrices, affectant les systèmes de filtration membranaire et d'autres dispositifs industriels. La recherche explore les mécanismes physico-chimiques et biologiques impliqués dans la formation et la maturation des biofilms.
1. Définition et importance des biofilms
Le texte introduit la notion de biofilm, un mode de vie pour de nombreux organismes unicellulaires (bactéries, algues, levures...). Harremoës (1977) est cité comme le premier à utiliser ce terme. La définition consensuelle décrit un biofilm comme une adhérence irréversible de micro-organismes à une surface ou interface (solide/liquide, liquide/gaz ou liquide/liquide), grâce à une matrice de substances polymériques extracellulaires (EPS), principalement composées de polysaccharides, conférant au biofilm une grande stabilité. L'étude des biofilms est devenue un domaine pluridisciplinaire majeur, avec des centres de recherche dédiés. L'importance des biofilms dépasse le cadre académique, car ils posent de sérieux problèmes dans de nombreux domaines.
2. Conséquences négatives des biofilms dans les procédés industriels le biofouling
Dans les procédés industriels, les biofilms constituent une source importante de contamination. Ils abritent de nombreuses bactéries pathogènes et destructrices, comme observé dans l'industrie laitière (Mittelman, 1998). Les conséquences ne se limitent pas à l'aspect infectieux potentiel, mais touchent aussi les performances des systèmes industriels. Par exemple, les biofilms réduisent l'efficacité des systèmes de filtration membranaire (Baker et Dudley, 1998; Flemming, 2002) par un phénomène appelé biofouling, une accumulation de dépôts biologiques indésirables sur une surface. Ce biofouling affecte divers dispositifs industriels, tels que les systèmes de refroidissement, les réservoirs de stockage et les systèmes de distribution d'eau potable.
3. Facteurs influençant le développement des biofilms
Le développement et le comportement des biofilms sont influencés par une multitude de facteurs. L'étude mentionne trois facteurs clés : (i) les propriétés chimiques des substances composant le biofilm (interactions avec la matrice solide, entre elles et avec les micro-organismes), (ii) les propriétés physico-chimiques et hydrodynamiques de la matrice solide (composition minéralogique, granulométrique, texture), et (iii) l'activité biologique du milieu. La composition granulométrique et la texture du sol déterminent les propriétés hydrodynamiques et hydrodispersives (porosité, perméabilité, dispersivité) de la matrice poreuse. La composition minéralogique (teneur en matière organique) conditionne la réactivité de la matrice avec les espèces chimiques présentes. L'activité microbienne, via les processus de biodégradation et de biotransformation, influence le transport et le devenir des substances chimiques en solution, contribuant à l'atténuation naturelle des polluants organiques du sol et à la formation du biofilm. Le mode de vie en biofilm est présenté comme une stratégie de survie préférentielle pour les micro-organismes dans l'environnement (Zobell, 1943), offrant une résistance aux stress environnementaux (manque de nutriments, agents antimicrobiens) et une protection contre la prédation. Des études de laboratoire sont menées pour comprendre ces mécanismes complexes.
II.Maturation du biofilm et Adhésion Microbienne
La maturation du biofilm, un processus complexe contrôlé par divers facteurs environnementaux (nutriments, pH, oxygène), implique l'adhésion irréversible des bactéries, leur division, et la production d'EPS. Deux théories, DLVO et l'approche thermodynamique, tentent d'expliquer l'adhésion microbienne, mais leurs limitations sont discutées. L'étude souligne l'importance des aspects génétiques et physiologiques dans le développement du biofilm, influençant la résistance aux agents antimicrobiens.
1. Processus de maturation du biofilm
La maturation du biofilm commence après l'adhésion irréversible des cellules bactériennes à une surface. Ce processus est régulé par plusieurs facteurs, notamment la disponibilité des nutriments, le pH interne, le transfert d'oxygène, la source de carbone et l'osmolarité (Dunne, 2002). Après l'adhésion initiale, le développement du biofilm implique la division cellulaire, la mobilité sur la surface et la co-adhésion (Hall-Stoodley et Stoodley, 2002). La croissance bactérienne est alimentée par les nutriments du film conditionnant et ceux du fluide environnant (Kumar et Anand, 1998). On observe une croissance horizontale puis transversale des micro-colonies qui s'élargissent et fusionnent pour former une couche cellulaire complète. La production d'exopolysaccharides (EPS) est essentielle pour l'ancrage des cellules et la stabilisation des colonies face aux fluctuations de l'environnement (Kumar et Anand, 1998; Watnick et Kolter, 2000). Des micro-organismes, initialement incapables d'adhérer, peuvent ensuite se fixer aux cellules pionnières par co-adhésion (Walker et Marsh, 2004), nécessitant parfois des structures spécialisées comme les flagelles, fimbriae de type I, curli, et la protéine Ag43 chez Escherichia coli K-12 (Reisner et al., 2009).
2. Théories physico chimiques de l adhésion microbienne
L'adhésion des micro-organismes aux surfaces est expliquée par deux théories physico-chimiques principales : la théorie DLVO (Derjaguin et Landau, 1941; Verwey et Overbeek, 1948) et l'approche thermodynamique (Van Oss et al., 1986; Bos et al., 1999; Hori et Matsumoto, 2010). La théorie DLVO, initialement développée pour les suspensions colloïdales, décrit l'équilibre entre les forces d'attraction de Lifshitz-van der Waals et les forces de répulsion électrostatiques. Cependant, cette théorie présente des limitations pour l'adhésion bactérienne car elle ne tient pas compte de la nature dynamique de la surface cellulaire et de structures comme les flagelles et les fimbriae, qui jouent un rôle significatif dans l'adhésion (Busscher et Van Der Mei, 1997; Boks et al., 2008). De plus, l'application de la théorie DLVO, conçue pour des particules rigides et imperméables, est remise en question pour les bactéries qui sont des particules « molles » et perméables (Duval et Ohshima, 2006). De nouveaux formalismes ont été développés pour prendre en compte ces aspects (Ohshima, 2008; Duval et al., 2011).
3. Aspects génétiques et physiologiques de la formation du biofilm
Le mode de vie en biofilm induit des changements morphologiques et physiologiques importants chez les bactéries par rapport à leurs homologues planctoniques. Ces changements résultent souvent de gradients de concentration de solutés réactifs dus à la limitation de la diffusion (Stewart, 2003). Des études ont montré une stratification de l'activité métabolique à l'intérieur des biofilms, notamment en fonction de la disponibilité en oxygène (Werner et al., 2004; Teal et al., 2006 pour P. aeruginosa et Shewanella oneidensis). La structure tridimensionnelle du biofilm est hétérogène, composée de micro-colonies de cellules bactériennes dans une matrice d'EPS, séparées par des canaux d'eau permettant la circulation de liquides et la diffusion de nutriments et d'agents antimicrobiens (Donlan, 2002). La définition de Donlan et Costerton (2002) englobe ces aspects observables et physiologiques, définissant le biofilm comme une communauté microbienne sessile irréversiblement attachée, enveloppée dans une matrice d'EPS produite par les cellules, avec une modification phénotypique liée au taux de croissance et à la transcription des gènes.
III.Transfert de gènes et Résistance aux Antimicrobiens
La communication intercellulaire, le quorum sensing, joue un rôle crucial dans la formation des biofilms. L'expression génique dépend du stade de croissance du biofilm, influençant ses propriétés, notamment sa résistance aux agents antimicrobiens. Cette résistance est due à plusieurs facteurs, comme la limitation de la diffusion par la matrice d'EPS, et les modifications physiologiques. Les biofilms constituent des vecteurs importants de maladies nosocomiales et sources de contamination industrielle.
1. Quorum Sensing et Expression Génétique
La formation des biofilms est fortement influencée par la communication intercellulaire, appelée quorum sensing. Ce processus permet aux bactéries de percevoir la densité de la population environnante grâce à des molécules de signal extracellulaires. Ces molécules influencent l'expression des gènes, la coopération et la compétition métabolique, le contact physique entre cellules, et la production d'exoproduits antimicrobiens (Davey and O’Toole, 2000). L'expression génétique dans un biofilm dépend de son stade de croissance, entraînant des phénotypes variés selon les étapes de développement (Sauer et al., 2002). La capacité à communiquer et à adapter l'expression de leurs gènes permet aux bactéries de coordonner leur activité et de répondre aux variations de leur environnement.
2. Mécanismes de résistance aux agents antimicrobiens
Les biofilms présentent une forte résistance aux agents antimicrobiens, ce qui en fait des réservoirs importants d'organismes pathogènes (Costerton et al., 1985; Anwar et al., 1990; Donlan et Costerton, 2002). Une étude comparative sur une souche mutante de Klebsiella pneumoniae a démontré une tolérance à l'ampicilline beaucoup plus élevée pour le biofilm que pour les cellules planctoniques (Anderl et al., 2000). Cette résistance est multifactorielle : la matrice d'EPS crée une barrière diffusionnelle, limitant la pénétration des molécules antimicrobiennes (Donlan et Costerton, 2002; Stewart, 2003). L'EPS peut également réagir avec les molécules antimicrobiennes ou influencer leur transport vers l'intérieur du biofilm. Des modifications physiologiques induites par le transfert de gènes lors de la formation du biofilm affectent aussi la susceptibilité aux agents antimicrobiens (Fux et al., 2005). Enfin, la faible croissance des micro-organismes sessiles comparativement aux cellules planctoniques contribue à la faible assimilation des agents antimicrobiens (Donlan et Costerton, 2002). Cette résistance accrue, notamment sur les implants médicaux, rend les biofilms responsables de maladies nosocomiales (Barbeau et al., 1998; Wisplinghoff et al., 2004; Cerca et al., 2005), et leur détachement est une source de contamination dans l'industrie (Stoodley et al., 2001).
IV.Méthodologie Expérimentale et Shewanella oneidensis MR 1
L'étude utilise une approche expérimentale pour analyser le couplage entre la croissance bactérienne et le transport de soluté en milieu poreux. La souche bactérienne Shewanella oneidensis MR-1, un bacille à Gram négatif aérobie et anaérobie facultatif, est utilisée. Des billes de verre puis du sable de quartz sont testés comme matrices solides, l'Erioglaucine et le Bleu Dextran comme traceurs. Un dispositif expérimental spécifique (cellule d'écoulement) permet le suivi in situ de la croissance du biofilm et du transport du traceur.
1. Choix de la souche bactérienne Shewanella oneidensis MR 1
L'étude utilise Shewanella oneidensis MR-1, une bactérie de la famille des Shewanellaceae, caractérisée comme aérobie et anaérobie facultative. Morphologiquement, c'est un bacille à Gram négatif mobile grâce à un flagelle polaire simple (Venkateswaran, 1999; Nealson et Scott, 2006). Physiologiquement, S. oneidensis MR-1 se développe optimalement entre 25 et 35°C (30°C dans l'étude) et à un pH de 7 à 8 (7,4 dans l'étude), avec une tolérance à des températures plus basses (4°C) ou plus élevées (40°C) (Venkateswaran, 1999). Elle utilise une variété de sources de carbone et d'énergie, incluant les acides organiques (acétate, lactate, pyruvate), les alcools (éthanol), et les acides aminés (sérine, cystéine), ainsi que des molécules plus complexes comme l'ADN extracellulaire (Nealson et Myers, 1990; Nealson et Scott, 2006; Pinchuk et al., 2008). Sa capacité à utiliser un large éventail d'accepteurs d'électrons (O2, NO3-, S2O32-, fer, manganèse, fumarate) est également notable (Nealson et Scott, 2006).
2. Sélection de la matrice solide et du traceur
Le choix de la matrice solide et du traceur est crucial pour l'expérimentation. Des tests préliminaires (détaillés dans la thèse d'Orgogozo, 2009) ont comparé deux colorants (Rhodamine 6B et Rose Bengale B) sur deux matrices : le Nafion® et des billes de verre Retsch®. Le Nafion® a montré une forte adsorption des deux colorants. Les billes de verre Retsch® présentaient une adsorption plus faible, notamment pour le Rose Bengale B, mais restaient appropriées pour l'adhésion de Shewanella oneidensis MR-1. Initialement, les billes de verre Retsch® ont été sélectionnées, mais des problèmes d'adhérence ont mené au choix final du sable de quartz. Concernant les traceurs, l'Erioglaucine (ou Brillant Blue), présentant une adsorption quasi nulle sur le verre, a été choisie pour sa faible interaction avec la matrice, contrairement à la Rhodamine 6B et au Rose Bengale B. L'Erioglaucine a donc servi comme traceur conservatif pour les expériences de transport.
3. Dispositif expérimental et protocole
Le dispositif expérimental se compose d'une cellule d'écoulement en acier inoxydable, avec deux réservoirs (amont et aval) et une zone de mesure (10x10x0.5 cm3) contenant le milieu poreux (initialement des billes de verre, puis du sable de quartz). La cellule permet la visualisation de la croissance du biofilm et du transport du traceur. Un microscope (F1.8 DG Macro Aspherical) et une caméra CCD haute définition sont utilisés pour l'acquisition d'images. Un système robotisé (Charly Robot Isel® Automation) permet d'automatiser les prises de vue. Le système d'écoulement utilise des tubes Cole-Palmer® à faible interaction avec l'Erioglaucine. Des vannes permettent de contrôler l'écoulement et l'injection du traceur. Pour les cultures bactériennes, un milieu de culture LML+F (Anceaux, 2008) ou un milieu LB-Miller dilué au 1/10 avec fumarate sont utilisés. Des ajustements au protocole initial (utilisation de deux pompes) ont été nécessaires pour optimiser la croissance du biofilm et éviter la bio-obstruction, en finissant par une seule pompe Ismatec® à vitesse contrôlée.
V.Résultats Expérimentaux et Perméabilité
Les expériences montrent une diminution significative de la perméabilité du milieu poreux due à la croissance du biofilm. L'analyse des images révèle une distribution spatiale hétérogène du biofilm, impactant le transport du soluté. L'utilisation du Bleu Dextran permet de caractériser la fraction volumique du biofilm. Les essais de traçage avec l'Erioglaucine montrent un passage d'un comportement de transport de type « double milieu » à un régime fickien selon le stade de développement du biofilm (17 vs 29 jours).
VI.Modélisation du Transport et Changement d échelle
La modélisation du transport de soluté en présence du biofilm utilise des modèles macroscopiques (LEA et TEM), obtenus par la méthode de changement d'échelle par prise de moyenne volumique. La comparaison entre les résultats expérimentaux et les simulations numériques permet de déterminer le régime de transport (fickien ou double milieu) le plus approprié selon le stade de développement du biofilm et la distribution spatiale de la biomasse.
1. Approches de modélisation du transport en milieu poreux biotique
La modélisation du transport de solutés en milieu poreux en présence de biofilm repose sur deux grandes approches (Weiss et Cozzarelli, 2008). La première, mécanistique, identifie les processus principaux de réaction et de transfert de masse (par exemple, la limitation du transfert de masse entre la phase aqueuse et le biofilm) puis formule un modèle mathématique à l'échelle de Darcy ou du volume élémentaire représentatif (VER). Cependant, cette approche manque de rigueur formelle pour le changement d'échelle, les paramètres macroscopiques étant supposés a priori et non liés à la structure microscopique du milieu. Une caractérisation fine de la dispersion est essentielle, comme souligné par de nombreuses études (Cirpka et al., 1999) pour éviter la surestimation de la biodégradation. La seconde approche utilise des méthodes de changement d'échelle, soit stochastiques (traitant les propriétés du milieu comme des variables aléatoires, Matheron et De Marsily, 1980; Dagan, 1984; Gelhar et al., 1992; Miller et al., 1998), soit déterministes (basées sur l'hypothèse de séparation des échelles et la périodicité du milieu dans une cellule unitaire représentative - VER, Cushman et al., 2002). L'étude privilégie une approche déterministe utilisant la méthode de prise de moyenne volumique (Anderson and Jackson, 1967; Marle, 1967; Slattery, 1967; Whitaker, 1967).
2. Modèles utilisés LEA et TEM
Pour simuler le transport de solutés, deux modèles sont utilisés : le modèle LEA (équilibre de masse locale, modèle fickien classique) et le modèle TEM (modèle à deux équations, ou modèle à double porosité). Le modèle LEA suppose un comportement fickien, tandis que le modèle TEM, basé sur une équation de conservation de masse par phase, considère un échange de masse entre une phase fluide (transport dispersif et convectif) et une phase biofilm (eau immobile, échanges par diffusion). Ce modèle à double porosité, similaire aux modèles « mobile-immobile », est rarement appliqué aux systèmes biologiques de manière rigoureuse (Baveye et Valocchi, 1989; Seifert et Engesgaard, 2007; Chatelier, 2010). Étant donné le caractère conservatif des traceurs utilisés (Erioglaucine non biodégradable par Shewanella oneidensis MR-1), seuls les modèles LEA et TEM sont considérés. Les simulations numériques sont réalisées à l’aide du logiciel COMSOL MULTIPHYSICS®.
3. Conditions aux limites et comparaison avec les résultats expérimentaux
Les simulations numériques utilisent une condition de Dirichlet non homogène en temps à l'entrée, reflétant le profil de concentration mesuré expérimentalement (effet de rampe). Pour s’affranchir des difficultés aux premiers centimètres de la zone d'étude, une pseudo-condition limite est imposée à 1,9.10⁻² m de l'entrée. Un flux dispersif nul est appliqué en sortie. La comparaison entre les résultats expérimentaux (courbes de percée) et les prédictions numériques des modèles LEA et TEM permet de déterminer le modèle le plus adéquat pour chaque stade de croissance du biofilm et chaque régime d’écoulement. L'accord entre les modèles et les données expérimentales permet de valider la méthode de mesure de la fraction volumique du biofilm (Bleu Dextran) et de mettre en évidence l'influence des hétérogénéités locales sur les propriétés de transport. Le passage d'un comportement de type « double milieu » à 17 jours à un régime fickien à 29 jours, observé expérimentalement, est analysé à travers la modélisation.
VII.Conclusion
L'étude a démontré l'impact significatif de la croissance du biofilm sur les propriétés hydrodynamiques (perméabilité, dispersion) d'un milieu poreux. L'approche expérimentale et numérique combinée permet une meilleure compréhension du couplage entre la croissance bactérienne et le transport de soluté. L'hétérogénéité spatiale du biofilm influence fortement le comportement du transport, nécessitant des modèles plus complexes que les modèles classiques de convection-dispersion dans certains cas.
1. Synthèse des résultats et validation des hypothèses
Cette étude visait à mieux comprendre la croissance des biofilms en milieu poreux, à caractériser le transport d'un soluté organique en présence de biofilm, et à explorer les interactions entre l'hydrodynamique du milieu et l'activité microbienne. L'utilisation d'un traceur conservatif (Erioglaucine) et d'une souche bactérienne spécifique (Shewanella oneidensis MR-1) a permis d'étudier ces couplages. Les résultats ont confirmé l'influence significative de la croissance du biofilm sur les propriétés hydrodynamiques du milieu poreux, notamment la perméabilité. La méthode de suivi in situ de la concentration a été validée, permettant de caractériser la fraction volumique du biofilm grâce au Bleu Dextran. Après 29 jours, un biofilm couvrant 50% du volume poral a été formé. L'analyse des résultats a montré que la croissance du biofilm n'est pas uniforme, ce qui impacte le transport de soluté. Les modèles numériques (LEA et TEM), basés sur la méthode de prise de moyenne volumique, ont permis de reproduire les observations expérimentales.
2. Impact de l hétérogénéité spatiale du biofilm sur le transport
Les essais de transport de l'Erioglaucine, réalisés à deux vitesses d'injection et à deux stades de croissance du biofilm (17 et 29 jours), ont révélé l'importance des hétérogénéités locales. A 17 jours, une colonisation partielle du milieu (moitié inférieure) a conduit à un comportement de transport de type « double milieu », nécessitant un modèle à deux équations (TEM). En revanche, à 29 jours, avec une colonisation complète du milieu, un comportement fickien classique a été observé, modélisable par le modèle LEA. Ces résultats soulignent que l'hypothèse d'un biofilm spatialement homogène est une simplification excessive, surtout aux premiers stades de croissance. La méthode de caractérisation in situ du biofilm au Bleu Dextran s'est avérée valide pour déterminer les fractions volumiques, essentielles pour la modélisation.
3. Perspectives et limitations de l étude
Malgré les résultats concluants, certaines limitations subsistent. La bioadhérence insuffisante des billes de verre initialement utilisées a nécessité un changement de substrat (sable de quartz). La croissance du biofilm, malgré les efforts de contrôle, n’était pas parfaitement uniforme, notamment dans la partie inférieure de la cellule. Une analyse pixel par pixel du biovolume aurait permis une meilleure précision, mais les incertitudes des mesures de densité optique étaient trop importantes. La proportion exacte de chaque composant du biofilm (cellules bactériennes et EPS) n'a pas pu être déterminée. Des recherches ultérieures pourraient approfondir ces points, notamment en améliorant le suivi de la distribution spatiale du biofilm et en caractérisant plus finement sa composition. Les résultats obtenus constituent malgré tout une avancée significative dans la compréhension des couplages complexes entre la croissance bactérienne et le transport en milieu poreux.
