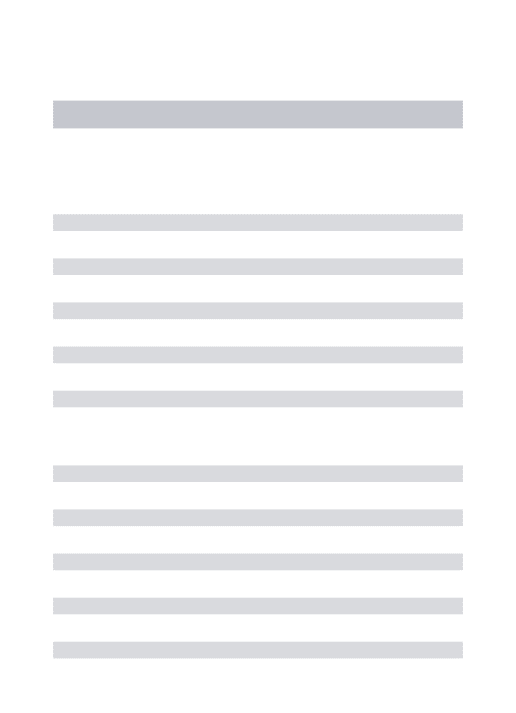
Identification des facteurs historiques de vulnérabilité dans la relation entre sylviculture et biodiversité
Informations sur le document
| Auteur | Jean-Luc Dupouey |
| École | INRA-Université de Lorraine |
| Spécialité | Ecologie et Ecophysiologie forestière |
| Type de document | Rapport de recherche |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 1.80 MB |
- sylviculture
- biodiversité
- histoire forestière
Résumé
I.Les Quarts en Réserve de Lorraine Impact Historique sur la Biodiversité Forestière
Cette étude examine l'impact à long terme des pratiques de sylviculture traditionnelles, notamment le système des « quarts en réserve », sur les forêts de Lorraine. Mis en place dès 1669, ce système consistait à maintenir un quart de la surface boisée en réserve pour assurer l'approvisionnement en bois de futaie. La comparaison entre ces forêts anciennes (anciens quarts en réserve) et les zones exploitées en coupes affouagères (forêts récentes) révèle de faibles mais significatives différences en termes de composition des peuplements, de richesse spécifique et de propriétés des sols forestiers. Les quarts en réserve présentent une plus grande proportion de gros bois, une flore légèrement moins riche et des sols plus riches en matière organique.
1. Historique et Mise en Place des Quarts en Réserve
L'ordonnance de 1669 a perpétué une mesure de gestion forestière qui, au XVIIIe siècle, a été adoptée par les Ducs de Lorraine pour les forêts du duché. Cette mesure consistait à maintenir des « quarts en réserve », soit un quart de la surface boisée, préservée de l'exploitation intensive. Le régime forestier de 1827 n'a pas modifié l'obligation du quart en réserve, mais on observe une augmentation notable des autorisations de coupes extraordinaires entre 1827 et 1900. À partir du milieu du XIXe siècle, une subdivision des quarts en réserve apparaît sur les plans d'archives, contrairement à la représentation en bloc des siècles précédents. Une numérotation spécifique (chiffres romains) a été attribuée à ces coupes, se distinguant de la numérotation des coupes affouagères (chiffres arabes). Au XXe siècle, l'exploitation des quarts en réserve est devenue plus libre une fois l'âge d'exploitation atteint, les coupes extraordinaires devenant ordinaires. Les quarts en réserve témoignent d'une période d'exploitation intensive du bois de feu, contrastant avec les pratiques sylvicoles plus fréquentes et moins protectrices des coupes affouagères (ou coupes ordinaires).
2. Objectifs et Principes du Quart en Réserve
La règle du « quart en réserve » imposait la mise en réserve d'un quart de la surface boisée des forêts communales et des établissements publics. Cette mesure de prévoyance visait à répondre aux besoins en bois de futaie pour la construction navale et l'architecture. Cette zone en réserve, parfois appelée « mise en futaie », était gérée en futaie régulière ou en mélange taillis-futaie riche en réserve, assurant ainsi une gestion durable des ressources forestières à long terme. L'objectif était double : garantir la pérennité des forêts et répondre aux besoins en bois de qualité pour des usages spécifiques. La mise en place de cette mesure témoigne d’une volonté de gestion forestière responsable, anticipant les risques liés à une exploitation non régulée. Les différents régimes sylvicoles mettent en lumière les évolutions des pratiques forestières au cours du temps, ainsi que leur impact potentiel sur l'environnement et la biodiversité.
3. Méthodes d Analyse et Résultats Préliminaires
L'étude a utilisé un modèle d'analyse de variance mixte pour tester l'impact de l'ancien usage (quart en réserve vs. série affouagère) sur des variables continues (dendrométriques, pédologiques, axes factoriels). L'analyse a considéré la zone géologique (calcaire, marne, acide) comme effet fixe, et le site comme effet aléatoire. Les pourcentages ont été transformés avant l'analyse. Le nombre de taxons relevés variait de 10 à 65 par relevé, avec une légère différence entre les anciens quarts en réserve (32 taxons en moyenne) et les anciennes séries affouagères (33,6 taxons en moyenne). Cette différence n'est significative que pour les végétations sur substrat marneux (P<0,05). L'analyse de la composition en essences du peuplement n'a pas révélé de différence significative, si ce n'est une tendance à une plus forte proportion de chêne sessile dans les gros bois des anciens quarts en réserve. Des analyses plus spécifiques sur substrats acides montrent des différences significatives de composition des communautés végétales. L’analyse multivariée révèle un effet faible mais significatif de l'ancien usage sur la composition du sol, notamment en termes de carbone et d'azote. Des pertes importantes de matière organique (14%) sont observées dans les anciennes séries affouagères sur substrat marneux uniquement.
4. Discussion Conclusion et Limites de l Étude
Les résultats montrent des effets visibles, mais faibles, de l'ancien usage sur les descripteurs étudiés. Les quarts en réserve présentent plus de gros bois, une flore légèrement moins riche et des sols plus riches en matière organique. La date exacte de l’arrêt des pratiques distinctes est mal connue, mais elle se situe au cours du XXe siècle ou à la fin du XIXe. L'effacement de l'impact écologique des quarts en réserve a été rapide, de l'ordre de moins d'un siècle. La baisse de matière organique observée dans les zones sur marnes s'explique par des exportations de matière ligneuse plus importantes et une fréquence plus élevée des coupes dans les anciennes séries affouagères. Cette perte de carbone suggère un effet à long terme des prélèvements de bois énergie, similaire aux problèmes observés dans les sols agricoles. Cependant, il est étonnant que cette perte ne soit observée que sur les substrats marneux. Les différences observées sont parfois limitées à une seule zone géologique, rendant difficile l'interprétation. Enfin, l'étude note des limites méthodologiques, utilisant une base de données existante au lieu d'un échantillonnage ad hoc.
II.Analyse Comparative des Anciens Usages Forestiers Lorraine et Vercors
L'étude étend son analyse à une autre zone géographique, le Vercors, comparant les anciennes futaies et les anciens mélanges taillis-futaie. Contrairement aux résultats de Lorraine, cette comparaison révèle des différences significatives dans la composition des peuplements, de la végétation forestière, et des propriétés du sol. Les anciennes futaies montrent une végétation plus acidiphile et des sols plus acides que les anciens mélanges taillis-futaie. L’étude souligne la difficulté de contrôler les biais liés à l’hétérogénéité des substrats, notamment dans le Vercors, où l'appariement des placettes n’était pas aussi rigoureux que pour les quarts en réserve de Lorraine. L'impact des changements d'usage des sols est démontré.
1. Comparaison Lorraine Vercors Méthodologie et Contrastes
L'étude compare l'impact des anciens usages forestiers en Lorraine et dans le Vercors. En Lorraine, l'analyse se concentre sur la comparaison entre les anciens « quarts en réserve » et les séries affouagères, utilisant un appariement précis des placettes pour minimiser les biais. Dans le Vercors, la comparaison porte sur les anciennes futaies et les anciens mélanges taillis-futaie. L'appariement des placettes dans le Vercors s'est fait en fonction des contraintes environnementales, contrairement à l'approche plus systématique en Lorraine. Cette différence méthodologique est cruciale : en Lorraine, la proximité des parcelles comparées et l'homogénéité des sols permettent un contrôle plus rigoureux des facteurs externes. Dans le Vercors, l'échantillonnage plus dispersé dans l'espace rend plus difficile la comparaison et l'élimination des biais liés à l'hétérogénéité des substrats. L'étude souligne les défis liés à l'appariement des placettes en présence de contraintes environnementales. Le Vercors, avec sa géologie plus complexe, nécessite une méthodologie plus affinée pour comparer l'impact des usages anciens, contrairement à la relative homogénéité des sols en Lorraine.
2. Résultats et Différences Significatives
Contrairement aux résultats observés en Lorraine, où les différences entre les anciens quarts en réserve et les séries affouagères étaient faibles, la comparaison des anciennes futaies et des anciens mélanges taillis-futaie du Vercors montre un signal cohérent et significatif. Dans le Vercors, les anciennes futaies présentent une végétation plus acidiphile et des sols plus acides que les anciens mélanges taillis-futaie. Les anciens peuplements avec taillis ont aujourd'hui une surface terrière plus faible et une proportion de hêtre et d'érable sycomore plus faible que les anciennes futaies. Cette différence significative entre les deux régions souligne l’influence de différents facteurs, notamment l'intensité et la nature des pratiques sylvicoles ainsi que les conditions pédologiques spécifiques à chaque zone d’étude. Le contraste entre les résultats de la Lorraine et ceux du Vercors est frappant et met en évidence la nécessité de prendre en compte les conditions spécifiques de chaque contexte géographique lors de l'analyse de l'impact des pratiques sylvicoles.
3. Analyse des Biais et Perspectives
L'étude souligne la présence potentielle de biais non maîtrisés, notamment dans le Vercors, en raison de la difficulté d'assurer une homogénéité absolue des substrats dans un échantillonnage non apparié. Les sols calcaires du Vercors Nord sont très caillouteux et peu profonds, rendant difficile une caractérisation précise du sol. Il est possible que les traitements en taillis aient été réservés aux sols moins fertiles, tandis que les futaies étaient implantées sur des sols plus profonds et plus acides. Il est également possible que le choix des zones pour les traitements en taillis et en futaie n'ait pas été aléatoire, mais déterminé par des différences préexistantes dans le paysage, affectant les conclusions. L’étude suggère la nécessité de mieux quantifier et localiser les pratiques sylvicoles anciennes pour une meilleure analyse des effets à long terme. Des études futures devraient s’appuyer sur des cas mieux documentés et des plans d’échantillonnage spécifiques tenant compte de l'hétérogénéité des sols et des contraintes microtopographiques. Les comparaisons entre les résultats de Lorraine et du Vercors soulignent l’importance de la méthodologie et les défis posés par les biais d'échantillonnage.
III.L Impact des Usages Anciens sur la Composition des Communautés Végétales
En utilisant une base de données du Conservatoire Botanique Régional Alpin (CBNA), l'étude explore le lien entre les anciens usages du sol (anciennes cultures, pâturages, forêts) et la composition actuelle de la végétation herbacée dans les Préalpes du Nord. Un nombre significatif d'espèces végétales montrent une préférence marquée pour les forêts anciennes ou les forêts récentes, reflétant l'impact persistant des activités humaines passées. Les auteurs identifient trois causes principales: modifications du milieu, dette de colonisation, et choix initiaux des usages en fonction des contraintes environnementales. Des espèces montagnardes, jusqu'alors non identifiées comme telles, sont associées à ces préférences, soulignant l'importance de considérer l'histoire pour comprendre la biodiversité actuelle. L'étude met en avant la difficulté d'identifier les espèces rares liées à l'ancienneté de l'état boisé.
1. Zone d étude et données du CBNA
L'étude porte sur la sylvoécorégion IGN des Préalpes du Nord (H10), notamment la zone des Quatre-Montagnes et le Vercors. Le Conservatoire Botanique Régional Alpin (CBNA) a fourni 5226 relevés floristiques localisés dans les forêts actuelles, après croisement avec les données de l'IGN/IFN. Après sélection des relevés avec au moins 5 espèces et élimination de ceux sans essence forestière, 3808 relevés ont été conservés pour l'analyse. Le pourcentage de forêts anciennes est de 71,4%, et le déboisement de 1850 a été de 5,8%. La propriété forestière est majoritairement privée (55,4%), suivie des forêts communales (31,7%) et domaniales (12,9%). Il est observé une corrélation entre le type de propriété et le pourcentage de forêts anciennes : forêts domaniales (87,3%), communales (79,3%) et privées (63,3%). La progression forestière récente (150 ans) a principalement eu lieu sur des terrains privés. Des observations sur la distribution des forêts récentes et anciennes dans le paysage, principalement une expansion centripète autour des villages, sont décrites, ainsi que des exemples géographiques spécifiques comme Bouvante, Château-Bernard et Rencurel.
2. Analyse de la présence absence des espèces et facteurs environnementaux
L'analyse de la présence/absence de 1359 taxons dans les 3808 relevés en fonction de l'ancienneté (forêt ancienne vs. forêt récente) a identifié 505 espèces montrant une préférence significative pour l'un ou l'autre type de forêt. Le nombre d'espèces associées aux forêts récentes est trois fois plus élevé que celui des espèces liées aux forêts anciennes, avant correction des effets altitude et exposition. La fréquence d'occurrence d'une espèce est fortement corrélée à sa valeur indicatrice pour l'ancienneté. Les espèces dites « neutres » ont une faible fréquence d'occurrence (< 5,5%), empêchant une analyse fiable. Seule l'épicéa, espèce fréquente, est indifférente à l'ancienneté de la forêt (présent dans 45% des relevés). L'étude met en lumière les difficultés liées à l'analyse des espèces rares ; par exemple, Epipogium aphyllum et Corallorrhiza corallorhiza, peu fréquentes, ne permettent pas d'analyse statistique fiable de leur préférence pour un type de forêt. La faible fréquence d'occurrence des taxons entraine une impossibilité de déterminer le preferendum des espèces pour l'ancienneté de l'état boisé.
3. Causes du lien entre occupation ancienne et distribution des espèces
Trois causes principales expliquent le lien entre l'histoire du site et la composition actuelle des communautés végétales. Premièrement, les activités humaines passées ont modifié le milieu : les sols cultivés ont été aplanis, épaissis, et épierrés. Deuxièmement, une dette de colonisation pourrait expliquer la présence d'espèces cantonnées aux forêts anciennes, n'ayant pas encore recolonisé les forêts récentes. La difficulté d'identifier les espèces limitées par leur mode de dispersion est mentionnée, en particulier pour les espèces montagnardes. Melampyrum nemorosum et Moehringia muscosa sont citées comme exemples d'espèces montagnardes myrmécochores à élaïosome, potentiellement limitées par la dispersion. Troisièmement, un lien initial préexistant entre type d'occupation et caractéristiques du milieu explique le choix des usages par l'Homme : sols plus épais et plats pour les cultures, sols humides pour les prairies, zones pierreuses pour les pâturages. L'étude souligne l'influence de facteurs comme l'altitude et l'exposition, qui rendent difficile l'identification précise de l'impact de l'ancienneté de la forêt. Des biais liés à la distribution inégale des cultures et pâturages selon les altitudes sont signalés.
4. Discussion Conclusion et Limites Méthodologiques
L'étude démontre un lien fort entre les anciens usages et la composition des communautés végétales, avec de nombreuses espèces présentant une préférence nette pour les forêts anciennement cultivées ou non. Des espèces montagnardes non identifiées précédemment sont associées aux forêts anciennes. L'étude identifie les limites méthodologiques liées à l'utilisation d'une base de données existante (CBNA) au lieu d'un échantillonnage ad hoc. L'analyse statistique est limitée par la fréquence des espèces : les espèces rares ne permettent pas de conclusions fiables. L’étude souligne la difficulté de dissocier l’impact des actions humaines des contraintes environnementales préexistantes. Des propositions pour des études futures incluent une analyse plus fine de la dispersion des espèces et la prise en compte des variations microtopographiques et pédologiques pour affiner les résultats. En conclusion, l'impact des usages anciens du sol sur la composition floristique est important, mais des études ultérieures sont nécessaires pour préciser les mécanismes en jeu.
IV.Espèces Sensibles et Conclusion
Contrairement aux hypothèses initiales, l'étude ne met pas en évidence d'espèces particulièrement sensibles à long terme aux différents types de sylviculture comparés (anciens mélanges taillis-futaie vs. anciennes futaies). Cependant, l’analyse révèle une fidélité plus forte des espèces de forêts anciennes à leur milieu que celles des forêts récentes, illustrant la difficulté de colonisation de certaines espèces. L'étude souligne l'importance d'intégrer l'histoire des pratiques sylvicoles et des changements d'usage des sols pour une meilleure compréhension de la biodiversité forestière et de la gestion forestière durable. Des recherches futures devraient s'appuyer sur des cas historiquement mieux caractérisés pour affiner l'analyse de l'impact écologique des pratiques passées.
1. Espèces sensibles aux pratiques sylvicoles résultats inattendus
Contrairement aux hypothèses initiales, l'étude n'a pas identifié d'espèces végétales sensibles à long terme aux traitements sylvicoles comparés (anciens mélanges taillis-futaie vs. anciennes futaies), ni en Lorraine ni dans le Vercors. Le terme « espèce sensible » désigne une espèce risquant une régression ou une disparition à long terme à cause d'un type précis de sylviculture. L'absence d'espèces significativement affectées à long terme remet en question les hypothèses initiales concernant l'impact des pratiques sylvicoles sur la biodiversité. Cette observation suggère une forte capacité de résilience des écosystèmes étudiés, ou bien que l'impact des pratiques sylvicoles se manifeste sur des échelles de temps plus longues que celles couvertes par l'étude. La notion de « sensibilité » à long terme des espèces végétales nécessite donc une analyse approfondie et une définition précise des critères.
2. Observations sur la fidélité des espèces aux différents types de forêts
L'analyse montre que la fidélité des espèces de forêts anciennes à leur milieu est significativement plus élevée que celle des espèces de forêts récentes. Ce résultat est cohérent avec l'hypothèse d'une faible capacité de colonisation des espèces de forêts anciennes, contrairement aux espèces des forêts récentes. Les différences de fréquence de présence des espèces, entre les anciens mélanges taillis-futaie et les anciennes futaies, sont négligeables. Quelques espèces montrent une légère tendance à moins bien supporter le régime des coupes de taillis à long terme : Galeopsis tetrahit, Ilex aquifolium, Carex pallescens, Anemone nemorosa, Pteridium aquilinum, Picea abies, Abies alba et Dryopteris carthusiana. Cependant, ce sont toutes des espèces banales, ce qui nuance l'importance de cette observation. L'étude mentionne également des espèces forestières relativement rares (Cirsium erisithales, Huperzia selago, etc.) et des espèces de micro-habitats intra-forestiers qui semblent préférer les forêts anciennes, même si la forêt n'est pas leur habitat primaire.
3. Conclusion générale et perspectives futures
Globalement, les résultats montrent des effets visibles mais faibles des anciens usages sylvicoles sur les descripteurs étudiés. L’étude conclut que, dans les cas étudiés, l'impact à long terme des pratiques sylvicoles sur la biodiversité est moindre que ce qui était initialement supposé. L'effacement de l'impact des pratiques sylvicoles, notamment en ce qui concerne les quarts en réserve, s'est révélé rapide, inférieur à un siècle. Il est crucial de mieux reconstituer l’historique des pratiques sylvicoles, en quantifiant les exportations de bois sur de longues périodes, pour une meilleure compréhension de leur impact écologique. Les résultats du Vercors, où les mélanges taillis-futaie semblent plus riches que les anciennes futaies, posent la question du bilan de deux actions contradictoires : amélioration des écosystèmes par l’introduction de feuillus, mais appauvrissement par des coupes répétées. Des études futures, avec des données plus précises et un échantillonnage plus rigoureux, sont nécessaires pour confirmer ces résultats et affiner la compréhension des interactions entre pratiques sylvicoles et biodiversité.
