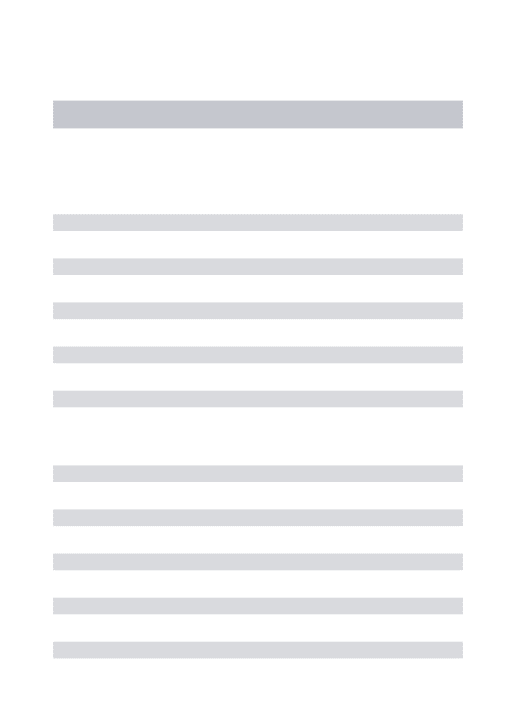
Nanoparticules polymères: Applications anti-cancer et anti-HIV
Informations sur le document
| Auteur | Maxime Laville |
| instructor/editor | Michèle Léonard |
| École | Université de Lorraine |
| Spécialité | Chimie-Physique Macromoléculaire |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 6.70 MB |
Résumé
I.Vectorisation de principes actifs contre le VIH 1 Utilisation de nanoparticules
Cette recherche explore l'utilisation de la vectorisation de principes actifs, notamment pour le traitement du VIH-1. L'objectif principal est d'améliorer la biodisponibilité des médicaments antirétroviraux et de réduire les effets secondaires des trithérapies et de la HAART (thérapie antirétrovirale hautement active). L'étude se concentre sur l'emploi de nanoparticules de première et deuxième génération, en particulier celles à base de PLA (acide polylactique) recouvertes de dextrane, pour encapsuler des inhibiteurs de protéase du VIH-1. L'amélioration du ciblage des cellules infectées par le VIH-1 (lymphocytes T et macrophages) est un enjeu majeur. Les méthodes d'élaboration de ces nanoparticules, notamment par nanoprécipitation et émulsion/évaporation de solvant, sont détaillées, ainsi que l'importance de leur stabilité colloïdale et de la modification de leur surface pour assurer une vectorisation efficace et éviter l’agrégation.
1. Définition de la vectorisation d un principe actif et biodisponibilité
Cette section introduit le concept crucial de biodisponibilité, définie comme le rapport entre la quantité de principe actif administrée et celle effectivement utilisée au niveau de la zone cible. L'amélioration de la biodisponibilité est un objectif majeur en biomédical. La vectorisation des principes thérapeutiques est présentée comme une approche pour y parvenir. Elle vise à prolonger la durée de vie des molécules bioactives dans l'organisme, en favorisant une libération progressive et en améliorant leur passage à travers les barrières naturelles. Des vecteurs stables, capables de transporter la substance active du site d'administration au site d'action avec un dosage et une cinétique précis, sont nécessaires. Le texte mentionne une classification des vecteurs médicamenteux en trois générations en fonction de leur biodisponibilité, soulignant que certaines thérapies nécessitent de multiples prises pour une efficacité à long terme. La compréhension et la maîtrise de la biodisponibilité sont essentielles pour optimiser les traitements.
2. Méthodes d élaboration des nanoparticules
Cette partie détaille les diverses méthodes de fabrication de nanoparticules permettant l'encapsulation de substances, hydrophiles ou hydrophobes. Deux catégories principales sont identifiées : les élaborations directes et celles à base de polymères préformés. La polymérisation en émulsion est citée comme une technique rapide pour créer des nanoparticules, y compris des nanocapsules via une polymérisation interfaciale (ex: cyanoacrylate). L’utilisation de polysaccharides amphiphiles est également abordée, mettant en avant leurs avantages : hydrophilisation de la surface des nanoparticules (prévention de l'adsorption non spécifique des protéines), ciblage actif de cellules cibles grâce à la présence de récepteurs spécifiques (ex: nanoparticules cœur PLGA/couronne acide hyaluronique pour le traitement articulaire), et bonne biocompatibilité et biodégradabilité. L'emploi de polymères comme le PEG (polyéthylène glycol) pour rendre la surface des nanoparticules hydrophile est également mentionné, ainsi que des exemples spécifiques de fonctionnalisation à l'aide de PEG, d'acide folique et de cholestérol. Différents polysaccharides et leur modification par des groupes cholestérol pour créer des copolymères amphiphiles auto-assemblés en nanoparticules sont aussi discutés. Enfin, la synthèse de copolymères dextrane-g-poly(ε-caprolactone) est présentée comme exemple de création de nanoparticules à coeur PCL et couronne de dextrane.
3. Nanoparticules de 1ère et 2ème générations pour une vectorisation efficace contre le VIH 1
Cette section souligne les inconvénients des traitements de trithérapie actuels contre le VIH-1 : doses importantes (3 à 5 gélules jusqu'à 5 fois par jour) et effets secondaires (vomissements, perte d'appétit). L’administration intraveineuse associée à des nanoparticules de 1ère ou 2ème génération est proposée comme solution pour améliorer le ciblage passif ou furtif des zones infectées (lymphocytes, réservoirs viraux). Le texte aborde les difficultés à cibler spécifiquement les cellules malignes, expliquant les effets secondaires des chimiothérapies (perte de cheveux, infections, anémies, hémorragies) et les moyens pour y remédier. L'utilisation de nanoparticules vise à réduire ces effets secondaires en améliorant le ciblage et la délivrance du médicament. Des exemples de fonctionnalisation de nanoparticules, notamment avec des peptides de reconnaissance des intégrines αvβ3 (surexprimées dans certaines tumeurs), sont donnés. L’objectif est d’obtenir des nanoparticules restant suffisamment longtemps dans l’organisme pour diffuser, être distribuées et captées par le système immunitaire, même si elles sont qualifiées de « furtives ».
II.Inhibiteurs de la dimérisation de la protéase du VIH 1
Une partie importante de l'étude porte sur les inhibiteurs de la dimérisation de la protéase du VIH-1. Le Pam-LEY, un tripeptide synthétisé au LCPM (Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée de Paris), est présenté comme un inhibiteur prometteur, plus efficace que les inhibiteurs commerciaux, et moins sensible aux mutations du virus. L'encapsulation du Pam-LEY dans des nanoparticules PLA/dextrane est étudiée pour améliorer son administration et son efficacité.
1. Problématique des inhibiteurs de protéase du VIH 1 et résistance aux médicaments
Le texte aborde la difficulté à traiter efficacement le VIH-1 en raison de la capacité du virus à muter. Il est spécifiquement question des inhibiteurs de protéase, utilisés dans les trithérapies et la HAART (thérapie antirétrovirale hautement active). Le document souligne que malgré l'efficacité initiale de ces inhibiteurs, l'émergence de mutations du virus, environ 47 mutations étant recensées près ou à l'extérieur du site actif de la protéase, réduit considérablement leur efficacité. Ces mutations conduisent à une résistance aux traitements existants, rendant les inhibiteurs inefficaces ou à faible activité contre la protéase mutée. La recherche de nouveaux traitements pour contourner cette résistance est une priorité majeure. La recherche d'inhibiteurs de la dimérisation de la protéase du VIH-1 est identifiée comme une voie prometteuse.
2. Inhibiteurs de la dimérisation études et développement
Des études sur les variations structurales de mimes de l'extrémité C-terminale de la protéase (plus efficaces que les mimes de l'extrémité N-terminale) ont permis d'identifier la séquence consensuelle ISYEL (Kid = 390 nM). Le LEMF (Laboratoire d'Enzymologie Moléculaire et Fonctionnelle) de l'UPMC (Université Pierre et Marie Curie) a étudié l'ajout d'une chaîne aliphatique hydrophobe à l'extrémité N-terminale de cette séquence, conduisant à des lipopeptides plus efficaces (Kid = 11 nM) en tant qu'inhibiteurs de la dimérisation. L’introduction d'un groupe guanidinium bicyclique, capable de liaison ionique avec l'extrémité C-terminale de la protéase, entre le peptide et la partie lipidique est également mentionnée. L'apparition de la HAART en 1996, associant plusieurs antirétroviraux pour une meilleure efficacité, est évoquée comme une avancée majeure, bien que ces traitements restent lourds pour les patients. La recherche vise à améliorer l'efficacité des molécules pour réduire le nombre de prises journalières, et à développer des traitements utilisant des molécules et solvants moins nocifs.
3. Le Palmitoyl LEY Pam LEY un inhibiteur prometteur
Le LCPM (Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée de Paris) a synthétisé le Palmitoyl-LEY (Pam-LEY), un tripeptide modifié, hautement efficace pour inhiber la dimérisation de la protéase du VIH-1. Un atout majeur du Pam-LEY réside dans sa capacité à maintenir son efficacité même en présence de mutations du virus, contrairement aux inhibiteurs commerciaux. Cependant, son caractère très hydrophobe pose un défi pour son administration. La solution proposée est son encapsulation dans des nanoparticules de 2ème génération (cœur PLA/couronne dextrane). Malgré leur nature « furtive », ces nanoparticules devraient être reconnues et captées par le système immunitaire, permettant une meilleure délivrance de l'inhibiteur aux cellules cibles.
III.Synthèse et caractérisation de nanoparticules PLA dextrane
La recherche détaille la synthèse de copolymères dextrane-g-PLA par chimie click (type thiol-yne/thiol-ène) pour obtenir des nanoparticules à cœur hydrophobe (PLA) et couronne hydrophile (dextrane). Deux stratégies de synthèse sont comparées : la nanoprécipitation de copolymères préformés et la technique d’émulsion/évaporation de solvant avec réaction in situ. La caractérisation des nanoparticules inclut la mesure de leur taille, potentiel zêta, quantité de dextrane ancrée, et leur stabilité colloïdale en présence de sels et de tensioactifs (comme le SDS, dodécylsulfate de sodium). L'influence de la longueur des chaînes alkyle du dextrane et de la présence de fonctions azide sur les propriétés tensioactives et la stabilité des nanoparticules est étudiée.
1. Synthèse de copolymères dextrane g PLA par chimie click
La synthèse de nanoparticules PLA-dextrane repose sur l'utilisation de la chimie click, plus précisément une réaction de type azide-alcyne catalysée par le cuivre (CuAAC). Le document décrit la synthèse de copolymères greffés dextrane-g-PLA en faisant réagir du dextrane fonctionnalisé par des azides (DexN3) avec du PLA fonctionnalisé par des alcynes (PLA α-alcyne). Cette réaction de chimie click permet de lier de manière covalente le dextrane à la surface des nanoparticules PLA. Le document souligne que le choix d'utiliser des dérivés du dextrane avec des groupements azide permet une fonctionnalisation ultérieure des copolymères. Cependant, des problèmes liés au temps disponible ont mené à une orientation de la synthèse vers des copolymères principalement solubles dans des solvants organiques (acétone), plutôt que dans l’eau, en utilisant des proportions massiques de PLA supérieures à 74%. L’analyse RMN 1H et la chromatographie d’exclusion stérique (SEC) sont utilisées pour vérifier l'efficacité de la réaction et de la purification des copolymères.
2. Méthodes de préparation des nanoparticules nanoprécipitation et émulsion évaporation
Deux méthodes de préparation des nanoparticules PLA-dextrane sont comparées : la nanoprécipitation et la technique d’émulsion eau-huile (o/w) / évaporation de solvant. Dans la méthode de nanoprécipitation, des copolymères dextrane-g-PLA sont utilisés, leur auto-organisation conduisant à la formation de nanoparticules avec le polyester au cœur et le polysaccharide en surface. La technique d'émulsion/évaporation de solvant est détaillée, incluant l'utilisation du DexN3 ou du DexC6 comme stabilisant à l'interface eau/huile. L’ajout de CuBr permet une réaction de chimie click in situ entre le DexN3 et le PLA α-alcyne durant la sonication, ce qui permet de créer une liaison covalente entre le dextrane et le cœur de PLA. L’emploi de PLA commercial ou de PLA α-alcyne, avec ou sans CuBr, est comparé. La sonication est mise en avant comme une étape clé pour l'obtention des nanoparticules, mais la température et la durée d'évaporation du solvant, l’agitation et le type de seringue employés sont des paramètres étudiés afin d'optimiser le procédé et de limiter l’influence sur la taille des nanoparticules.
3. Caractérisation et stabilité des nanoparticules
La caractérisation des nanoparticules obtenues par les deux méthodes inclut la mesure de leur diamètre moyen (Dz), leur potentiel zêta, et la quantité de dextrane ancrée à leur surface. Le document note une taille similaire (environ 150 nm) pour les nanoparticules produites par la technique d'émulsion/évaporation, indépendamment de l'utilisation de PLA commercial ou α-alcyne, avec ou sans chimie click in situ. La stabilité colloïdale des nanoparticules est étudiée dans des solutions de chlorure de sodium à différentes concentrations, mettant en évidence l'influence de la force ionique. L'utilisation du DexC6 et du DexN3 comme stabilisants surfacique est comparée, notant des différences de taille et une influence sur la conformation du dextrane à la surface des nanoparticules. L’effet d’un surfactant anionique puissant (SDS) et de protéines circulantes (BSA) sur l’adsorption et la stabilité de la couche de dextrane en surface est également mentionné. Les méthodes de récupération et de conditionnement des nanoparticules, incluant la centrifugation et la lyophilisation (avec ou sans cryoprotecteur) pour éviter l'agrégation, sont décrites.
IV.Études in vitro de la cytotoxicité et de l activité des nanoparticules
Des tests in vitro sont réalisés pour évaluer l'effet des nanoparticules sur l'activité de la protéase du VIH-1 et sur la viabilité cellulaire (lignée humaine HEK-293). Un test fluorométrique est utilisé pour mesurer l'activité de la protéase, tandis qu'un test XTT (colorimétrique) permet d'évaluer la cytotoxicité des nanoparticules. Les résultats montrent que les nanoparticules, qu'elles soient vides ou chargées de Pam-LEY, n'affectent pas significativement l'activité de la protéase et sont dépourvues d'effet cytotoxique sur les cellules humaines testées.
1. Effet des nanoparticules sur l activité de la protéase du VIH 1 in vitro
Des expériences in vitro ont été menées pour déterminer l'impact des nanoparticules de PLA recouvertes de DexC6-14 et lyophilisées sur l'activité de la protéase du VIH-1. L'étude a été réalisée avec des nanoparticules vides et des nanoparticules contenant l'inhibiteur Pam-LEY. Un test fluorométrique basé sur le transfert d'énergie de fluorescence a été utilisé. Le substrat fluorogène DABCYL-γ-Abu-S-Q-N-Y-P-I-V-Q-EDANS, mimant le site de coupure p17-p24 de la polyprotéine Gag-Pol, a été employé. L'hydrolyse du substrat, catalysée par la protéase, provoque une augmentation mesurable de la fluorescence. Les résultats ont montré que les nanoparticules vides, quelle que soit leur méthode d'obtention, n'affectent pas l'activité de la protéase pendant les 4 premières minutes du test. Cette observation est importante car elle indique une non-interférence des nanoparticules avec la réaction enzymatique, ce qui est primordial pour la validité des tests ultérieurs avec l’inhibiteur encapsulé.
2. Effet des nanoparticules sur la viabilité cellulaire d une lignée humaine modèle
La cytotoxicité des nanoparticules sur des cellules humaines (lignée HEK-293) a été évaluée in vitro. Une culture cellulaire en phase exponentielle de croissance a été traitée avec différentes concentrations de nanoparticules (0,5 mg/mL à 10 mg/mL). La viabilité cellulaire a été mesurée après 24, 48 et 72 heures à l’aide du test XTT, un test colorimétrique basé sur la réduction du bromure de 3-(4,5-diméthylthiazol-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium (MTT) par la déshydrogénase mitochondriale des cellules métaboliquement actives. La formation de formazan bleu-pourpre, mesurée par spectrophotométrie à 540 nm et 690 nm, est directement proportionnelle au nombre de cellules viables. Les résultats indiquent que les nanoparticules sont dépourvues d'effet cytotoxique sur les cellules HEK-293 testées aux concentrations utilisées. Ce résultat est crucial car il confirme la biocompatibilité des nanoparticules, un aspect essentiel pour leur utilisation potentielle dans une thérapie anti-VIH-1.
