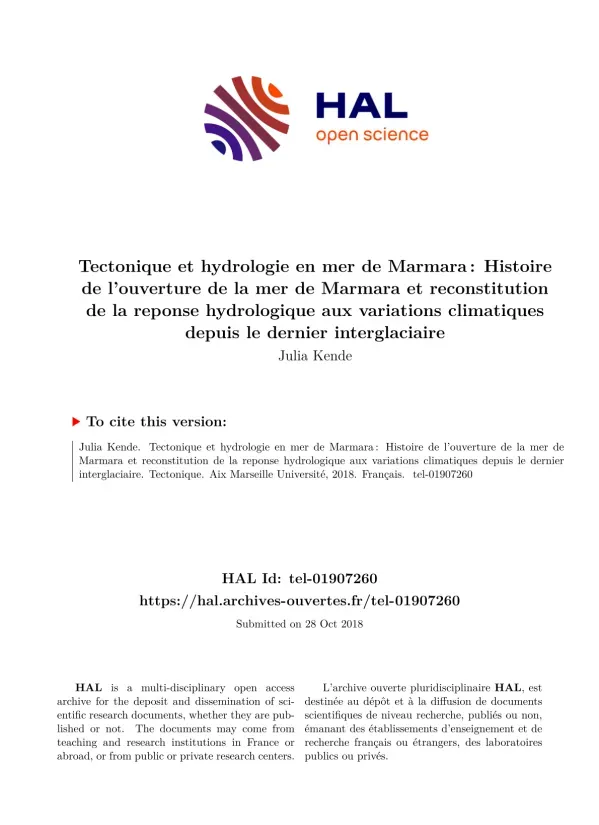
Tectonique et Hydrologie en Mer de Marmara : Étude des Variations Climatiques et de l'Ouverture de la Mer
Informations sur le document
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 28.57 MB |
- Tectonique
- Hydrologie
- Mer de Marmara
Résumé
I.Quantifications de l extension crustale en Mer de Marmara
Cette étude utilise l'anomalie de gravité et des données géophysiques pour modéliser l'épaisseur crustale en Mer de Marmara. En appliquant la méthode de Parker et une nouvelle méthode d'inversion, un modèle de la topographie du Moho est construit, révélant un amincissement crustal significatif sous les bassins de Tekirdağ, Central et Çınarcık. L'analyse compare le volume crustal avant et après déformation, quantifiant ainsi l'extension néogène. Les résultats suggèrent une vitesse d'extension quasi constante depuis 5 Ma, même après l'incursion de la Faille Nord-Anatolienne, indiquant une possible coexistence d'un régime extensif préexistant et d'un système transformant dextre. L'amincissement crustal s'étend au-delà des côtes, suggérant une extension à grande échelle impliquant des détachements crustaux. Les incertitudes liées aux densités latéralement variables et à la correction thermique sont prises en compte. Les données GPS, notamment celles de McClusky et al. (2000), Reilinger et al. (2006) et Hergert and Heidbach (2010), permettent de contraindre les estimations actuelles de vitesse de déplacement de la faille. L'étude de Bécel et al. (2009) sur la croûte inférieure est également utilisée comme contrainte.
1. Modélisation de la topographie du Moho par inversion de l anomalie de gravité
Cette partie décrit la méthode utilisée pour quantifier l'extension crustale en Mer de Marmara. Elle commence par l'analyse de l'anomalie de gravité, révélant une faible densité des bassins sédimentaires partiellement compensée dans la croûte inférieure. Des études géophysiques de la croûte supérieure sont compilées pour déterminer la géométrie des bassins sédimentaires. La méthode de Parker est appliquée pour corriger le signal de gravité de l'influence de la géologie de la croûte supérieure. En supposant que les anomalies à longue longueur d'onde dans le signal de gravité résiduel sont causées par des variations de la topographie du Moho, une inversion du résidu permet de construire un modèle 3D de la topographie du Moho. Ce modèle montre un bombement en forme de selle sous la Mer de Marmara, avec un amincissement crustal maximal sous les bassins, le Moho atteignant environ 25 km de profondeur, soit 5 km au-dessus de la profondeur de référence. L'extension néogène est ensuite évaluée en comparant la surface couverte par ce modèle aminci 3D avec celle d'un modèle non aminci ayant le même volume crustal. Cette approche permet de quantifier l'extension crustale totale dans la région.
2. Contraintes sismiques et géométriques du modèle crustal
L'existence d'une croûte inférieure réfléchissante, mise en évidence par des données sismiques multicanaux (Laigle et al., 2008) et des sismomètres fond de mer (Bécel et al., 2009), est intégrée au modèle. Cependant, les réflexions profondes n'étant identifiables que sur quelques profils sismiques multicanaux, des données de réfraction-réflexion à grand angle, enregistrées par des stations éloignées et quelques OBS, sont utilisées pour contraindre la profondeur de la croûte inférieure et du Moho. Bécel et al. (2009) ont imagé le sommet de la croûte inférieure sur trois profils 2D, proposant un modèle 2D où la croûte inférieure et le Moho ont une géométrie similaire, l'interface croûte supérieure/croûte inférieure se situant aux 2/3 de la profondeur du Moho. Ce rapport est supposé conservé en 3D, faute d'autres données indépendantes. La géométrie de l'interface croûte supérieure/croûte inférieure est donc calculée conjointement avec celle du Moho. Les profondeurs calculées du Moho et de l'interface croûte supérieure/croûte inférieure sont ensuite comparées aux contraintes disponibles provenant d'études sismiques. Une analyse de la densité des sédiments, intégrant la fraction de schiste comme variable, permet d'évaluer les incertitudes, compte tenu de la variabilité des sédiments. L'utilisation de la loi d'Athy (Grall et al., 2012, 2013) pour la porosité en fonction de la profondeur permet de calculer une densité moyenne de la première couche de sédiments.
3. Comparaison du modèle avec les données existantes et analyse des incertitudes
Cette section compare les résultats du modèle 3D avec les données de Bécel et al. (2009), basées sur des données sismiques multicanaux, des OBS et des enregistrements de réflexion/réfraction terrestres. La comparaison montre une bonne concordance entre le Moho inversé à partir des valeurs de gravité et celui obtenu par modélisation, avec deux zones d'amincissement maximal dans les parties est et ouest de la Mer de Marmara. La zone d'amincissement ouest est centrée au nord-est de l'île de Marmara, ce qui est cohérent avec une compensation isostatique en grande partie contrôlée par la géométrie des bassins. Cependant, des différences locales sont observées, indiquant un déficit isostatique sous la zone de faille principale de Marmara et une compensation excessive sous les bassins du sud. L'incertitude principale du modèle provient du non-traitement des densités latéralement variables. Aydin et al. (2005) ont montré des variations de profondeur du point Curie, suggérant des variations de température et de densité dans la croûte inférieure et le manteau. Une correction thermique de la gravité pourrait être envisagée, mais son impact sur le résultat final est estimé comme faible. L'étude des données GPS et de la répartition de l'amincissement crustal, apportant des informations sur le fonctionnement du système extensif avant la propagation de la Faille Nord-Anatolienne, est incluse.
4. Analyse de la déformation extensive et du rôle de l écoulement ductile de la croûte inférieure
L'étude utilise une nouvelle approche mathématique basée sur la résolution des sources de déformation élastique (Haines et al., 2015) pour calculer le taux d'extension à partir des données GPS de Reilinger et al. (2006). Ce taux d'extension est ensuite comparé à l'extension totale calculée à partir du modèle de gravité. La répartition de l'amincissement crustal révèle des différences entre une zone est et une zone ouest. À l'est, l'amincissement s'étend jusqu'à la côte sud, tandis qu'à l'ouest, il est plus localisé. Cette différence est expliquée par la présence de systèmes de détachement à l'est (Bécel et al., 2009; Le Pichon et al., 2015) ayant généré une zone amincie bien définie, facilitant l'écoulement ductile de la croûte inférieure. Après la propagation de la branche nord de la Faille Nord-Anatolienne, l'extension est principalement concentrée le long de la faille. Cependant, le bassin d'Imralı (Sorlien et al., 2012) montre une subsidence stable, suggérant la persistance d'un système extensif à l'est. La distribution de l'amincissement crustal ne supporte pas la présence d'une composante importante d'extension localisée le long du système de failles méridional. L'épaisseur de la croûte ductile inférieure est estimée à environ 15 km, potentiellement plus mince dans les zones d'extension. L'étude propose donc que le processus d'extension précoce est associé à un écoulement ductile de la croûte inférieure en régime permanent vers la fosse profonde de Marmara.
5. Conclusion et interprétation globale
En conclusion, l’étude, grâce à la méthode de Parker et une nouvelle méthode d'inversion, a permis de construire un modèle de profondeur du Moho en Mer de Marmara. Ce modèle révèle un bombement en forme de selle sous la mer, avec deux zones principales d'amincissement crustal. L'amincissement s'étend au-delà des côtes de la Mer de Marmara, ce qui est cohérent avec l'hypothèse d'une phase d'extension précoce impliquant des détachements à l'échelle de la croûte (Bécel et al., 2009; Le Pichon et al., 2015). L’étude propose que ce processus précoce soit associé à un écoulement ductile de la croûte inférieure en régime permanent vers la fosse profonde de Marmara, au sein d'un système de faille en constante évolution. Le résidu de gravité après correction pour le modèle complet du bassin et de la croûte ne montre pas d'anomalies à grande longueur d'onde, ce qui témoigne de la robustesse du modèle. Le taux d’extension calculé, basé sur une épaisseur de croûte de référence et ramené à l'extension actuelle mesurée par GPS, suggère une vitesse d’extension quasi-constante depuis 5 Ma. Ceci indique que les contraintes extensives dans la région ont peu varié depuis l’époque précédant l’incursion de la faille Nord-Anatolienne, suggérant la superposition d'un système transformant dextre sur un système extensif préexistant.
II.Modélisation de l âge des sédiments et implications pour la vitesse de la Faille Nord Anatolienne
L'étude s'intéresse à l'estimation de la vitesse de mouvement de la Faille Nord-Anatolienne sur environ 500 ka. Des modèles d'âge des sédiments en Mer de Marmara, basés sur l'interprétation de profils sismiques (réflexion, réfraction et profils 3.5 kHz) et des taux de sédimentation, sont présentés. Ces modèles, notamment ceux de Grall et al. (2013, 2014) et Sorlien et al. (2012), reposent sur la corrélation de séquences sédimentaires (niveaux drapés et unités de remplissage) avec les variations du niveau marin (cycles glacio-eustatiques de 100 ka). La campagne MARSITE a permis de prélever des carottes de sédiments, dont la carotte MRS-CS-22, pour valider ces extrapolations. L'étude des réflecteurs sismiques, dont le réflecteur H1 (« rouge »), et de la stratigraphie des carottes permet de réviser l'âge de ces réflecteurs, initialement estimé à 105 ka, et de mieux contraindre la vitesse de déplacement de la faille. Les travaux de Kurt et al. (2013) sur la migration du dépocentre du bassin de Cinarcik sont également considérés.
1. Modèles d âge existants et nécessité de validation
L'estimation de la vitesse de déplacement de la Faille Nord-Anatolienne sur le long terme (environ 500 ka) repose sur des modèles d'âge des sédiments en Mer de Marmara. Ces modèles, développés par Grall et al. (2013, 2014) et Sorlien et al. (2012), utilisent l'interprétation de profils sismiques et les taux de sédimentation récents. Dans la partie Est, la corrélation de deltas avec des épisodes de bas niveau dans le bassin d'İmralı Nord est utilisée (Sorlien et al., 2012), tandis que dans la partie Ouest, l'alternance de deux géométries de dépôts sédimentaires est la base du modèle (Grall et al., 2014). Bien qu'une concordance soit supposée entre les principaux réflecteurs sismiques et une similitude visuelle des séquences, aucune continuité le long de la Mer de Marmara ne confirme cette hypothèse. Les modèles concordent sur les premiers cycles, coïncidant avec l'extrapolation des taux de sédimentation mesurés sur des carottes atteignant 40 ka, mais des divergences persistent pour les couches plus anciennes. L'incertitude liée à l'extrapolation augmente significativement avec la profondeur. Ces modèles représentent les seules tentatives d'estimation au-delà de 15 000 ans, soulignant le besoin de validation par des données plus fiables.
2. La campagne MARSITE et l objectif de datation directe
La campagne MARSITE visait à prélever des carottes de sédiments afin de vérifier directement la validité des extrapolations des modèles d'âge existants. L'objectif principal était d'atteindre des horizons sismiques anciens pour obtenir une datation directe des réflecteurs sismiques. Une étude de Grall et al. (2013) sur un complexe de glissements de terrain chevauchant la Faille Nord-Anatolienne, dont les parties sont décalées par le mouvement de la faille, a permis une première estimation de la vitesse de déplacement (15.1–19.7 mm/an depuis 405–490 ka), mais cette estimation repose sur l'extrapolation des taux de sédimentation sur les derniers 40 000 ans. La compréhension et l'interprétation de la stratigraphie nécessitent une combinaison d'approches géophysique et paléo-environnementale. La campagne visait donc à prélever des carottes dans des zones précises pour atteindre les réflecteurs clés, et à combiner les données sismiques avec les informations paléo-environnementales obtenues des carottes. L'identification et la datation du réflecteur « rouge » H1, le premier réflecteur principal utilisé dans les modèles d'âge, étaient primordiales.
3. Résultats préliminaires et interprétation stratigraphique
L'étude détaille les premiers résultats de la mission MARSITE, notamment ceux concernant la carotte MRS-CS-22. Cette carotte contient les couches responsables du réflecteur H1 « rouge », le plus récent des réflecteurs utilisés dans les modèles d'âge. Le choix de l'emplacement du carottage visait à obtenir un enregistrement condensé de la stratigraphie, tout en évitant les poches de gaz. L'âge du réflecteur H1 est estimé à 105 ± 13 ka par extrapolation des taux de sédimentation dans le Haut Ouest (Grall et al., 2013), et corrélé à l'horizon Red-1 dans la partie Est de la Mer de Marmara, estimé à 110 ka (Sorlien et al., 2012). La corrélation des horizons sismiques sur toute la Mer de Marmara est complexe en raison de canyons profonds. Cependant, l'hypothèse est que H1, premier réflecteur haute amplitude à polarité négative sous le fond marin, possède une caractéristique conservative sur toute la mer. L’analyse de la stratigraphie dans la carotte, l'identification de deux niveaux de cendres volcaniques et la présence de niveaux marins, permettent de proposer une nouvelle chronologie et de discuter de la validité des modèles d'âge existants basés sur les extrapolations des taux de sédimentation.
III.Etude Paléo environnementale de la carotte MRS CS 22
L'analyse détaillée de la carotte MRS-CS-22, prélevée lors de la campagne MARSITE à bord du navire océanographique Le Pourquoi Pas ?, fournit des informations paléo-environnementales cruciales. L'étude combine des données géophysiques et des indicateurs paléo-environnementaux (variations chimiques et faunistiques, téphras, foraminifères) pour dater les réflecteurs sismiques, notamment le réflecteur H1 (« rouge »). L'identification de deux niveaux de cendres volcaniques (22 ka et 39 ka) permet de préciser la chronologie. L'analyse des assemblages de foraminifères révèle des variations de l'oxygénation des eaux de fond. L'alternance de périodes marines et lacustres est confirmée, avec une interprétation des variations du niveau marin et de l'hydrologie de la Mer de Marmara. Le rapport Sr/Ca dans les carbonates est utilisé pour reconstituer les variations de salinité. L'âge du réflecteur H1 est réévalué à environ 70 ka, ce qui diffère des estimations initiales.
1. Description lithologique et contenu fossile de la carotte MRS CS 22
L'étude paléo-environnementale se concentre sur la carotte MRS-CS-22, prélevée en Mer de Marmara lors de la mission MARSITE à bord du navire "Pourquoi Pas ?". L'analyse lithologique révèle une succession de faciès. Une description détaillée de la carotte MRS-CS-22 indique une transition lithologique majeure entre un faciès vert laminé et un faciès gris homogène plus dense. Cette transition est à l'origine du réflecteur sismique « rouge » H1. La présence de deux niveaux de cendres volcaniques à 22 ka et 39 ka au-dessus de l'interface, et d'un niveau de sédiment marin franc en dessous, permet d'estimer une première fourchette temporelle pour cette transition entre 111 ka et 39 ka, soit entre le MIS 5d et le MIS 3. Le contenu fossile est très variable selon les unités sédimentaires. L'unité 4, la plus profonde, est riche en foraminifères benthiques, indiquant une période marine riche, évoluant vers un environnement appauvri en oxygène. L'unité 2, plus superficielle, est plus pauvre en fossiles, avec quelques fragments de coquilles de Dreissena sp., indiquant un environnement lacustre. L'absence de diatomées est probablement due à la dissolution des bioclastes siliceux après un changement d'alcalinité de l'eau. Ces observations permettent de mieux comprendre l'évolution paléo-environnementale de la Mer de Marmara.
2. Datation des tephras et corrélations stratigraphiques
L'identification de deux niveaux de tephra dans la carotte MRS-CS-22 est une étape clé de la datation. La description et la position stratigraphique de ces tephras suggèrent une corrélation avec le tephra MT1 et MT2 documentés par Çağatay et al. (2015). Ces derniers ont corrélé ces tephras avec l'éruption du Cap Riva de Santorin à 22 ka (téphra marin Y-2) et avec l'éruption ignimbritique campanienne des Champs Phlégréens en Italie à 39 ka (téphra marin Y-5). Des analyses chimiques par microscopie électronique à balayage (SEM) couplée à un spectromètre à dispersion d'énergie (EDS) confirment la composition chimique des tephras, cohérente avec l'hypothèse de corrélation avec les éruptions volcaniques de Santorin et des Champs Phlégréens. Cette datation précise des tephras permet d'encadrer chronologiquement les différents niveaux sédimentaires de la carotte MRS-CS-22, contribuant ainsi à la construction du modèle d'âge des sédiments. La présence de ces marqueurs stratigraphiques permet de calibrer les différentes unités sédimentaires et de mieux appréhender la chronologie de la Mer de Marmara.
3. Analyse du contenu en foraminifères et implications hydrologiques
L'étude du contenu fossile, en particulier des foraminifères, apporte des informations cruciales sur l'évolution hydrologique de la Mer de Marmara. Le contenu en foraminifères de la carotte MRS-CS-22 est très différent selon les unités sédimentaires. Dans l'unité 4, la faune de foraminifères est riche et diversifiée, incluant des espèces indicatrices d'environnements oxygénés (Cibicidoides spp., Quinqueloculina spp., Kaiho et al., 1994), témoignant d'une période marine. Cependant, une diminution progressive de la diversité et la disparition des indicateurs d'environnements oxygénés sur 1 m vers le haut de l'unité suggèrent une perte progressive d'oxygène dans les eaux de fond. L'unité 2 est beaucoup plus pauvre en fossiles, contenant principalement quelques fragments de Dreissena sp., espèce caractéristique des sédiments lacustres de la Mer de Marmara (Aksu et al., 2002; Çağatay et al., 2009; Gasperini et al., 2011; Aloisi et al., 2015), et des ostracodes (Candona sp., Loxoconcha sp., Vidal et al., 2010) indiquant une influence de la faune de la Mer Noire (Boomer et al., 2010). L'analyse des foraminifères permet donc de retracer les variations de l'environnement marin à lacustre, liées à des changements de salinité et d'oxygénation.
4. Variations du niveau marin de la salinité et interprétation des résultats
En combinant les données paléoenvironnementales avec les variations du niveau marin au cours du MIS 5 (Gökaşan et al., 2008; Çağatay et al., 2009), l'étude propose des hypothèses sur l'hydrologie de la Mer de Marmara. Même si les variations du niveau marin du MIS 5e au MIS 5a semblent faibles par rapport à la profondeur actuelle du seuil des Dardanelles, le seuil était probablement à une altitude plus élevée par le passé. L'étude du rapport Sr/Ca dans les carbonates de la carotte MRS-CS-22 permet de reconstituer les variations de salinité. Des valeurs élevées de Sr/Ca indiquent des périodes marines, tandis que des valeurs plus faibles suggèrent des périodes lacustres. L'analyse indique que la Mer de Marmara n'était peut-être pas complètement déconnectée avant la fin du MIS 5a, un faible apport d'eau salée empêchant la dilution complète des eaux de fond. La transition marin/lacustre correspond à un réflecteur sismique qui, dans la carotte MRS-CS-22, est daté à environ 70 ka, plus jeune que les estimations initiales (105 ka), suggérant que ce réflecteur correspond à la fin du stade 5, avec une chute brutale du niveau de la mer marquant une possible déconnexion totale entre les deux mers. Des couches de sable érosif à l’interface confirment un événement de déstabilisation des pentes.
