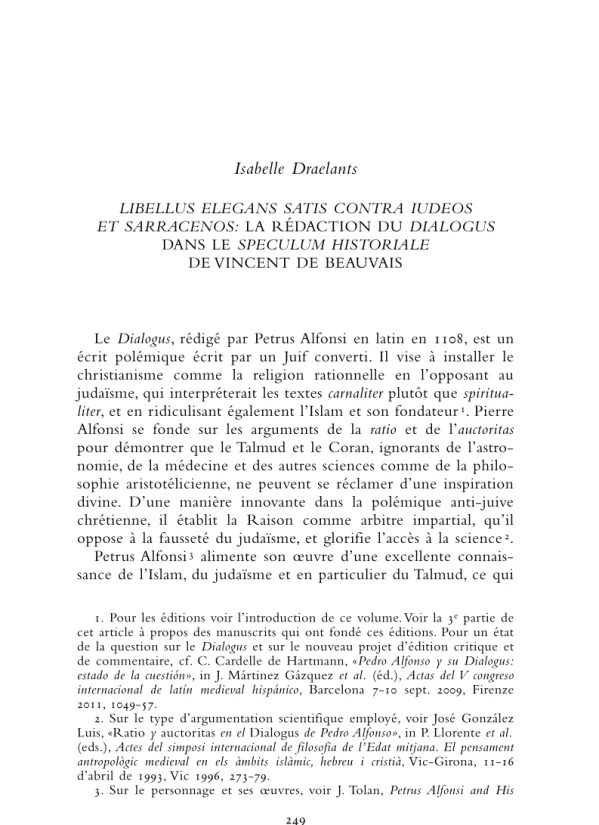
Analyse du Dialogus de Petrus Alfonsi dans le Speculum Historiale
Informations sur le document
| Auteur | Plusieurs auteurs sont cités dans le texte, notamment C. Cardelle De Hartmann, José González Luis, M. J. Lacarra Ducay, John Tolan, Philipp Roelli, Dieter Bachmann |
| École | Université Non Spécifiée |
| Matière | Histoire médiévale, études religieuses, philologie |
| Type de document | Article scientifique ou chapitre de livre |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 291.91 KB |
- Polemique religieuse
- Judaïsme
- Islam
Résumé
I.Le Dialogus de Petrus Alfonsi Une œuvre polémique médiévale majeure
Le Dialogus, rédigé en latin en 1108 par Petrus Alfonsi, un Juif converti au christianisme, est un texte clé des polémiques médiévales. Il vise à établir la supériorité rationnelle du christianisme en le comparant au judaïsme, à l'islam et à son fondateur, qu'il critique en s'appuyant sur la ratio et l'auctoritas. Petrus Alfonsi, expert en judaïsme (notamment le Talmud) et en islam, utilise la science (astronomie, médecine, philosophie aristotélicienne) pour réfuter les deux autres religions. L'œuvre, de forme scolastique, est une source essentielle d'informations sur les religions monothéistes du Moyen Âge et marque une innovation dans la polémique anti-juive chrétienne.
1. Le contexte et les objectifs du Dialogus
Le Dialogus de Petrus Alfonsi, écrit en 1108, s'inscrit dans un contexte de polémiques religieuses. Rédigé en latin par un Juif converti au christianisme, il présente le christianisme comme une religion rationnelle, supérieure au judaïsme et à l’islam. Alfonsi accuse le judaïsme d’interpréter les textes « carnaliter » plutôt que « spiritualiter », et critique l’islam et son fondateur. Son argumentation repose sur la ratio et l’auctoritas, utilisant la raison et les références religieuses pour réfuter les arguments du Talmud et du Coran. Il soutient que ces textes, ignorants de l'astronomie, de la médecine et de la philosophie aristotélicienne, ne peuvent prétendre à une inspiration divine. Cette approche, utilisant la raison comme arbitre impartial et valorisant la science, constitue une innovation dans la polémique anti-juive chrétienne. La maîtrise d'Alfonsi de l'islam, du judaïsme et du Talmud fait du Dialogus une source essentielle pour l'étude des religions monothéistes au Moyen Âge, malgré ses emprunts à la littérature polémique chrétienne antérieure, notamment aux citations de l'Ancien Testament. Le texte, structuré comme un dialogue fictif entre Moïse (représentant Alfonsi avant sa conversion) et Petrus (après sa conversion), sert à la fois de justification de sa conversion et d'incitation à la conversion pour les lecteurs. Un chapitre entier est dédié à une description systématique de l’islam, une approche inédite en Occident latin à l’époque.
2. La structure et l argumentation du Dialogus
Le Dialogus met en scène un débat entre deux personnages fictifs : Moïse, représentant le point de vue juif, et Petrus, représentant Petrus Alfonsi après sa conversion au christianisme. Les interventions de Petrus sont longues et argumentées, tandis que celles de Moïse sont plus courtes, servant principalement de transition entre les différents sujets. L’œuvre utilise une structure argumentative basée sur trois piliers : la compatibilité du christianisme avec les sciences et la logique, l’identification d’erreurs et de mauvaises interprétations dans le Talmud, et la démonstration de la présence de croyances chrétiennes dans les écrits juifs post-bibliques. Alfonsi utilise une approche scientifique et philosophique, s’appuyant sur l’astronomie, la météorologie, la médecine et la cosmologie pour soutenir ses arguments. Il illustre ces points notamment en proposant des explications physiques pour étayer des concepts religieux comme la création, la résurrection et l'ascension du Christ. L'argumentation repose aussi sur une approche tropologique, reliant les types de l'Ancien Testament aux éléments du Nouveau Testament. Alfonsi propose ainsi trois modes de connaissance pour déterminer la véracité d'une affirmation, démontrant la solidité de sa méthode argumentative.
3. Petrus Alfonsi et son influence comme auctoritas
Le succès du Dialogus a rapidement établi Petrus Alfonsi comme une auctoritas en matière de polémique anti-juive. La diffusion de l’œuvre a commencé en France entre 1120 et 1130, et on dénombre plus de 70 manuscrits complets, sans compter les adaptations et traductions. L'ouvrage a été copié et conservé dans des centres intellectuels majeurs du nord-ouest de l’Europe, notamment les abbayes de Saint-Victor, Saint-Germain-des-Prés, Cîteaux, et des institutions anglaises. Les manuscrits les plus anciens proviennent du nord de la France et d’Angleterre, où Petrus Alfonsi a enseigné. Plusieurs auteurs ultérieurs se sont inspirés de ses attaques contre le Talmud, mais n’ont pas retenu l’importance de sa dimension philosophique et scientifique. Au XIIIe siècle, le Dialogus sert de matériel aux ordres mendiants, particulièrement aux Dominicains, dans leurs efforts de conversion et de mission, aussi bien auprès des musulmans que des juifs. L’importance du Dialogus dans la propagation des arguments anti-juifs et la volonté de conversion des communautés juives est souligné par l'exemple de Raymond de Peñafort, troisième prieur général des Dominicains, qui encouragea l'apprentissage de l'hébreu pour convaincre les Juifs des erreurs dans leurs écritures. La popularité de l'œuvre est confirmée par le nombre élevé de manuscrits et son usage répété dans les siècles suivants.
II.Diffusion et Influence du Dialogus
Diffusé dès les années 1120-1130, le Dialogus compte plus de 100 manuscrits, incluant adaptations et traductions. Des centres intellectuels comme Saint-Victor, Saint-Germain-des-Prés, Cîteaux, et des abbayes anglaises en possédaient des copies. Des auteurs importants comme Pierre le Vénérable (Adversus Judaeorum inueteratam duritiem), Jacques de Voragine (Legenda aurea), et Alfonso de Espina s'inspirent de ses attaques contre le Talmud, mais négligent sa dimension philosophique et scientifique. Au XIIIe siècle, les ordres mendiants, notamment les Dominicains, l'utilisent à des fins missionnaires, témoignant d'une volonté de conversion des Juifs et des Musulmans.
1. Diffusion géographique et temporelle du Dialogus
La diffusion du Dialogus commence probablement en France entre 1120 et 1130. Le texte connaît un succès remarquable, avec plus de 70 manuscrits complets recensés, auxquels s'ajoutent de nombreuses adaptations et traductions, portant le nombre total à plus de 100. John Tolan a dénombré 21 manuscrits du XIIe siècle, 24 du XIIIe, 14 du XIVe, 18 du XVe et 2 du XVIe siècle ; des travaux plus récents précisent ces chiffres, notamment pour les manuscrits du XIIe siècle, dont le nombre s'élève désormais à 15. Parmi ceux-ci, on peut citer celui de Chartres (ms. 127, provenant de l'abbaye Saint-Père-en-Vallée), malheureusement perdu durant la Seconde Guerre mondiale. Au XIIe siècle, de nombreux centres intellectuels du nord-ouest de l'Europe possédaient des copies, incluant Saint-Victor, Saint-Germain-des-Prés, Cîteaux (France), Reading et la cathédrale d'Hereford (Angleterre). Les manuscrits les plus anciens proviennent du nord de la France et d'Angleterre, régions où Petrus Alfonsi a enseigné. Cette large diffusion témoigne de l’impact et de l’influence du Dialogus dans le monde intellectuel médiéval. La recherche actuelle, menée par Carmen Cardelle de Hartmann à Zurich (avec Darko Senekovic et Thomas Ziegler), ainsi que l'étude de Philipp Roelli et Dieter Bachmann dans la Revue d'histoire des textes, affinent constamment notre compréhension de cette diffusion.
2. Influence du Dialogus sur les auteurs et les mouvements religieux
Le Dialogus a eu une influence significative sur plusieurs auteurs et mouvements religieux. Des figures importantes comme Pierre le Vénérable (avec son Adversus Judaeorum inueteratam duritiem), Jacques de Voragine (auteur de la Legenda aurea, rédigée entre 1260 et 1266), et Alfonso de Espina (XVe siècle) se sont inspirés de ses attaques contre le Talmud. Cependant, ils n'ont pas conservé la dimension philosophique et scientifique qui constituait une part essentielle de l'objectif du Dialogus. Au XIIIe siècle, le Dialogus est utilisé à des fins missionnaires par les ordres mendiants, notamment l’ordre dominicain. Cet ordre, animé d'un fort esprit missionnaire, cherchait à comprendre l'islam pour mieux convertir ses fidèles. Des écrits dominicains témoignent de cette approche ethnologique, ainsi que du désir de convertir les Juifs d'Occident. L'exemple de Raymond de Peñafort (1185-1275), troisième prieur général de l'ordre dominicain, illustre ce point : il aurait encouragé l’apprentissage de l’arabe et de l’hébreu par ses frères pour faciliter la conversion des musulmans et des juifs respectivement. L'œuvre de Petrus Alfonsi a donc joué un rôle important dans les débats religieux et les stratégies missionnaires du Moyen Âge.
3. Utilisation et adaptation du Dialogus par Vincent de Beauvais
Vincent de Beauvais, dominicain du XIIIe siècle, a inclus une partie du Dialogus dans son Speculum Maius, une encyclopédie majeure du Moyen Âge. Dans le Speculum Historiale, il incorpore sous forme de florilège et de paraphrase les cinq premiers tituli du Dialogus (livre XXV, chapitres 118-145). Vincent de Beauvais privilégie ainsi les passages qui constituent une attaque contre le judaïsme, négligeant la moitié de l’œuvre originale qui propose une apologie du christianisme. Cette sélection reflète le contexte idéologique du XIIIe siècle, où la présence des Juifs était perçue comme une menace au sein de la société chrétienne, même si leur érudition scripturaire était admirée. L’intégration du Dialogus dans le Speculum Maius n’est pas apparue dès la première rédaction de l'Speculum Historiale (la « version Klosterneuburg »), antérieure à 1244. Son ajout se situe dans une phase ultérieure de la rédaction, entre 1244 et 1254, probablement dans les années 1240, dans une version bifaria du Speculum Maius, avant sa grande révision en trois parties. L'ajout volontaire et spécifique du Dialogus dans la partie historique du Speculum témoigne de son rôle dans le contexte politique et idéologique de la France du XIIIe siècle.
III.Le Dialogus et la Grande Controverse de 1240
En 1239, Nicolas Donin, Juif converti et frère dominicain, dénonce le Talmud comme hérétique. La « grande controverse » publique sur le judaïsme a lieu à Paris en juin 1240, impliquant des figures importantes comme la reine mère Blanche de Castille, Eudes de Châteauroux, Guillaume d'Auvergne, et les rabbins Yeh.iel ben Joseph de Paris et Moïse ben Jacob de Coucy. Le couvent dominicain Saint-Jacques joue un rôle central. La condamnation définitive du Talmud intervient en 1248. La Pharetra fidei contra Judeos, compilation d'extraits rabbiniques traduits, est probablement rédigée par Thibaut de Sézanne et d'autres Dominicains après la controverse.
1. Le rôle de Nicolas Donin et l excommunication du Talmud
La « grande controverse » de 1240 concernant le Talmud est précédée par les actions de Nicolas Donin. Juif converti au christianisme devenu frère dominicain de La Rochelle, il avait été excommunié (h.erem) par les autorités rabbiniques. En 1239, Donin identifie et soumet au pape Grégoire IX des passages du Talmud qu'il juge offensants ou blasphématoires, les dénonçant comme hérétiques. Cette action conduit à la confiscation des livres religieux juifs en mars 1240, marquant le début d'une importante controverse publique. Cette controverse, qui met en lumière les tensions religieuses de l'époque, met en exergue le rôle joué par les conversions religieuses et les tensions entre les communautés juives et chrétiennes. La démarche de Nicolas Donin, motivée par une volonté de dénonciation hérétique, aura des conséquences considérables sur la perception du Talmud au sein de l'Église catholique.
2. Le déroulement de la Grande Controverse à Paris en 1240
La controverse publique sur le judaïsme se tient à Paris le 25 juin 1240, sous le patronage de la reine mère Blanche de Castille. Y participent des figures clés de l'Église : Eudes de Châteauroux (légat du pape et chancelier de l'Université de Paris), Guillaume d'Auvergne (évêque de Paris), ainsi que les évêques de Senlis et de Sens. Du côté juif, les principaux représentants sont Yeh.iel ben Joseph de Paris et Moïse ben Jacob de Coucy. Le couvent dominicain de Saint-Jacques, abritant Henri de Cologne, inquisiteur des écrits juifs, semble avoir été le cœur de l'événement. Grégoire IX avait exigé que les exemplaires du Talmud soient remis aux ordres mendiants de Paris. La controverse marque un point culminant dans les tensions entre les communautés juives et chrétiennes, mettant en lumière les divergences doctrinales et les enjeux politiques de l’époque. Le débat met en scène des acteurs clés de la société et de l’Église catholique de l’époque. La controverse publique témoigne des mécanismes institutionnels mis en œuvre par l’Eglise pour contrôler les écrits des communautés juives.
3. La condamnation du Talmud et les actions subséquentes de l Ordre Dominicain
La controverse culmine par la condamnation définitive et ferme du Talmud par Eudes de Châteauroux, devenu cardinal et légat pontifical en France, soutenu par quarante et un clercs le 15 mai 1248. Parmi ceux-ci figuraient les dominicains Henri de Cologne, Guillaume d'Auvergne et Albert le Grand. Thibaut de Sézanne, sous-prieur dominicain du couvent Saint-Jacques à Paris (1240-1250), aurait, avec l’aide d’autres frères dominicains, compilé la Pharetra fidei contra Judeos, un recueil d'extraits rabbiniques traduits rigoureusement. Les chapitres généraux de l’ordre dominicain (1243, 1244 et 1256) ordonnent la correction des cahiers doctrinaux contenant des éléments d’origine orientale, suite à la condamnation de dix articles de théologie néoplatonicienne en 1241-1244 par Guillaume d'Auvergne et les maîtres de l'université de Paris. Ces articles, répandus dans l'ordre dominicain, concernaient par exemple l'inaccessibilité de Dieu et la procession du Saint-Esprit. Ces actions démontrent la volonté des Dominicains de contrôler l’orthodoxie et d’influencer la perception du Talmud et des écrits juifs.
IV.L intégration du Dialogus dans le Speculum Maius de Vincent de Beauvais
Vincent de Beauvais, dominicain et proche de Louis IX, intègre une partie du Dialogus dans son Speculum Maius, notamment dans le Speculum Historiale. Il sélectionne principalement les passages attaquant le judaïsme, omettant l'apologie du christianisme et une grande partie des arguments scientifiques et philosophiques de Petrus Alfonsi. L'insertion du Dialogus dans le Speculum Historiale se situe entre 1244 et 1254, probablement dans les années 1240, avant la grande révision de l'encyclopédie. Cette intégration s'inscrit dans un contexte dominicain de polémique anti-juive et de mission, influencée par la politique royale.
1. Vincent de Beauvais et le Speculum Maius contexte et choix éditoriaux
Vincent de Beauvais, dominicain et lecteur à l'abbaye cistercienne de Royaumont à partir de 1246, intègre une partie du Dialogus de Petrus Alfonsi dans son Speculum Maius. Ce choix s'inscrit dans un contexte de durcissement de la polémique anti-juive au milieu du XIIIe siècle, où la présence juive est perçue comme une menace. Vincent de Beauvais, proche de Louis IX, roi de France très zélé dans l'application des ordres pontificaux contre le Talmud, utilise le Dialogus dans son Speculum Historiale. Il inclut un florilège des cinq premiers tituli du Dialogus (livre XXV, chapitres 118-145), qui constituent une attaque contre le judaïsme. Il omet les tituli VI à XII, qui présentent une apologie du christianisme, ainsi que les arguments philosophiques et scientifiques fondamentaux de l'œuvre d’Alfonsi. Cette sélection ciblée répond à un objectif précis : fournir une matière prédicable aux frères dominicains, frappante par son contraste culturel entre les religions, sans viser le même degré d’exigence intellectuelle que Petrus Alfonsi. L'intégration du Dialogus dans le Speculum Historiale témoigne de l'utilisation stratégique de textes polémiques dans le contexte de la croisade et de la volonté de conversion des Dominicains.
2. Intégration du Dialogus dans les différentes versions du Speculum Historiale
L'intégration du Dialogus dans le Speculum Historiale ne se fait pas dès la première version de l’œuvre, la « version Klosterneuburg » (Hb), achevée en 1244. Son ajout est postérieur et s'insère au sein de la version « Dijon » (Ha), toujours bifaria (partie historique et partie naturelle). L'analyse des étapes de rédaction du Speculum Historiale, notamment grâce au travail de J. B. Voorbij, indique que l'ajout a eu lieu entre 1244 et 1254, probablement dans les années 1240. Le Dialogus se retrouve ensuite dans des versions ultérieures du Speculum Maius, avec trois ou quatre parties, incluant la « version Vienne » (Hc). Un manuscrit de cette version, à Berlin (SBB-PK, lat. fol. 75-85), montre l'intégration autonome du Dialogus (28 chapitres) au sein du livre XXV, entre deux sections existantes. L'ajout du Dialogus témoigne d'une adaptation progressive du Speculum Historiale, en lien avec l’évolution du contexte idéologique et politique de l’époque.
3. Transformations textuelles et choix éditoriaux de Vincent de Beauvais
La version du Dialogus dans le Speculum Historiale présente des différences importantes avec le texte original. Vincent de Beauvais ou son équipe a considérablement remanié le texte. L'ordre des mots est perturbé, la structure dialoguée est modifiée pour devenir un monologue adressé aux Juifs. Les noms des interlocuteurs (Moïse et Petrus) disparaissent, et les interventions de Petrus sont adaptées pour s’adresser directement à un public juif généralisé. Les arguments philosophiques et scientifiques, pourtant fondamentaux dans le Dialogus original, sont grandement réduits. Par exemple, les preuves de la création et de la Trinité fondées sur la science aristotélicienne sont absentes de la version de Vincent de Beauvais. Même la structure en chapitres est modifiée, certains chapitres du Speculum Historiale coupant au milieu des répliques de l'œuvre originale. Cette transformation ne correspond pas à la méthode habituelle de compilation et d'abréviation employée par Vincent de Beauvais pour d'autres parties du Speculum Maius. L'hypothèse est avancée que Vincent de Beauvais a utilisé une copie déjà modifiée du Dialogus, potentiellement fournie par un acteur de la Grande Controverse de 1240.
V.Analyse textuelle de la version du Dialogus dans le Speculum Historiale
L'analyse montre que la version du Dialogus dans le Speculum Historiale est une rédaction spécifique, différant significativement du texte original de Petrus Alfonsi. Vincent de Beauvais modifie l'ordre des mots, la structure en chapitres, et même la personne des verbes, transformant le dialogue en monologue. Cette réécriture, qui simplifie les arguments philosophiques et scientifiques, sert un objectif polémique et missionnaire, plutôt qu'une transmission fidèle du texte original. L'étude stemmatique suggère une possible origine cistercienne, en Espagne, pour le manuscrit utilisé par Vincent de Beauvais, différent des manuscrits bénédictins du nord de la France et de Belgique.
1. La version du Dialogus dans le Speculum Historiale une rédaction spécifique
L’analyse textuelle révèle que la version du Dialogus intégrée au Speculum Historiale par Vincent de Beauvais diffère considérablement du texte original de Petrus Alfonsi. Il ne s’agit pas d’un simple abrégé, mais d’une rédaction autonome présentant des modifications significatives. John Tolan a déjà pointé plusieurs divergences. Au-delà des différences de formulation et de l'ordre des mots, la structure même du Dialogus a disparu. Le texte a été découpé en chapitres calibrés de longueur approximativement égale, parfois interrompant ou complétant des répliques au milieu. Le dialogue initial s'est transformé en monologue adressé à un interlocuteur muet, représentant l’ensemble des Juifs, atténuant fortement l'aspect dialectique. Les noms des interlocuteurs ont disparu, et les appréciations de Petrus sur les arguments de Moïse ont été effacées ou généralisées. La personne des verbes et les pronoms ont été modifiés pour rendre le texte plus impersonnel et moins interactif. Des ajouts spécifiques à la forme du monologue ont même été introduits. Cette version du Dialogus dans le Speculum Historiale doit donc être considérée comme une œuvre à part entière, et non comme une simple extraction du texte original.
2. Analyse comparée et stemmatique des manuscrits
L’étude compare la version de Vincent de Beauvais à différents manuscrits du Dialogus, afin d’identifier l'exemplaire utilisé. Contrairement aux attentes, le texte de Vincent de Beauvais s'avère moins proche des manuscrits du nord de la France et de la Belgique que prévu. L'analyse stemmatique, facilitée par les travaux de Monique Paulmier-Foucart et Carmen Cardelle de Hartmann, révèle des variantes caractéristiques du groupe c1a, incluant des manuscrits hispaniques, ce qui suggère une origine inattendue. L'étude du manuscrit Ta de l'abbaye cistercienne de Santes Creus (Tarragona), antérieur dans le stemma aux manuscrits espagnols du sous-groupe c1a-1, confirme une variante spécifique au titulus V, également présente chez Vincent de Beauvais. Cette variante concernant les pratiques de purification musulmanes renforce l’hypothèse d’une ascendance cistercienne espagnole. Malgré l’examen de manuscrits picards, belges et de Saint-Victor, aucune filiation directe n’a pu être établie, confirmant le caractère unique de la version de Vincent de Beauvais. L’étude de manuscrits apparentés, tels que ceux de Pontigny ou d'Alcobaça, est également évoquée pour une meilleure compréhension de l’origine de ce texte.
3. Conclusion une réécriture pour un contexte particulier
L'analyse souligne que la version du Dialogus dans le Speculum Historiale n’est pas un simple abrégé mais une réécriture significative. Les modifications dépassent largement celles attendues pour un simple florilège, altérant la structure, le style, et même le sens du texte original. La comparaison avec le Dialogus dans sa version la plus répandue (plus de 70 manuscrits complets) révèle une distance importante, soulignant le caractère unique de la version de Vincent de Beauvais. L'intégration du Dialogus, entre 1244 et 1254, probablement dans les années 1240, au sein d'une version bifaria du Speculum Maius, avant sa révision trifaria, suggère un ajout volontaire, probablement sur commande dominicaine et sous l’influence royale. La version de Vincent de Beauvais, différente de celle du texte original, possède sa propre tradition manuscrite, confirmant son importance dans la diffusion de la polémique anti-juive du XIIIe siècle. L'hypothèse d'une copie déjà adaptée du Dialogus, provenant directement d'un acteur de la Grande Controverse, est avancée pour expliquer la nature des modifications textuelles.
