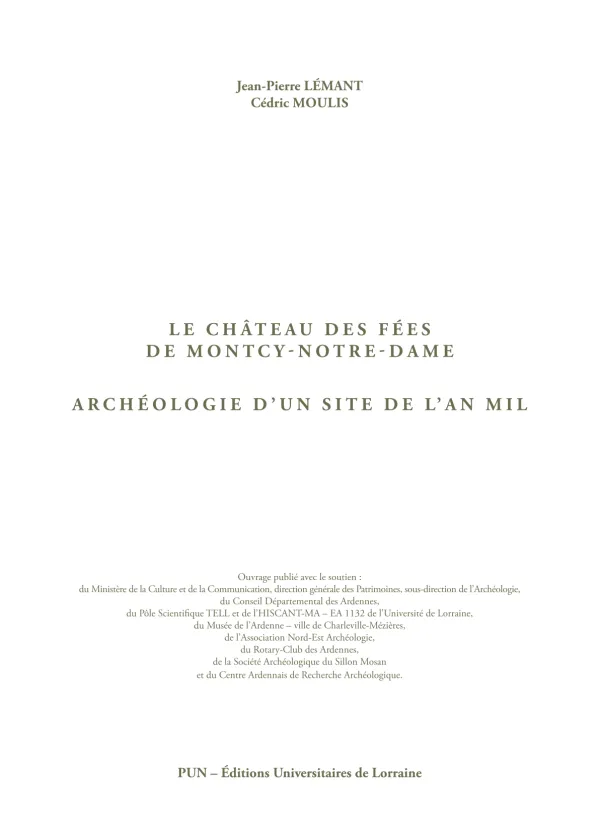
Étude Archéologique du Château des Fées de Montcy-Notre-Dame
Informations sur le document
| Auteur | Jean-Pierre Lémant |
| École | Université de Lorraine |
| Spécialité | Archéologie |
| Année de publication | 1988-1992 (fouilles), année de publication non spécifiée |
| Lieu | Ville de publication non spécifiée |
| Type de document | Ouvrage |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 64.49 MB |
- archéologie
- patrimoine
- fouilles
Résumé
I.Le Château des Fées de Montcy Notre Dame Une Exploration Archéologique
Ce rapport présente les résultats d'une fouille archéologique majeure au Château des Fées, situé à Montcy-Notre-Dame sur la rive gauche de la Meuse. L'étude se concentre sur la compréhension de l'occupation du site, depuis la période gallo-romaine jusqu'au Moyen Âge. Des vestiges importants, tels qu'un murus gallicus et une enceinte du XIIIe-XIVe siècle, témoignent d'une histoire riche. Des éléments architecturaux, dont une aula (salle principale) et des bâtiments annexes, ont été mis au jour, permettant de reconstituer l'organisation du château médiéval. L’analyse stratigraphique et la découverte de mobilier (céramique, métal, etc.) sont cruciales pour la datation et l'interprétation du site. L'implication de figures clés comme Robert Bucheler (maire) et le docteur Gérard Fleury a été essentielle à la réalisation de cette recherche archéologique, ainsi que la Société Archéologique du Sillon Mosan.
1. Contexte de la Recherche et Découverte Initiale
L'objectif principal était d'étudier plusieurs sites fortifiés le long de la Meuse, afin de les présenter comme des ponts entre le passé et le futur. Le premier site exploré par l'équipe de Jean-Pierre Lémant fut le Mont-Vireux à Vireux-Molhain. L'étude commença par une fouille de sauvetage d'un cimetière des IVe-Ve siècles. Une habitation fut rapidement identifiée au sommet du mont, en connexion avec les sépultures. Entre 1980 et 1992, des fouilles successives ont permis la découverte de deux enceintes : un murus gallicus de la période du Bas-Empire et une enceinte maçonnée de la fin du XIIIe-début du XIVe siècle. Des bâtiments à fonction religieuse se sont succédés sur la partie sommitale nord, allant d'un temple possiblement dédié à Jupiter à une chapelle (VIIe-XIe siècle). En 1988, la commune de Montcy-Notre-Dame, sous l'impulsion du maire Robert Bucheler et de son adjoint, le docteur Gérard Fleury, a racheté le site, initiant une campagne de fouilles et un projet de mise en valeur du patrimoine (château, chemin de croix, grotte à la Vierge, jardin romantique et carrière aménagée en amphithéâtre).
2. Méthodologie de la Fouille et Relevés Topographiques
Des prospections ont été menées sur les pentes pour récupérer le mobilier dispersé par les rejets et l'exploitation de la carrière. La DRAC Champagne-Ardenne a délivré l'autorisation de fouilles en 1988. Les premières campagnes se sont concentrées sur les côtés sud-ouest et nord-ouest, plus fragilisés par l'érosion. L'intérieur de l'aula a été fouillé par coupes successives pour étudier les différentes strates. Le secteur sud-est et la motte orientale ont également fait l'objet de fouilles, révélant des murs en pierres sèches aménagés pour contenir la terre et les pierres constitutives de la motte, suggérant une construction planifiée. Un relevé topographique, initié dès 1990 par le cabinet Vannier pour le compte de la Société Archéologique du Sillon Mosan, a permis une localisation précise des vestiges, mais nécessitait des compléments pour une meilleure compréhension du contexte géographique et des microreliefs. Des techniques de descente en rappel ont été utilisées sur les parois schisteuses de la carrière pour obtenir un plan plus précis.
3. Analyse Stratigraphique et Mobilier Découvert
La stratigraphie du site est relativement simple, avec une couche d'humus recouvrant des remblais de terre et de pierres provenant de la carrière ou de l'effondrement des maçonneries. Les couches varient selon les endroits. Une couche cendreuse noire, d'épaisseur variable (5 à 85 cm), a été trouvée sur la surface de l’aula, contenant un mobilier abondant : restes carpologiques, faune, céramique (pâtes noire et claire), métal (clous, clés, couteaux) et verre plat. La stratigraphie du mur nord-est de la pièce a été perturbée par une tranchée. A l’extérieur, sur les pentes, une couche d’humus recouvrait un remblai avec du mobilier médiéval (céramique à pâte noire et grise, carreaux d'arbalète, faune), sous lequel une strate noire issue d'un incendie contenait également divers objets. Des travaux de canalisation en 2006 ont mis au jour des fondations de caves gallo-romaines incendiées vers la fin du IIIe siècle, confirmant une présence plus ancienne. Sur le site même, des tessons de céramique sigillée et des fragments de tegulae gallo-romaines ont été découverts. Une tête de lion en calcaire, ainsi que des éléments de remploi romain (pierres, meule), ont aussi été exhumés, attestant d'une présence gallo-romaine, même si modeste.
II.Vestiges Gallo Romains et Occupations Précédentes
Des découvertes gallo-romaines, incluant des fondations de caves et des tessons de céramique sigillée, confirment une occupation antérieure au château médiéval. La présence de matériaux de remploi dans les constructions médiévales souligne la continuité de l'occupation du site. Des prospections ont également révélé des traces d’occupation préhistorique.
1. Vestiges Gallo Romains Présence et Nature de l Occupation
L'étude a révélé des indices significatifs d'une occupation gallo-romaine antérieure à la construction du château médiéval. Des travaux de canalisation effectués en octobre 2006 près du château ont permis la découverte de fondations de caves gallo-romaines, vraisemblablement détruites à la fin du IIIe siècle. Le mobilier retrouvé et le contexte général des boucles mosanes, marqués par une crise politique entraînant de nombreuses destructions, confirment cette datation. Parallèlement, un gobelet en terre sigillée du IIe siècle a été découvert dans la Meuse par dragage au niveau du barrage sous le château. Plus directement sur le site, la fouille a mis au jour des tessons de céramique sigillée du Haut et du Bas-Empire, ainsi que deux fragments de tegulae de pâtes différentes, disposés sur le rocher ou dans des trous de poteaux. Une tête de lion de 31 cm de haut, sculptée dans du calcaire blanc, a été exhumée d'une citerne au centre de l'aula. L'analyse de la latrine a révélé deux pierres calcaires romaines en remploi, dont une avec une mortaise pour agrafe. Un fragment de meule à main romaine a également été retrouvé. Bien que ces découvertes ne permettent pas de déterminer l'ampleur du peuplement gallo-romain, elles confirment néanmoins une présence, même modeste, sur l'éperon rocheux avant l'édification du château.
2. Occupations Préhistoriques et Traces d Occupation Avant le Château
Le site n'était pas vierge avant l'implantation du château médiéval. Des prospections sur le plateau ont révélé la présence d'éclats de taille en silex dispersés dans les pentes de la motte, témoignant d'une occupation au moins sporadique à l'époque préhistorique. Cette découverte suggère une occupation humaine du site bien avant la période gallo-romaine, et même avant la construction du château. Un autre indice de cette occupation antérieure au château est la découverte d'un potin rème au guerrier courant dans les talus du chemin de croix. Ces éléments matériels suggèrent une occupation ancienne et variée du site. Il est donc clair que le site du Château des Fées a connu une longue histoire d'occupation humaine bien avant la construction du château médiéval, couvrant un large spectre chronologique.
III.L Aula et les Bâtiments en Pierre du Château des Fées
L'analyse de l' aula, la salle principale du château, met en lumière une construction en pierre, probablement sur plusieurs niveaux. La technique de construction, avec l'utilisation de grès et de schistes et la disposition des pierres en épi, est caractéristique de l'architecture médiévale de la région des Ardennes. L'étude de la stratigraphie a révélé des phases constructives successives et des traces d'un incendie. Des pièces annexes, dont une possible tour-latrine, complètent le complexe architectural.
1. L Aula Structure Matériaux et Construction
L' aula, salle principale du château, est un élément central de l'étude. Son périmètre a été mis en évidence par les fouilles, son intérieur étant exploré par coupes successives pour observer les strates. Les murs de l'aula sont construits en grès et en schistes gris, avec des inclusions de quartz. Les pierres sont grossièrement assises, avec un module moyen de 20x15cm, bien que des variations de taille soient observées. L'horizontalité parfaite n'était pas recherchée, les pierres s'adaptant à l'assise précédente. L'utilisation de pierres posées de biais, en épi, est fréquente et comparable aux techniques employées sur d'autres sites du massif ardennais. Deux fragments de meules retaillées et insérés dans la maçonnerie témoignent de techniques de construction spécifiques. L'aula présentait probablement deux niveaux, la salle principale étant à l'étage (19,68m x 10,36m, soit 212m² au sol). Des traces d'enduit sur les murs intérieurs ont été observées, mais celui-ci a disparu rapidement après la fouille. Une gaine verticale dans l'angle nord, possible négatif d'une poutre verticale servant d'élément de rigidification, a également été identifiée, une technique peu commune pour les armatures en bois. La présence de cavités dans le socle schisteux pourrait correspondre à des emplacements de perches d'échafaudage, mais leur disposition ne corrobore pas totalement cette hypothèse.
2. Pièces Annexes et Fonctionnalités du Bâtiment
L'aula est flanquée de trois pièces annexes. La pièce B est la plus grande (4,20m x 2,80m, soit 11,8m²), avec des murs épais (1,22 à 1,36m) conservés sur 1,15m de hauteur. La pièce C est plus petite (1,95m x 1,15m, soit 2,2m²) et ses murs moins homogènes (1 à 1,25m d'épaisseur), conservés jusqu'à 1,60m de hauteur à l'extérieur. Ces pièces semblent construites en même temps. Elles sont principalement construites en grès et schiste, mais contiennent également du calcaire, qui pourrait provenir de Saint-Marcel. L’appareil de la pièce C est moins oblong que sur les autres pièces et rarement disposé en épi, son module standard étant plus petit (15x6cm), ce qui pourrait évoquer des matériaux de remploi gallo-romains, bien que cela ne puisse être prouvé. La pièce C, compte tenu de sa petitesse, est interprétée comme une possible tour-latrine à fosse, comparable à des exemples trouvés en Allemagne, France et Suisse. Des enduits étaient présents sur les élévations extérieures et intérieures de ces pièces, jouant un rôle protecteur et ostentatoire. Une datation au carbone 14, utilisant du charbon de bois du mortier, place leur construction entre 913 et 970 (courbe Sigma 1, 82% de probabilité), dans la même fourchette que l'édification de l'aula. L’emplacement excentré de ces pièces, à une altitude inférieure de 25m à la plateforme principale, soulève la question de leur fonction exacte, et leur lien avec le Château des Fées.
IV.Chronologie et Disparition du Château des Fées
La datation par le carbone 14, combinée à l'analyse du mobilier archéologique, permet de proposer une chronologie pour le château. La destruction du site par le feu est attestée, mais sa date précise reste à affiner. La mention du palatium de Munceio en 1114 dans les sources écrites pourrait faire référence au Château des Fées, soulignant la question de sa disparition après cette date. Des remblais postérieurs suggèrent un réaménagement du site, peut-être à vocation militaire, au XVIIe-XVIIIe siècle.
1. Datation et Chronologie du Château
La chronologie du Château des Fées est établie à partir de plusieurs sources. Une datation radiocarbone effectuée sur du charbon de bois contenu dans le mortier des murs des pièces annexes donne une fourchette de 913-970 (courbe Sigma 1 à 82% de probabilité). Cette datation est cohérente avec la période d'édification de l'aula. La comparaison avec le site du Tchesté de la Rotche à Sugny (Belgique), qui présente une évolution similaire d'une structure en bois à une construction en pierre, appuie cette chronologie. Cependant, la datation du bâtiment en bois reste incertaine, bien qu'un événement historique en 894 (Francon, évêque de Tongres-Maastricht-Liège, obtient la restitution de biens à Arches) puisse être lié à son apparition. L'étude des dimensions de l'aula permet également des comparaisons avec d'autres sites, attestant de la présence de l'aula au moins dès le Xe siècle, ce qui concorde avec la datation du Château des Fées. Malgré des éléments incertains, la chronologie du Château des Fées est donc en grande partie définie.
2. La Disparition du Château Éléments et Hypothèses
La fouille a révélé une couche d'incendie sur l'ensemble du site. Une datation au radiocarbone sur une céréale calcinée provenant de cette couche donne une fourchette de 1034-1208, démontrant que cet incendie n'est pas contemporain de l'éventuelle intervention de l'évêque de Liège en 933. Le site a donc survécu à une première destruction. La disparition du Château des Fées est un événement mal connu. Seule une mention écrite de 1114, où le comte de Namur donne le palatium de Munceio à l'abbaye Saint-Nicaise de Reims, pourrait faire référence au Château des Fées. L'évolution de la sémantique du terme palatium, passant d'une référence royale ou pontificale à un usage aristocratique épiscopal et princier à partir du milieu du XIe siècle, rend cette association plausible. Si le site était encore fonctionnel en 1114, sa disparition définitive a dû se produire peu de temps après. La stratigraphie des remblais, avec des couches régulières, suggère un remblaiement volontaire, probablement à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle, lorsque le site aurait été brièvement réaménagé en poste militaire, servant de point d'observation sur la Meuse. La présence de balles en plomb, de boutons au nom de Louis XV, et d'une monnaie de 1791-1793 sur la motte corroborent cette hypothèse.
