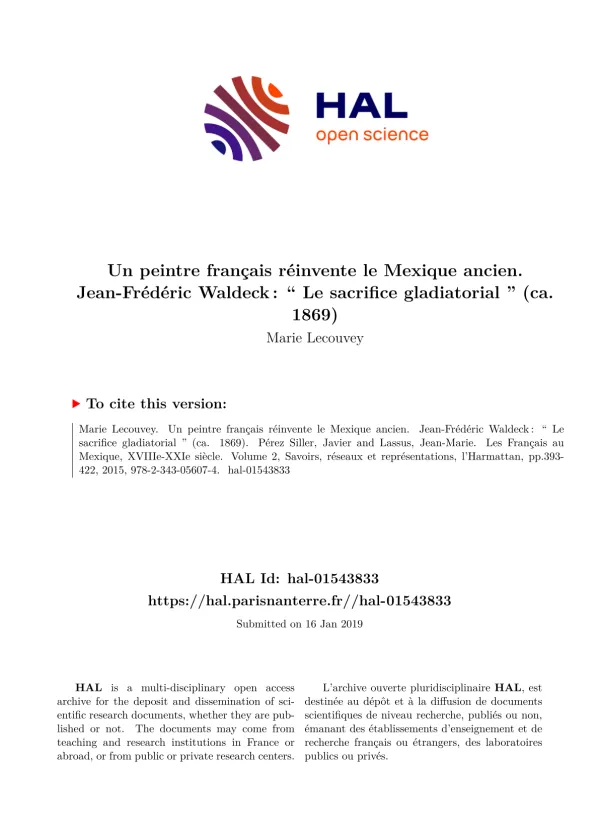
La Réinvention du Mexique Ancien par Jean-Frédéric Waldeck
Informations sur le document
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 4.01 MB |
- Jean-Frédéric Waldeck
- art préhispanique
- représentation culturelle
Résumé
I.L œuvre atypique de Jean Frédéric Waldeck une reconstitution du sacrifice gladiatoire aztèque
Cet article explore le tableau de Jean-Frédéric Waldeck, exposé à Paris en 1869, représentant un sacrifice gladiatoire aztèque. Ce tableau d’histoire, montrant des figures clés comme Moctezuma II et Cuauhtémoc, vise à la fois à instruire et à divertir le spectateur. L’étude pose la question de la notion de « nationalisme » dans la représentation artistique, comparant l’œuvre de Waldeck à celles d’artistes mexicains de la même période (1851-fin du siècle) qui ressuscitent le passé préhispanique. Des artistes comme Manuel Vilar et Adrián Unzueta sont mentionnés, soulignant la diversité des approches artistiques malgré une thématique commune : l'art préhispanique mexicain et l'interprétation de l'identité mexicaine.
1. Description du tableau et son contexte
Le tableau de Jean-Frédéric Waldeck, exposé à Paris en 1869, présente une reconstitution d'un sacrifice gladiatoire aztèque, centré sur le personnage de Tlahuicole. Cette peinture d'histoire, qualifiée de « didactique », inclut des figures importantes de l'histoire aztèque, comme Moctezuma II et Cuauhtémoc. L'artiste lui-même affirme que son œuvre est unique en son genre, représentant les coutumes mexicaines avant la conquête espagnole. Cette affirmation souligne l'importance de l'œuvre en tant que document historique et artistique unique. Le tableau est analysé dans un contexte plus large, celui de la production artistique mexicaine de la seconde moitié du XIXe siècle, soulignant les liens entre l’œuvre de Waldeck et la résurgence de l’intérêt pour le passé préhispanique au Mexique. L’étude soulève la question de l'expression du nationalisme dans l'art : est-il plus « national » de peindre des Aztèques que des paysans italiens ? La comparaison met en évidence la multiplicité des regards et des tendances au sein d'une même institution artistique et autour d'une thématique commune, illustrée par les différences entre les artistes Waldeck et Unzueta, par exemple.
2. Comparaison avec l art mexicain et la notion d art national
L'étude met en perspective le tableau de Waldeck avec les productions d’artistes mexicains entre 1851 et la fin du siècle, tous explorant le passé préhispanique. L’analyse se concentre sur les similarités formelles et conceptuelles, sans parler d'influence directe étant donné que Waldeck ne retourne pas au Mexique après 1836. On observe un parallèle entre l’œuvre de Waldeck et les créations de plusieurs générations d’artistes de l’Académie de San Carlos, dont Manuel Vilar et Adrián Unzueta. Cette comparaison, entre œuvres produites et exposées dans des contextes différents, permet de mieux comprendre les diverses interprétations de l’histoire préhispanique et du concept d’« art national ». L'étude explore les ambiguïtés et les contradictions, tant dans le regard de Waldeck que dans les représentations contemporaines et postérieures, sans pour autant le considérer comme un précurseur. Les similitudes formelles et conceptuelles sont liées à la complexité de l’identité des élites mexicaines et à la formation des artistes mexicains fortement influencés par l’Europe.
3. Analyse stylistique et interprétative du tableau
L’œuvre de Waldeck est analysée à travers le prisme de la peinture d’histoire, mais aussi de son aspect didactique. L'artiste utilise des références précises à des figures historiques et des événements importants du Mexique précolombien, tels que le sacrifice gladiatoire et les personnalités de Moctezuma II et Cuauhtémoc. Le tableau, tout en possédant une dimension descriptive et informative (éléments archéologiques), permet également à Waldeck d’exprimer ses convictions politiques et morales. L'étude détaille les descriptions dans la brochure accompagnant l'œuvre, révélant les intentions de l'artiste, entre rigueur historique et interprétation subjective. La comparaison avec d'autres œuvres, notamment celles de Manuel Vilar (dont la sculpture de Tlahuicole), permet de mettre en évidence les similitudes et différences stylistiques, ici le néoclassicisme, mais aussi les interprétations divergentes de la même scène ou des mêmes personnages. Le choix d’un casque d’or pour Tlahuicole, par exemple, est analysé comme un artifice esthétique reliant la scène à l’Antiquité gréco-romaine, plus qu’à l'authenticité préhispanique.
II.Le séjour mexicain de Waldeck et ses implications artistiques
Le séjour de Jean-Frédéric Waldeck au Mexique (1825-1836) a été déterminant pour sa production artistique. Lithographe et collectionneur d’objets archéologiques, il a participé à la publication de la Colección de las antiguedades mexicanas, collaborant avec l'imprimeur Pierre Robert. Son expédition à Palenque (1832-1834), soutenue par Lucas Alamán, a fourni une connaissance de terrain considérable qui a influencé son œuvre ultérieure. Son Voyage pittoresque et archéologique dans la province d’Yucatan témoigne de cette période. Son attitude parfois ambiguë vis-à-vis des objets archéologiques, relatée dans des articles du Fénix de la Libertad et de la Revista Mexicana, a suscité des critiques au Mexique.
1. Formation artistique et débuts au Mexique
L'analyse du séjour mexicain de Jean-Frédéric Waldeck commence par souligner ses compétences artistiques acquises en France avant la Révolution, notamment en peinture et en lithographie. Arrivé au Mexique en 1825, il devient rapidement collectionneur d'objets archéologiques, dessinant sa collection et celles de ses amis européens. Dès 1827, son expertise est sollicitée : il collabore avec l'imprimeur Pierre Robert à Mexico à la création de la Colección de las antiguedades mexicanas, première publication illustrée du Musée national du Mexique. Cette collaboration, commandée par I. Icaza et I. Gondra (directeurs du Musée National et de son département d'archéologie), le familiarise avec les objets du musée et les dessins des expéditions archéologiques espagnoles du début du XIXe siècle. L'importance de cette expérience pour sa future carrière artistique est soulignée. Son implication dans ce projet est un élément clé de son immersion dans le monde de l’archéologie mexicaine, le préparant pour ses travaux futurs et pour devenir une figure influente de l’américanisme.
2. L expédition à Palenque et sa publication
L'expédition de Waldeck à Palenque (1832-1834), soutenue par Lucas Alamán, marque un tournant dans sa carrière. Il réalise des relevés, des fouilles, et des copies minutieuses des bas-reliefs, démontrant une approche méticuleuse et une expertise croissante. L'expérience sur ce site Maya crucial est présentée comme un point central de son expertise en archéologie. Son séjour à Palenque ne se limite pas à l'aspect scientifique ; il inclut une immersion dans le village puis sur le site lui-même. Il publie par la suite Voyage pittoresque et archéologique dans la province d’Yucatan, fruit direct de ses recherches et de ses observations, illustrant la diversité de ses compétences, tant dans le domaine archéologique que dans la description des coutumes locales. La publication de son ouvrage et l'obtention d'une médaille de la Société de Géographie témoignent de la reconnaissance de son travail. Cependant, l'extrait du Fénix de la Libertad (1833) révèle des critiques sur son comportement concernant l'appropriation d'objets archéologiques, soulignant l’ambiguïté de sa position vis-à-vis du patrimoine mexicain.
3. Réception de son travail et implication dans le milieu scientifique
Le texte souligne la réception mitigée du travail de Waldeck au Mexique. Si ses lithographies sont comparées aux dessins de Castañeda, certaines publications mexicaines critiquent son approche, notamment son attitude ambiguë envers les objets archéologiques. Des extraits du Fénix de la Libertad (1833) et de la Revista Mexicana (1835) illustrent ces critiques contradictoires: accusations de pillage et reconnaissance de ses contributions scientifiques. Le document détaille sa présence dans des instances scientifiques françaises comme les Actes de la Société d’Ethnographie (1865), où il présente un article sur Palenque et une expédition à Teotihuacan. Son engagement dans le milieu scientifique français est démontré par la publication, en 1866, des Monuments anciens du Mexique (Abbé Brasseur de Bourbourg), pour lesquels Waldeck a rédigé les explications des planches. Ces explications vont au-delà de simples descriptions, témoignant de ses analyses et interprétations des éléments archéologiques et mayas. Son expérience au Mexique, consolidée par ses publications, lui permet de s’établir comme une figure majeure de l’américanisme.
III.Waldeck et l art mexicain comparaisons et divergences
L’étude compare le tableau de Waldeck à des œuvres d’artistes mexicains de l’Académie de San Carlos. Malgré l’absence d’influence directe, des similitudes formelles et conceptuelles existent. L’utilisation du néoclassicisme, l’insertion d’éléments archéologiques exotiques (comme le casque de Tlahuicole), et la volonté de créer une atmosphère du passé préhispanique sont des points communs. Cependant, les contextes de production et les intentions artistiques diffèrent. Les critiques de l’époque, concernant des œuvres de Félix Parra ( Fray Bartolomé de Las Casas) et d'autres, sont analysées afin de mettre en lumière la perception du passé préhispanique au Mexique.
1. Similitudes et différences stylistiques avec l art mexicain
L’analyse compare l’œuvre de Jean-Frédéric Waldeck à celle des artistes mexicains de la seconde moitié du XIXe siècle, notamment ceux de l’Académie de San Carlos. Bien qu'il n'y ait pas d'influence directe (Waldeck ne retourne pas au Mexique après 1836, et son œuvre ne semble pas avoir eu d'écho critique au Mexique), des similitudes formelles et conceptuelles sont identifiées. Le néoclassicisme, le recours à l’exotisme archéologique (avec une utilisation d'éléments préhispaniques, parfois inexacts d’un point de vue scientifique), et la volonté de créer une atmosphère évoquant le passé préhispanique sont mis en avant. Cependant, les contextes de production et de réception de son art diffèrent sensiblement de ceux des artistes mexicains. L'utilisation d'éléments archéologiques exotiques, comme le casque de Tlahuicole, est comparée. Le document souligne également des différences: tandis que Waldeck, à distance du Mexique, conserve un style classique dans la représentation de ses personnages, les artistes mexicains adoptent parfois des approches différentes. L'étude note l'absence de traits morphologiques indigènes distinctifs chez Waldeck, contrastant avec certaines œuvres mexicaines.
2. L interprétation du passé préhispanique regards multiples
La comparaison des œuvres met en lumière la pluralité des interprétations du passé préhispanique au Mexique. L'étude analyse la manière dont les artistes mexicains, formés à l’Académie de San Carlos (avec l’Europe comme seul référent), représentent cette période. L'approche de Waldeck, qui n'est pas un artiste mexicain, est comparée, soulignant les similarités et les différences. Les artistes mexicains, souvent d'origine créole et appartenant aux élites, séparent souvent les Indiens du passé de ceux du présent. L’étude mentionne des exemples de critiques d'époque sur des tableaux de Manuel Vilar et Félix Parra, soulignant les exigences des critiques quant aux signes distinctifs du passé, tout en tolérant l’inexactitude scientifique. L'étude compare le traitement du personnage de Tlahuicole par Waldeck et par Vilar, soulignant des divergences stylistiques et interprétatives. La question de l'utilisation du passé préhispanique dans la construction d'un « art national » est centrale.
3. Analyse comparative avec des artistes mexicains spécifiques
L'analyse approfondie compare l’œuvre de Waldeck à des exemples spécifiques d'art mexicain. L’étude cite Rodrigo Gutiérrez, dont les œuvres incluent un traitement similaire des sculptures colossales, inspirées d'objets de céramiques à plus grande échelle. De même, l'inclusion de fresques copiées de codex est un point commun. Cependant, des divergences significatives sont mises en lumière à travers la comparaison avec Félix Parra, dont le tableau Fray Bartolomé de Las Casas utilise une approche très différente pour représenter la Conquête, plus réaliste et axée sur la souffrance des populations indigènes. Cette comparaison souligne les différentes perspectives artistiques et les intentions distinctes des artistes. La différence de générations entre Waldeck et les artistes mexicains de la fin du siècle est également mise en évidence, avec des styles artistiques et des sensibilités distinctes. Même si Waldeck, dans son Voyage pittoresque, critique les colonisateurs, sa cible diffère de celle de Parra, ce qui met en évidence les nuances dans l'approche de l'histoire coloniale et de ses conséquences.
IV.Les choix artistiques et leurs implications politiques
Le choix de Waldeck de représenter un épisode de l’histoire aztèque, et non maya, est questionné. Son tableau, malgré son aspect didactique, véhicule des opinions politiques et des considérations anthropologiques. L'interprétation de Tlahuicole comme un « fier républicain » révèle l'idéologie de Waldeck. L’étude examine comment le choix des sujets, comme les Tlaxcaltèques, et la représentation du passé préhispanique, sont liés à la construction d’une identité nationale et aux idéaux politiques de l’époque (libéralisme, républicanisme). Les œuvres de Rodrigo Gutiérrez (Sénat de Tlaxcala) sont mentionnées comme exemples complémentaires.
1. Le choix des Aztèques et son interprétation politique
Le choix de Waldeck de représenter une scène aztèque, et non maya (malgré sa connaissance approfondie de Palenque), est analysé à la lumière des implications politiques. Le document soulève la question de savoir pourquoi, connaissant si bien le monde maya, il n’a pas choisi Palenque comme décor. L’hypothèse est qu’il a privilégié un sujet plus connu, particulièrement après l’intervention française au Mexique: le centre du pouvoir politique de son temps. Ce choix rejoint celui des artistes mexicains, qui représentent majoritairement les peuples du centre du pays. L’exception de Guilena, une princesse tarasque peinte en 1863, est mentionnée. Cette tendance, également visible dans la section mexicaine de l’Exposition de Madrid (avec les aquarelles de Velasco et la maquette de la pyramide d’El Tajín), est interprétée comme une stratégie pour plaire au pouvoir central, renforçant sa légitimité par l'évocation d'un héritage historique spécifique. L'impasse sur d'autres peuples préhispaniques, sauf pour des raisons scientifiques et pour un public étranger, crée l’image d’un pouvoir de Mexico imposé dès les origines de la nation.
2. Les valeurs libérales et la représentation des Tlaxcaltèques
L’analyse porte sur l’utilisation des Tlaxcaltèques dans les représentations artistiques, et leur implication politique. Le tableau de Waldeck, ainsi que des œuvres ultérieures de Rodrigo Gutiérrez, représentent des Tlaxcaltèques comme des figures emblématiques de valeurs libérales. Waldeck, par exemple, qualifie explicitement Tlahuicole de « fier républicain », soulignant ainsi ses convictions politiques. Le document compare cette approche avec celle de Manuel Vilar, qui, en 1851, représente Tlahuicole sans mettre en avant son aspect républicain, s'inscrivant davantage dans un moule conservateur. L'utilisation du terme « Sénat de Tlaxcala », repris au XIXe siècle dans un sens moderne associé à la démocratie et au libéralisme, est analysée comme un indice de l'influence politique sur la représentation artistique. Le contexte politique de la création du tableau de Waldeck, sous le règne de Napoléon III, et la publication tardive de la brochure explicative (1874), sont pris en compte pour comprendre l’affirmation des convictions républicaines de Waldeck.
3. Comparaison avec d autres œuvres et conclusions sur les choix artistiques
L’analyse continue en comparant les choix artistiques et leurs implications politiques avec d'autres œuvres. L’œuvre de Félix Parra, Le massacre de Cholula, est comparée à celle de Waldeck, soulignant les différences significatives dans le traitement du sujet, malgré certaines similitudes formelles. Chez Parra, la souffrance des Indiens est mise en avant, dans un but de galvaniser les Mexicains contre les impérialismes, à l'inverse de l’approche de Waldeck. Le document examine le rôle des élites mexicaines dans la « capture » du passé préhispanique, utilisé pour construire une identité nationale et légitimer le pouvoir central. L’étude souligne comment le choix de représenter des scènes et des personnages spécifiques, comme ceux du centre du Mexique, répond à des préoccupations politiques et esthétiques, reflétant les aspirations et les idéaux de l’époque, notamment le libéralisme et le républicanisme. L’acquisition de certaines peintures, comme La fondation de Mexico de Luis Coto par Maximilien, est mentionnée comme preuve de l’influence du pouvoir politique sur le choix des sujets artistiques.
V.Le regard ambigu sur les populations indigènes
Waldeck, tout en valorisant certains aspects de la culture préhispanique, exprime un regard ambigu sur les populations indigènes de son temps. Il souligne à la fois leurs qualités et leurs défauts, critiquant implicitement les gouvernements mexicains pour leur traitement des Indiens. Son œuvre révèle une complexité dans la représentation du passé et du présent, mettant en lumière les préjugés et les stéréotypes de l'époque. L’analyse prend en compte des références à des artistes comme Petronilo Monroy (Le sacrifice d’une princesse acolhua) pour illustrer la diversité des points de vue sur l'histoire et le sort des populations autochtones.
1. Le regard de Waldeck sur les Indiens entre admiration et critique
L’analyse du texte met en lumière le regard complexe et parfois contradictoire de Waldeck sur les populations indigènes du Mexique. Bien qu’il ne permette pas aux Mexicains de s’enorgueillir d’une culture entièrement autochtone, il ne justifie pas non plus leur situation de subordination. Dans la brochure accompagnant son tableau de 1869, il défend les Indiens, critiquant indirectement les gouvernements mexicains. Il consacre des pages à l’« anthropologie des races d’Amérique centrale », faisant l’éloge de la « nation chole », qu'il décrit comme étant initialement blanche. Il souligne ensuite les qualités physiques et intellectuelles des Indiens, mentionnant par exemple un élève indien qui excellait en dessin et en langues, et un artiste indien nommé Patiño, d’un talent exceptionnel, non reconnu par les gouvernements mexicains successifs. Ce passage met en évidence une admiration pour certaines compétences des Indiens, tout en critiquant le manque de reconnaissance de leur talent par les autorités.
2. Comparaisons et contrastes l exemple de Petronilo Monroy
L'analyse du texte compare le point de vue de Waldeck sur les populations indigènes à celui d'autres artistes. Il est mentionné que Waldeck, dans ses écrits, attaque les gouvernements mexicains pour leur mauvais traitement des Indiens, soulignant l'injustice de leur situation. L’œuvre de Petronilo Monroy, El sacrificio de una princesa acolhua, est présenté comme un exemple complémentaire. Ce tableau, jamais exposé, représente le sacrifice d’une princesse et la réaction horrifiée de son père, ce qui laisse supposer un jugement moral négatif sur la pratique du sacrifice. La comparaison entre les deux œuvres met en lumière des approches différentes sur le même sujet : tandis que Waldeck exprime une opinion mitigée, mêlant admiration et critique, Monroy, par le choix de sa composition et de son style sombre, exprime une condamnation implicite des rites préhispaniques. L’étude met donc en évidence la complexité et la diversité des interprétations des populations indigènes dans l’art mexicain.
3. Le regard de Waldeck et la complexité de la représentation des Indiens
Le document souligne l’ambiguïté du regard de Waldeck sur les Indiens, un regard complexe qui dépasse une simple dichotomie entre admiration et condamnation. Il ne se contente pas d'idéaliser ou de dénigrer les populations indigènes, mais il met en lumière les contradictions du système colonial et la place des Indiens au sein de la société mexicaine. Il évoque dans la brochure accompagnant son tableau, à la fois leurs qualités physiques et intellectuelles, tout en insistant sur des aspects culturels qu'il juge parfois négatifs, faisant notamment référence à des pratiques violentes. Son anticléricalisme prononcé, visible dans son Voyage pittoresque, est mis en parallèle avec son regard sur les Indiens, soulignant une critique de l'influence de l'Église dans la société. L’analyse souligne que Waldeck, loin de se limiter à une description ethnographique objective, exprime des jugements de valeur, parfois contradictoires, révélant les préjugés et les stéréotypes de son temps sur les populations indigènes, tout en manifestant une certaine empathie envers leur situation. Le document souligne que son objectif n'est pas de promouvoir une vision idyllique des populations préhispaniques.
VI.Conclusions Paralleles et divergences dans la représentation du passé préhispanique
L’étude conclut que les similitudes entre l’œuvre de Waldeck et l’art mexicain du XIXe siècle sont autant des coïncidences que des influences directes. Elle souligne la diversité des perspectives artistiques et des intentions, malgré un contexte culturel commun. L'analyse compare des artistes comme Parra et Unzueta, mettant en évidence les contradictions et les ambiguïtés dans la représentation du passé préhispanique. L’impact de l’esthétique européenne sur l’art mexicain est également mis en lumière, révélant un regard distancié sur l'histoire et les populations indigènes.
1. Le parallélisme entre l œuvre de Waldeck et l art académique mexicain
La conclusion souligne l'ampleur du parallélisme entre le tableau de Waldeck et le corpus académique mexicain du dernier tiers du XIXe siècle. Cette concordance, malgré des contextes de production radicalement différents, révèle la complexité des intentions et des points de vue des artistes. L'étude note des similarités, notamment dans l’utilisation du passé préhispanique et dans les choix esthétiques, mais aussi des discordances significatives. L’analyse met en lumière la diversité des regards, des intentions et des sensibilités des artistes académiques mexicains, illustrée par la comparaison entre Félix Parra, dont l’œuvre met l’accent sur la souffrance des Indiens, et Adrián Unzueta, qui exprime un regard plus distancié et critique sur les Aztèques. Malgré des similitudes apparentes, les motivations des artistes français et mexicains ne sont pas identiques.
2. L ambiguïté du regard et l influence de la culture européenne
La conclusion réaffirme l’ambiguïté du regard porté sur le passé préhispanique et sur les populations indigènes, tant par Waldeck que par les artistes mexicains. Waldeck, ouvertement républicain et méfiant vis-à-vis des monarchies, exprime un regard à la fois universaliste (Tlahuicole incarnant des valeurs de patriotisme et de courage) et voyeuriste, insistant sur la violence de la civilisation aztèque. Cette approche contraste avec certaines œuvres mexicaines, qui traitent ce sujet avec encore plus de violence. L’étude souligne également l’assimilation de la culture et de l’esthétique européennes par les artistes mexicains. Le regard distancié des artistes académiques mexicains est mis en avant, avec l'influence persistante de l'esthétique européenne dans la conception de leurs œuvres. L'analyse rappelle que les artistes, comme les critiques, exigent des signes distinctifs du passé, mais tolèrent les inexactitudes scientifiques.
3. L apport de l étude et les perspectives futures
L'étude conclut en soulignant l'importance de la comparaison entre le tableau de Waldeck et l'art académique mexicain du XIXe siècle. Ce travail met en évidence la diversité des points de vue et des intentions des artistes, révélant la complexité de la représentation du passé préhispanique. La recherche offre une nouvelle perspective sur les contradictions et les ambiguïtés inhérentes à la construction d'une identité nationale à travers l'art. L'étude propose une analyse nuancée, allant au-delà d'une simple identification d'influences directes entre les artistes français et mexicains. L’analyse souligne finalement l’importance de considérer les contextes culturels et politiques spécifiques pour comprendre pleinement les choix artistiques et les interprétations du passé. Le parallèle entre les œuvres permet de mieux appréhender la complexité du regard porté sur les populations indigènes et la place de l'esthétique européenne dans le développement de l’art mexicain.
