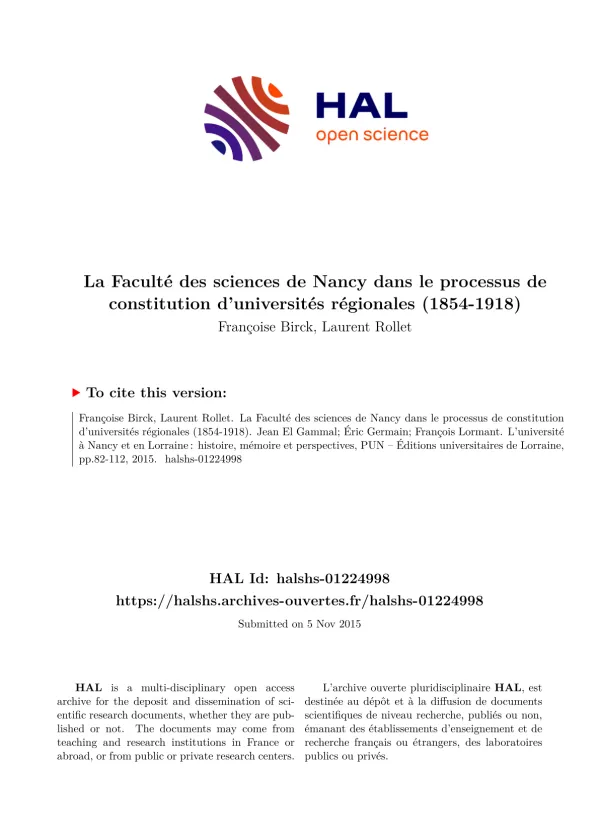
La création de la Faculté des sciences de Nancy (1854-1918) et son impact sur l'enseignement supérieur régional
Informations sur le document
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 0.91 MB |
- universités régionales
- histoire de l'enseignement supérieur
- Faculté des sciences de Nancy
Résumé
I.La Refondation de l Enseignement Supérieur à Nancy après 1854 Un Modèle de Développement Régional
Ce document retrace l'histoire de la Faculté des sciences de Nancy après le Traité de Francfort, soulignant la reconstruction de l'enseignement supérieur dans une ville qui récupère une partie des institutions de Strasbourg annexée. La réorganisation, initiée par le recteur Henri Faye, vise à restaurer la souveraineté locale et à créer des pôles scientifiques de province, formant des « pépinières d'ingénieurs ». L'accent est mis sur le rôle crucial de figures clés telles qu'Albin Haller, Ernest Bichat, et Louis Liard dans ce renouveau. Cette période voit la création de plusieurs instituts techniques (Institut chimique, Institut électrotechnique, etc.) pour répondre aux besoins du développement industriel, à travers une approche innovante combinant sciences pures et sciences appliquées.
1. Le contexte de la refondation 1854 et après
En 1854, une partie de l’ancien enseignement supérieur de l’Université de Lorraine est rétablie à Nancy, malgré les revendications de Metz. Des décrets ministériels organisent la Faculté des sciences et la Faculté des lettres, chacune avec quatre chaires (philosophie, littérature, histoire pour Lettres; mathématiques, physique, chimie, histoire naturelle pour Sciences). L’École préparatoire de médecine et de pharmacie est également renforcée. Le discours inaugural du recteur Henri Faye, mathématicien et membre de l’Institut, souligne le retour de la souveraineté locale dans le domaine de l’enseignement supérieur, après les pertes subies pendant la Révolution Française. Il célèbre la volonté impériale de créer des pôles scientifiques de province, formant des « pépinières d’ingénieurs », mettant en avant l'utilité publique de la science, en contraste avec l'excès de centralisation révolutionnaire. Initialement, la Faculté des sciences peine à répondre à ces attentes, les conditions d’enseignement sont difficiles et les étudiants rares. Cependant, après la guerre de 1870, et surtout entre la fin des années 1880 et le début de la Première Guerre mondiale, Nancy devient un pôle scientifique de premier plan dans les sciences appliquées.
2. Le rôle des réformes républicaines et la concurrence allemande
Le développement de l’enseignement technique supérieur à Nancy au début de la Troisième République est complexe, impliquant des logiques politiques, économiques et sociales. Des mesures clés, comme le décret Goblet de 1885 (personnalité civile aux facultés) et celui de 1897 (droit aux universités de délivrer leurs propres diplômes), libèrent les initiatives universitaires en province. Ce développement est aussi lié à la volonté de contrer la puissance économique et scientifique de l’Allemagne. Plusieurs chercheurs (Robert Fox, Mary Jo Nye, André Grelon) ont mis en avant l'engagement d'universitaires convaincus que la science devait jouer un rôle majeur dans le développement industriel, notamment face à la concurrence allemande, illustrée notamment par la création de l’Université de Strasbourg sous l'empire allemand. À Nancy, ce courant est particulièrement fort, en partie grâce à l’engagement d'Ernest Bichat, proche des milieux politiques républicains. L'affirmation du monopole étatique de la collation des grades universitaires au début des années 1880 vise à freiner le développement d'universités catholiques, une menace palpable à Nancy, où certains professeurs ont rejoint l'Université catholique de Lille (ex: Amédée Jacquin de Margerie, Jules Chautard), remplacés par des figures républicaines comme Émile Boutroux et Ernest Bichat. La refondation laïque et républicaine de l’enseignement supérieur est donc indissociable de son développement.
3. Expansion des structures et diversification de l offre de formation
La création des instituts et la réforme universitaire provoquent une expansion des structures de la Faculté des sciences. L’Institut chimique libère de l’espace, permettant la construction de nouveaux bâtiments (Institut électrotechnique, Institut de mathématiques et de physique). L'arrivée d’élèves « industriels » nécessite un agrandissement des locaux dédiés aux sciences pures. La diversification de l’offre d’enseignement se traduit par la création de nouvelles chaires et maîtrises de conférences. Le développement repose sur une population universitaire hétérogène et hiérarchisée, avec des réseaux sociaux qui dépassent le cadre strict de l’université. L'augmentation du nombre d'étudiants (80 en 1882 à la Faculté des sciences, dont 18 boursiers), grâce aux bourses de licence (300 dès 1877) et d'agrégation (200 dès 1881) sous Waddington et Ferry, pose la question de la réorganisation des laboratoires. L'octroi de la personnalité civile aux facultés par le décret Goblet de 1885 leur permet une plus grande autonomie et la gestion de subventions et legs.
II.L Institut Chimique Un Pilier du Développement Industriel Nancéien
La création de l’Institut chimique en 1889-1890, sous l’impulsion d’Albin Haller et avec le soutien déterminant d’Ernest Bichat, marque un tournant. Inspiré par les modèles allemands et face à la concurrence économique allemande, il vise à former des chimistes pour l’industrie. Le financement est mixte, combinant subventions de l’État, de la ville de Nancy et des départements. L’institut, rattaché à la Faculté des sciences, offre des formations conduisant à des diplômes d’université et des diplômes de chimiste, ouverts même aux étudiants sans baccalauréat, reflétant une politique d’ouverture de l’enseignement supérieur. Le mécénat, notamment d’Ernest Solvay, joue un rôle important dans son essor.
1. Genèse et Objectifs de l Institut Chimique
L’Institut chimique de Nancy, créé entre 1889 et 1890, représente un pilier du développement industriel local. Son origine se trouve dans le contexte de la reconstruction de l’enseignement supérieur à Nancy après le Traité de Francfort, et dans la volonté de combler le retard de la France en matière de sciences appliquées face à l’Allemagne. Le projet, porté par Albin Haller (maître de conférences de chimie organique dès 1879) et soutenu par Ernest Bichat, s'inspire des universités allemandes, mettant l’accent sur les travaux pratiques en laboratoire pour former des spécialistes aptes à intégrer l’industrie. L’ambition dépasse le simple enseignement académique : il s’agit de former des ingénieurs capables de contribuer à la découverte scientifique et à ses applications industrielles. Le manque de compétitivité de l’industrie chimique française par rapport à l'Allemagne, mis en lumière par le rapport de Charles Lauth (1878), justifie cette démarche. Contrairement à une idée répandue, le projet ne dépend pas initialement de l’industrie chimique locale ni d’Ernest Solvay, mais d'une volonté universitaire de dynamiser le secteur.
2. Financement et Soutiens Locaux
Le financement de l’Institut chimique est un élément clé de son succès. L’État promet 500 000 francs, à condition d’une contribution équivalente des assemblées locales, principalement la ville de Nancy. Cette condition vise à tester l’engagement des forces politiques locales dans le contexte du développement des universités de province. Ernest Bichat, actif au conseil général et municipal de Nancy, joue un rôle crucial dans la défense du projet auprès des autorités locales. Après des débats, la ville de Nancy intègre le financement dans son budget, fournit le terrain, proche des anciens remparts. Les départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges apportent une contribution plus modeste. Ce modèle de financement, combinant subventions publiques et locales, illustre un effort de développement régional basé sur une collaboration étroite entre les pouvoirs publics et la communauté locale. L'obtention de ce financement est un enjeu majeur dans le contexte de la discussion sur le nombre de centres académiques pouvant obtenir le statut d'université.
3. Organisation Pédagogie et Ouverture de l Enseignement
L’organisation et la pédagogie de l’Institut chimique s’inspirent de la vision de Louis Liard sur le rôle de l’université : « placer la science au centre même de l’enseignement professionnel ». La Faculté des sciences de Nancy prend la décision de créer l’institut, confiant sa direction à Albin Haller. Les cours théoriques sont assurés par des professeurs de la Faculté. Une caractéristique importante est l’ouverture de la formation : les étudiants, même sans baccalauréat, peuvent s’inscrire, recevant un diplôme de chimiste de l’Université de Nancy pour une insertion professionnelle dans l’industrie. Seuls les bacheliers accèdent au grade de licencié. Ce système, mis en place avant le décret de 1897 (distinction entre diplômes d’université et d’État), témoigne d’une politique d’ouverture de l’enseignement supérieur, accessible même aux élèves de l’École primaire supérieure ou de l’École professionnelle de l’Est, crucial étant donné le nombre limité de bacheliers à l'époque. L’Institut chimique crée ensuite un doctorat d’université pour la section appliquée, contribuant à son propre développement en formant les futurs préparateurs. L’architecture du bâtiment, quatre fois plus spacieuse que les locaux précédents, reflète cette ouverture et les ambitions de l'institut.
III.L Évolution des Relations entre Science et Industrie à Nancy Au delà de l Institut Chimique
L'Institut chimique n'est qu'une première étape. Suite à sa création, d’autres instituts et écoles pour les sciences appliquées voient le jour (École de brasserie, École des mines, etc.), démontrant la volonté d'améliorer la compétitivité industrielle. L'approche se caractérise par une collaboration croissante entre la Faculté des sciences et les milieux économiques locaux. Paul Petit, directeur de l’École de brasserie, illustre le lien entre le monde universitaire et industriel. La participation des industries locales au financement et à la direction de certains instituts (Institut commercial notamment) marque une nouvelle étape, avec une hybridation des modèles de gestion.
1. De l Institut Chimique à la diversification des instituts de sciences appliquées
Après le succès de l’Institut chimique, la Faculté des sciences de Nancy poursuit son développement en créant d’autres instituts et écoles dédiés aux sciences appliquées. Cette expansion n’obéit pas à un plan préétabli, mais répond à des opportunités et aux besoins de l’environnement économique. L’objectif reste d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises face à la concurrence allemande en introduisant plus de science dans les lieux de production. La création de l’École de brasserie en 1893 illustre cette stratégie. La concurrence entre les centres académiques pour accéder au rang d’université pousse la Faculté à mobiliser les ressources de son environnement. Louis Liard souligne cette nécessité, en parlant d'un « cordon nourricier » avec l’État, mais aussi d’un « placenta local » pour assurer le développement. Cette collaboration avec le monde industriel et local se traduit par des financements spécifiques pour différentes formations, comme le diplôme de maître-brasseur, hébergé à l’Institut chimique et incluant l'installation d'une brasserie expérimentale sous la direction de Paul Petit.
2. L implication des industriels locaux et le cas de l École de brasserie
L’École de brasserie, créée en 1893, est un exemple concret de la collaboration entre la Faculté des sciences et le monde industriel. Elle vise à améliorer la qualité de la production brassicole lorraine, développée après la perte de l’Alsace. Pour ce projet, la Faculté, encouragée par le doyen Bichat, ne sollicite pas l’État, mais les industriels locaux. La résistance initiale des brasseurs lorrains souligne la difficulté d'une telle collaboration, nécessitant trois années de démarches. L’accord se concrétise par la création d’un laboratoire d’analyses. Paul Petit, qui dirige l’école pendant 40 ans, voit sa carrière scientifique s'orienter vers les questions de l'industrie brassicole. Cette expérience lui confère une crédibilité qui lui permet, en 1919, de devenir l’interlocuteur privilégié des métallurgistes lorrains pour la création de l’École des mines (Institut métallurgique et minier).
3. Le rôle du mécénat et l évolution des liens avec l industrie
Le financement des instituts ne repose pas uniquement sur des subventions publiques. L’implication de l’industrie locale est essentielle, à travers des financements ponctuels et des collaborations. Albin Haller, en s’inspirant du modèle américain, sollicite des dons d’entreprises locales pour le développement de la chimie physique et de l’électrochimie à l’Institut chimique. La Société industrielle de l’Est, via l'avocat Grillon, joue un rôle d'intermédiaire pour obtenir le soutien financier d’Ernest Solvay, mécène généreux. Ce mécénat marque une étape dans les relations entre la Faculté et le monde industriel. L’industrie finance aussi directement des laboratoires spécialisés, comme le laboratoire d’analyses industrielles à l’Institut chimique, financé par le Comité des forges et mines de fer de Meurthe-et-Moselle. Le cas de René Nicklès, maître de conférences en géologie, sollicité par la Société des hauts-fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson pour des travaux de géologie appliquée, illustre les demandes industrielles directes. Malgré ce développement, le nombre d’intervenants industriels reste faible, comparativement aux universitaires, suggérant une interaction plus indirecte que prévue dans les discours volontaristes sur l'utilité industrielle de la science.
4. L Institut Commercial et l hybridation des modèles de gestion
La création de l’Institut commercial en 1905 marque une mutation significative dans les relations entre la Faculté des sciences et son environnement. La Chambre de commerce de Nancy, cherchant à créer un « mariage entre la science et le commerce », s'appuie sur les liens déjà établis avec le monde industriel. Le ministère impose des conditions : assimilation des diplômes à ceux de l'université, programmes examinés par le conseil supérieur de l’Instruction publique, et prise en charge des enseignements appliqués par la Chambre de commerce. L’accord final, négocié par le recteur Charles Adam, donne naissance à un fonctionnement hybride : institut d’université et école de commerce, règles du service public et gestion de droit privé. Ce modèle particulier, qui inclut une participation financière et décisionnelle des industriels, est reproduit ensuite pour d’autres instituts comme celui des mines. Ce fonctionnement hybride perdure et contribue à la spécificité de certaines institutions.
IV.Le Personnel Enseignant Au delà des Élites un Écosystème Universitaire Complexe
L'analyse du personnel enseignant de la Faculté des sciences de 1854 à 1918 (environ 150 personnes) révèle une grande diversité. L’étude dépasse les seules figures influentes (Victor Grignard, Élie Cartan, etc.), pour inclure les maîtres de conférences, chefs de travaux, et chargés de cours. L’origine géographique (nombreux Lorrains), la formation (École normale supérieure, mais aussi écoles locales), et les parcours de carrière sont étudiés. L’analyse met en lumière l'existence d'un vaste écosystème universitaire incluant des liens avec les lycées, les écoles professionnelles et les industries. Le document souligne l’importance des réseaux sociaux et familiaux dans le recrutement et la mobilité du personnel.
1. Au delà des professeurs titulaires une population enseignante hétérogène
L'étude du personnel enseignant de la Faculté des sciences de Nancy entre 1854 et 1918 révèle un écosystème universitaire bien plus complexe que ne le suggèrent les récits institutionnels centrés sur les professeurs titulaires. Le document souligne l’importance de considérer l'ensemble de la population enseignante, soit environ 150 personnes, incluant les professeurs titulaires de chaires (39%), les maîtres de conférences (11%), les chefs de travaux et les chargés de cours (environ 50%). Ce dernier groupe, très hétérogène, comprenait des jeunes normaliens, des licenciés ès sciences, des professeurs de lycée, des professeurs de la Faculté des lettres, des militaires, des agronomes, des ingénieurs des mines, et des industriels. Cette diversité remet en question la vision traditionnelle, souvent limitée aux élites parisiennes, et enrichit la compréhension du fonctionnement quotidien de la Faculté. L'analyse des parcours de carrière de ces 150 enseignants, très variés selon leur statut (titulaire ou provisoire), permet d'appréhender les dynamiques de recrutement et les réseaux de sociabilité au sein de cet écosystème universitaire.
2. Dynamiques de carrière et mobilité du corps professoral
Les dynamiques de carrière des 150 enseignants varient considérablement. Certains professeurs visent une carrière nationale, comme Émile Mathieu, dont le travail est reconnu internationalement, mais qui reste à Nancy. D’autres, comme Élie Cartan, utilisent Nancy comme étape avant un poste parisien. Certains ont une double carrière, comme Albin Haller (Nancy puis Sorbonne et École de physique et de chimie industrielles de Paris). D'autres encore, comme Jules Chautard, quittent Nancy pour l'Université catholique de Lille. Pour beaucoup, la Faculté des sciences de Nancy est un lieu d'épanouissement scientifique, comme pour Ernest Bichat, Gaston Floquet, Lucien Cuénot, et Julien Thoulet. Le faible nombre de postes dans les facultés de province et la difficulté d'obtenir un poste à Paris expliquent pourquoi de nombreux professeurs restent à Nancy. L'étude montre une grande hétérogénéité des parcours, une mobilité variable selon les statuts, et un fort ancrage local pour une partie significative du personnel.
3. Origines géographiques formations et réseaux familiaux
L'analyse des lieux de naissance et de formation des enseignants apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement de la Faculté des sciences. Parmi les 101 enseignants n’ayant pas fait carrière à Nancy, 33% sont nés en Lorraine, et 50% dans les régions limitrophes. Ce taux est plus élevé pour les chargés de cours et chefs de travaux que pour les professeurs. Le recrutement des 31 chefs de travaux est majoritairement local (24 formés à Nancy), notamment parmi les diplômés de l’École de brasserie. La moitié des chefs de travaux ont commencé comme préparateurs. Pour les professeurs titulaires, l’École normale supérieure est une filière de formation importante (15 sur 49). Cependant, 10 professeurs ont été formés à Nancy, principalement des chimistes. L’étude souligne aussi le rôle des connexions familiales dans le recrutement. Environ un tiers des enseignants ayant fait carrière à la Faculté des sciences sont liés par des liens familiaux (filiation, mariage, cousinage), illustrant une certaine reproduction sociale au sein de l'institution, même si la mobilité sociale reste limitée à la fin du XIXe siècle.
4. Le périmètre élargi de la Faculté et son écosystème universitaire
L’étude du périmètre de la Faculté des sciences dépasse le cadre strict de l’institution. L’analyse des 62 chargés de cours extérieurs met en lumière un écosystème universitaire étendu. Les enseignements confiés à ces chargés de cours sont variés, allant de cours classiques (physique, agronomie) à des formations plus spécialisées (moteurs agricoles, hygiène coloniale, législation minière), en lien avec les instituts techniques. Les enseignants extérieurs proviennent de diverses institutions (Facultés nancéiennes, lycée, Institut commercial, École de commerce, Station agronomique de l’Est, et quelques entreprises). Cependant, la faible participation d’intervenants directs du monde économique est notable, malgré le développement des sciences appliquées et le discours volontariste sur l’utilité industrielle. Cette analyse souligne l’importance des réseaux de recrutement, de la répartition des tâches, et des relations entre la Faculté, son environnement académique immédiat, et le monde industriel.
V.L Héritage de la Faculté des Sciences de Nancy Une Régionalisation Universitaire Réussie
La Faculté des sciences de Nancy a réussi à répondre au défi de la ré régionalisation universitaire, en développant un enseignement des sciences appliquées et en tissant des liens forts avec le monde économique local. Cependant, des faiblesses persistent, liées à la dépendance aux financements locaux et au manque de démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur. Malgré des tentatives de séparation des instituts techniques en une Faculté des sciences appliquées, leur intégration à la Faculté des sciences s'est avérée durable, assurant le développement du pôle scientifique nancéien jusqu'à la création de l’Université de Lorraine.
1. Bilan de la régionalisation universitaire à Nancy Succès et limites
La Faculté des sciences de Nancy a relevé le défi de la régionalisation universitaire, initié par le recteur Faye et poursuivi par les réformateurs républicains. La création successive d’instituts de sciences appliquées, avec l’appui de l’environnement économique local, représente un succès. Ces instituts forment des ingénieurs, combinant sciences appliquées et recherche. La Faculté des sciences devient la composante principale de l’Université de Nancy, surpassant les facultés professionnelles (droit et médecine) en nombre d’étudiants (935 contre 491 et 376 respectivement, à la veille de la Première Guerre mondiale). Entre 1896 et 1904, elle délivre 728 licences et forme plus de 500 ingénieurs chimistes et électriciens. Cependant, cette réussite est nuancée par des faiblesses structurelles. La dépendance à des financements locaux ponctuels, face à des engagements faibles de l’État, expose la Faculté à des risques en cas de conjoncture défavorable. L’accès à l’enseignement supérieur n’étant pas démocratisé, le nombre d’étudiants et les ressources des instituts restent limités.
2. La relation complexe Paris province et l autonomie des Facultés
L’histoire de la Faculté des sciences de Nancy illustre les relations complexes entre Paris et la province. Le discours inaugural de Faye met en avant cette relation dialectique entre le centre et la périphérie. L’approche souligne l’importance des initiatives locales, même si les stratégies républicaines sont pilotées depuis Paris. La réforme universitaire, en accordant des marges d’autonomie aux facultés, a permis à la Faculté des sciences de Nancy de développer un enseignement original. Cette autonomie a permis de s’adapter aux besoins locaux et de créer des formations innovantes en sciences appliquées. Le succès de la Faculté repose sur l’engagement d’universitaires nancéiens, qui ont su mobiliser des ressources humaines et financières locales pour construire durablement un pôle scientifique régional. Le texte mentionne la mobilisation de ressources humaines au-delà des universitaires (ingénieurs, militaires, industriels), contribuant au fonctionnement de la faculté.
3. L évolution des instituts et l affirmation des écoles nationales supérieures
L’intégration des instituts techniques à la Faculté des sciences a été remise en question à plusieurs reprises. Après la Première Guerre mondiale, un projet de création d’une Faculté des sciences appliquées, indépendante, est envisagé, mais échoue. La crise économique des années 1930 et la baisse démographique conduisent au déclin des instituts. Des tenants des « sciences pures » envisagent même leur disparition. Cependant, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la transformation des instituts en écoles nationales supérieures (1947) renforce le rôle de la Faculté dans la formation d'ingénieurs. Dans les années 1960, ces écoles sont présentées comme « la partie la plus vivante et la plus prospère de l’université », justifiant leur intégration dans un campus unitaire. La création de l’Institut national polytechnique en 1970 marque une nouvelle étape, mais les écoles restent intégrées à la grande nébuleuse régionale de l’Université de Lorraine.
