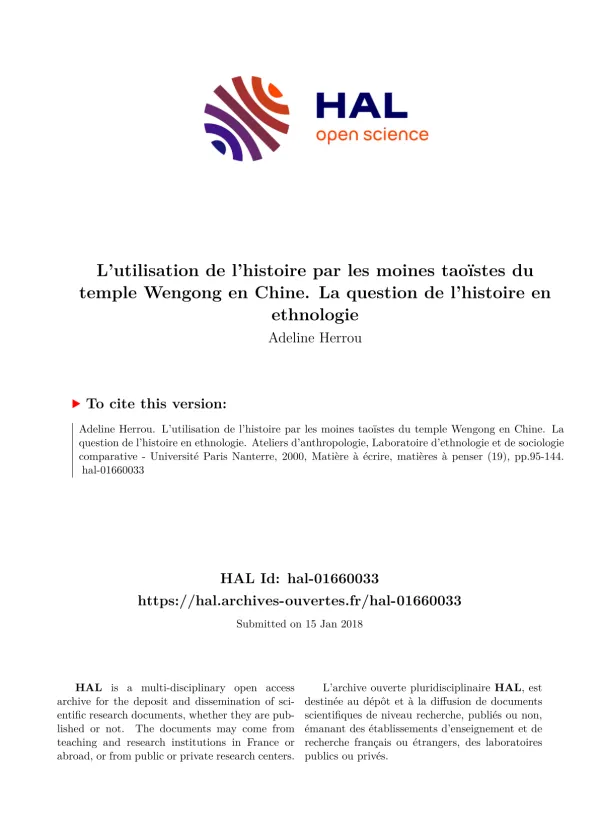
L'Utilisation de l'Histoire en Ethnologie: Étude des Moines Taoïstes du Temple Wengong en Chine
Informations sur le document
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 23.80 MB |
- ethnologie
- histoire
- taoïsme
Résumé
I.L intégration des données historiques en ethnologie en Chine le cas du Temple Wengong
Cette étude ethnologique explore les défis méthodologiques et épistémologiques liés à l'utilisation des données historiques dans la recherche sur le taoïsme en Chine. L'auteure, confrontée à la richesse et à la complexité de l'histoire chinoise, interroge la manière dont un ethnologue peut intégrer des données historiques (sources historiques) dans une perspective synchronique, en utilisant des éléments de diachronie. L'étude porte sur le Temple Wengong à Hanzhong (province du Shaanxi), un monastère taoïste dont l'histoire est complexe et multi-interprétée par les acteurs (moines, fidèles, historiens locaux...). La question centrale est de comprendre comment l’histoire, telle que vécue et interprétée par la communauté du temple, est constitutive de son identité et de son organisation.
1. Le défi méthodologique de l intégration des données historiques en ethnologie chinoise
L'auteure introduit le dilemme central de sa recherche ethnologique en Chine : l'intégration des données historiques dans une étude ethnologique. La Chine possède une riche histoire, abondamment documentée, qui imprègne tous les aspects de la vie sociale, y compris les témoignages oraux collectés sur le terrain. Ce « monstre » que représente l'histoire du pays pose un défi méthodologique important : comment l'ethnologue, non historien de formation, peut-il et doit-il intégrer ces données dans sa recherche sans dénaturer l'approche ethnologique ? La question dépasse le cadre purement méthodologique et soulève une problématique épistémologique : dans quelle mesure l'ethnologue peut-il et doit-il « faire de l'histoire » ? Le texte explore cette tension entre l'approche synchronique de l'ethnologie et la dimension diachronique inhérente à l'histoire du sujet d'étude. Il s'interroge sur la gestion des sources historiques, qu'elles soient issues de « l'histoire des historiens » ou de sources primaires collectées sur le terrain. L'objectif est de trouver un équilibre entre l'intégration nécessaire de données historiques pour comprendre les références culturelles du groupe étudié et le maintien d'une perspective ethnologique centrée sur l'analyse des significations et des pratiques contemporaines. La discussion au sein d'un atelier d'écriture a mis en lumière la diversité des approches et des opinions sur ce sujet, révélant un débat fondamental au sein même de la discipline ethnologique.
2. L expérience personnelle et l orientation de la recherche
L'auteure décrit son expérience personnelle dans le cadre d'un atelier d'écriture, où elle a présenté un synopsis de la première partie de sa thèse consacrée à l'étude d'un groupe de moines taoïstes. Initialement axée sur la présentation du cadre géographique, historique, politique et culturel, la réflexion collective suscitée par son travail a permis de redéfinir l'approche. Le « monstre » de l'histoire chinoise, initialement perçu comme un obstacle méthodologique, est réinterprété. La recherche s'est recentrée sur la manière dont l'histoire, telle que la vivent et la racontent les moines eux-mêmes, est constitutive de leur identité et de leur organisation. Il ne s'agit plus de présenter un simple « cadre historique », mais d'analyser les histoires multiples et parfois contradictoires qui façonnent la vie et les pratiques de la communauté. L'auteure souligne l'importance de livrer au lecteur les éléments historiques nécessaires à la compréhension des discours et des pratiques, en précisant toujours la provenance des informations. Cette nouvelle orientation a conduit à une première partie de thèse profondément transformée, centrée sur l'analyse des histoires partagées par les moines et les fidèles plutôt que sur une simple description du contexte.
3. Marcel Granet et l approche sociologique de l histoire en Chine
La réflexion sur les méthodes d'intégration des données historiques en ethnologie chinoise est enrichie par une brève référence à l'œuvre de Marcel Granet. Bien qu'historien de formation, Granet est considéré aujourd'hui comme un ethnologue précurseur dans son approche sociologique de l'histoire de la Chine ancienne. Son travail, basé sur une analyse sociologique de légendes et de textes historiques, philosophiques et littéraires de la Chine des Zhou et du début de l'empire, ainsi que sur des rapports de missionnaires et d'anthropologues, sert d'exemple d'une intégration réussie des données historiques dans une analyse sociologique. Malgré un court séjour en Chine et un travail basé principalement sur des sources secondaires, Granet a su construire une analyse ethnologique pertinente, démontrant la possibilité d'une approche qui combine histoire et ethnologie. Cette référence permet de souligner qu'une étude ethnologique peut s'appuyer sur des données historiques sans pour autant se réduire à une simple compilation de faits historiques ou à une analyse chronologique linéaire. Elle illustre la possibilité d'une approche nuancée qui intègre des éléments diachroniques dans une perspective synchronique, centrée sur les significations sociales des données historiques.
II.Multiplicité des histoires et perspectives sur le Temple Wengong
L'enquête révèle une pluralité d'histoires concernant le Temple Wengong. Pour certains, le temple date de 1993 (reconstruction), tandis que d'autres évoquent une histoire bien plus ancienne, remontant même à la dynastie Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.). Ces différentes narrations, issues de sources orales et écrites, mettent en lumière la complexité de la mémoire collective et la manière dont le passé est réinterprété et instrumentalisé par les différents acteurs. L’étude explore la notion de « récits de fondation », soulignant comment ces récits façonnent l'identité du temple et sa place dans la société chinoise. Des personnages clés émergent : Han Yu (divinité principale), Qiu Chuji (fondateur de l'obédience), et Wang Chongyang (patriarche de l'obédience de la Perfection totale). La question de la transmission des traditions et de l'influence de la Révolution culturelle est aussi abordée.
1. Le Temple Wengong Une multiplicité d histoires et de perspectives
L'étude du Temple Wengong à Hanzhong, un monastère taoïste, révèle une grande diversité de perspectives sur son histoire. Les différents acteurs impliqués – moines actuels (installés depuis 1993), anciens moines, adeptes, pèlerins, voisins, historiens locaux et représentants de l'État – proposent des narrations distinctes, révélant une pluralité d'histoires plutôt qu'une seule histoire linéaire. Pour certains, le temple date de 1993, année de sa reconstruction. Pour d'autres, son histoire remonte à bien plus longtemps, certains évoquant même une origine datant de la dynastie Han (206 av. J.-C. – 220 ap. J.-C.). Cette multiplicité des récits reflète la complexité de la mémoire collective et la manière dont le passé est interprété et instrumentalisé selon les perspectives individuelles et collectives. L'étude analyse ces récits comme autant de « récits de fondation », chacun contribuant à construire l'identité et la signification du Temple Wengong dans le paysage religieux et social de Hanzhong. Le contraste entre ces visions souligne la difficulté de reconstituer une histoire objective et souligne l'importance de considérer la multiplicité des voix et des interprétations. L'analyse se concentre sur la façon dont ces différentes histoires interagissent et contribuent à la construction d'une identité complexe et dynamique pour le temple.
2. Sources et interprétations des récits historiques
Les sources des différents récits historiques concernant le Temple Wengong sont variées et complexes. Les récits des moines actuels et des érudits locaux s'appuient sur des éléments matériels tels que les restes de stèles anciennes (décrites comme brisées mais partiellement déchiffrées) et une partie de mur conservée, ornée d'idéogrammes et de sculptures. L'histoire orale du voisinage, ainsi que des monographies locales, contribuent aussi à la construction de ces narrations. Cependant, la plupart des sources ne sont pas clairement identifiées ni référencées, ce qui complique l’analyse critique. L'étude relève les divergences d'interprétation, notamment concernant l'agrandissement du temple dans les années 1920. Alors que les anciens moines attribuent ce changement à un incident impliquant une femme atteinte de folie, les moines actuels le lient à un vœu exaucé d'un seigneur de guerre, Wu Xintian. Ces divergences ne sont pas perçues comme des erreurs, mais comme des éléments constitutifs de la richesse et de la complexité des histoires du temple. L'absence de sources documentées pour la période antérieure à 1993 illustre la fragilité et la nature reconstruite des récits historiques, et montre comment l'histoire du temple est en constante construction et réinterprétation.
3. Réseaux et liens historiques du Temple Wengong
L'analyse historique du Temple Wengong met en lumière ses liens multiples et complexes avec d'autres temples taoïstes de la région et du pays. Ces liens s'inscrivent dans différents registres : cultuel (avec le mont Taibai et le culte de Han Yu), d'obédience (avec le Palais de Chongyang et les grottes de la Porte du Dragon, liés à l'obédience de la Perfection totale), lié aux origines du Taoïsme (principauté de Zhang Lu et belvédère Louguan), et de transmission d'enseignement direct (mont Tiantai et le moine Zhang Mingshan). Ces réseaux tissent une histoire interconnectée des temples taoïstes, démontrant comment un lieu saint particulier est lié à une géographie sacrée plus large. La conception même de la fondation d'un temple comme une propagation « en chaîne » d'un culte est évoquée, illustrant comment les temples s'inscrivent dans une histoire partagée et transmise à travers des réseaux d'enseignement et de solidarité. L'étude souligne aussi un lien politique, visible à travers l'impact de la Révolution culturelle et la réorganisation du taoïsme après la libéralisation politique, notamment par le biais de l'Association taoïste. Ces multiples connexions historiques contribuent à créer une riche et complexe identité pour le Temple Wengong, dépassant sa seule matérialité.
III.Le Temple Wengong continuité et rupture dans le temps
Le Temple Wengong, détruit durant la Révolution culturelle, a été reconstruit au début des années 1990. L'étude analyse cette reconstruction comme une nouvelle fondation, marquée par une transformation de son architecture, de son panthéon (divinités), et de ses liens avec d'autres temples taoïstes. Le lien entre temporalité et changement social est au cœur de l'analyse, explorant comment le temple articule son histoire et son identité à travers différentes strates de culte et d’enseignement. L’Association taoïste, le rôle de figures comme Zhang Mingshan (moine clé de la reconstruction), et l'importance du territoire sont des éléments-clés de cette section. L'étude aborde la relation complexe entre histoire officielle et histoires locales, la manière dont le passé est (re)construit et utilisé pour légitimer le présent. L'analyse se base sur la comparaison entre la « carte réelle » et la « carte de mémoire » du lieu.
1. La reconstruction du Temple Wengong une nouvelle fondation
La section analyse la reconstruction du Temple Wengong après sa destruction durant la Révolution culturelle. Reconstruit à partir de 1993, le temple n'est pas une simple restauration, mais une nouvelle fondation, modifiant son architecture, son organisation spatiale et son panthéon. L'étude souligne la différence entre la conception occidentale de « restauration » et la vision chinoise, où le neuf peut être considéré comme une continuation de l'ancien, un « vestige du passé » (guji) « sauvegardé » (baohu). Bien que le bâtiment soit flambant neuf, il est présenté comme une relique antique (gulao de), conservant l'architecture, les dimensions et les couleurs de son prédécesseur. Cette approche contraste avec la notion occidentale de ruines comme des débris du passé, soulignant une conception différente du temps et de la transmission de la mémoire. L’étude explore les choix architecturaux et leur signification, notamment l'orientation des bâtiments selon les principes de la géomancie chinoise. La reconstruction progressive du temple, impliquant la communauté des moines et des fidèles, ainsi que les contributions financières diverses, met en lumière la dimension collective et la dynamique de cette nouvelle fondation. Une nouvelle stèle et des inscriptions identifient le temple dans sa forme actuelle, mais les textes ne sont pas toujours identiques aux versions antérieures. Le temple est une preuve de la capacité d'adaptation et de résilience des traditions taoïstes face à la destruction et à la rupture.
2. Le Temple Wengong et son territoire organisation et transformation
L'étude examine la transformation du territoire du Temple Wengong lors de sa reconstruction. Le concept de territoire est appréhendé à la fois comme « objectivement organisé » (par les moines et fidèles) et « culturellement inventé », produit d'un système de représentations. La reconstruction prend en compte la nouvelle situation du terrain, notamment l'enfouissement de la rivière qui traversait autrefois le temple. Ce changement physique est intégré à la nouvelle architecture, le nouveau bâtiment de l'Empereur de Jade étant édifié au-dessus du cours d'eau enterré. L'agrandissement du temple et le déplacement du mur d'enceinte témoignent d'une expansion du territoire sacré. Les contraintes matérielles (occupation des anciens bâtiments, ressources financières limitées) ont influencé les étapes de la reconstruction, commencée par la partie nord (arrière) du temple, contrairement à la tradition qui veut que l'entrée principale soit orientée au sud. La construction progressive du temple, durant plusieurs années, et l’intégration progressive des anciens logements d’État dans les espaces du temple, mettent en lumière les adaptations nécessaires pour intégrer le passé dans le présent. L'étude contraste l'organisation actuelle du temple avec sa configuration passée, démontrant comment une nouvelle organisation se construit sur les traces du passé.
3. Continuité et changement dans le panthéon et les pratiques
L'analyse porte sur les changements intervenus dans le panthéon et les pratiques du Temple Wengong après sa reconstruction. La composition des divinités vénérées n’est pas la même qu’avant la Révolution culturelle. Si Han Yu restait la divinité principale, le Seigneur du Ciel sombre (Xuantian shangdi), divinité exorciste, prend une importance accrue, occupant même initialement la salle principale du temple. Ce changement est interprété comme une réponse au contexte socio-religieux post-révolutionnaire, où le besoin d'exorciser les « mauvais morts » (huaigui) est important. Ce changement reflète l'adaptation du taoïsme à son contexte, le mini-panthéon étant modulable selon les besoins de la communauté et le contexte politique. Le Temple Wengong, en tant que siège de l'Association taoïste de Hanzhong, doit aussi représenter l'identité taoïste locale et nationale. L'étude souligne ainsi comment les traditions sont à la fois conservées et réinventées, illustrant le dynamisme et la capacité d'adaptation du taoïsme. L'étude aborde les liens entre les divinités du temple, soulignant leur importance symbolique dans la construction d'une identité taoïste forte et une connexion au-delà de la simple localisation.
IV.Conclusion L histoire comme élément constitutif de l identité du Temple Wengong
En conclusion, cette recherche souligne l'importance de l'histoire dans la compréhension de l'identité du Temple Wengong et de sa communauté. L'étude montre comment le passé est activement utilisé, réinterprété, et négocié par les acteurs pour façonner leur présent. La multiplicité des histoires n'est pas vue comme un obstacle, mais comme un élément constitutif de la dynamique identitaire du temple. La notion de longévité et l’importance de la transmission des savoirs et des pratiques au sein de l'association des moines sont des points importants. Le travail met en lumière la complexité des rapports entre ethnologie et histoire, montrant comment une méthodologie ethnologique rigoureuse permet d'appréhender les dimensions multiples de la réalité sociale.
1. L histoire comme facteur constitutif de l identité du Temple Wengong
La conclusion souligne que l'histoire, dans sa complexité et sa multiplicité d'interprétations, est un élément fondamental de l'identité du Temple Wengong. L'étude démontre comment le passé est activement utilisé, réinterprété et négocié par les acteurs (moines, fidèles, etc.) pour construire et légitimer leur présent. La coexistence de narrations différentes, parfois contradictoires, n'est pas vue comme un problème méthodologique, mais comme une caractéristique constitutive de l'identité du temple. Cette multiplicité des histoires reflète la mémoire collective et la façon dont le passé continue d'influencer et de façonner les pratiques et les croyances contemporaines. La reconstruction du temple après la Révolution culturelle est analysée non pas comme une simple restauration, mais comme une nouvelle fondation, intégrant à la fois des éléments de continuité et de rupture. La profondeur historique du Temple Wengong, résultant de ses transformations successives, est interprétée comme l'expression de la longévité du groupe de moines et de la persistance de la tradition taoïste.
2. La conception taoïste du temps et de la transmission
La conclusion met en perspective la perception du temps et de la transmission des traditions dans le contexte taoïste. La valorisation de l'ancienneté et la profondeur historique du temple renvoient à la conception taoïste de la vie et de la mort, où l’obtention de la longue vie est primordiale. L'accumulation des connaissances et l'élaboration des pratiques rituelles sont considérées comme essentielles à la quête de l'immortalité. L'érudition fait partie de l'ascèse, et les histoires du passé nourrissent ce bagage de savoirs transmis entre les générations de moines. Le concept de « mémoire collective » est central : l’histoire taoïste, transmise principalement oralement, est un ensemble de fragments dispersés sur tout le territoire chinois, dont le Temple Wengong possède une partie. La conception taoïste de la pérennité n'est pas liée à la matérialité du temple, mais à la continuité de la tradition et de la transmission des savoirs. La conclusion met ainsi l'accent sur la dimension dynamique de l'histoire et l'importance de comprendre la manière dont les acteurs façonnent et utilisent le passé pour construire leur identité dans le présent.
3. Implications méthodologiques et conclusion générale
L'étude du Temple Wengong propose des réflexions méthodologiques importantes pour l'ethnologie. L'approche adoptée souligne que l'intégration des données historiques ne doit pas se limiter à une simple compilation de faits, mais qu'elle doit tenir compte de la multiplicité des interprétations et de la manière dont le passé est (re)construit et utilisé par les acteurs sociaux. L'histoire n'est pas un « cadre » extérieur à la réalité sociale, mais un élément constitutif de celle-ci. L’étude met en lumière la nécessité pour l’ethnologue d'adopter une perspective résolument ethnologique, en utilisant des éléments de la diachronie au sein d'une perspective synchronique, pour analyser la façon dont les « multiples histoires » sont faites et utilisées par la communauté étudiée. La conclusion réaffirme l'importance d'une approche nuancée et réflexive de l'histoire dans la recherche ethnologique, soulignant que la compréhension de l'identité et des pratiques d'un groupe ne peut se faire sans tenir compte de la complexité de ses rapports avec le passé.
