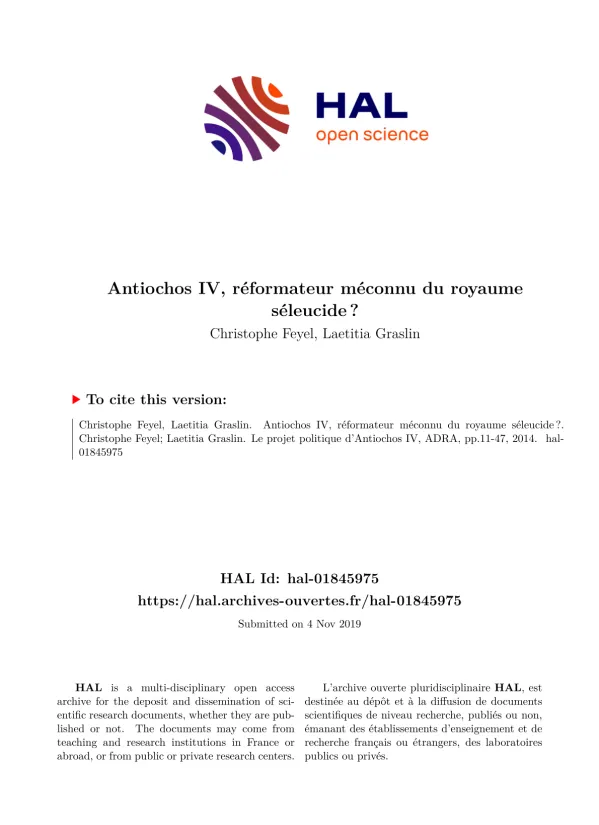
Antiochos IV : Un Réformateur Méconnu du Royaume Séleucide
Informations sur le document
| Auteur | Christophe Feyel |
| instructor/editor | S. Honigman |
| École | Université de Lorraine |
| subject/major | Histoire |
| Type de document | Article de recherche |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 320.29 KB |
- Antiochos IV
- royaume séleucide
- histoire ancienne
Résumé
I.L image contrastée d Antiochos IV roi séleucide entre grand stratège et souverain dément
L'étude porte sur la figure controversée d'Antiochos IV, roi du royaume séleucide durant la période hellénistique. Les sources historiques, notamment Polybe, Diodore de Sicile, et Tite-Live, présentent des visions divergentes : un grand roi compétent en politique extérieure, mais aussi un souverain étrange, voire fou, dans la gestion de son royaume. Les livres des Maccabées renforcent cette image négative, dépeignant Antiochos IV comme un roi impie. L'objectif est de comprendre cette dualité et d'analyser les politiques intérieures d'Antiochos IV à la lumière des sources disponibles.
1. Antiochos IV une image contrastée par les sources historiques
L'étude débute par la présentation d'une image paradoxale d'Antiochos IV. Polybe et Diodore de Sicile le décrivent comme un grand roi, habile stratège, reconnu pour ses succès militaires et ses entreprises politiques. Cependant, ces mêmes auteurs soulignent l'incompréhension suscitée par le comportement du roi au sein de son propre royaume, le qualifiant d'homme étrange, voire de dément aux yeux de certains sujets. Cette perception est renforcée par les sources juives grecques, notamment les deux livres des Maccabées, qui le présentent comme un roi impie, profanateur de sanctuaires, finalement puni par la divinité. Cette dualité pose la question centrale de l'étude : comment un même monarque peut-il être à la fois un brillant homme d'État à l'étranger et un dirigeant incompris et contesté en interne ? L'hypothèse explorée est qu'Antiochos IV aurait eu des idées novatrices en matière de politique intérieure, aussi audacieuses que ses politiques extérieures, mais qui n'ont pas trouvé un écho favorable chez ses sujets, provoquant ainsi des réactions négatives et une image contrastée transmise par les sources.
2. Les sources historiques entre interprétations divergentes et biais narratifs
L'analyse des sources historiques est cruciale pour comprendre la complexité de la personnalité et du règne d'Antiochos IV. L’étude mentionne Polybe comme source principale, bien que ses écrits sur Antiochos IV soient en grande partie perdus. Les fragments conservés révèlent une tendance à dénigrer le souverain, ne trouvant pas chez lui l'idéal du roi tel qu'il le conçoit. Diodore de Sicile, utilisant Polybe comme source, propose une interprétation différente, soulignant une volonté délibérée d'Antiochos IV de rompre avec les traditions royales. Tite-Live, également en s'appuyant sur Polybe, recourt à la notion philosophique de « genre de vie », suggérant que le caractère d'Antiochos IV l'empêchait d'adopter une seule ligne de conduite. Au-delà de Polybe, Diodore et Tite-Live, l'étude intègre d'autres sources comme le monnayage original d'Antiochos IV et les tablettes babyloniennes en akkadien, ces dernières fournissant des informations précises sur sa politique dans l'Orient séleucide. Enfin, l'étude souligne l'importance des livres des Maccabées, tout en précisant leur nature d'histoire sainte, influençant leur perspective sur les événements et le personnage d'Antiochos IV. La multiplicité des sources et leurs biais respectifs complexifient l'interprétation, nécessitant une approche critique et nuancée.
3. L analyse du comportement d Antiochos IV à Antioche
Le comportement d'Antiochos IV à Antioche, la capitale du royaume séleucide, est analysé comme une tentative d'innovation politique et d'adaptation aux réalités de son règne. Son excessive générosité, décrite par Tite-Live comme la marque d'une âme royale, est interprétée non pas comme un signe de folie, mais comme une stratégie politique visant à gagner la reconnaissance de ses sujets. Cette générosité s'inscrit dans les pratiques habituelles de l'époque hellénistique, où les bienfaits royaux sont attendus et suscitent reconnaissance, voire un culte. L'étude met en lumière l'imitation par Antiochos IV des mœurs politiques romaines. Il cherche la proximité du peuple, occupant des fonctions civiles comme démarque et agoranome, des postes traditionnellement occupés par des citoyens, se comportant comme un candidat à une magistrature romaine. L’analyse se base sur des sources antiques et compare les actions d'Antiochos IV aux comportements politiques romains, notamment en ce qui concerne l'organisation de spectacles publics (combats de gladiateurs), imitant ainsi les stratégies de communication politique romaine pour capter l'adhésion de la population. Sa fréquentation des artisans, en particulier des orfèvres, est liée à l'originalité de son monnayage.
II.Sources historiques et monnayage d Antiochos IV
L'analyse s'appuie sur des sources variées : les écrits fragmentaires de Polybe, Diodore de Sicile, et Tite-Live (souvent malveillants envers Antiochos IV); les livres des Maccabées (source partisane); son monnayage original, unique parmi les rois séleucides; et les tablettes babyloniennes en akkadien, révélant des aspects de sa politique en Orient séleucide. Ces tablettes, provenant de Babylone et d'Uruk, apportent des précisions sur les relations entre les notables et le souverain.
1. Sources littéraires Polybe Diodore de Sicile Tite Live et les livres des Maccabées
L'étude de la personnalité et du règne d'Antiochos IV repose sur une analyse critique de plusieurs sources littéraires. Les auteurs classiques, Polybe, Diodore de Sicile et Tite-Live, offrent des perspectives divergentes. Polybe, bien que ses écrits sur Antiochos IV soient largement perdus, est considéré comme une source importante, même si son jugement sur le roi est souvent négatif, voire malveillant. Ses fragments, utilisés par Diodore et Tite-Live, montrent un Antiochos IV qui ne correspond pas à l'idéal de souverain selon Polybe. Diodore de Sicile et Tite-Live, utilisant Polybe comme source, interprètent différemment le comportement d'Antiochos IV. Diodore suggère une volonté délibérée de rupture avec les traditions royales, tandis que Tite-Live invoque des notions philosophiques, expliquant ses actions par son incapacité à s'en tenir à un seul « genre de vie ». Parallèlement, les deux livres des Maccabées, bien que constituant une histoire sainte avec une perspective non strictement historique, constituent des sources précieuses. Le Premier livre des Maccabées est riche en détails sur la politique d'Antiochos IV en Judée, tandis que le second livre apporte d’autres éléments contextuels. La nature partisane de ces textes juifs, écrits initialement en hébreu puis en grec pour le premier, et uniquement en grec pour le second, doit être prise en compte dans l'analyse. L’étude souligne donc l’importance d’une lecture critique et comparative des diverses sources pour éviter les biais interprétatifs.
2. Sources non littéraires le monnayage et les tablettes babyloniennes
Au-delà des sources littéraires traditionnelles, l'étude se base sur des documents moins conventionnels, enrichissant l'analyse de la politique d'Antiochos IV. Le monnayage d'Antiochos IV est notable pour son originalité, tranchant avec celui de ses prédécesseurs séleucides, constituant ainsi une source visuelle importante. Les tablettes babyloniennes, rédigées en akkadien, apportent des éléments nouveaux et précis sur sa politique dans l'Orient séleucide. Ces tablettes cunéiformes, principalement découvertes à Babylone et à Uruk, constituent la quasi-totalité des documents cunéiformes de l'époque hellénistique retrouvés à ce jour. Elles incluent des récits événementiels et des documents administratifs, offrant des informations précisément datées sur les relations entre les notables babyloniens et le souverain. L'utilisation de l'araméen comme langue courante à cette époque, tandis que l'akkadien est réservé aux élites et aux milieux religieux, souligne la perspective particulière que ces tablettes offrent, celle des notables traditionnels liés aux temples. Cette perspective est d'autant plus importante qu'elle concerne les interlocuteurs privilégiés des souverains séleucides à une certaine époque.
III.La politique intérieure d Antiochos IV à Antioche imitation du modèle romain
À Antioche, Antiochos IV adopte un comportement inhabituel pour un roi hellénistique. Il imite les pratiques politiques romaines, cherchant la proximité du peuple, occupant des magistratures civiles (démarque et agoranome), et multipliant les libéralités, comme le souligne Tite-Live. Il s'inspire du Commentariolum Petitionis de Cicéron pour sa campagne électorale. Cette imitation du modèle romain, notamment dans les domaines militaire et politique, est peut-être une stratégie pour assurer le succès et la stabilité du pouvoir.
1. L imitation du modèle romain une stratégie politique
L'analyse de la politique intérieure d'Antiochos IV à Antioche met en évidence une tentative d'imitation du modèle politique romain. Les sources, notamment Polybe et Diodore de Sicile, rapportent que le roi fréquentait le peuple, participant même à des magistratures civiles, des actes inhabituels pour un souverain hellénistique. Cette proximité avec le peuple, et son implication dans des fonctions municipales comme démarque et agoranome, se rapprochent des pratiques politiques romaines. L'étude mentionne le Commentariolum Petitionis de Cicéron pour illustrer la manière dont un candidat romain cherchait à gagner la faveur populaire. Antiochos IV, en occupant ces magistratures et en multipliant les actes de générosité envers les citoyens ordinaires, semblait imiter les pratiques électorales romaines. Cette imitation s'étend au domaine militaire avec le défilé de cinq mille soldats armés à la romaine lors des fêtes de Daphné. La notion de politeia, centrale dans la pensée grecque antique, est évoquée. L'intérêt d'Antiochos IV pour la politeia romaine, peut-être influencé par son séjour en otage à Rome, suggeste une volonté d'adopter des éléments de ce modèle politique perçu comme une clé de leur succès. L’ensemble de ces actions, loin d’être des actes incohérents, suggère une stratégie politique visant à renforcer son pouvoir et sa légitimité.
2. La critique des sources antiques proximité du peuple et générosité excessive
Les sources antiques, Polybe, Diodore et Tite-Live, critiquent le comportement d'Antiochos IV à Antioche, le jugeant déviant par rapport aux normes royales hellénistiques. Polybe reproche au roi de fréquenter les artisans, un groupe social perçu comme potentiellement révolutionnaire. Diodore s'étonne de sa familiarité avec le peuple, de son refus de rester cloîtré dans son palais. Tite-Live souligne le risque politique d'un souverain négligeant ses « Amis » (l'administration royale) au profit d'une générosité excessive envers des inconnus. L'étude nuance ces critiques. La recherche d'amis en dehors de la cour n'est pas en soi exceptionnelle. Le parti pris d'Antiochos IV est d’avoir recherché l’amitié non pas de notables, mais de citoyens ordinaires, ce qui peut être interprété comme une conséquence de son intérêt pour la politeia romaine, où peuple, sénat et consuls collaborent au succès de la cité. L'étude réfute l'idée que ces actions soient déraisonnables. Au contraire, la fréquentation de voyageurs, d'orfèvres, et d'artisans était un moyen d'obtenir des informations et des avis sur son royaume, influençant potentiellement son monnayage et l'organisation de fêtes fastueuses comme celles de Daphné.
3. Les magistratures civiques démarque et agoranome
L'étude détaille l'exercice par Antiochos IV de magistratures civiles à Antioche : démarque et agoranome. La fonction de démarque, bien que mieux connue dans le contexte athénien classique, est évoquée comme une magistrature importante au sein d'un dème. L'agoranomie, quant à elle, est une magistrature plus répandue dans le monde grec et hellénistique, concernant la police du marché. À Antioche, ces magistratures étaient pourvues par élection, après une campagne électorale où le roi-candidat se rapprochait du peuple. L'exercice de ces fonctions par le roi lui-même est inhabituel, et souligne sa volonté d'interaction directe avec la population. L'étude compare l'agoranomie à l'édilité romaine, soulignant un parallélisme entre les deux institutions. De même, la magistrature de démarque évoque les tribuns de la plèbe. Antiochos IV imite également la majestas des magistrats romains, utilisant par exemple un siège en ivoire, comme les consuls romains, et multipliant les spectacles publics (à l'instar des jeux organisés par les édiles), démontrant une fois de plus l'influence du modèle romain sur sa politique intérieure.
IV.Antiochos IV et la religion le cas de la Judée
En Judée, la politique d'Antiochos IV diffère radicalement de celle de ses prédécesseurs. Il nomme des grands prêtres (Jason puis Ménélas), autorise la fondation d'une polis à Jérusalem, et profane le Temple en y installant le culte de Zeus Olympien. Les livres des Maccabées rapportent ces événements avec un parti pris marqué, ce qui rend l'interprétation historique difficile. La politique d'Antiochos IV en Judée a entraîné une révolte majeure, contrairement aux autres parties du royaume où les réformes furent moins contestées. Figures clés: Jason et Ménélas (grands prêtres).
1. La politique d Antiochos IV en Judée rupture avec la tradition séleucide
En Judée, la politique d'Antiochos IV marque une rupture significative avec l'approche de ses prédécesseurs. Contrairement à la pratique établie des premiers rois séleucides qui collaboraient avec les élites locales et religieuses (le Grand Prêtre), Antiochos IV intervient directement dans la nomination des Grands Prêtres, nommant d'abord Jason puis Ménélas. Cette intervention directe dans les affaires religieuses juives est rapportée avec force détails dans les livres des Maccabées et les Antiquités juives de Flavius Josèphe, ainsi que plus allusivement dans le livre de Daniel. L'autorisation de la fondation d'une cité à Jérusalem, mentionnée dans les livres des Maccabées, choque les rédacteurs de ces textes. La suite des événements, décrite comme une campagne en Égypte catastrophique, suivie d’un saccage et d'une profanation du Temple où il instaure le culte de Zeus Olympien, est interprétée différemment selon les sources. Un « édit de persécution », dont la réalité historique est débattue, est mentionné, interdisant selon les livres des Maccabées la pratique du judaïsme. Cette politique, radicalement différente des pratiques antérieures, soulève des questions sur les motivations réelles d'Antiochos IV et les conséquences de ces actions.
2. Interprétations divergentes des motivations d Antiochos IV
Les sources historiques proposent des interprétations divergentes des motivations d'Antiochos IV en Judée. La multiplicité des interprétations souligne la difficulté de construire un récit historique objectif à partir de sources partisanes. Les livres des Maccabées, destinés à l'édification du peuple juif, présentent les événements sous un angle très défavorable à Antiochos IV, et avec un biais narratif visant à légitimer la dynastie hasmonéenne. Les auteurs soulignent des détails mineurs de manière disproportionnée s’ils ont une portée symbolique et présentent des pratiques courantes dans l'empire séleucide comme inédites. Plusieurs hypothèses sont envisagées. Pour certains, Antiochos IV aurait cherché à réprimer une révolte de Juifs pieux opposés aux réformes menées par les élites hellénisées. Pour d'autres, il s'agirait d'une simple réorganisation administrative. D'autres encore voient dans ces actions une volonté délibérée de déclencher un conflit pour réaffirmer son autorité après une humiliation subie à Éleusis. Enfin, certains suggèrent une erreur d’appréciation, sans réelle intention d'oppression religieuse. La complexité et la divergence des interprétations confirment la difficulté d'établir une analyse historique définitive sans un examen attentif des sources.
3. Contexte politique et contrôle des temples dans le royaume séleucide
La politique d'Antiochos IV en Judée est mise en perspective avec le contexte plus large du royaume séleucide. La relative absence de troubles ailleurs dans le royaume souligne que sa politique en Judée était particulièrement agressive. L’étude explique que cette politique prolonge en partie des réformes entreprises par ses prédécesseurs. Des représentants du pouvoir séleucide étaient présents dans les temples de Babylonie dès le début de la présence grecque. Cependant, le contrôle des temples par le pouvoir royal semble s'être renforcé à partir du règne de Séleucos IV, aussi bien en Babylonie qu'en Syrie. Une inscription de Maresha, datant de 178 avant notre ère, mentionne une lettre de Séleucos IV nommant un grand prêtre pour toute la région, Judée incluse. L’étude évoque également le rôle d'un prostatès à Jérusalem, nommé Simon, chargé d'intervenir dans les affaires financières du Temple, un signe de l'implication croissante du pouvoir séleucide dans la gestion administrative des sanctuaires. L'installation après 168 d'un Phrygien, Philippe, à Jérusalem et d'Andronicos au sanctuaire samaritain du Mont Garizim, après la révolte, montrent la volonté d'un contrôle total par le pouvoir séleucide des institutions religieuses juives. Cette politique de reprise en main administrative des temples est observée aussi bien en Babylonie qu'en Judée.
V.La politique d Antiochos IV à Babylone et Uruk
À Babylone et Uruk, Antiochos IV poursuit une politique similaire à ses prédécesseurs, privilégiant les relations avec les élites traditionnelles (haut clergé) regroupées autour des temples (Esagil à Babylone, Bit Reš à Uruk). Il maintient le rôle des intermédiaires entre la couronne et la population locale. Il accorde une attention particulière à Babylone, peut-être en restaurant son théâtre, comme le suggèrent certaines inscriptions.
1. Continuité et changement dans la politique séleucide en Babylonie et à Uruk
En Babylonie et à Uruk, la politique d'Antiochos IV est comparée à celle de ses prédécesseurs. Les premiers rois séleucides avaient délégué la gestion des affaires locales aux personnes jouissant de la meilleure légitimité auprès de la population, souvent le haut clergé. À Babylone, le haut clergé du temple d'Esagil, dédié à Marduk, avait su s'imposer comme interlocuteur privilégié auprès d'Alexandre le Grand puis des premiers Séleucides, conservant une influence majeure malgré le déclin de l'akkadien au profit de l'araméen. L'administrateur civil du sanctuaire, le šatammu, servait d'intermédiaire entre le pouvoir royal et les Babyloniens, aidé par la kiništu, l'assemblée de l'Esagil. À Uruk, les souverains hellénistiques utilisaient une approche similaire, privilégiant les notables suméro-accadiens traditionnels liés au temple de Bit Reš, consacré à Anu. L’exemple d'Anu-uballiṭ, gouverneur d'Uruk sous Séleucos II, ayant reçu un nom grec (Nikarchos), illustre l'interaction entre les élites locales et le pouvoir séleucide. Cette collaboration entre le pouvoir royal et les élites religieuses et traditionnelles caractérise la politique des premiers Séleucides, une continuité que l'on retrouve en partie sous Antiochos IV.
2. La fondation d une polis à Babylone l intérêt d Antiochos IV pour la cité grecque
L'étude évoque la création d'une polis à Babylone sous le règne d'Antiochos IV, bien que la date précise de sa fondation fasse encore débat. L'épigraphie atteste cependant la présence de Grecs à Babylone dès le IIIe siècle avant notre ère. Une inscription découverte à Andros, datant probablement du IIIe siècle, mentionne un certain Drômôn, fils de Phanodèmos, habitant de Babylone, honoré de proxénie et de titres honorifiques par la cité d'Andros. Une autre inscription grecque, OGI 253, mise au jour en Babylonie, et datant d’une période légèrement plus tardive (167/6 av. J.-C.), qualifie Antiochos IV de « fondateur et bienfaiteur de la cité ». Ce terme de « fondateur » peut avoir deux significations : fondateur d'une cité ou bienfaiteur dont les actions sont comparables à une nouvelle fondation. La restauration du théâtre de Babylone au début du IIe siècle avant notre ère pourrait être attribuée à Antiochos IV. Même si Antiochos IV n'est pas le fondateur initial de la cité grecque de Babylone, son implication dans sa vie et son développement est évidente, illustrant l'intérêt du roi pour les modèles et structures urbains grecs dans son empire. Cette politique de soutien aux élites hellénisées est un point important à noter dans l'analyse de la politique d'Antiochos IV.
3. Comparaison des politiques d Antiochos IV à Antioche Babylone et Jérusalem
L'étude propose une comparaison des politiques d'Antiochos IV à Antioche, Babylone et Jérusalem. Bien que des parallèles existent entre les réformes entreprises à Jérusalem et Babylone, l'étude souligne l’importance de comparer ces politiques à celle d’Antioche. Les contextes sont différents : un souverain séleucide ne s'adresse pas de la même manière à des Grecs vivant en cité et à des populations indigènes. Les similarités incluent une volonté de créer des structures grecques (polis) dans des zones habitées par des populations non-grecques. Les éléments typiques d’une cité grecque (gymnase, par exemple) sont présents dans les trois villes. L’étude note l'apparition possible d'une boulè à Babylone. Cependant, les différences sont aussi notables : l’approche d’Antiochos IV est plus directe et interventionniste à Jérusalem. À Babylone et Uruk, il conserve l'approche traditionnelle des Séleucides, collaborant avec les élites religieuses locales. L'étude conclut en mettant en lumière la complexité et la diversité des stratégies employées par Antiochos IV pour gérer son vaste empire, en fonction des contextes politiques, sociaux et religieux de chaque région.
VI.Conclusion Cohérence et défis du règne d Antiochos IV
En conclusion, malgré l'image contrastée d'Antiochos IV, ses actions, même si perçues comme incohérentes par certains auteurs antiques, s'inscrivent dans un projet politique plus large visant à consolider son pouvoir au sein du royaume séleucide. Il adapte sa stratégie selon les contextes (Antioche, Judée, Babylone), cherchant de nouveaux alliés en marge des élites traditionnelles, tout en cherchant à légitimer son règne par l'imitation du modèle romain et une image de roi-dieu épiphane. La documentation disponible, souvent partisane, rend cependant l'interprétation difficile et ne couvre qu'une partie du royaume séleucide.
1. Le règne difficile d Antiochos IV et la nécessité de légitimation
La conclusion souligne les difficultés du règne d'Antiochos IV. Comme tout souverain séleucide, il devait prouver sa légitimité, tâche rendue plus complexe par les conséquences de la paix d'Apamée qui limitait l'expansion occidentale de l'empire et par son accession compliquée au trône. Pour consolider son pouvoir, Antiochos IV a mis en œuvre deux types de mesures : des mesures de continuité, prolongeant les politiques de ses prédécesseurs, et des mesures novatrices, propres à son règne. L'interprétation de ces mesures repose sur un faisceau d'indices convergents, permettant de formuler des hypothèses probables mais non définitivement prouvées. L’analyse prend en compte la faiblesse structurelle du pouvoir séleucide, dont la légitimité reposait sur les victoires militaires. La mise à l’écart des interlocuteurs traditionnels (élites locales) s’explique par la volonté d’Antiochos IV de trouver de nouveaux alliés.
2. La recherche de nouveaux alliés et la modification des modalités d apparition royale
Antiochos IV semble avoir cherché de nouveaux soutiens, privilégiant des communautés nouvelles et des citoyens ordinaires à Antioche. Ailleurs dans son royaume, il abandonne l'alliance avec les élites traditionnelles, déléguant des responsabilités à de nouveaux interlocuteurs. A Jérusalem, Jason et Ménélas sont nommés grands prêtres ; à Babylone, les lettres royales sont adressées directement aux citoyens ; à Uruk, une famille de notables est écartée au profit de nouveaux venus. Cette stratégie témoigne d’un changement d'approche par rapport à ses prédécesseurs qui privilégiaient les collaborations avec les élites locales. L’étude évoque la modification des modalités d'apparition royale. À Antioche, Antiochos IV rompt avec les conventions habituelles des souverains hellénistiques, cherchant la proximité du peuple ; à Babylone, la lecture des lettres royales se fait désormais au théâtre, au lieu de l'assemblée du temple de l'Esagil. Ces changements suggèrent une stratégie consciente pour remodeler l'image du roi et se rapprocher directement des citoyens.
3. Cohérence du projet politique d Antiochos IV et limites de l interprétation historique
En conclusion, malgré les critiques des sources antiques qui le dépeignent comme un souverain incohérent, les actions d'Antiochos IV forment un ensemble cohérent lorsqu'on les considère en lien avec les problèmes structurels de la monarchie séleucide. Son objectif était de renforcer le pouvoir royal et l'influence du trône. Il a tenté de s’inspirer du modèle romain, et cherché des soutiens au sein du peuple. Il a aussi cherché à se présenter comme un dieu épiphane, renforçant sa légitimité. Son intérêt pour les institutions civiques et la cité, outil administratif commode pour toute monarchie hellénistique, s’explique par la nécessité de renforcer le trône séleucide. L'étude conclut en soulignant la difficulté de tirer des conclusions historiques définitives à partir de sources fragmentaires, partiales et souvent hostiles au roi. La documentation étant incomplète et limitée géographiquement, l’analyse reste une interprétation probable, distinguant clairement les faits certains, les hypothèses probables et les possibilités.
