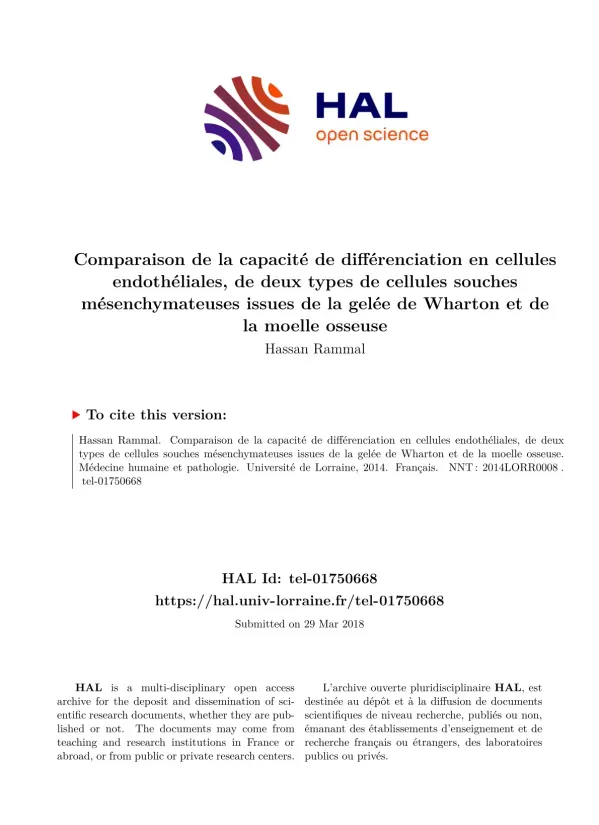
Comparaison de la capacité de différenciation des cellules souches mésenchymateuses
Informations sur le document
| Auteur | Hassan Rammal |
| school/university | Université de Lorraine |
| subject/major | Sciences de la vie et de la santé |
| Type de document | Thèse |
| city_where_the_document_was_published | Nancy |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 5.41 MB |
- Cellules souches mésenchymateuses
- Différenciation cellulaire
- Médecine régénérative
Résumé
I.Nécessité de Substituts Vasculaires et Limites Actuelles
Les maladies vasculaires, dont l'athérosclérose, constituent une cause majeure de mortalité. Le remplacement des vaisseaux de petit diamètre (<6mm) pose problème en raison de la formation de caillots et d'hyperplasie intimale. Les substituts vasculaires actuels, souvent à base de polymères comme le Téflon® ou le Dacron®, sont efficaces pour les gros diamètres, mais moins pour les petits. L'obtention d'une surface hémocompatible est un défi majeur de l'ingénierie vasculaire.
1. Le Défi du Remplacement Vasculaire
L'avènement des biomatériaux a conduit à l'utilisation de matrices artificielles pour la fabrication de substituts artériels. Des polymères tels que le Téflon® et le Dacron® sont employés avec succès dans la chirurgie vasculaire pour le traitement des artères de gros diamètre. Cependant, le remplacement des vaisseaux de petit diamètre (inférieur à 6 mm) pose un problème majeur. À court terme, la formation de caillots est fréquente, tandis qu'à long terme, une hyperplasie intimale se développe près de l'anastomose. Le développement d'une surface physiologiquement hémocompatible reste un défi crucial. La recherche en ingénierie vasculaire vise à créer des substituts vasculaires mimant au mieux les caractéristiques d'un vaisseau natif, avec une surface luminale hémocompatible et similaire à celle retrouvée in vivo. L’objectif est donc de surmonter les limitations actuelles des prothèses vasculaires afin d’améliorer la réussite des interventions chirurgicales sur les artères de petit calibre.
2. Incidence des Pathologies Vasculaires et Limites des Autogreffes
Les pathologies vasculaires coronariennes et périphériques sont parmi les principales causes de décès dans le monde. L'athérosclérose, avec la formation de plaques d'athérome, peut mener à l'obstruction des vaisseaux et avoir des conséquences fatales. Lorsque la désobstruction est impossible, le remplacement vasculaire devient nécessaire. Le recours aux vaisseaux autologues est privilégié, mais un tiers des patients n'ont pas accès à cette solution en raison d'une utilisation antérieure, d'une taille inadaptée ou d'une qualité médiocre du tissu disponible. Ce manque de disponibilité des autogreffes constitue un frein majeur. L’objectif est ainsi de développer des substituts vasculaires cellularisés, particulièrement pour les petits diamètres, permettant une meilleure adaptation aux contraintes homéostasiques du corps. La recherche se concentre sur la création de vaisseaux fonctionnels, capables de s’intégrer parfaitement au système circulatoire du patient.
3. Les Défis de l Hémocompatibilité et de la Biocompatibilité
Le texte souligne les défis liés à l'hémocompatibilité, c'est-à-dire la capacité d'un matériau à interagir de manière appropriée avec le sang sans provoquer de réactions indésirables comme la formation de thrombus (caillots sanguins). Une surface hémocompatible est essentielle pour le succès des substituts vasculaires. L'utilisation de matériaux biocompatibles, c'est-à-dire non thrombogènes et non immunogènes, est donc cruciale pour minimiser les risques de rejet et de complications post-opératoires. La durabilité et la résistance aux infections des substituts sont également des éléments importants à considérer pour assurer leur efficacité à long terme. Le texte mentionne aussi l’utilisation d’anticoagulants (warfarine, aspirine, clopidogrel) pour prévenir la thrombose, ainsi que des polymères à libération de molécules antiprolifératives (paclitaxel, sirolimus) pour inhiber la resténose, malgré des cas de thrombose tardive rapportés, soulignant la nécessité de diversifier les approches.
4. Analyse des Autogreffes et Facteurs de Réussite
Les autogreffes, prélevées directement chez le patient, représentent une solution privilégiée pour le remplacement vasculaire, notamment la veine saphène pour les pontages périphériques. Elles affichent un taux de réussite élevé (80 à 90%) à un an grâce à leur facilité d'emploi, leur stabilité et leur perméabilité. Cependant, les occlusions peuvent survenir, principalement dues à une hyperplasie intimale au niveau des sutures d'anastomose ou de segments potentiellement traumatisés durant le prélèvement. Des progrès considérables ont été réalisés dans l’identification des facteurs déterminant la réussite d’une greffe vasculaire. On distingue des facteurs mécaniques (résistance, perméabilité, compliance, élasticité) et des facteurs biologiques (biocompatibilité, durabilité, résistance aux infections, comportement in vivo). Enfin, des facteurs cliniques incluent le temps de fabrication, le coût, la disponibilité et les caractéristiques dimensionnelles des greffons. L’ingénierie tissulaire des vaisseaux représente une approche prometteuse pour créer des substituts artificiels réunissant l’ensemble de ces caractéristiques.
II.Sources de Cellules pour l Ingénierie Vasculaire
La recherche explore différentes sources de cellules pour la création de substituts vasculaires cellularisés. Les cellules endothéliales (CEs) matures, bien que fonctionnelles, présentent une prolifération limitée. Les cellules souches mésenchymateuses (CSMs), notamment celles issues de la gelée de Wharton (GW) du cordon ombilical, sont une alternative prometteuse grâce à leur facilité d'extraction, leur forte capacité de prolifération et leur potentiel de différenciation en CEs et cellules musculaires lisses (CMLs). La différenciation des CSMs est influencée par divers facteurs: milieu de culture, densité cellulaire, surface de culture, etc.
1. Cellules Endothéliales Matures Limites et Alternatives
Les cellules endothéliales (CEs) matures, utilisées pour tapisser les substituts vasculaires, peuvent être isolées à partir d'artères humaines. Cependant, leur capacité de prolifération est limitée, et elles subissent une dédifférenciation progressive lors de leur expansion in vitro. Cette limitation justifie la recherche de sources cellulaires alternatives, plus facilement accessibles et présentant un potentiel de prolifération plus élevé. L'objectif est d'identifier une source de CEs non traumatisante pour le patient et capable de se multiplier rapidement pour assurer un revêtement adéquat des substituts vasculaires. La difficulté de la prolifération in vitro des CEs matures et le risque de contamination, associé à la nécessité d’une expertise technique chirurgicale importante, oriente la recherche vers des alternatives plus efficaces et moins invasives.
2. Cellules Souches Mésenchymateuses CSMs Une Solution Prometteuse
Face aux limitations des CEs matures, l'attention s'est tournée vers les cellules souches mésenchymateuses (CSMs), notamment celles issues de la gelée de Wharton (GW) du cordon ombilical. Ces CSMs offrent plusieurs avantages: une extraction simple et non invasive, une capacité de prolifération élevée, et un temps de différenciation accéléré. L'utilisation des CSMs de la GW représente donc une avancée significative dans le domaine de l'ingénierie vasculaire, car elles répondent aux besoins d'une source cellulaire facilement accessible et capable de se multiplier rapidement. Cependant, la différenciation des CSMs vers une lignée cellulaire spécifique, comme la lignée endothéliale, dépend de plusieurs facteurs, incluant le milieu de culture, la densité d'ensemencement, les caractéristiques de la surface de culture, la fraction d'oxygène et les contraintes mécaniques. L’identification et le contrôle de ces facteurs sont donc importants pour optimiser le processus de différenciation.
3. Autres Sources de Cellules et Leurs Défis
Le document mentionne brièvement d'autres sources de cellules pour l'ingénierie vasculaire, soulignant leurs avantages et inconvénients. Les cellules souches embryonnaires humaines (ESCs), bien que pluripotentes et capables de différenciation en cellules endothéliales, soulèvent des questions éthiques et posent des risques de rejet immunologique et de formation de tératomes. Les cellules souches pluripotentes induites (iPS) sont présentées comme une alternative potentiellement inépuisable, facile à produire et sans problème immunologique ni question d'éthique. Cependant, le texte souligne la faible efficacité de la reprogrammation des fibroblastes en iPS (moins de 0.1%) et l'utilisation de vecteurs viraux, pouvant entraîner une intégration aléatoire de l'ADN viral dans le génome cellulaire. Enfin, le document aborde l’utilisation des cellules progénitrices endothéliales (EPCs), dont la capacité à se différencier en CEs matures est limitée par leur faible quantité et leur perte de potentiel après culture prolongée. Ces différents aspects mettent en évidence la nécessité de trouver un équilibre entre la disponibilité, l’efficacité de différenciation et les risques associés aux différentes sources cellulaires.
III.Utilisation des Cellules Souches Mésenchymateuses CSMs
L'étude se concentre sur la différenciation des CSMs de la moelle osseuse (MO) et de la gelée de Wharton (GW) en cellules endothéliales. Des films multicouches de polyélectrolytes (PAH-PSS), avec une couche terminale de PAH chargée positivement, sont utilisés pour fonctionnaliser les surfaces de culture. Ces films ont démontré une amélioration de l'adhésion et de la viabilité des CEs dans des études précédentes. L'objectif est de créer un environnement favorable à la différenciation des CSMs en cellules endothéliales fonctionnelles pour l'ingénierie vasculaire.
1. Objectif Principal Différenciation des Cellules Souches Mésenchymateuses
L'objectif principal de l'étude est de différencier les cellules souches mésenchymateuses (CSMs) issues de la moelle osseuse (MO) et de la gelée de Wharton (GW) en cellules endothéliales. Ce choix repose sur le potentiel multipotent des CSMs, qui les positionne comme cellules d'intérêt majeur en ingénierie tissulaire. La moelle osseuse est traditionnellement la source principale de CSMs, mais son isolement est une procédure invasive et douloureuse. Les cellules périnatales, et plus précisément les CSMs de la gelée de Wharton (GW), constituent une alternative intéressante car leur extraction est simple, non invasive, et ne soulève pas de problèmes éthiques. L'étude vise à comparer le comportement et la capacité de différenciation des CSMs issues de ces deux sources en cellules endothéliales fonctionnelles. La différenciation cellulaire est un processus complexe influencé par divers facteurs, dont la fonctionnalisation de la surface de culture, point clé de cette étude.
2. Films Multicouches de Polyélectrolytes PAH PSS Un Support de Culture Optimalisé
Pour optimiser la différenciation des CSMs, l'étude utilise des films multicouches de polyélectrolytes (PAH-PSS), constitués de poly(allylamine hydrochloride) (PAH) et de poly(styrène sulfonate) (PSS). Ces films sont choisis suite à des études préliminaires ayant démontré leur efficacité à modifier les surfaces de culture (verre, plastique, artères décellularisées, PTFE), en les rendant bioactives et adhésives pour divers types cellulaires, dont les cellules endothéliales, les cellules progénitrices endothéliales (EPCs) et les CSMs de la MO. La construction des films, avec une couche terminale de PAH chargée positivement, est motivée par les résultats positifs obtenus dans des travaux précédents concernant l'adhésion et la viabilité des cellules endothéliales ainsi que la différenciation in vitro des EPCs en cellules endothéliales. L’utilisation de ce support vise à créer un environnement optimal pour la différenciation des CSMs de la MO et de la GW vers un phénotype endothélial.
3. Comparaison des CSMs de la Moelle Osseuse MO et de la Gelée de Wharton GW
L’étude compare le comportement des CSMs issues de la moelle osseuse (MO) et de la gelée de Wharton (GW) cultivées sur des films (PAH-PSS)3-PAH, terminant par une couche de PAH chargée positivement. Les résultats préliminaires suggèrent une différence de comportement entre les CSMs de la GW et celles de la MO sur ce type de support. L'analyse des résultats permettra de déterminer si la source des CSMs (MO vs GW) influence leur différenciation et leur morphologie sur cette surface fonctionnalisée. L'utilisation des CSMs de la GW est justifiée par leur accessibilité facile et leur extraction non invasive, contrairement aux CSMs de la MO, rendant cette source plus attractive pour les applications cliniques. Une caractérisation complète des CSMs de la GW et de la MO sera faite avant et après culture sur le support (PAH-PSS)3-PAH pour identifier d’éventuelles différences en terme de phénotype.
IV.Résultats et Discussion sur la Différenciation Cellulaire
Les résultats montrent que les CSMs-GW, cultivées sur des films (PAH-PSS)4, présentent un comportement différent des CSMs-MO et des cellules endothéliales (CEs) matures. Une croissance tridimensionnelle a été observée pour les CSMs-GW sur les films terminant par une couche de PAH, alors qu'une croissance bidimensionnelle conventionnelle est obtenue avec une couche terminale de PSS. La charge de la surface du film joue donc un rôle crucial dans le comportement des cellules. La stimulation avec EGM-2® améliore la croissance et la différenciation des CSMs-GW en CEs fonctionnelles, caractérisées par l'incorporation de Dil-Ac-LDL et la production de vWF.
1. Comportement Différentiel des CSMs sur Films PAH PSS
L'étude a révélé un comportement différentiel des cellules souches mésenchymateuses (CSMs) de la gelée de Wharton (GW) et de la moelle osseuse (MO) cultivées sur des films de polyélectrolytes (PAH-PSS). Alors que les CSMs de la MO cultivées sur des films (PAH-PSS)3-PAH, terminant par une couche de PAH chargée positivement, prolifèrent normalement, les CSMs de la GW s'organisent en structures tridimensionnelles après 10 jours de culture. Ce résultat inattendu suggère une influence de la charge de surface du film sur le comportement cellulaire. Ce comportement tridimensionnel des CSMs de la GW sur le film (PAH-PSS)3-PAH, inattendu et non désiré dans le cadre de la création d'un revêtement endothélial, a conduit à explorer d'autres configurations de films. Les résultats observés soulignent l’importance de la nature du support de culture et son impact sur la morphologie et la croissance des CSMs.
2. Influence de la Charge de Surface sur la Morphologie Cellulaire
De manière surprenante, l'utilisation de films (PAH-PSS)4 terminant par une couche de PSS chargée négativement a induit une croissance bidimensionnelle conventionnelle des CSMs de la GW, similaire à celle observée pour les CSMs de la MO et les cellules endothéliales matures sur des films terminant par une couche de PAH. Cette observation suggère que la charge de la couche terminale des films de polyélectrolytes est un facteur déterminant dans l'organisation spatiale des CSMs de la GW. La couche terminale définit la polarité de l'architecture du film et semble influencer directement la prolifération cellulaire, les CSMs de la GW ayant une préférence pour les surfaces négativement chargées et une croissance bidimensionnelle, en opposition à la formation de structures tridimensionnelles observées sur les films avec une couche terminale positive. Ces résultats suggèrent un lien entre la charge de surface et le comportement cellulaire.
3. Différenciation des CSMs GW en Cellules Endothéliales Fonctionnelles
L’étude a démontré que la combinaison de films (PAH-PSS)4 et d’un milieu de culture enrichi en facteurs de croissance angiogéniques (EGM-2) stimule la différenciation des CSMs de la GW en cellules endothéliales (CEs) fonctionnelles. Après 14 jours de stimulation, les CSMs-GW cultivées sur le film (PAH-PSS)4 ont montré une capacité d'incorporation de lipoprotéines acétylées (Ac-LDL), un marqueur des CEs fonctionnelles. De plus, une expression significative du facteur de Von Willebrand (vWF), une glycoprotéine impliquée dans l'hémostase, a été observée dans ces cellules. En comparaison, les CSMs cultivées sur du collagène de type I n’ont pas démontré de différenciation significative en CEs fonctionnelles. Ces résultats soulignent la synergie entre le support de culture et le milieu enrichi en facteurs de croissance pour promouvoir la différenciation des CSMs-GW en CEs fonctionnelles. L’étude suggère que la surface (PAH-PSS)4 favorise l'adhésion, la prolifération et la différenciation endothéliale.
V.Conclusion et Perspectives
L'étude démontre le potentiel des CSMs-GW pour la production de cellules endothéliales fonctionnelles pour l'ingénierie vasculaire. La fonctionnalisation des surfaces de culture par des films de polyélectrolytes (PAH-PSS), en particulier ceux terminant par une couche de PSS, améliore la différenciation cellulaire. Ces résultats ouvrent des perspectives pour le développement de substituts vasculaires biocompatibles et efficaces pour le traitement des maladies cardiovasculaires. Des recherches futures exploreront l'optimisation de la différenciation cellulaire et les propriétés mécaniques des néo-tissus.
1. Synthèse des Résultats Comportement des CSMs sur Différents Supports
L'étude a mis en évidence un comportement différent des cellules souches mésenchymateuses (CSMs) de la gelée de Wharton (GW) et de la moelle osseuse (MO) en fonction du support de culture. Sur les films de polyélectrolytes (PAH-PSS) terminant par une couche de PAH chargée positivement, les CSMs-MO prolifèrent normalement, tandis que les CSMs-GW adoptent une organisation tridimensionnelle. À l'inverse, sur des films (PAH-PSS) terminant par une couche de PSS chargée négativement, les CSMs-GW présentent une croissance bidimensionnelle conventionnelle, similaire aux CSMs-MO et aux cellules endothéliales matures. Ces observations soulignent l'influence cruciale de la charge de surface du film sur le comportement des CSMs, notamment sur leur organisation spatiale. L'utilisation de films (PAH-PSS) avec une couche terminale de PSS semble donc plus appropriée pour obtenir une croissance mono-couche nécessaire à la formation d'un revêtement endothélial fonctionnel.
2. Différenciation Endothéliale et Fonctionnalité des Cellules
L'utilisation d'un milieu de culture enrichi en facteurs de croissance angiogéniques (EGM-2) en combinaison avec les films (PAH-PSS)4 a permis de stimuler la différenciation des CSMs-GW en cellules endothéliales (CEs) fonctionnelles. Après 14 jours de stimulation, ces cellules ont démontré la capacité d'incorporer des lipoprotéines acétylées (Ac-LDL) et d'exprimer le facteur de Von Willebrand (vWF), confirmant leur phénotype endothélial et leur fonctionnalité. Cette différenciation n'a pas été observée de manière significative pour les CSMs cultivées sur du collagène de type I, soulignant l’impact du support de culture et de la stimulation angiogénique sur le processus de différenciation. Ces résultats confirment le potentiel des CSMs-GW, combinées à une surface fonctionnalisée, pour la construction de substituts vasculaires.
3. Perspectives et Recherches Futures
Les résultats obtenus ouvrent des perspectives prometteuses pour l'ingénierie vasculaire, notamment pour la création de substituts vasculaires fonctionnels à partir de CSMs-GW. L'utilisation des films de polyélectrolytes (PAH-PSS)4 avec une couche terminale négative apparaît comme une stratégie efficace pour favoriser la différenciation endothéliale et une croissance bidimensionnelle des cellules. Des études futures devront approfondir l'influence de la charge de surface en utilisant d'autres composés chargés positivement comme le chitosan, pour confirmer le rôle déterminant de la polarité du film sur le comportement des CSMs. L'analyse de l'expression génique et protéique dans les structures tridimensionnelles formées par les CSMs-GW sur les films terminant par une couche de PAH permettra de mieux comprendre leur comportement et leur potentiel dans les applications de génie tissulaire. L’étude de l’impact d’autres paramètres (environnement cellulaire, densité cellulaire) devra être poursuivie pour optimiser encore le processus de différenciation.
