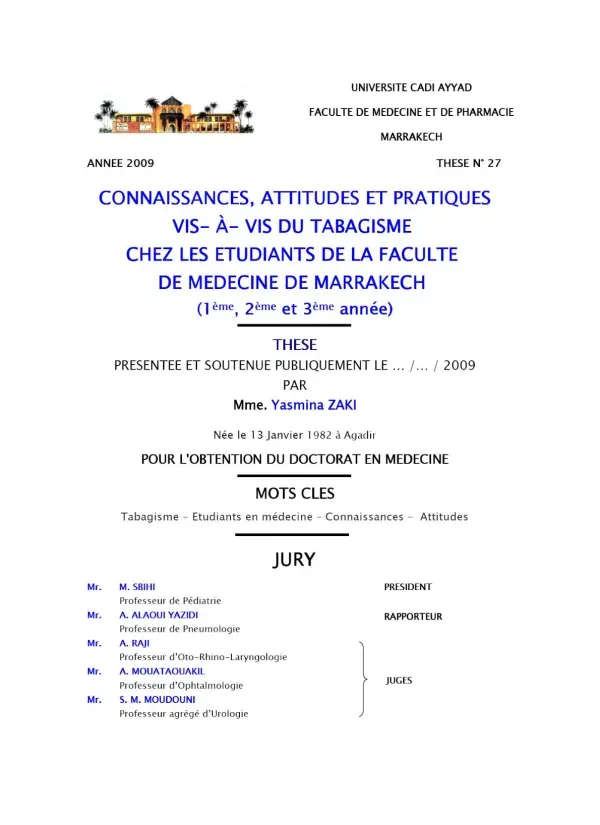
Connaissances et Dédicaces : Étude sur le Tabagisme chez les Étudiants de la FMPM
Informations sur le document
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 1.12 MB |
- tabagisme
- dédicaces
- reconnaissance
Résumé
I.Prévalence du tabagisme chez les étudiants en médecine de Marrakech
Une étude transversale menée en 2007 auprès de 399 étudiants de la Faculté de Médecine de Marrakech (FMPM) a révélé une prévalence du tabagisme de 7,3%. Ce taux est significativement plus élevé chez les garçons (14,3%) que chez les filles (0%). La prévalence varie selon l'année d'étude et l'âge, avec un taux plus important chez les étudiants de plus de 20 ans (10,6%) et chez les non-pratiquants de la prière (28,8%). L'initiation au tabagisme se fait principalement au lycée (71,4%) et le plaisir est le principal motif (75,8%). Environ 57,1% des fumeurs ont tenté d'arrêter de fumer. Cette prévalence est faible comparée à d'autres études nationales et internationales.
1. Prévalence globale du tabagisme à la FMPM
L'étude, réalisée entre le 3 avril et le 7 mai 2007 auprès de 399 étudiants des trois premières années de la Faculté de Médecine de Marrakech (FMPM), a révélé une prévalence globale du tabagisme de 7,3 %. Il est important de noter que ce taux est basé sur un échantillon de 399 questionnaires valides, sur un total de 422 distribués, soit un taux de participation de 80%. Cette prévalence, considérée comme faible par rapport à d’autres études nationales et internationales, est très différente selon le genre. En effet, elle atteint 14,3 % chez les garçons, contre 0 % chez les filles. La méthodologie employée est une enquête transversale par auto-questionnaire, avec une analyse statistique utilisant le test du Chi2. La différence est jugée significative si le risque d'erreur est inférieur à 5%.
2. Prévalence du tabagisme selon l année d étude et l âge
La prévalence du tabagisme varie en fonction de l'année d'étude : 8,7% en première année, 1,6% en deuxième année et 10,8% en troisième année (p=0,0099). Cette variation suggère une évolution possible du taux de fumeurs au cours des études de médecine, bien que l'étude ne permette pas d'établir de conclusion définitive sur l'influence des études médicales sur le comportement tabagique. La prévalence est également significativement différente selon les tranches d'âge. Le taux de fumeurs est respectivement de 4,5% et 10,6% dans les tranches d'âge ≤20 ans et >20 ans (p=0,015). Ceci met en lumière le rôle de l'âge sur l’initiation et le maintien de l’habitude tabagique.
3. Influence de la pratique religieuse et du statut familial
L'étude révèle une corrélation significative (p<0,0001) entre la pratique de la prière et le tabagisme. Le taux de fumeurs est considérablement plus élevé chez les non-pratiquants (28,8%) que chez les pratiquants (3,3%). Il s'agit d'un facteur socioculturel important à prendre en compte.Concernant le statut familial, tous les étudiants fumeurs de l'étude étaient célibataires, contrairement aux résultats variables observés dans d'autres études. A Dakar, par exemple, une étude a montré que la plupart des fumeurs étaient célibataires, sauf en 6ème année où 28% étaient mariés. Cette différence souligne l’importance de contextes culturels et sociétaux distincts.
4. Age de début du tabagisme lieu d initiation et motif principal
L’analyse montre que 92,3% des fumeurs ont commencé à fumer entre 15 et 20 ans, soulignant la précocité de l’initiation au tabagisme dans ce groupe. Le lieu d'initiation au tabagisme se situe principalement au lycée (71,4%) et, dans une moindre mesure, à la faculté (21,4%). Il est pertinent de remarquer que dans 50% des cas, les étudiants fument au sein même de l'enceinte universitaire. Le motif principal de l’initiation au tabagisme est le plaisir, cité par 75,8% des fumeurs. Ces informations soulignent l'importance des facteurs environnementaux (milieu scolaire, pairs) et de l'influence sociale sur le comportement des jeunes fumeurs.
5. Tentatives de sevrage et comparaison internationale
Un pourcentage significatif de fumeurs (57,1%) a rapporté avoir déjà tenté d’arrêter de fumer. Cette donnée met en lumière le souhait de nombreux étudiants de renoncer à cette addiction. Enfin, il est essentiel de comparer la prévalence du tabagisme observée à Marrakech avec des études menées dans d'autres pays. Par exemple, au Japon, 44,2% des élèves infirmiers avaient commencé à fumer avant l'université. De même, aux Etats-Unis, 81% des étudiants universitaires avaient commencé avant 20 ans. Ces comparaisons internationales permettent de contextualiser les résultats de l'étude marocaine et d'identifier les spécificités du contexte local.
II.Connaissances et attitudes des étudiants face au tabagisme
L'étude a également évalué les connaissances et les attitudes des étudiants face au tabagisme. Bien que la majorité des étudiants soient conscients des dangers du tabac, notamment le cancer du poumon et les maladies cardio-respiratoires, leur connaissance des autres risques reste limitée. Une majorité d'étudiants considèrent que le personnel de santé, et les médecins en particulier, devraient jouer un rôle actif dans la prévention du tabagisme et le sevrage tabagique. Cependant, une proportion importante d'étudiants estiment ne pas posséder suffisamment de connaissances pour conseiller efficacement les fumeurs souhaitant arrêter. La sensibilisation à la loi marocaine anti-tabac de 1991 reste également faible.
1. Connaissance des risques du tabagisme
L'étude a révélé que les étudiants de la FMPM, même s'ils connaissent les principaux risques du tabagisme (cancer du poumon et maladies cardio-pulmonaires), présentent des lacunes concernant d'autres conséquences. Chez les fumeurs, le cancer du poumon et les problèmes cardio-pulmonaires étaient les plus cités, tandis que d'autres cancers et maladies (angine, hémorragie cérébrale) étaient beaucoup moins connus. Chez les non-fumeurs, le cancer du poumon et du larynx étaient les plus cités, les autres pathologies étant moins mentionnées. De plus, la connaissance des risques varie selon l'année d'étude, les étudiants de troisième année ayant une meilleure connaissance de certains risques spécifiques (angor, artérite, certains cancers). Ces résultats soulignent la nécessité d'améliorer l'éducation sanitaire sur les conséquences multiples du tabagisme.
2. Attitudes face au tabagisme et rôle du personnel de santé
L'étude explore les attitudes des étudiants face au tabagisme et le rôle perçu du personnel de santé. Une majorité (60,7%) déclare mettre en garde les patients contre les méfaits du tabac en cas de pathologie liée au tabac, mais seulement 10,5% le font systématiquement, même en l'absence de maladie. Seulement 37% des étudiants estiment avoir les connaissances suffisantes pour conseiller les fumeurs souhaitant arrêter. Il est intéressant de noter que 93,7% des étudiants estiment que le personnel de santé doit donner le bon exemple en ne fumant pas et que 89,7% considèrent qu'il est de la responsabilité du médecin de convaincre les gens d'arrêter de fumer. Ces chiffres reflètent une certaine conscience des enjeux mais soulignent aussi un décalage entre les intentions et les compétences des futurs médecins.
3. Connaissance de la loi anti tabac et participation à des campagnes
La connaissance de la loi marocaine anti-tabac de 1991 (loi n°15-91) est faible parmi les étudiants. Ce manque de connaissance, couplé à des informations imprécises sur les méfaits du tabac, suggère un besoin d'efforts supplémentaires en matière d'information et de sensibilisation. Seulement 7,2% des étudiants interrogés avaient déjà participé à une campagne anti-tabac. Ce faible taux de participation met en lumière la nécessité d'une intervention plus active et plus ciblée pour informer et sensibiliser les étudiants et le grand public sur l'existence et le contenu de la loi anti-tabac. L’étude met en évidence un manque d’implication active, qui souligne l’importance d'une éducation sanitaire plus précoce et plus complète.
III.Facteurs associés au tabagisme et prévention
Plusieurs facteurs sont associés à l'augmentation du risque de tabagisme chez les étudiants, notamment l'influence familiale (présence d'un proche fumeur), l'âge de début du tabagisme (principalement entre 15 et 20 ans) et le manque de pratique religieuse. Les résultats suggèrent l'importance d'interventions préventives ciblant les jeunes, notamment à travers des programmes d'éducation à la santé axés sur la prévention du tabagisme dès l'âge de 12-14 ans et la sensibilisation aux méfaits du tabac, y compris les risques moins connus. Une meilleure formation des futurs médecins sur le sevrage tabagique est également indispensable.
1. Influence de l environnement familial et social
L'étude met en évidence le rôle significatif de l'environnement familial et social dans le tabagisme des étudiants. 80,8% des étudiants fumeurs ont déclaré la présence d'un proche fumeur dans leur entourage. D'autres études confirment l'influence du tabagisme parental, Bentalha [29] soulignant le rôle du père et des amis pour les garçons, et celui de la mère et des sœurs pour les filles. Badouri [28] note une augmentation du taux de fumeurs lorsque le père fume (27,1% vs 23,1%). L'influence du tabagisme maternel est également observée. Chader [31] insiste sur l'impact de l'exemple donné par l'entourage familial et amical, un facteur confirmé par des études en Turquie [73] où 37% des jeunes fumeurs ont des membres de famille fumeurs contre 25,6% pour les non-fumeurs. L'interdiction parentale de fumer, inversement, est associée à une diminution du tabagisme chez les adolescents, comme le montrent les travaux du Baromètre Santé 2000 [76] et d'Agnès Hochard [77].
2. Pratiques religieuses et réussite académique
La pratique de la prière apparaît comme un facteur protecteur contre le tabagisme. L'étude révèle une différence significative (p<0,0001) entre le taux de fumeurs chez les pratiquants (3,3%) et les non-pratiquants (28,8%). Ce résultat met en lumière l'influence des facteurs religieux et culturels sur le comportement tabagique. Par ailleurs, une relation inverse est observée entre le temps consacré aux études et le tabagisme. Les étudiants qui consacrent plus de 20 heures par semaine à leurs études ont moins de chances d'être fumeurs, ce qui suggère un lien entre réussite académique et abstinence tabagique. Le tabagisme semble associé à un mode de vie moins régulier et à une moins bonne intégration familiale, renforçant l’hypothèse d'un comportement anomique.
3. Stratégies de prévention primaire et rôle des professionnels de santé
Pour réduire la prévalence du tabagisme, des stratégies de prévention primaire doivent cibler les jeunes, notamment les adolescents, les femmes et les personnes à faibles revenus [89]. Ces stratégies doivent prendre en compte les facteurs environnementaux (famille, amis), les facteurs liés à la personnalité (connaissances, attitudes) et les situations à haut risque (influence positive des pairs et de la famille). L'éducation sanitaire précoce, dès l'âge de 12 à 14 ans, est essentielle pour éviter l'initiation au tabagisme [8]. Les professionnels de santé, et notamment les médecins, ont un rôle crucial à jouer dans la prévention et le sevrage tabagique, notamment en donnant l'exemple en ne fumant pas, en conseillant l'arrêt du tabac et en maîtrisant les techniques de sevrage. Une formation adéquate des futurs médecins sur ces aspects est indispensable pour une intervention efficace.
