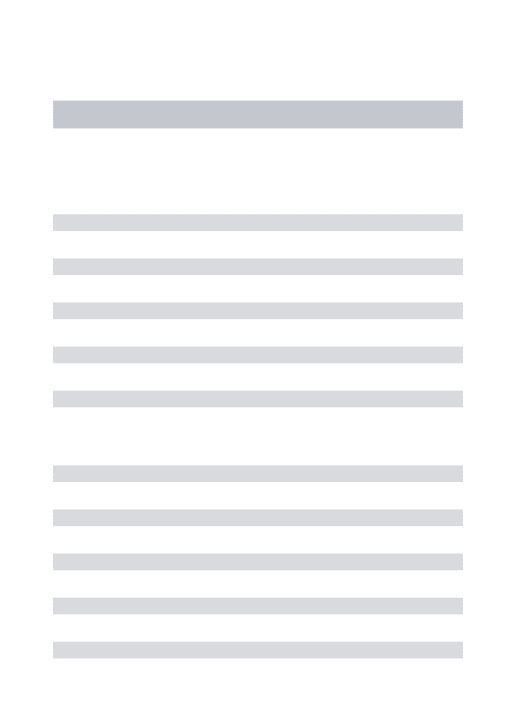
Contribution des récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes en physiopathologie articulaire
Informations sur le document
| Auteur | Meriem Tibari-Koufany |
| school/university | Université de Lorraine |
| subject/major | Sciences de la vie et de la Santé |
| Type de document | Thèse |
| city_where_the_document_was_published | Nancy |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 13.76 MB |
- récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes
- physiopathologie articulaire
- thèse de doctorat
Résumé
I.Rôle des PPARs dans l inflammation et l arthrite
Cette thèse explore le rôle des récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes (PPARs, notamment PPARα et PPARγ) dans la régulation de l'inflammation et du métabolisme osseux, en se focalisant sur leurs implications dans l'arthrite. L'étude compare l'efficacité anti-arthritique d'agonistes synthétiques de haute affinité pour PPARα (fénofibrate) et PPARγ (pioglitazone). Les résultats montrent un effet bénéfique sur la sévérité de l'arthrite expérimentale, incluant une réduction de l'œdème et de l'inflammation articulaire, ainsi qu'une préservation de la masse osseuse. L'interleukine-17 (IL-17) et le RANKL émergent comme cibles clés de l'action des PPARs.
1. Introduction aux PPARs et leur rôle dans l inflammation
La section introduit les récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes (PPARs), soulignant leur importance dans le métabolisme énergétique et leur implication croissante dans le traitement des dyslipidémies, de la résistance à l'insuline, et de l'inflammation. Trois sous-types de PPARs sont décrits: PPARα, PPARγ, et PPARβ/δ, chacun ayant une distribution tissulaire différente et un spectre d'activité spécifique. L'inflammation est identifiée comme un dénominateur commun aux pathologies où les PPARs interviennent comme régulateurs majeurs, positionnant ces récepteurs à l'interface entre le métabolisme lipidique, les désordres métaboliques, et le système immunitaire. Des études antérieures (Issemann & Green, 1990; Michalik et al., 2006; Bishop-Bailey & Wray, 2003; Desvergne & Wahli, 1999; Escher & Wahli, 2000; Bordji et al., 2000; Boyault et al., 2001; Simonin et al., 2002; Braissant et al., 1996; Auboeuf et al.) sont citées pour étayer ces informations, précisant la découverte des PPARs, leur classification, leur activation par des ligands naturels et synthétiques, et leur distribution tissulaire. La spécificité des ligands est abordée, mentionnant que certains effets anti-inflammatoires pourraient être indépendants de l'activation directe des PPARs, impliquant des protéines mitochondriales comme mitoNEET et MPC/mTOT (Colca et al., 2013; Colca et al., 2004).
2. PPARα et son potentiel anti inflammatoire
Cette partie détaille le rôle de PPARα, présenté comme un "senseur nutritionnel" régulant le métabolisme énergétique hépatique et le catabolisme des lipides (Desvergne & Wahli, 1999). L'invalidation du gène codant pour PPARα chez la souris a démontré son rôle clé dans l'oxydation des lipides (Kersten, 1999). Chez l'homme, les agonistes de PPARα, comme le fénofibrate, améliorent le profil lipidique en diminuant les triglycérides et en augmentant le HDL (Linton, 2000; Zandbergen & Plutzky, 2007). L'étude souligne l'effet anti-inflammatoire du fénofibrate dans un modèle d'arthrite expérimentale. Le traitement par fénofibrate a diminué la sévérité de l'arthrite, mesurée par la réduction de l'œdème des pattes et un score clinique amélioré, ainsi que par la diminution de l'expression des cytokines IL-1β et IL-6. L'effet protecteur sur la perte osseuse associée à l'arthrite est également mentionné, avec une préservation partielle du contenu minéral osseux. Ces résultats confirment le potentiel anti-inflammatoire de l'activation de PPARα dans l'arthrite, renforçant son intérêt thérapeutique.
3. PPARγ inflammation et métabolisme osseux
Cette section explore le rôle de PPARγ, notamment dans l'adipogenèse et l'homéostasie du glucose. L'expression forte de PPARγ dans le tissu adipeux et son rôle dans la différenciation adipocytaire sont détaillés, citant des études démontrant que la surexpression de PPARγ dans les myoblastes ou les fibroblastes induit leur différenciation en adipocytes (Teboul et al., 1995; Tontonoz et al., 1994), et que l'invalidation de PPARγ entraîne l'absence de tissu adipeux (Rosen et al., 1999). Son rôle dans le maintien des fonctions de l'adipocyte mature et le métabolisme des lipides est également mis en avant. L'étude aborde l'impact des agonistes de PPARγ, les thiazolidinediones (TZDs), sur le métabolisme osseux, mentionnant des résultats épidémiologiques controversés concernant la perte osseuse et le risque de fracture chez les patients diabétiques de type II (A. V. Schwartz et al., 2006; Vestergaard, 2007; Loke et al., 2009). L'effet de PPARγ sur la différenciation des progéniteurs de la moelle osseuse, favorisant la voie adipocytaire au détriment de la voie ostéoblastique, et sa capacité à moduler l'ostéoclastogénèse, est discuté (Gimble et al., 1996; Lazarenko et al., 2007; Mbalaviele et al., 2000).
II.Effets de la Pioglitazone agoniste de PPARγ sur l arthrite et la perte osseuse
L'étude se concentre sur les effets de la pioglitazone, un agoniste de PPARγ, sur un modèle d'arthrite expérimentale. Les résultats indiquent que la pioglitazone réduit la sévérité de l'arthrite, atténue l'inflammation, et préserve la micro-architecture osseuse, limitant ainsi la perte osseuse inflammatoire. Des mécanismes d'action impliquant la régulation de l'IL-17 et du RANKL, ainsi que l'inhibition du facteur de transcription RORγt (régulateur de la voie IL-17/Th17), sont explorés.
1. Effets de la pioglitazone sur la sévérité de l arthrite expérimentale
Cette partie de l'étude examine l'impact de la pioglitazone, un agoniste sélectif de PPARγ, sur un modèle d'arthrite expérimentale. L'analyse se concentre sur la réduction de la sévérité de l'arthrite induite. Les résultats montrent que le traitement par pioglitazone a significativement diminué la sévérité de l'arthrite expérimentale, ce qui est démontré par une amélioration des paramètres cliniques tels que la réduction de l'œdème des pattes et une diminution du score clinique de sévérité de l'arthrite. L'étude note également un impact positif sur le poids des animaux, témoignant d'une arthrite moins sévère chez les animaux traités. Ces observations suggèrent que l'activation de PPARγ par la pioglitazone a des effets bénéfiques sur l'inflammation articulaire et la progression de la maladie. En plus de ces observations cliniques, l'étude a également examiné les effets de la pioglitazone au niveau moléculaire, ce qui sera détaillé plus tard.
2. Effets de la pioglitazone sur la perte osseuse inflammatoire
Outre son effet sur la sévérité de l'arthrite, l'étude explore l'influence de la pioglitazone sur la perte osseuse inflammatoire, un aspect important de l'arthrite. L'analyse se concentre sur les effets de la pioglitazone sur la microarchitecture osseuse, un indicateur clé de la santé osseuse. Les résultats indiquent que le traitement par pioglitazone a réduit de manière significative la perte osseuse associée à l'arthrite expérimentale. Cette réduction de la perte osseuse est mise en relation avec la préservation de la structure de la microarchitecture osseuse dans les articulations périphériques des animaux traités. Contrairement aux animaux non traités qui ont présenté une perte osseuse importante due à une activité ostéoclastique exacerbée, les animaux traités avec la pioglitazone ont montré une diminution de la résorption osseuse, soulignant l'effet protecteur de ce composé sur le tissu osseux dans le contexte inflammatoire de l'arthrite. Ce résultat corrobore les effets anti-inflammatoires observés précédemment, suggérant une action multi-cible de la pioglitazone dans la modulation de la réponse inflammatoire et de la préservation du tissu osseux.
3. Mécanismes d action de la pioglitazone régulation de l IL 17 et du RANKL
Pour comprendre les mécanismes moléculaires sous-jacents à l'effet bénéfique de la pioglitazone, l'étude explore son impact sur des marqueurs clés de l'inflammation et du remodelage osseux. L'interleukine-17 (IL-17) et le RANKL sont identifiés comme des cibles potentielles de l'action de la pioglitazone. Les résultats montrent que le traitement par pioglitazone a significativement diminué la production locale et systémique de l'IL-17 chez les animaux arthritiques. L'IL-17 étant un facteur clé dans la physiopathologie articulaire, capable d'induire la production de TNFα et d'IL-1 et de réguler positivement la production de RANKL, cette observation est significative. De plus, l'étude suggère une action de la pioglitazone sur la voie RANKL/OPG, un régulateur important du remodelage osseux. L’étude mentionne des travaux antérieurs qui montrent que PPARγ régule négativement la différenciation des cellules Th17 chez l'homme et la souris (Klotz et al., 2009) et inhibe l'expression de RORγt, un régulateur principal de la voie IL-17/Th17 (Solt et al., 2011). L'inhibition de l'IL-17 et du RANKL par la pioglitazone contribue à la réduction de la résorption osseuse observée.
III.Rôle de PPARγ dans le développement de l arthrite étude sur des souris déficientes en PPARγ
Pour approfondir le rôle de PPARγ dans l'arthrite, l'étude utilise un modèle de souris déficientes en PPARγ. Ces souris développent une arthrite spontanée sévère, caractérisée par une synovite importante, une infiltration cellulaire, et une dégradation du cartilage et de l'os. Cette arthrite est associée à des taux élevés d'IL-17, de TNFα, et à une infiltration accrue de mastocytes dans la synoviale. Ces observations confirment le rôle crucial de PPARγ dans la prévention du développement de l'arthrite.
1. Développement spontané d arthrite chez les souris déficientes en PPARγ
L'étude utilise un modèle de souris génétiquement modifiées, totalement déficientes pour le gène PPARγ, afin d'évaluer le rôle de ce récepteur dans le développement de l'arthrite. L'analyse histologique des articulations de ces souris révèle le développement d'une polyarthrite sévère affectant les chevilles et les genoux, avec une incidence de 100%. La synovite apparaît dès l'âge de 3 semaines. Les articulations touchées présentent des caractéristiques similaires à la polyarthrite rhumatoïde humaine: hyperplasie de la membrane synoviale, vascularisation abondante, infiltration importante de cellules immunitaires, érosion cartilagineuse et remodelage osseux significatifs. L'observation de taux élevés de cytokines pro-inflammatoires, telles que l'IL-17 et le TNFα, ainsi que de chimiokines (KC), et de taux réduits de cytokines anti-inflammatoires/immunomodulatrices (IL-10) confirme un état inflammatoire chronique intense. Ces résultats suggèrent un rôle protecteur majeur de PPARγ contre le développement d'une arthrite spontanée.
2. Profil cytokinique et infiltration cellulaire dans l arthrite spontanée
L'analyse du microenvironnement inflammatoire des articulations des souris déficientes en PPARγ montre un profil cytokinique caractéristique d'une inflammation accrue. Les taux élevés de cytokines pro-inflammatoires, telles que l'IL-17 et le TNFα, et de chimiokines (KC) sont cohérents avec le développement d'une arthrite sévère. À l'inverse, les taux diminués de cytokines anti-inflammatoires/immunomodulatrices comme l'IL-10 suggèrent une absence de régulation de la réponse immunitaire, favorisant le processus inflammatoire chronique. De plus, l'étude note la présence d'une infiltration importante de cellules immunitaires dans la synoviale. L'analyse plus fine des populations cellulaires infiltrantes est discutée dans la suite de l'étude. Ces données suggèrent que l'absence de PPARγ perturbe l'équilibre cytokinique, favorisant un environnement pro-inflammatoire qui conduit au développement et à la progression de l'arthrite spontanée dans ce modèle animal.
3. Rôle potentiel des mastocytes dans l arthrite liée à la déficience en PPARγ
L'étude observe une augmentation notable du nombre de mastocytes dans le tissu synovial inflammatoire des souris déficientes en PPARγ, suggérant une implication de ces cellules dans la pathogenèse de l'arthrite. Ces mastocytes expriment l'IL-17, ce qui corrobore les observations chez des patients arthritiques (Hueber et al., 2010). La production de SCF, facteur essentiel de différenciation des mastocytes, par les fibroblastes synoviaux et les mastocytes eux-mêmes, est également signalée. L'augmentation du nombre de mastocytes pourrait être due à une infiltration accrue de précurseurs qui maturent in situ, ou à une prolifération des mastocytes matures (Bischoff & Sellge, 2002). L’hypothèse d’un lien entre l’absence de PPARγ, l’absence de tissu adipeux (puisque le modèle de souris utilisé est souvent associé à une lipodystrophie) et la prolifération de mastocytes est avancée. Des études complémentaires sont nécessaires pour déterminer si cette mastocytose est un effet direct de la délétion de PPARγ ou une conséquence indirecte de l'absence de tissu adipeux.
IV.Implications des mastocytes dans l arthrite et la mastocytose
L'étude met en évidence une augmentation significative du nombre de mastocytes dans la synoviale des souris déficientes en PPARγ, suggérant un lien entre l'arthrite et la mastocytose. Les mastocytes produisent de l'IL-17, contribuant à l'inflammation. Le facteur de croissance SCF, impliqué dans la différenciation des mastocytes, est également produit par les fibroblastes synoviaux et les mastocytes eux-mêmes. Une étude de cas clinique d'un patient souffrant à la fois de polyarthrite rhumatoïde et de mastocytose systémique est présentée, soulignant la possible association entre ces deux affections.
1. Mastocytes et arthrite une implication dans la réponse inflammatoire
Cette section explore le rôle des mastocytes dans le contexte de l'arthrite, en se basant sur les observations faites lors de l'étude des souris déficientes en PPARγ. L'étude met en évidence une accumulation significative de mastocytes dans la synoviale inflammatoire de ces souris. Ces mastocytes expriment l'IL-17, une cytokine pro-inflammatoire majeure dans l'arthrite. Cette observation est corroborée par des études antérieures montrant un profil cytokinique similaire des mastocytes retrouvés dans le tissu synovial des patients arthritiques (Hueber et al., 2010). La présence de ces mastocytes dans la synoviale inflammatoire, ainsi que la production d'IL-17 par ces cellules, suggèrent une implication directe des mastocytes dans l'entretien et l'amplification de la réponse inflammatoire au niveau articulaire. La production de SCF (Stem Cell Factor), un facteur de croissance essentiel pour leur propre différenciation, par les fibroblastes synoviaux et les mastocytes eux-mêmes, souligne l’auto-entretien possible de l’inflammation mastocytaire au niveau de l’articulation.
2. Mastocytose et arthrite un lien potentiel à explorer
L'observation d'une importante infiltration de mastocytes dans les articulations des souris déficientes en PPARγ soulève la question d'un lien potentiel entre l'arthrite et les états de mastocytose. L'étude évoque la possibilité d'une implication physiopathologique des mastocytes dans l'arthrite chez les souris déficientes en PPARγ. Il est suggéré que la mastocytose observée pourrait résulter d'un dysfonctionnement direct lié à l'absence de PPARγ ou d'un effet indirect en raison de l'absence de tissu adipeux, souvent corrélée à la déficience en PPARγ. Une étude de cas d'un patient atteint à la fois de polyarthrite rhumatoïde et de mastocytose systémique est présentée pour illustrer l'association possible de ces deux pathologies chez l'homme. Cette co-morbidité suggère un lien clinique potentiel entre la mastocytose et l'arthrite inflammatoire, nécessitant des investigations plus approfondies pour déterminer le rôle exact des mastocytes et les mécanismes impliqués dans cette association.
3. Mécanismes d action des mastocytes dans l arthrite
L'étude évoque brièvement les mécanismes potentiels par lesquels les mastocytes contribuent à la pathogénèse de l'arthrite. Ils produisent des médiateurs pro-inflammatoires et sont capables d'activer les lymphocytes T via le TNFα (Suto et al., 2006) et de présenter des antigènes via le CMH I et II (Stelekati et al., 2009; Poncet et al., 1999), ce qui pourrait influencer la réponse immunitaire adaptative. La libération de médiateurs mastocytaires, notamment la tryptase, pourrait activer des métalloprotéinases matricielles (MMPs) contribuant à la dégradation du cartilage et de l'os (Magarinos et al., 2013). L’histamine, médiateur majeur libéré par les mastocytes, est également impliquée dans le métabolisme osseux, augmentant la résorption osseuse (Fitzpatrick et al., 2003; Biosse-Duplan et al., 2009; Simmons & Raisz, 1991; Zupan et al., 2013). L’héparine joue également un rôle dans l’augmentation de la résorption osseuse. Le rôle angiogénique des mastocytes (Suurmond et al., 2015) est mentionné. L'étude propose des investigations futures pour mieux comprendre le rôle des mastocytes dans l'arthrite, notamment en étudiant leur prolifération, leur homing, et leur interaction avec le tissu adipeux.
