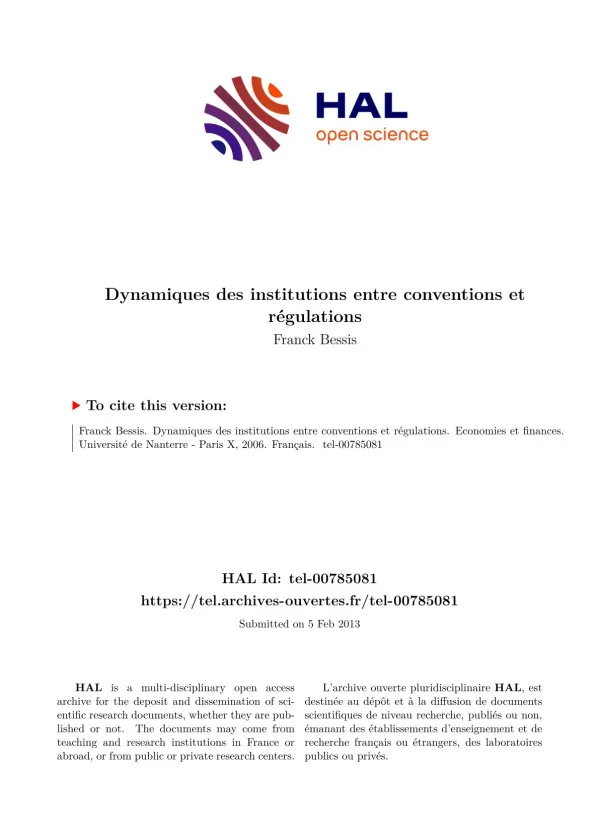
Dynamiques des Institutions et Régulations Économiques
Informations sur le document
| Auteur | Franck Bessis |
| École | Université de Paris X - Nanterre, UFR de Sciences Économiques, Gestion, Mathématiques et Informatique |
| Spécialité | Sciences Économiques |
| Type de document | Thèse |
| Lieu | Nanterre |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 1.55 MB |
- Économie
- Institutions
- Régulations
Résumé
I.La Théorie de la Régulation TR et l Économie des Conventions EC Une Comparaison
Ce document compare la Théorie de la Régulation (TR) et l'Économie des Conventions (EC), deux approches hétérodoxes en économie. L'analyse se concentre sur le changement institutionnel, explorant les concepts d'institutions, de conventions, et de coordination. La TR, influencée par Marx et Keynes, met l'accent sur les rapports de force et les conflits d'intérêts, tandis que l'EC, inspirée par Boltanski et Thévenot, souligne l'importance des conventions et de la justification des actions. L'objectif est d'identifier les points de convergence et de divergence entre ces deux programmes de recherche afin de proposer une synthèse.
1. Les Limites de l approche néoclassique et l émergence d approches hétérodoxes
L'étude commence par souligner la distance maintenue par rapport à toute investigation concrète, privilégiant une analyse de catégories abstraites pour approfondir le débat entre deux grandes approches économiques: la Théorie de la Régulation (TR) et l'Économie des Conventions (EC). Le changement institutionnel est central, impliquant des concepts vastes comme l'autorité, le conflit, la coordination, l'efficacité, l'incertitude, la justice, le pouvoir et la rationalité. L'incapacité des approches néoclassiques à rendre compte de phénomènes comme le chômage involontaire (Keynes) est soulignée. L'hétérodoxie est définie négativement par son incapacité à profondément transformer la théorie économique dominante, malgré la pertinence de ses critiques. La citation de Favereau (« il y a un objet qui devrait être dedans – et qui est dehors ») résume bien cette situation. L'étude vise donc à enrichir le débat en examinant ces deux cadres théoriques dans leur ensemble et non en se focalisant sur des explications concurrentes d'un même fait stylisé. Il s'agit d'une démarche de philosophie économique visant l'élaboration conceptuelle.
2. Approches comparées de la TR et de l EC Points de convergence et divergence
L'analyse explore ensuite les points de convergence et de divergence entre la TR et l'EC. Un rapprochement initial entre les deux approches, suggéré par Allaire et Boyer en 1995, est remis en question par la suite (Boyer, 2004; Amable et Palombarini, 2005), mettant en lumière des différences significatives dans leurs programmes de recherche. L’EC prend ses distances avec l'approche évolutionniste des conventions et la théorie des jeux, jugée inadaptée à rendre compte des dimensions interprétatives et politiques de l'action. Parallèlement, la TR développe une analyse des représentations et du politique, soulignant les conflits d'intérêts et les rapports de domination, s'inspirant de la théorie de l'action de Pierre Bourdieu. Malgré ces divergences, l'existence d'un noyau commun de notions intermédiaires au niveau 2 est mise en évidence (Boyer, 1986), permettant la possibilité d'un débat fructueux malgré la diversité des fondements théoriques de la TR (Marx, Keynes, Girard, etc.). La question du changement institutionnel reste le point central de la discussion, chaque approche proposant une perspective distincte sur cette dynamique.
3. L Économie des Conventions EC comme Programme Généraliste
La troisième partie approfondit la conception de l'EC, présentée par Eymard-Duvernay comme un programme généraliste visant une vision globale de l'économie, explorant différents niveaux d'analyse. L'auteur souligne l'importance des travaux d'Olivier Favereau, inspirés par le projet radical de Keynes, pour comprendre la cohérence de cette conception. La thèse défendue est que l'EC, avec son caractère englobant, est le cadre le plus pertinent pour analyser les difficultés d'articulation avec la TR, et pour développer une théorie conventionnaliste du changement institutionnel. La discussion avec la nouvelle sociologie économique, notamment par Orléan, est abordée; Orléan tente de construire un projet de science sociale unifiée, mais l'étude remet en question la base de ce projet d'« unidisciplinarité » en raison de la tension entre les conventions évolutionnistes et les conventions légitimes.
4. Approches méthodologiques et niveaux d analyse
L'étude précise ses objectifs méthodologiques: il ne s'agit pas de produire une théorie originale ou de réfuter des théories alternatives, mais plutôt d'intégrer des fragments de théories existantes. Une logique de « confrontation/coopération » guide l'approche, visant un traitement symétrique des deux approches pour explorer leurs manques respectifs et proposer des aménagements convergents. L'objectif est de créer un compromis acceptable par l'EC et la TR. Trois niveaux d'analyse sont distingués, permettant une mise à distance des hypothèses simplificatrices liées à la modélisation ou à l'investigation empirique, évitant ainsi les oppositions entre visions métaphysiques. L'évaluation des constructions théoriques repose moins sur ce qu'elles ne disent pas que sur ce qu'elles ne permettent pas de dire, le but étant de restituer une classe générale de phénomènes (le changement).
II.Les Conventions Coordination et Justification
L'Économie des Conventions (EC) propose un modèle de coordination basé sur la pluralité des conventions, notamment les six cités (formes de coordination générales) identifiées par Boltanski et Thévenot. Ces conventions, associées à des principes d'évaluation légitimes, permettent de dépasser la seule logique marchande. L'analyse explore également la pluralité des régimes d'engagement, hiérarchisant les modalités d'engagement dans l'action selon leur degré de généralisation. Des auteurs comme François Eymard-Duvernay, Robert Salais, et Laurent Thévenot ont contribué significativement à l'élaboration et aux applications empiriques de ce modèle, notamment à travers l'étude des salaires comme règles conventionnelles et non comme simples prix de marché.
1. Les Conventions Générales Le Modèle des Six Citès
Cette section détaille le concept de conventions au cœur de l'Économie des Conventions (EC). L'EC identifie six conventions généralisables, appelées « cités », acceptables par tous car associées à un principe d'évaluation légitime. Ces conventions représentent autant de formes de coordination opérationnelles pour des populations de toute taille, replaçant la transaction marchande au sein d'une pluralité de manières de faire l'accord. Chaque cité est caractérisée par son principe de coordination et d'évaluation, son mode d'expression du jugement, l'entité collective qu'elle crée, et la manière dont les personnes et les objets entrent en relation. L'analyse anticipe sur la notion de régimes d'engagement, suggérant une interconnexion entre ces conventions et les modalités de coordination. Le travail de Boltanski et Thévenot, fondamental pour la construction du modèle, est implicitement reconnu ici, et la mention de tableaux (non inclus ici) suggère une présentation plus formelle de ces caractéristiques pour chaque cité.
2. Pluralisme des Régimes d Engagement et Formes de Coordination Locales
La section explore le pluralisme vertical des régimes d'engagement ou régimes d'action, ajouté par l'EC au pluralisme horizontal des formes de coordination générales. Ce pluralisme hiérarchise les modalités d'engagement selon leur aptitude à la mise en commun, allant des régimes locaux aux formes de coordination générales applicables à toute une population. L'analyse, s'appuyant sur les travaux de Thévenot (2006), décrit chacun de ces régimes par son mode d'évaluation de l'engagement, la caractérisation de l'état des personnes et des objets, la façon dont l'évaluation est arrêtée et le mouvement de déconvenue qui la remet en cause. La distinction entre régimes réflexifs et moins réflexifs est cruciale pour comprendre la dynamique des conventions et des organisations. Salais et Storper (1993) proposent une solution intermédiaire en réduisant la pluralité à partir de l'observation des enchaînements d'actions, centrée sur le régime de paix en justesse, permettant de mieux restituer les distances entre les formes d'organisation. La justesse, autorisant des déplacements entre formes de coordination, devient un plan d'analyse privilégié.
3. Conventions Épreuves de Grandeur et Justification de l Action
Cette section se concentre sur la mise à l'épreuve des conventions. L'épreuve, toujours une confrontation de forces, peut être légitime lorsqu'elle est soumise à des contraintes de justification et lorsque les protagonistes jugent ces contraintes respectées (Boltanski et Chiapello, 1999). L'EC établit un continuum entre les épreuves de force et les épreuves légitimes, ces dernières nommées « épreuves de grandeur ». Ces épreuves nécessitent des investissements collectifs et individuels, déterminant la nature du sacrifice consenti. L'analyse décrit comment l'évaluation des personnes repose à la fois sur l'investissement dans le dispositif de l'épreuve et sur l'investissement individuel dans le respect des contraintes de la forme. Les exemples d'épreuves modèle, la forme de l'évidence, et la formule d'investissement sont évoqués, suggérant la présence de tableaux explicatifs (non inclus ici). L'accent est mis sur le caractère potentiellement continu de la mise à l'épreuve des conventions et la manière dont l'habitude et la routine peuvent affaiblir la vigilance critique, ce qui ne se manifeste qu'avec l'apparition de nouveaux problèmes ou de dispositifs d'alerte externes.
4. Salaires Règles Conventionnelles et Dynamique des Organisations
La section analyse les salaires non pas comme des prix, mais comme des règles conventionnelles, produit de règles explicites mais arbitraires et dépendantes d'une convention. Cette approche explique pourquoi les salaires ne sont pas la première variable d'ajustement en cas de pénurie de main-d'œuvre ou de chômage. Le contrôle de l'exécution de ces règles est guidé par une représentation du fonctionnement satisfaisant du collectif, une convention de qualité (Eymard-Duvernay, 1987; Boltanski et Thévenot). La fixation du prix d'un bien est discutée, en soulignant le rôle des coûts du travail et du capital, de la faible élasticité de substitution, et des capacités d'apprentissage de l'organisation (Favereau, Biencourt et Eymard-Duvernay, 2002). L'issue est présentée comme un rapport de forces marchandes, rendu favorable à l'entreprise par la construction de la rareté. L'interaction entre les conventions et la dynamique organisationnelle est ainsi expliquée à travers le concept de convention de qualité.
III.Rationalité Réflexivité et Habitus L Action des Agents
Le document examine la notion de rationalité, en particulier la rationalité limitée et la réflexivité, en lien avec l'habitus de Pierre Bourdieu. L'analyse souligne les difficultés à concilier la théorie de l'habitus avec l'EC et la TR. Le débat porte sur la capacité des cadres théoriques à rendre compte de la spontanéité de l'action et du changement institutionnel. L'EC propose une approche plus pluraliste des régimes d'action, intégrant les dimensions interprétatives et critiques de l'action des agents. Une approche spinoziste du conatus est envisagée pour compléter l'analyse.
1. La Théorie de l Action de Bourdieu et ses Limites
Cette section explore le lien complexe entre la Théorie de la Régulation (TR), l’Économie des Conventions (EC) et la théorie de l’action de Pierre Bourdieu. Bourdieu, source majeure d’inspiration pour la TR, est analysé de manière plus ambivalente par l’EC. Le versant sociologique de l’EC, notamment Boltanski et Thévenot (1991), est perçu à la fois comme un prolongement et une prise de distance par rapport à Bourdieu. L’EC privilégie une sociologie de la critique plutôt qu’une sociologie critique, rejetant l’idée d’une position surplombante du chercheur. Favereau (2001) et Bessy & Favereau (2003) questionnent la capacité du couple champ-habitus à restituer les changements et les failles de la reproduction, soulignant les difficultés symétriques du couple rationalité-marché à rendre compte des défauts de coordination. Le débat central porte sur la capacité du concept d’habitus à rendre compte de la spontanéité de l'action et des changements.
2. Vers une Théorie Pluraliste de l Action Au delà de l Habitus
La section propose de dépasser les limites de la théorie de l’action de Bourdieu en intégrant une théorie plus large et pluraliste. La théorie de la réflexivité limitée, qui vise à restituer la spontanéité de l'action dans l'urgence, est critiquée pour son incapacité à penser les degrés de réflexivité critique nécessaires à la restitution endogène du changement. La pluralité des régimes d’action, mise en avant par l’EC, offre une alternative en intégrant les relations de domination non questionnées par l’habitus et les contraintes de légitimité soulevées par les critiques des agents. Cette théorie pluraliste de l'action se différencie de toute idée de libre-arbitre. Pour compléter cette analyse, une hypothèse anthropologique, l’anthropologie spinoziste du conatus, est introduite afin d'expliciter une conception de la personne transversale aux manières d’être engagé dans l’action, permettant de théoriser les changements d’état. L’objectif est de construire un cadre théorique capable d’intégrer à la fois les dimensions spontanées et réflexives de l’action.
3. Réflexivité Prise de Conscience et Critique de la Théorie de l Habitus
L’analyse explore la notion de réflexivité, en distinguant la réflexivité limitée de la prise de conscience plus forte évoquée par Servais (2000). Cette dernière est définie comme « le travail de gestion de ses propres dispositions » ou l’« acte de distanciation par rapport aux déterminations internes propres à l’habitus ». Des exemples comme les « activités de gestion » et les « théories indigènes » montrent la possibilité pour les agents de déposer des connaissances hors d’eux-mêmes, dépassant ainsi la logique purement pratique de l’habitus. Cependant, l'approche critique se concentre sur les limites de la théorie de Bourdieu. Le concept d’habitus est considéré comme trop statique, ne tenant pas compte des stratégies de subversion ou de la capacité des agents à la critique pratique. La notion de violence symbolique, chez Bourdieu, est vue comme renforçant cet interdit. La section souligne la nécessité de distinguer ce dont Bourdieu parle et ce que ses instruments permettent de dire, ce qui permet de nuancer la portée de sa théorie de l’action.
IV.Le Changement Institutionnel et la Dynamique des Rapports Sociaux
La section aborde la dynamique du changement institutionnel, soulignant l’importance des contradictions intrinsèques aux rapports sociaux. La TR met l'accent sur la complémentarité et la hiérarchie des formes institutionnelles au sein d'un mode de régulation, soulignant les mécanismes politiques de formation des compromis institutionnalisés (Stefano Palombarini). L'inertie des institutions est expliquée par trois sources : l'interdépendance des intérêts, la hiérarchie institutionnelle, et les représentations des agents. L'analyse examine la distinction entre l'équilibre de règles et les crises de régulation, et comment les institutions évoluent en réponse aux tensions et conflits.
1. La Dynamique Intrinsèque des Rapports Sociaux
Cette section analyse la dynamique du changement institutionnel à travers le prisme des rapports sociaux. Elle souligne que ces rapports, loin d'être statiques, possèdent une dynamique intrinsèque due à leur dimension contradictoire. Les individus sont à la fois unis et opposés dans leurs projets, créant une incertitude radicale au sens keynésien. La TR, en dynamisant l'héritage d'Althusser, considère la régulation comme une reproduction non systématique, où la crise prime sur la reproduction. La gestion des contradictions contenues dans les rapports sociaux, soit l'existence d'un mode de régulation, est stabilisée par différents degrés de codification dans une pluralité compatible, complémentaire et hiérarchisée de formes institutionnelles et de dispositifs. Le régime d'accumulation, forme en vigueur de l'accumulation du capital, est au cœur de cette dynamique. L'étude met en lumière la tension entre la reproduction et la crise, inhérente au mode de production capitaliste.
2. Complémentarité Institutionnelle et Inertie des Institutions
L'hypothèse de complémentarité institutionnelle est analysée comme une surdétermination des contradictions des rapports sociaux. Amable (2005) définit la complémentarité institutionnelle comme une situation où l'existence ou la forme d'une institution renforce une autre dans un autre domaine. Seules certaines conjonctions de formes institutionnelles permettent de contenir temporairement les contradictions internes et externes des rapports sociaux, limitant la diversité des arrangements institutionnels viables et expliquant l'inertie des formes par rapport à leur arrangement. L'importation d'une forme d'un arrangement à un autre ne garantit pas son pouvoir de régulation (Aoki, 1993; Amable et alii, 1997 et 2002). Trois sources d'inertie des institutions sont identifiées: la hiérarchie institutionnelle, l'équilibre des intérêts du bloc social dominant, et les représentations des agents concernant leur marge de manœuvre. Certaines institutions, considérées comme des contraintes exogènes, sont plus difficiles à modifier que d'autres en raison de leur position hiérarchique ou de leur rôle central dans le compromis qui fonde la stabilité du bloc dominant.
3. Crises Reproduction et le Rôle de la Politique
La section aborde les crises cycliques comme l'expression même du mode de régulation, devenant de plus en plus difficiles à surmonter avec l'évolution tendancielle du régime. Ces évolutions affectent les formes institutionnelles jusqu'à remettre en cause leur vertu stabilisatrice. Par exemple, l'augmentation de la demande de différenciation des produits remet en cause les gains de productivité liés à la production de masse. Palombarini (2001) offre une analyse détaillée des mécanismes politiques de formation des compromis institutionnalisés au sein de la TR. La régulation économique est considérée comme une composante importante, mais non déterminante, du mode de régulation. L'étude souligne les dimensions politiques et symboliques des rapports sociaux, l'existence du mode de régulation signifiant la reproduction à travers la conjonction de formes institutionnelles. Un mode de régulation peut être viable avec un chômage élevé si le partage de la valeur ajoutée assure la reproduction des groupes sociaux et que la demande sociale valide l'évolution des capacités de production. L’analyse met en garde contre la généralisation d’une caractéristique à l’ensemble des modes de régulation.
4. Arbitrage Politique et Pluralité des Intérêts
Dans un système de vote à la majorité, la politique consiste à imposer à une minorité les choix d'une majorité, même au détriment de l'intérêt général (Amable et Palombarini, 2005). Cette stratégie, la plus efficace et souvent la seule possible, reflète la pluralité contradictoire des intérêts des individus. L'inertie de certaines institutions est analysée à la lumière de cette dynamique politique. Des institutions hiérarchiquement supérieures affectent l'équilibre entre les intérêts des différents éléments du bloc social dominant. Ces institutions représentent souvent le cœur du compromis sur lequel repose la stabilité de ce bloc. Certaines modifications institutionnelles, même bénéfiques pour le bloc dominant, peuvent se révéler coûteuses si le risque de conflit est élevé. La section souligne donc le rôle central du politique dans le maintien ou la transformation des arrangements institutionnels.
