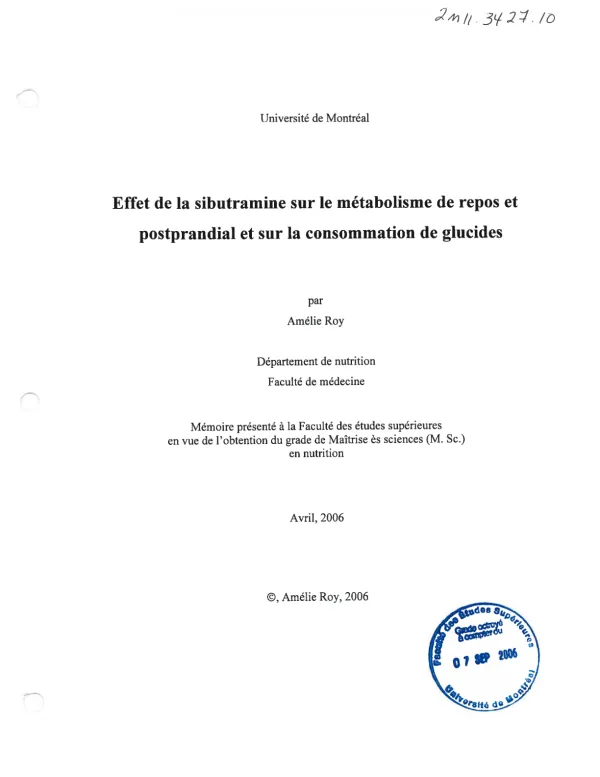
Sibutramine et métabolisme: Effets sur la satiété
Informations sur le document
| Auteur | Amélie Roy |
| instructor | Dr Eugenio Rasio |
| École | Université de Montréal |
| Spécialité | Nutrition |
| Type de document | Mémoire de maîtrise |
| Lieu | Montréal |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 6.24 MB |
Résumé
I.Prévalence et Déterminants de l Obésité
L'étude aborde la prévalence croissante de l'obésité et du surpoids au Canada, soulignant le doublement des cas d'obésité en 20 ans. Elle explore les déterminants environnementaux et génétiques de l'obésité, reconnaissant l'importance des facteurs génétiques tout en insistant sur le rôle crucial de l'environnement, voire d'un environnement obésogène. L'impact de la régulation de l'appétit, notamment le rôle des lipides alimentaires, du rassasiement, et de la satiété, est également examiné. Des troubles comme l'hyperphagie boulimique sont identifiés comme contribuant au développement de l'obésité.
1. Prévalence de l obésité et du surpoids au Canada
Le document débute par un constat alarmant : l’obésité et le surpoids sont en augmentation constante, représentant un problème de santé publique majeur. Au Canada, en 2003, 33% des adultes étaient en surpoids et 15% souffraient d’obésité, selon des données auto-déclarées. L'incertitude quant à la fiabilité de ces données auto-déclarées est soulignée, car des mesures plus précises révèlent une augmentation plus que doublée de la prévalence de l’obésité chez les Canadiens au cours des 20 dernières années. Cette augmentation rapide met en évidence la nécessité d'une meilleure compréhension des facteurs contribuant à cette épidémie d'obésité et la mise en place de stratégies de prévention efficaces. La différence entre les données auto-déclarées et les données mesurées souligne la complexité de l'évaluation de la prévalence de l'obésité et suggère que les chiffres officiels pourraient sous-estimer le problème.
2. Déterminants environnementaux de l obésité
Bien que la génétique joue un rôle dans la prédisposition à l’obésité, le document souligne l’importance des déterminants environnementaux dans l’explication de l’épidémie actuelle. L’augmentation constante de la prévalence de l’obésité au cours des deux dernières décennies ne peut être expliquée uniquement par des facteurs génétiques. Ceci suggère une forte influence de l'environnement, allant jusqu'à l'existence d'un environnement « pathologique » ou même « obésogène ». Une revue de littérature de Blundell et al. (28) met en lumière le rôle des matières grasses, qui semblent avoir peu d'effet sur le rassasiement et la satiété, favorisant ainsi une surconsommation énergétique. Cependant, des différences méthodologiques dans l'évaluation de l'impact des nutriments sur le rassasiement et la satiété compliquent la généralisation des conclusions à toutes les populations. L'importance de la terminologie utilisée pour définir le rassasiement et la satiété dans les études est également mise en avant, soulignant la nécessité d'une plus grande standardisation pour une meilleure interprétation des résultats.
3. Rôle de l hyperphagie boulimique
Le document aborde le lien entre l’hyperphagie boulimique et l’obésité. Les individus atteints d’hyperphagie boulimique ont des difficultés à contrôler leurs apports alimentaires, contribuant ainsi à leur surpoids. La sévérité du syndrome est corrélée au degré d’obésité, et les personnes obèses présentent souvent des attentes irréalistes concernant la perte de poids et un manque de confiance en leurs capacités. L’hyperphagie boulimique pourrait donc jouer un double rôle : favoriser le gain de poids par des épisodes répétés d’hyperphagie et entraver la perte de poids en limitant les efforts de restriction alimentaire. La quantité de calories ingérées lors de ces épisodes peut même dépasser l’apport calorique quotidien total d’un individu, aggravant ainsi le problème de prise de poids et de maintien de l'obésité.
4. Facteurs génétiques et formes monogéniques d obésité
Le texte discute des aspects génétiques de l'obésité, introduisant les formes monogéniques liées à des mutations uniques sur les chromosomes X. Ces mutations sont responsables d'une vingtaine de syndromes génétiques d'obésité, souvent caractérisés par une obésité importante et un retard mental. Le syndrome de Prader-Willi est cité comme exemple, étant le syndrome monogénique d'obésité le plus fréquent. L’héritabilité de la masse corporelle est abordée, avec des estimations variant entre 25 à 40% (études combinées) et 50 à 80% (études sur les jumeaux). Ces variations illustrent l’influence combinée des facteurs génétiques et environnementaux. L'étude souligne la nécessité de recherches multicentriques sur les familles affectées par ces syndromes rares pour mieux comprendre les gènes impliqués et les traits cliniques variés. L'exemple des Indiens Pima est cité pour illustrer l'interaction entre prédisposition génétique à l'obésité et au diabète et l'influence d'un environnement obésogène sur la prévalence de ces maladies.
II.Facteurs Génétiques et Environnementaux dans le Développement de l Obésité
L'héritabilité de la masse corporelle est estimée entre 50 et 80 % selon des études sur les jumeaux, et entre 25 et 40 % selon des études combinées. L'influence de facteurs génétiques est indéniable, mais l'expression phénotypique dépend également d'un environnement prédisposant. L'exemple des Indiens Pima illustre l'interaction entre facteurs génétiques et environnement obésogène dans le développement de l'obésité et du diabète.
1. L héritabilité de l obésité estimations et limites
Le texte explore l'héritabilité de l'obésité, soulignant la complexité de son estimation. Des études sur les jumeaux suggèrent une héritabilité de la masse corporelle entre 50 et 80%, tandis que des études combinant différents types d'apparentement (descendance et adoption) aboutissent à une estimation plus basse, de 25 à 40%. Ces variations soulignent les limitations des méthodes d'estimation et l'influence probable d'autres facteurs, notamment environnementaux, sur l'expression du phénotype. L'étude de Stunkard et al. (56) sur des jumeaux homozygotes et dizygotes, initialement estimant l'héritabilité à 78%, a été réévaluée à 81% après 25 ans de suivi, soulignant l'importance des études longitudinales. Cependant, les études d'adoption seules suggèrent une héritabilité plus faible, entre 10 et 30%, ce qui renforce l'idée d'une interaction complexe entre génétique et environnement dans le développement de l'obésité. En conclusion, bien que les facteurs génétiques aient une influence considérable, ils ne suffisent pas à expliquer entièrement le développement de l'obésité.
2. L interaction entre génétique et environnement
Le document insiste sur l'interaction cruciale entre facteurs génétiques et environnementaux dans le développement de l'obésité. Il est clairement établi que la susceptibilité génétique joue un rôle important, mais la présence d'un environnement propice semble nécessaire à l'expression phénotypique de cette susceptibilité. L'exemple des Indiens Pima est utilisé pour illustrer ce point : génétiquement prédisposés à l'obésité et au diabète, ils présentent une prévalence plus faible de l'obésité dans des environnements « restrictifs » comparés à des environnements « obésogènes » comme le sud des États-Unis. Ceci met en évidence la plasticité phénotypique et l'importance du contexte environnemental dans l'expression des prédispositions génétiques. La simple présence d'une prédisposition génétique ne garantit pas le développement de l'obésité ; un environnement favorable est également nécessaire. Cette interaction complexe nécessite des recherches plus approfondies pour une meilleure compréhension des mécanismes impliqués et pour développer des stratégies de prévention et de traitement efficaces.
III.Le Métabolisme et la Balance Énergétique
La dépense énergétique (DÉ) diminue avec l'âge, en partie due à la réduction de la masse maigre. Des mécanismes tels que l'altération des pompes Na-K et la diminution de la sensibilité aux hormones thyroïdiennes sont évoqués. La balance énergétique influence la DÉ, avec une augmentation de la DÉ en cas de balance positive et une réduction en cas de balance négative. Le rôle de l'hypothalamus et d'hormones comme la leptine et l'insuline dans la régulation de l'appétit et de la balance énergétique sont discutés. La résistance à la leptine est présentée comme un facteur important dans l'obésité.
1. La dépense énergétique et le vieillissement
Le document explore la relation entre la dépense énergétique et l'âge. Il est mentionné que le métabolisme de repos (MR) diminue avec l'âge, ce qui entraîne une réduction de la dépense énergétique. Cette diminution est principalement attribuée à la réduction de la masse maigre et de ses composantes métaboliquement actives, remplacées par des composantes moins énergivores. Plusieurs mécanismes sont évoqués pour expliquer cette réduction, notamment l'altération des pompes Na-K, la diminution de l'utilisation de l'oxygène, la réduction du taux de renouvellement protéique, et la diminution de la sensibilité aux hormones thyroïdiennes et à la réponse adrénergique. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour clarifier les mécanismes précis liant l'âge à la réduction de la dépense énergétique. La difficulté de mesurer précisément la dépense énergétique est également soulignée, car une immobilité prolongée (au moins 7 heures) est requise pour une mesure précise du métabolisme de repos, ce qui peut affecter la fiabilité des données. Des études suggèrent que des mesures alternées (périodes de mesure et de repos) pourraient fournir des données plus stables et fiables.
2. La balance énergétique et la dépense énergétique nette d activité DÉNAF
La section traite de la relation entre la balance énergétique et la dépense énergétique nette d'activité (DÉNAF). Chez l'humain, la DÉNAF augmente avec une balance énergétique positive et diminue avec une balance énergétique négative. Cette variation de la DÉNAF serait liée à la déplétion des réserves chez les rongeurs, souvent accompagnée d'une augmentation à court terme de l'activité physique pour compenser la réduction de la dépense énergétique. Il existerait une régulation centrale de la DÉNAF, avec l'hypothalamus comme intégrateur principal, mais le mécanisme exact reste à élucider. L'implication de l'orexine est évoquée comme un possible mécanisme de régulation. L'administration de leptine, une hormone impliquée dans la régulation de l'appétit et de la balance énergétique, est mentionnée pour ses effets sur l'hyperphagie et la perte de poids. Chez les humains et les rongeurs, une déficience en leptine, due à des mutations génétiques, entraîne une obésité massive. Bien que rares chez l'humain, ces mutations peuvent être corrigées par une thérapie à la leptine. L'hypothalamus est identifié comme le principal site d'action de la leptine dans l'homéostasie énergétique.
3. Le rôle de la leptine de l insuline et d autres hormones
Le document détaille le rôle de la leptine, de l'insuline et d'autres hormones dans la régulation de l'appétit et de la balance énergétique. Une faible proportion d'individus obèses présentent une déficience en leptine, tandis que la majorité présente des niveaux plasmatiques élevés, suggérant une résistance à l'action de la leptine. Cette résistance pourrait être due à un transport altéré à travers la barrière hémato-encéphalique et à un signalement inadéquat dans les neurones influencés par la leptine. L'insuline est évoquée comme un signal anorexigène dans le système nerveux central, son injection entraînant une réduction des apports alimentaires et une perte de poids. Le rôle du peptide YY (PYY) et de l'oxyntomoduline (OXM) dans le contrôle de l'appétit est également abordé, soulignant leur potentiel thérapeutique pour l'obésité. Enfin, le texte mentionne les variations diurnes des concentrations du polypeptide pancréatique (PP) et son implication possible dans le contrôle de l'appétit chez les rongeurs. L'étude souligne la complexité de la régulation de la balance énergétique et la nécessité de recherches supplémentaires pour une meilleure compréhension de ces mécanismes hormonaux.
IV.Hormones et Régulation de l Appétit
L'étude explore le rôle de plusieurs hormones dans la régulation de l'appétit, incluant la leptine, l'insuline, le peptide YY (PYY), l'oxyntomoduline (OXM), et la sérotonine. Les effets anorexigènes de ces hormones et leur implication potentielle dans le traitement de l'obésité sont analysés. L'influence de la sérotonine sur la consommation de macronutriments (lipides et glucides) est discutée.
1. La leptine régulation de l appétit et résistance à la leptine
Le rôle de la leptine dans la régulation de l'appétit est central dans cette section. L'administration aiguë ou continue de leptine réduit l'hyperphagie et les apports alimentaires, entraînant une perte de poids. Une déficience en leptine, due à des mutations génétiques rares, provoque une obésité massive, réversible par une thérapie de remplacement. L'efficacité des injections centrales de leptine comparées aux injections périphériques suggère un site d'action principal dans l'hypothalamus. Cependant, la majorité des individus obèses présentent des niveaux plasmatiques élevés de leptine, indiquant une résistance à son action. Cette résistance pourrait résulter d'un transport altéré à travers la barrière hémato-encéphalique ou d'un signalement inadéquat dans les neurones sensibles à la leptine. Il est important de noter que la résistance à la leptine peut être une conséquence de l'obésité, mais une sensibilité réduite à la leptine pourrait aussi en être une cause. Stanley et al. (142) suggèrent d'ailleurs que la leptine soit plutôt une hormone de jeûne qu'une hormone de rassasiement.
2. L insuline et son rôle anorexigène
Le document explore le rôle potentiel de l'insuline comme signal anorexigène dans le système nerveux central (SNC). Les individus obèses sécrètent des quantités plus importantes d'insuline pour un même niveau de glucose sanguin, phénomène lié à la résistance à l'insuline, particulièrement marquée dans l'obésité abdominale. L'injection centrale d'insuline, ou d'une substance mimétique, entraîne une réduction des apports alimentaires et une perte de poids chez les primates et les rongeurs, l'effet étant dose-dépendant. Ces observations suggèrent un rôle important de l'insuline dans la régulation de l'appétit au niveau du SNC, en agissant potentiellement sur l'expression de gènes hypothalamiques impliqués dans cette régulation. La résistance à l'insuline, souvent observée dans l'obésité, pourrait perturber ce mécanisme de régulation de l'appétit, contribuant ainsi au développement et au maintien de l'obésité.
3. Autres hormones impliquées dans la régulation de l appétit PYY et OXM
La section aborde le rôle du peptide YY (PYY) et de l'oxyntomoduline (OXM) dans le contrôle de l'appétit. Le PYY, sécrété par l'intestin, augmente après l'ingestion d'un repas et son administration exogène (PYY 3-36) réduit les apports alimentaires chez l'humain et l'animal, suggérant un potentiel thérapeutique pour l'obésité. Malgré des taux plasmatiques de PYY réduits chez les individus obèses, ils restent sensibles à l'effet anorexigène du PYY exogène. L'oxyntomoduline (OXM), également sécrétée par l'intestin, est proportionnelle aux calories ingérées et réduit l'appétit et les apports alimentaires chez les individus sains et obèses. Des études montrent une perte de poids significative suite à une administration chronique d'OXM chez les sujets obèses. Bien que leur rôle précis dans la régulation pondérale reste à éclaircir, le PYY et l'OXM présentent un potentiel thérapeutique important pour le traitement de l'obésité.
4. La sérotonine et son rôle anorexigène
La sérotonine, un neurotransmetteur anorexigène, est discutée pour son rôle dans la régulation de l'appétit. Son implication dans ce processus est bien établie depuis plusieurs décennies, des études montrant que l'augmentation de ses concentrations dans le système nerveux central réduit significativement les apports alimentaires chez l'animal. La sérotonine pourrait même être un signal de satiété chez l'humain. Cependant, son influence sur les apports en macronutriments reste à préciser. Certains auteurs l'associent à la réduction des apports en lipides, d'autres en glucides. De plus, la consommation de glucides semble influencer le taux de renouvellement de la sérotonine chez les patients dépressifs. Chez l'animal, la sérotonine pourrait réduire le stress en favorisant la consommation de matières grasses. La composition des repas utilisés dans les études est donc cruciale pour éviter des biais méthodologiques dans l'évaluation de l'impact de la sérotonine sur l'appétit et les apports alimentaires.
V.Préférences Alimentaires et Obésité
Les préférences alimentaires sont influencées par des facteurs génétiques et environnementaux. L'héritabilité des préférences alimentaires est faible, mais l'apprentissage et l'environnement jouent un rôle majeur. Les individus obèses ont tendance à consommer des aliments à haute densité énergétique et riches en matières grasses et en sel. L'impact des facteurs culturels sur les choix alimentaires est également souligné.
1. Influence des facteurs génétiques et environnementaux sur les préférences alimentaires
Cette section explore les déterminants des préférences alimentaires, soulignant le rôle relatif des facteurs génétiques et environnementaux. Chez l'adulte, l'influence de l'environnement, incluant les croyances et attitudes envers le poids et la perte de poids, semble plus importante que celle des facteurs génétiques. Des études familiales et sur les jumeaux montrent une faible héritabilité des préférences pour des aliments ou macronutriments spécifiques (seulement 20% de la variance pour les glucides et les lipides selon Pérusse et al. (244)). Cependant, l'héritabilité serait plus notable pour l'apport total en macronutriments. La préférence pour les saveurs sucrées et la haute densité énergétique des aliments, ainsi que l'aversion pour les saveurs amères, sont discutées. L'aversion au goût amer semble être génétiquement déterminée, illustré par la perception variable du phenylthiocarbamide (PIC) et du 6-n-propylthiouracil (PROP). Cependant, la perception du PROP n'impacte pas l'IMC ou la consommation de lipides. Le document met en lumière que les préférences alimentaires s'acquièrent principalement par apprentissage, modifiable par l'expérience.
2. Apprentissage des préférences alimentaires association et satiété sensorielle spécifique
L'apprentissage joue un rôle essentiel dans le développement des préférences alimentaires. Les conséquences de la consommation d'un aliment influencent fortement les préférences et aversions futures. Une expérience négative (effets gastro-intestinaux) peut mener à une aversion apprise, même pour des aliments initialement appréciés. La satiété sensorielle spécifique, concept selon lequel le plaisir associé à la consommation d'un aliment diminue après une consommation répétée, est présentée comme un autre déterminant. Ce phénomène est lié à la stimulation sensorielle et à l'ingestion de l'aliment, et non aux effets post-absorption. Plusieurs facteurs sensoriels influencent la satiété sensorielle spécifique, notamment les perceptions gustatives (sucré, salé), l'intensité des saveurs, la perception visuelle et la texture. Cependant, l'effet du contenu énergétique et en macronutriments reste à déterminer en raison de résultats contradictoires. Birch (239) conclut que les préférences alimentaires sont principalement apprises et donc modifiables, soulignant le potentiel d'intervention pour modifier les comportements alimentaires.
3. Autres déterminants des préférences alimentaires et lien avec l obésité
Au-delà des facteurs génétiques et de l'apprentissage, l'environnement a un impact significatif sur les préférences alimentaires. Des facteurs comme la culture influencent la signification, la disponibilité, la préparation et l'utilisation des aliments. Les mélanges de sucres et de matières grasses sont considérés comme hautement appétissants. Les individus, quel que soit leur poids, semblent utiliser les mêmes critères (texture, goût, préférences hédoniques) pour choisir des aliments. Cependant, les personnes obèses consomment des aliments à plus forte densité énergétique et riches en sel. Ce chapitre souligne l'importance de l'environnement et de la culture dans la formation des préférences alimentaires et leur rôle dans le développement de l'obésité. La compréhension de ces interactions est essentielle pour la conception d'interventions efficaces visant à promouvoir des choix alimentaires sains et à lutter contre l'obésité.
VI.Traitements Pharmacologiques de l Obésité Sibutramine et Rimonabant
L'étude examine l'efficacité de la sibutramine et du rimonabant dans le traitement de l'obésité. La sibutramine, inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, induit une perte de poids à court terme, même sans régime, en augmentant la satiété. Des études cliniques (mentionnant des données sur les participants et les résultats) sont citées pour illustrer l'efficacité de la sibutramine, notamment l'étude STORM. Le rimonabant, bloqueur du récepteur cannabinoïde 1 (CB1), est également mentionné pour son efficacité sur la perte de poids et les facteurs de risque cardiovasculaires.
1. Le Rimonabant mécanisme d action et efficacité
Le document présente le rimonabant (SR141716A) comme un bloqueur sélectif du récepteur cannabinoïde 1 (CB1) agissant au niveau central et périphérique. Initialement développé pour l'arrêt du tabac, son efficacité dans la perte de poids et l'amélioration des facteurs de risque cardiovasculaires et métaboliques a été démontrée dans les études RIO-Europe et RIO-Lipids sur des patients en surpoids ou obèses et dyslipidémiques, avec une dose de 20 mg pendant 12 mois. L'étude RIO North-America a confirmé son efficacité sur 2 ans, combinée à un déficit énergétique de 2510 kJ (600 kcal). Un point notable est la durée de la perte de poids induite par le rimonabant, qui se maintient pendant au moins neuf mois avant d'atteindre un plateau, contrairement à d'autres molécules. Le texte souligne donc l'efficacité prolongée du rimonabant dans la gestion du poids et l'amélioration des paramètres métaboliques associés à l'obésité, en comparaison avec d'autres traitements disponibles.
2. La Sibutramine efficacité sur la perte de poids et mécanismes d action
La sibutramine est présentée comme un médicament sur ordonnance pour le traitement de l'obésité, agissant principalement en diminuant l'apport énergétique. Ses propriétés pharmacologiques incluent l'inhibition de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, stimulant ainsi le système nerveux sympathique. Des études ont montré son efficacité dans la perte de poids, même à court terme et sans prescription diététique ni activité physique. Une étude à court terme (7 jours) mentionnée dans le texte a montré une perte de poids significative (-0.8 kg vs -0.3 kg pour le placebo). Des études plus longues ont évalué l'efficacité de la sibutramine en combinaison avec des modifications des habitudes de vie, démontrant une potentialisation de la perte de poids. L'étude STORM, une étude européenne multicentrique de 24 mois, et une étude de Wadden et al. (287) soulignent l'efficacité accrue de la sibutramine combinée à une intervention sur les habitudes de vie. Le texte soulève l'hypothèse selon laquelle la sibutramine agirait sur le système nerveux sympathique, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour élucider complètement son mécanisme d'action sur la dépense énergétique et les préférences alimentaires.
VII.Étude sur l Effet de la Sibutramine chez des Hommes Obèses
Une étude menée à Montréal sur 12 hommes obèses a évalué l'effet à court terme (7 jours) de la sibutramine (15mg) sur le métabolisme de repos (MR), l'effet thermique de l'alimentation (ETA), la consommation de glucides et les préférences alimentaires, en particulier pour les aliments sucrés. Malgré une légère perte de poids significative, aucun effet significatif sur les préférences alimentaires n'a été observé. Les méthodes de mesure (calorimétrie indirecte, questionnaires alimentaires) sont détaillées.
1. Objectif et méthodologie de l étude
L'étude, menée à Montréal, visait à évaluer l'effet à court terme (7 jours) de 15 mg de sibutramine sur le métabolisme de repos (MR), l'effet thermique de l'alimentation (ETA), la consommation de glucides et les préférences alimentaires (particulièrement pour les aliments sucrés) chez 12 hommes obèses. Contrairement à la plupart des études sur la sibutramine, aucun régime alimentaire ou programme d'activité physique n'était prescrit. La méthodologie impliquait une étude croisée (crossover) avec deux périodes de traitement de 7 jours chacune (sibutramine 15 mg vs placebo), séparées par une période de lavage de 2 semaines. Des mesures répétées du poids, du tour de taille, de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, du MR et de l'ETA (par calorimétrie indirecte) ont été effectuées. Les préférences alimentaires ont été évaluées à l'aide d'un repas-test de type buffet et de rappels alimentaires sur 24 heures. L'objectif était d'évaluer l'impact de la sibutramine en l'absence de perte de poids significative, afin d'isoler ses effets sur le métabolisme et les préférences alimentaires.
2. Résultats de l étude perte de poids et dépenses énergétiques
Malgré l'absence de prescription diététique ou d'activité physique, une légère mais significative perte de poids a été observée avec la sibutramine (-0.8 kg vs -0.3 kg pour le placebo, p=0.013), même après seulement 7 jours de traitement. Ces résultats indiquent une efficacité à court terme de la sibutramine sur la perte de poids, même sans modifications du style de vie. Cependant, aucune différence significative n'a été trouvée concernant le métabolisme de repos (MR) et l'effet thermique de l'alimentation (ETA) entre les deux groupes (sibutramine vs placebo). L’absence d’effet significatif sur l’ETA peut être dû au faible nombre de participants ou au fait que la sibutramine n'agit pas sur les tissus adipeux bruns chez l'humain. L'absence de réduction significative de l'apport énergétique rapporté par les participants (via les rappels alimentaires de 24 heures) est discutée en relation avec les problèmes connus de sous-déclaration de la consommation alimentaire chez les individus obèses. L'étude met en évidence la complexité de la mesure de l'apport alimentaire et suggère la nécessité d'une méthodologie plus robuste pour des études futures.
3. Résultats de l étude apports en macronutriments et préférences alimentaires
L'étude n'a pas révélé d'impact significatif de la sibutramine sur les apports en macronutriments ou les préférences alimentaires (pour les aliments sucrés ou les glucides). Ce résultat suggère que l'effet de la sibutramine sur la consommation alimentaire serait davantage lié à une augmentation de la satiété qu'à une modification des préférences spécifiques pour certains nutriments ou goûts. L'absence d'effet sur les préférences pour les aliments sucrés est discutée en relation avec des études antérieures montrant que les manipulations sérotoninergiques peuvent réduire la sensation de faim sans modifier le plaisir hédonique de la nourriture. L’étude souligne l’indépendance possible des mécanismes hédoniques et homéostatiques de la régulation alimentaire. La conception de l'étude, avec un repas-test de type buffet en milieu laboratoire, pourrait avoir induit des comportements restrictifs chez les participants, influençant ainsi les résultats. L'inclusion d'une évaluation préalable des préférences alimentaires aurait pu améliorer la validité des données.
4. Discussion et limitations de l étude
L'étude conclut que le mécanisme de la perte de poids induite par la sibutramine est probablement lié à son impact sur l'apport alimentaire via une augmentation de la satiété, plutôt qu'à un effet sur les préférences alimentaires ou la dépense énergétique. Des études plus poussées sont nécessaires pour déterminer si l'efficacité de la sibutramine est accrue chez les patients présentant un déficit de satiété. Les auteurs discutent des limitations de leur étude, notamment la courte durée du traitement (7 jours), l'absence de prescription diététique ou d'activité physique, et le faible nombre de participants. L'absence d'augmentation significative de la fréquence cardiaque est discutée en lien avec l'action de la sibutramine sur le système nerveux sympathique, et l'hypothèse que la régulation de la fréquence cardiaque pourrait être influencée par le système nerveux parasympathique. Des facteurs méthodologiques, comme l'inclusion d'aliments sucrés riches en lipides dans le repas-test et la possibilité d'une sous-déclaration de la consommation alimentaire, sont également considérés. Enfin, le besoin d'études futures incluant une évaluation de la restriction cognitive et de la préoccupation à l'égard du poids est souligné.
