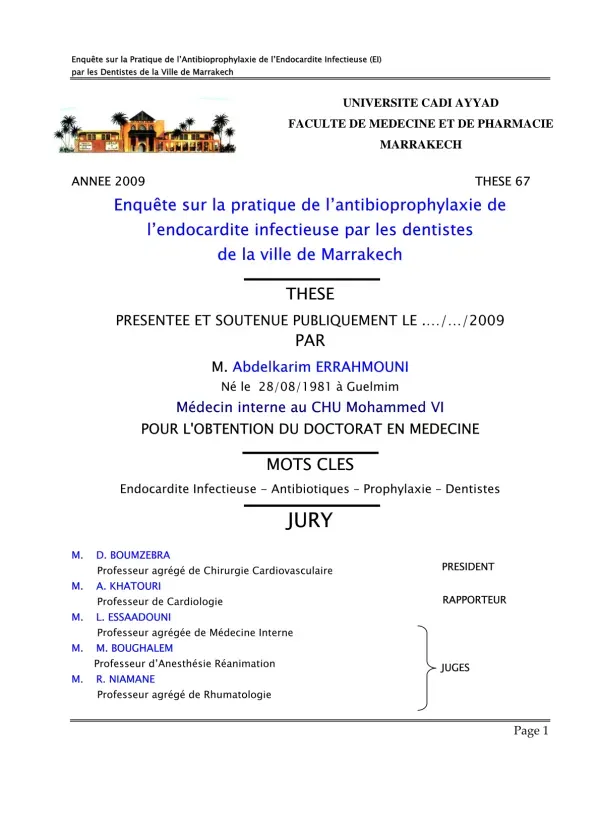
Enquête sur la Pratique de l'Antibioprophylaxie de l'Endocardite Infectieuse par les Dentistes de Marrakech
Informations sur le document
| Auteur | Abdelkarim Errahouni |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 2.54 MB |
- Antibioprophylaxie
- Endocardite Infectieuse
- Médecine Dentaire
Résumé
I.Antibioprophylaxie de l Endocardite Infectieuse EI et Soins Dentaires
Ce document analyse les pratiques des chirurgiens-dentistes concernant l’antibioprophylaxie avant des soins dentaires chez les patients à risque d'endocardite infectieuse (EI). L'étude met en lumière des divergences significatives entre les recommandations de la Société Française de Cardiologie (SFC) et les pratiques observées. Un taux de réponse de 92% a été obtenu auprès des dentistes interrogés, supérieur aux études similaires menées à Michigan (50%), Floride (65%), Londres (64%), Genève (66%) et Casablanca (79%). L'étude souligne l'importance de la bactériémie induite par les soins dentaires, et le rôle crucial de l'hygiène bucco-dentaire dans la prévention de l'EI. Des données sur l'utilisation de l'amoxicilline, la durée de l'antibioprophylaxie, et les types de cardiopathies à risque (incluant les cardiopathies congénitales cyanogènes et non cyanogènes) sont présentées, ainsi que l'analyse de la fréquence de l'EI post-intervention chirurgicale.
1. Étude sur les pratiques d antibioprophylaxie et l endocardite infectieuse
Cette section présente les résultats d'une enquête sur les pratiques des chirurgiens-dentistes concernant l'antibioprophylaxie avant les soins dentaires chez les patients à risque d'endocardite infectieuse (EI). Le taux de réponse à l'enquête (92%) est significativement supérieur à celui d'études similaires menées aux États-Unis (Michigan : 50%, Floride : 65%) et en Europe (Londres : 64%, Genève : 66%). L'étude de Casablanca, également citée, a obtenu un taux de réponse de 79%. L'enquête explore le protocole de prescription d'amoxicilline, la majorité des dentistes (85%) commençant le traitement une heure avant l'intervention, tandis qu'une minorité (10.8%) le débute six heures auparavant. De plus, des divergences apparaissent concernant la durée de l'antibioprophylaxie : 54.2% des dentistes se limitent à une prise unique, 32.5% prescrivent une deuxième dose 6 heures après, et 4.2% utilisent un autre schéma. Ces variations de pratiques soulignent la nécessité d'une meilleure harmonisation des protocoles pour la prévention de l'EI. La formation continue des chirurgiens dentistes est également abordée, avec une analyse de leurs méthodes d'actualisation des connaissances sur la prophylaxie de l'EI (revues médicales, discussions avec des cardiologues, conférences, sites internet).
2. Bactériémie hygiène bucco dentaire et prévention de l EI
Cette partie se concentre sur le rôle de la bactériémie dans le développement de l'endocardite infectieuse. Une comparaison des estimations de bactériémies spontanées (mastication, brossage) et des bactériémies provoquées par des interventions dentaires révèle que la bactériémie cumulative liée aux activités quotidiennes est bien plus importante. Selon Guntheroth [21], la bactériémie spontanée atteint 90 heures par mois, contre seulement 6 minutes pour une avulsion dentaire. Roberts [16] confirme cette différence significative (jusqu'à ×10⁸) entre les procédures quotidiennes et les interventions dentaires. Des études rétrospectives, notamment celle d'Al-Karaawi et al. [22], suggèrent que des actes dentaires ne nécessitant pas, selon l'American Heart Association et la British Society of Antimicrobial Chemotherapy, d'antibioprophylaxie, présentent un risque de bactériémie cumulative comparable aux procédures à risque. Cependant, la prudence s'impose face à ces études rétrospectives, notamment celles réalisées chez l'enfant sous anesthésie générale. Le texte souligne l'existence de bactériémies de bas grade, provoquées mais éphémères, et de bactériémies spontanées quotidiennes et répétées, toutes deux pouvant véhiculer des souches responsables d'EI. L'évolution des recommandations, depuis la mise en garde de 1960 sur l'émergence de souches résistantes à l'ampicilline jusqu'aux recommandations actuelles de l'AHA de 2007, met en lumière le changement de stratégie vers une antibioprophylaxie plus ciblée, axée sur les patients à risque élevé et le rôle de la bactériémie spontanée.
3. Recommandations actuelles groupes à risque et pratiques observées
Cette section détaille les recommandations de 2002 de la Société Française de Cardiologie, visant à limiter l'indication de l'antibioprophylaxie aux situations où le rapport bénéfice/risque est le plus élevé et à limiter le développement de résistances bactériennes. L'importance de mesures non médicamenteuses, comme une hygiène buccodentaire rigoureuse dès le plus jeune âge, est soulignée. La surveillance régulière de l'état dentaire est également préconisée, notamment chez les patients cardiaques à risque. L'étude explore les divergences entre les recommandations et les pratiques des dentistes, en particulier concernant la durée et le timing de l'antibioprophylaxie. Pour les patients du groupe B (risque moins élevé), l'antibioprophylaxie est optionnelle, laissant le choix au clinicien, avec une information préalable du patient et un carnet de suivi. L'étude de Casablanca révèle une surestimation du risque d'EI chez les dentistes, notamment concernant le pontage coronaire et le port de pacemaker. Le document rappelle que la majorité des recommandations internationales préconisent une monoprise d'antibiotiques une heure avant le geste à risque. Le faible taux d'adhérence (86.8%) aux recommandations souligne le besoin d'une meilleure éducation des professionnels de santé et des patients.
4. Analyse des cardiopathies des gestes à risque et des recommandations
Cette partie approfondit les différents types de cardiopathies à risque d’endocardite infectieuse (EI), en distinguant les cardiopathies à haut risque et celles à risque moins élevé. L’impact des interventions chirurgicales sur le risque d’EI est analysé, avec un focus sur les prothèses valvulaires et les cardiopathies congénitales (cyanogènes et non cyanogènes). Les données de Morris et al. [50] sont citées, indiquant un risque annualisé d’EI de 7.2‰ après remplacement valvulaire prothétique. Le document explore les différentes localisations des lésions d’EI et leur évolution. L’étude met en lumière des différences dans l’évaluation du risque entre les dentistes français et ceux de Casablanca. L’importance de l’antibioprophylaxie lors de la mise en place de sondes est rappelée, et le document conclut sur l’absence de preuve formelle d’un lien direct entre certains gestes dentaires et l’EI, même si la possibilité d’une implication reste envisagée faute de données suffisantes. Enfin, la nécessité d’adapter l’antibioprophylaxie à la porte d’entrée et à la sensibilité des bactéries impliquées est soulignée, avec une discussion sur les alternatives à la pénicilline en cas d’allergie. La divergence des pratiques des dentistes concernant la durée de l’antibioprophylaxie est encore soulignée, avec l'accent sur le besoin d’éducation des professionnels et des patients pour améliorer l’adhérence aux recommandations actuelles.
II.Recommandations et Pratiques de l Antibioprophylaxie
Les recommandations de la SFC de 2002 et de l'American Heart Association (AHA) de 2007, axées sur la limitation de l'antibioprophylaxie aux situations à haut risque, sont comparées aux pratiques des dentistes. Seulement 53% des dentistes de l'étude appliquent une prophylaxie unique avant le geste dentaire, conformément aux recommandations, alors que 46% utilisent des doses supplémentaires. Une divergence est également constatée concernant la prise d'amoxicilline: 85% des dentistes la prescrivent une heure avant la procédure, 10.8% six heures avant. L'étude de Casablanca montre des écarts similaires, avec seulement 33% des dentistes débutant l'antibioprophylaxie une heure avant le geste et la moitié poursuivant le traitement au-delà de 48 heures. L'adhérence aux recommandations reste un enjeu majeur, comme le montre le fait que 13.2% des patients informés n'ont pas suivi les conseils médicaux. Le document insiste sur l'importance de l'éducation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des patients pour améliorer l'observance.
1. Comparaison des recommandations et des pratiques d antibioprophylaxie
Cette section analyse les écarts entre les recommandations internationales et les pratiques réelles des chirurgiens-dentistes concernant l'antibioprophylaxie pour la prévention de l'endocardite infectieuse (EI). Elle met en lumière une divergence importante entre les recommandations de la Société Française de Cardiologie (SFC) de 2002 et celles de l'American Heart Association (AHA) de 2007, qui privilégient une approche plus restrictive, réservant l'antibioprophylaxie aux patients à plus haut risque. L'étude révèle que seulement 53% des dentistes interrogés suivent la recommandation d'une prophylaxie unique avant le geste dentaire, sans dose post-procédurale, tandis que 46% utilisent des doses supplémentaires. Cette différence de pratique est significative et souligne la nécessité d'une meilleure harmonisation des protocoles. De plus, le timing de la première prise d'antibiotiques (amoxicilline) varie: 85% des dentistes la prescrivent une heure avant l'intervention, tandis que 10.8% la prescrivent six heures avant. Ces variations de pratiques, également observées dans une étude similaire menée à Casablanca (avec seulement 33% des dentistes commençant l'antibioprophylaxie une heure avant le geste et la moitié poursuivant le traitement au-delà de 48 heures), mettent en évidence un manque d'uniformité dans l'application des recommandations. L'étude souligne le rôle essentiel de l'éducation médicale continue pour une meilleure adéquation entre les recommandations et les pratiques cliniques.
2. Adhérence aux recommandations et facteurs influençant les pratiques
Cette partie explore les raisons de la faible adhérence aux recommandations concernant l'antibioprophylaxie. L'étude révèle que 13.2% des 68 patients ayant bénéficié d'un acte à risque et informés de la nécessité d'une antibioprophylaxie n'ont pas suivi les conseils médicaux, soulignant le besoin d'une meilleure éducation du patient. Les recommandations internationales tendent à limiter l'utilisation de l'antibioprophylaxie aux procédures et populations les plus à risque d'EI, une tendance accentuée par les recommandations de l'AHA de 2007. Ces dernières réservent l'antibioprophylaxie aux patients à plus haut risque (prothèses valvulaires, antécédents d'EI, cardiopathies congénitales cyanogènes...). Les soins dentaires concernés impliquent une manipulation de la gencive, de la région péri-apicale, ou une rupture de la barrière muqueuse. Cependant, de nombreux cas d'EI ne sont pas associés à un geste invasif bucco-dentaire, soulignant le rôle potentiel des bactériémies spontanées. Dans notre contexte, l'exclusion des valvulopathies mitro-aortiques rhumatismales (fréquentes) des recommandations américaines est une limite importante, de même que la qualité variable de l'hygiène bucco-dentaire chez les patients cardiaques. Une meilleure information et éducation des patients et des professionnels restent donc essentielles pour améliorer l'observance des recommandations et une meilleure gestion de l'antibioprophylaxie.
III.Cardiopathies à Risque et Gestion de l EI
Le document détaille les différents types de cardiopathies présentant un risque élevé d'EI, en distinguant les groupes à haut risque et à risque moins élevé. Il aborde le risque d'EI lié à des interventions chirurgicales, notamment le remplacement valvulaire prothétique (risque de 7,2‰ année/patient selon Morris et al.), et les cardiopathies congénitales, soulignant le risque particulièrement élevé des cardiopathies cyanogènes (8,2‰ année/patient selon Corone). L'étude met en évidence des différences dans l'évaluation du risque d'EI entre les dentistes français et ceux de Casablanca, notamment concernant le pontage coronaire et le port de pacemaker. L'importance de la surveillance régulière de l'état dentaire chez les patients cardiaques est également soulignée. Enfin, le document évoque la nécessité d'une antibioprophylaxie adaptée en cas d'allergie à la pénicilline, avec une discussion sur les alternatives thérapeutiques.
1. Définition des cardiopathies à risque d endocardite infectieuse
Cette section définit les critères pour identifier les cardiopathies à risque d'endocardite infectieuse (EI). L'évaluation du risque tient compte non seulement de l'incidence de l'EI sur la cardiopathie, mais aussi de sa gravité. Cela a conduit les sociétés savantes à individualiser des groupes de cardiopathies à haut risque et des cardiopathies sans risque, qui ne nécessitent aucune prophylaxie en péri-soins dentaires. Le texte souligne l'importance de considérer le type de cardiopathie et les interventions chirurgicales déjà réalisées. Le remplacement valvulaire prothétique, par exemple, augmente considérablement le risque d’EI, avec un risque annualisé pouvant atteindre 7,2‰ année/patient selon Morris et al. [50]. Les cardiopathies congénitales sont également abordées, avec une distinction entre les cardiopathies cyanogènes (risque particulièrement élevé, notamment les ventricules uniques, les transpositions des gros vaisseaux, etc.), et les cardiopathies non cyanogènes. Le risque est évalué différemment selon que les cardiopathies congénitales ont été opérées ou non, la présence de lésions résiduelles (shunt, fuite valvulaire) influençant fortement le risque. L'étude mentionne le risque d'EI sur coarctation de l'aorte (0,7‰ année/patient selon Corone [39]), et le risque postopératoire accru après chirurgie comportant la mise en place de matériel prothétique (patchs, tubes prothétiques, shunts). Enfin, le document discute du cas des prolapsus mitraux, précisant que seuls ceux avec insuffisance mitrale ou épaississement valvulaire justifient une antibioprophylaxie.
2. Impact des interventions chirurgicales et des dispositifs médicaux
L'impact des interventions chirurgicales sur le risque d'endocardite infectieuse (EI) est un point central de cette section. Le texte explique que le risque peut être aboli après une réparation complète de la cardiopathie sans matériel prothétique et sans lésion résiduelle (ex: canal artériel opéré, CIV opérée sans insuffisance aortique). Cependant, le risque persiste en cas de lésions résiduelles comme un shunt ou une fuite valvulaire. Le risque est significativement plus important en cas de remplacement valvulaire prothétique, augmentant avec le temps postopératoire. L'étude de Morris et al. [50] est citée, indiquant un risque d'EI atteignant 7,2‰ année/patient dans ce cas. Pour la coarctation de l'aorte, le risque postopératoire est estimé à 1,2‰ année/patient. Le document souligne également l'augmentation du risque dans les chirurgies nécessitant du matériel prothétique (patchs, tubes prothétiques, shunts), notamment dans les trois à six premiers mois suivant l'intervention, avant l'endothélialisation. Des exemples de risques spécifiques liés à certains types d'interventions sont donnés: 11,5‰ année/patient pour les tubes prothétiques ventricule droit-artère pulmonaire dans les atrésies pulmonaires à septum ouvert. L'étude mentionne aussi les récidives d'EI, dont l'incidence est de 3 à 5 pour 1000 années-patients, et l'augmentation de leur fréquence ces dernières années, potentiellement liée à l’augmentation des EI chez les toxicomanes et au nombre d'EI opérées en phase bactériologiquement active.
3. Gestion du risque et recommandations spécifiques
Cette section traite de la gestion du risque d'endocardite infectieuse (EI) selon différents contextes et types de patients. Elle souligne la nécessité de tenir compte de la nature de l’acte réalisé et de l’état buccodentaire et général du patient, notamment pour les patients du groupe B (risque moins élevé) où l’antibioprophylaxie est optionnelle. L’information préalable du patient et son adhésion à la stratégie sont cruciales, avec l’utilisation d’un carnet de suivi. Le document détaille des recommandations spécifiques pour les soins endodontiques, distinguant les patients du groupe A (haut risque) et ceux du groupe B. Pour les patients du groupe A, les soins endodontiques doivent être exceptionnels, réalisés sous digue, en une seule séance, et réservés aux dents monoradiculées ou à la première prémolaire si les deux canaux sont accessibles. Pour les patients du groupe B, les traitements radiculaires sont conditionnels à un champ opératoire étanche, une accessibilité totale de l’endodonte et une réalisation en une seule séance; autrement, l’extraction est recommandée. La pose d’implants et la chirurgie parodontale sont déconseillées. L'antibioprophylaxie avant une chirurgie valvulaire est également abordée, précisant le bilan d’imagerie dentaire nécessaire et la sélection des dents à conserver. Enfin, le document discute des alternatives à la pénicilline en cas d'allergie, et les protocoles spécifiques pour les patients sous prophylaxie au long cours.
IV.Gestes Dentopathiques à Risque et Prévention
Le document classe les gestes dentaires selon leur risque de bactériémie et donc de développement d'EI. Il souligne que même des procédures apparemment mineures comme le détartrage ou les soins endodontiques peuvent présenter un risque chez les patients à risque. L'étude révèle qu'un nombre préoccupant de dentistes (5%) ne considèrent pas certains gestes comme à risque. Les recommandations concernant les soins endodontiques et les traitements radiculaires, en particulier chez les patients du groupe A (haut risque), sont détaillées, avec l'accent sur la nécessité d'un champ opératoire étanche (digue) et de protocoles stricts. L'importance de la prévention par une bonne hygiène buccodentaire est réaffirmée tout au long du document.
1. Classification des gestes bucco dentaires selon leur risque
Cette section se penche sur la classification des gestes bucco-dentaires selon leur niveau de risque de bactériémie et, par conséquent, de développement d'une endocardite infectieuse (EI). L'étude met en évidence une divergence de perception du risque entre les dentistes, certains sous-estimant le risque associé à des actes comme le drainage d'abcès, le traitement canalaire ou le détartrage sous-gingival chez les patients porteurs d'une cardiopathie à risque. Le document rappelle que le risque est lié à la capacité du geste à générer une bactériémie conséquente et intense, impliquant des souches responsables d'EI, et à l'attribuabilité de l'endocardite au geste réalisé. L'analyse d'études épidémiologiques est nécessaire pour établir une corrélation fiable entre le geste, la bactériémie induite et la survenue de l'EI. Le texte souligne le manque de données scientifiques définitives concernant le lien entre certains gestes dentaires et le développement d'une EI, rendant difficile une classification catégorique des actes à risque. Cependant, le concept de gestes bucco-dentaires à risque reste valide, et une approche prudente est recommandée en attendant de nouvelles données plus concluantes. Malgré une tendance à minimiser l'implication des bactériémies induites par les soins buccodentaires, leur possible implication dans les EI ne peut être exclue en raison de l'insuffisance des données actuelles.
2. Recommandations pour les soins endodontiques et autres interventions
Cette section détaille les recommandations spécifiques concernant certains gestes bucco-dentaires, notamment les soins endodontiques et les traitements radiculaires. Pour les patients à haut risque (groupe A), les soins endodontiques doivent être exceptionnels, réalisés sous digue, en une seule séance, et seulement sur des dents monoradiculées ou la première prémolaire si les deux canaux sont accessibles. La séparation des racines est fortement déconseillée. Pour les patients à risque moins élevé (groupe B), les traitements radiculaires sont possibles sous trois conditions : champ opératoire étanche (digue), accessibilité totale de l'endodonte et réalisation en une seule séance. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'extraction est recommandée. La pose d'implants et la chirurgie parodontale sont déconseillées pour ce groupe de patients. Avant une chirurgie valvulaire, une antibioprophylaxie est indiquée, ainsi qu'un bilan d'imagerie dentaire complet. Seules les dents pulpées ou avec un traitement endodontique parfait, sans élargissement desmodontal et remontant à plus d'un an, sont conservées. Le document souligne à nouveau l'importance d'une hygiène bucco-dentaire irréprochable, qui constitue une mesure de prévention essentielle de l'endocardite infectieuse. Il y est aussi mentionné que pour les patients du groupe B, l'antibioprophylaxie est optionnelle, le choix étant laissé au clinicien après information et adhésion du patient, consignée dans un carnet de suivi.
