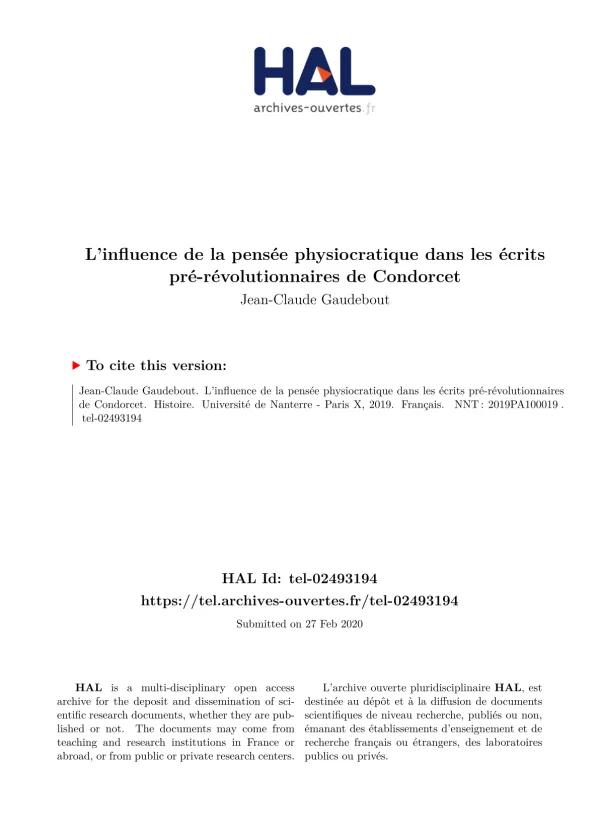
L'influence de la pensée physiocratique dans les écrits de Condorcet
Informations sur le document
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 2.79 MB |
- Condorcet
- pensée physiocratique
- histoire économique
Résumé
I.La Physiocratie et la Liberté du Commerce des Grains en France au XVIIIe siècle
Ce document explore les débats économiques et politiques du XVIIIe siècle en France, centrés sur la physiocratie et la question cruciale de la liberté du commerce des grains. Les idées des physiocrates, notamment Quesnay et son célèbre Tableau économique, prônant la grande culture, la productivité exclusive de l'agriculture, et le rôle central des propriétaires fonciers, sont analysées. Leur objectif était d'atteindre un « bon prix » des grains via la libre circulation, même à l'exportation, pour enrichir l'État. Cependant, cette politique a suscité de vives controverses. Des figures clés comme Turgot, contrôleur général des Finances, ont tenté de mettre en pratique ces idées, mais se sont heurtées à des résistances et à des troubles sociaux, notamment la « Guerre des farines ». L'échec des réformes de Turgot a illustré les difficultés de l'application d'une politique de marché libre sans infrastructure adéquate. Des auteurs comme Necker et Condorcet ont apporté des analyses critiques, soulignant les risques de spéculation et les inégalités sociales.
1. La doctrine physiocratique et la liberté du commerce des grains
La section initiale expose la doctrine physiocratique et son approche de la liberté du commerce des grains. Les physiocrates, dont Quesnay est une figure majeure, considéraient l'agriculture comme la seule source de richesse (« produit net »), prônant une grande culture et la liberté totale du commerce des grains, y compris l'exportation. L'argument central repose sur l'idée qu'une libre circulation des grains permettrait d'égaliser les prix sur le marché européen, garantissant un « bon prix » pour les producteurs français, même si cela impliquait une hausse initiale des prix dans le sud de la France. Ce mécanisme permettrait, à terme, une baisse des prix grâce à l'importation de grains des pays du nord de l'Europe. Cette théorie du « bon prix », visant à enrichir l'État, est présentée comme un moyen d'améliorer la situation des cultivateurs et des propriétaires fonciers, sans pour autant négliger les consommateurs. Le Tableau économique de Quesnay sert de modèle explicatif pour cette vision optimiste de la régulation du marché.
2. Tentatives de mise en œuvre et résistances le cas de Turgot
La section suivante analyse les tentatives de mise en œuvre de la politique physiocratique, notamment sous le ministère de Turgot. Turgot, contrôleur général des finances, a tenté d'appliquer les principes de la liberté du commerce des grains, mais ses réformes ont rencontré de fortes résistances. Le texte mentionne l’Arrêt du Conseil sur la liberté du commerce intérieur des grains et farines (septembre 1774) comme une étape clé. Cependant, la politique de libéralisation de Turgot a été confrontée à une crise alimentaire majeure, la « Guerre des farines », marquée par des émeutes populaires et une forte spéculation sur les prix du blé. La répression mise en place, notamment la loi martiale, souligne les tensions entre la théorie économique physiocratique et la réalité sociale. L’échec final de Turgot et le retour à des politiques plus interventionnistes illustrent les difficultés de la mise en œuvre du libre-échange dans le contexte de l'Ancien Régime, notamment le manque d'infrastructures commerciales et l'impact social de fortes fluctuations de prix. Cette section décrit les mesures concrètes prises par Turgot, comme le traité conclu avec les frères Leleu pour approvisionner Paris en farine.
3. Critiques et analyses alternatives de la liberté du commerce des grains
Cette partie présente des critiques et des analyses alternatives de la politique de liberté du commerce des grains. Necker, par exemple, conteste l'efficacité de la liberté totale, soulignant le risque de spéculation et la concentration du pouvoir entre les mains des négociants qui pourraient manipuler le marché à leur profit. La multiplication des intermédiaires, tout en étant nécessaire pour le commerce à grande échelle, peut selon Necker, renchérir les prix au détriment du consommateur. Condorcet, dans ses « Réflexions sur le commerce des blés », propose une analyse plus nuancée, distinguant les cas d'une liberté réciproque de l'exportation et ceux d'une liberté dissymétrique. L’analyse de Condorcet tient compte de la balance commerciale et des effets sur les prix à l'échelle internationale, tout en reconnaissant l'utilité de l'exportation pour l'encouragement à la production. Cependant, comme le remarque Necker et contrairement à Condorcet, la liberté de commerce favorise une concentration du capital entre les mains des négociants, transformant les grains en capital spéculatif, ce qui représente un risque important. Le texte met en lumière les divergences d'opinions et la complexité du débat économique et politique entourant la liberté du commerce des grains.
II.Condorcet Mathématique sociale et critique de la Physiocratie
Le document examine les contributions de Condorcet, philosophe et mathématicien, à la pensée économique et politique. Tout en reconnaissant l'influence initiale des physiocrates sur ses idées concernant la liberté du commerce des grains, Condorcet s'est ensuite démarqué, développant une approche plus moderne de la science sociale, incluant la mathématique sociale et le calcul des probabilités. Il a abordé des problèmes fondamentaux des sciences sociales contemporaines, cherchant à fonder les sciences morales sur la raison plutôt que sur l'opinion et à transformer le choix politique en décision rationnelle. Il a notamment critiqué certains aspects de la physiocratie, tout en partageant certains de leurs objectifs, comme la défense de la propriété et de la liberté individuelle.
1. Condorcet et la mathématique sociale une approche moderne des sciences sociales
Cette section explore la contribution originale de Condorcet à la pensée sociale et politique à travers le prisme de la mathématique sociale. Selon Keith Baker, Condorcet est présenté comme un « prophète de la mathématique sociale » et un « apôtre d’une politique rationnelle ». Son approche, jugée étonnamment moderne par des chercheurs comme Granger, Guilbaud et Duncan Black, se caractérise par l’application de méthodes scientifiques aux affaires humaines. Baker distingue deux aspects dans la conception de la science sociale chez Condorcet : un modèle scientifique reposant sur l’applicabilité des méthodes scientifiques aux réalités humaines, et une définition spécifique du champ social, envisageant la société et ses processus de manière particulière. L’influence de Hume est soulignée, comme réponse au scepticisme pyrrhonien. Condorcet cherche à créer une « science de la conduite » basée sur les probabilités, soumettant ainsi les contingences de la vie humaine à l’autorité des mathématiques, en s’inspirant notamment du calcul de Leibniz. Cette démarche vise à libérer les sciences morales de l’empire de l’opinion pour les soumettre à la raison, et à transformer le choix politique en une prise de décision rationnelle.
2. Condorcet et la physiocratie influences et divergences
L'analyse porte ensuite sur la relation complexe entre Condorcet et la physiocratie. Le texte met en lumière l’influence initiale de la physiocratie sur la pensée de Condorcet concernant notamment la liberté du commerce des grains. Il reprend des concepts clés comme le « bon prix » et la « grande culture ». Cependant, l'évolution de sa pensée, notamment à partir de 1790, est soulignée, marquant un éloignement progressif de la doctrine physiocratique. Le document mentionne l'adhésion de Condorcet à la mathématique sociale dès 1772, en partie influencée par Quesnay et le Tableau économique. Malgré cette évolution, certains auteurs, comme Gilles-Gaston Granger, estiment qu’il n’y a pas de contradiction entre son économie politique et sa mathématique sociale. L’influence de Turgot sur Condorcet est aussi mise en avant, ainsi que la manière dont Condorcet a intégré et remanié certains aspects de la doctrine physiocratique, particulièrement dans ses écrits sur le commerce des grains et sur les assemblées provinciales. L'auteur explore les tensions entre une approche pragmatique de la politique économique, et le développement d'un modèle plus abstrait de la science sociale basée sur le calcul des probabilités.
3. La conception du champ social chez Condorcet et son idéal politique
Enfin, le document explore la conception du champ social chez Condorcet et son idéal politique, en relation avec les débats du XVIIIe siècle. Keith Baker relie la vision de Condorcet à l’idéal politique de Turgot : une société de citoyens égaux devant la loi, contribuant à la rationalité des affaires publiques. Cette rationalité se définit par un débat entre citoyens propriétaires, mettant en jeu la part du « produit net » revenant au souverain. Le modèle scientifique de Condorcet sert alors de cadre pour analyser et comprendre ce processus social. Condorcet, selon Baker, restreint le terme « science sociale » à une approche reposant sur les principes premiers de la nature humaine, tels qu’ils sont décrits par la psychologie sensualiste. Cette science sociale, englobant les vrais principes de l’organisation sociale, requiert un « art social » fondé sur le raisonnement rigoureux, les faits reconnus et le calcul des probabilités. En somme, Condorcet adapte son modèle scientifique aux problèmes concrets du gouvernement et de la société de son temps, cherchant des solutions basées sur l’observation empirique et la rationalité, tout en reconnaissant les limites de l'application pure et simple des principes abstraits.
III.Les conséquences de la politique physiocratique la Guerre des Farines et ses acteurs
La mise en place de la liberté du commerce des grains, sous l’impulsion de la physiocratie, n'a pas été sans conséquences. Le document détaille la Guerre des Farines, une période de troubles sociaux marqués par des émeutes populaires et des actions de « taxation populaire » face à la hausse des prix du pain. La répression par Turgot, y compris l'utilisation de la force militaire, est examinée. Ces événements ont mis en évidence les limites du libéralisme économique face aux enjeux sociaux et la nécessité de tenir compte des réalités locales et des conditions de vie du peuple. L’étude des réactions face à la hausse des prix des grains met en lumière les différentes catégories sociales impliquées (producteurs, commerçants, consommateurs) et leurs stratégies dans un contexte de marché instable. L'analyse de la distribution des grains et l’impact de l’exportation sur les prix en France sont au cœur de cette section.
1. La Guerre des Farines 1774 1775 contexte et déroulement
Cette section détaille les conséquences concrètes de la politique physiocratique de libéralisation du commerce des grains, notamment la crise alimentaire et les émeutes connues sous le nom de « Guerre des Farines ». Le contexte est marqué par de mauvaises récoltes en 1774, entraînant une hausse dramatique des prix du grain et du pain, particulièrement dans le bassin parisien. Le texte souligne le rôle de la spéculation et de la frénésie d'achat dans l'aggravation de la pénurie. L'analyse de Cynthia A. Bouton identifie quatre types de régions concernées par les troubles, et quatre types de comportements des émeutiers, allant de la simple « taxation populaire » sur les marchés locaux à des réquisitions et pillages dans les grandes fermes. Le texte mentionne l’exemple de Beaumont-sur-Oise, où les émeutiers dénonçaient un prix du blé fixé par le roi, illustrant le décalage entre la réalité du marché et la perception populaire. L'analyse de Bouton met également en évidence l'évolution de la participation aux émeutes : une base sociale plus pauvre, une participation masculine accrue et une dimension rurale forte, particulièrement dans les régions de grande culture où la polarisation sociale était importante.
2. La réponse de Turgot et la répression des émeutes
Face à la « Guerre des Farines », le contrôleur général Turgot a réagi par la répression. Le document énumère les mesures prises pour protéger la libre circulation des grains : protection militaire des convois, loi martiale punissant de mort les personnes se rassemblant pour fixer les prix, interdiction pour les villageois de sortir sans certificat, suppression des impôts indirects sur les grains dans le nord de la France. Des centaines d'arrestations et même des exécutions publiques ont eu lieu. Le texte met en lumière la contradiction entre la défense du libre marché et le recours à une répression sévère. L’éviction du lieutenant-général de police Lenoir par Turgot illustre les tensions au sein même du gouvernement face à la crise. Malgré la victoire apparente de Turgot, les prix sont restés élevés et les marchés inégalement fournis, ce qui souligne les limites d'une politique de libéralisation économique pure et simple en l’absence d’une infrastructure commerciale et logistique suffisante pour assurer une distribution équitable des denrées. Le traité conclu par Turgot avec les frères Leleu pour approvisionner Paris en farine est mentionné comme un exemple de mesures exceptionnelles prises en contradiction avec les principes initiaux de la liberté du commerce.
3. Analyse des conséquences à long terme et perspectives
La section analyse les conséquences à long terme de la « Guerre des Farines » et propose des perspectives sur l’efficacité de la politique physiocratique. La chute de Turgot a marqué l’abandon temporaire de la liberté du commerce des grains. Cependant, elle sera brièvement rétablie par Loménie de Brienne en 1787, avec une argumentation toujours physiocratique. Cette dernière tentative de libéralisation souligne la persistance des principes physiocrates, même face aux difficultés rencontrées. L'échec de la politique de libéralisation sous Turgot est analysé par Walter Eltis, qui met en avant le manque d’infrastructure commerciale comme facteur déterminant de l’échec. Eltis souligne que des marchés libres, produisant des prix plus élevés, sont une condition préalable à la réalisation du potentiel productif d'une économie. Le texte suggère que les conséquences de la « Guerre des Farines » ont contribué à un questionnement plus approfondi sur les relations entre le libre marché, les structures sociales et politiques, et la sécurité alimentaire. Il souligne l'importance d'une approche plus globale et nuancée de la politique économique.
IV.Réformes Agraires et Résistances Vaines Pâtures et Communaux
L'étude s'intéresse également aux réformes agraires, notamment concernant l’abandon des vaines pâtures et la gestion des communaux. Des initiatives visant à favoriser la propriété privée et la grande culture ont rencontré des résistances de la part des paysans, qui s'appuyaient sur des pratiques traditionnelles et des droits d'usage collectifs. Le rôle de la monarchie et de l'administration royale dans ces changements, parfois favorisant la « réaction féodale », est mis en avant. L’analyse des pratiques agricoles traditionnelles, comme les vaines pâtures, et les conflits liés à la propriété de la terre illustre les enjeux sociaux et économiques des réformes agraires.
1. La critique des usages champêtres et l évolution de la propriété foncière
Cette section aborde les transformations agraires en France, en se concentrant sur la critique croissante des « usages champêtres » traditionnels, notamment la vaine pâture. À partir des années 1760, ces pratiques, autrefois communes, sont de plus en plus condamnées dans les écrits d’agronomie pour des raisons économiques et juridiques. La vaine pâture, utile à l’alimentation du bétail, est dénigrée par les « agronomes de la nouvelle école » qui la jugent incompatible avec l’efficacité économique et la propriété individuelle. Cependant, ses défenseurs insistent sur son utilité pour les paysans pauvres, ce qui amène le gouvernement à intervenir avec prudence. Marc Bloch, dans ses travaux sur « l’individualisme agraire », a analysé en détail cette évolution. Le passage de pratiques collectives vers une propriété foncière plus individualiste est au cœur de ces changements. Le remplacement de la vaine pâture par des pratiques plus intensives, utilisant des fourrages artificiels comme la luzerne ou le sainfoin, est une illustration de cette transformation.
2. L action de la monarchie et des intendants adjudications et politiques de partage
La section examine le rôle de la monarchie et de ses agents, notamment les intendants, dans la transformation des structures agraires. L'administration royale favorise une politique d’adjudications des communaux, au détriment des usages collectifs. L’exemple de la Picardie, étudié par Florence Gauthier, montre comment les intendants ont renforcé le contrôle sur les tourbières et restreint le droit de tourbage. La vente des communaux profite surtout aux paysans aisés, tandis que les seigneurs s’approprient une partie de ces terres. L’arrêt royal de 1753, confiant l’administration communale aux intendants, a accéléré cette tendance. Le texte mentionne l’édit concernant les Trois-Évêchés (1770) comme un exemple de partage des communaux, salué dans les « Éphémérides du citoyen ». La règle du triage, accordant un tiers des terres aux seigneurs, illustre l’appui de la monarchie à la « réaction féodale ». Cette section met en évidence les conflits d’intérêt entre l’administration royale, les seigneurs, et les communautés paysannes, qui tentent de s’opposer aux usurpations seigneuriales.
3. La liberté de clôture et les débats sur les communaux divergences d opinion
Cette section détaille les débats et les mesures concernant la liberté de clôture des champs et la gestion des communaux. Dans le Béarn, l'autorisation de la clôture des terres (1767) suscite des débats entre le Parlement, les États et les propriétaires. L’opposition entre la liberté de clôture, bénéfique pour l’agriculture intensive et la propriété individuelle, et le maintien des droits d’usage collectifs (droit de parcours, droit de vaine pâture) est au centre du conflit. Des édits successifs, entre 1767 et 1770, tentent de concilier ces intérêts parfois contradictoires, avec un succès mitigé. Le texte souligne la résistance des communautés paysannes à la suppression des droits d’usage collectifs, même en présence d'édicts royaux. La transformation des communaux, liés à des pratiques agricoles traditionnelles, en terres de propriété privée, est un processus progressif et conflictuel. Les « Éphémérides du citoyen » reflètent les différentes positions prises, illustrant les tensions entre modernité agricole et maintien de pratiques traditionnelles, avec les conséquences sociales qui en découlent pour les paysans.
