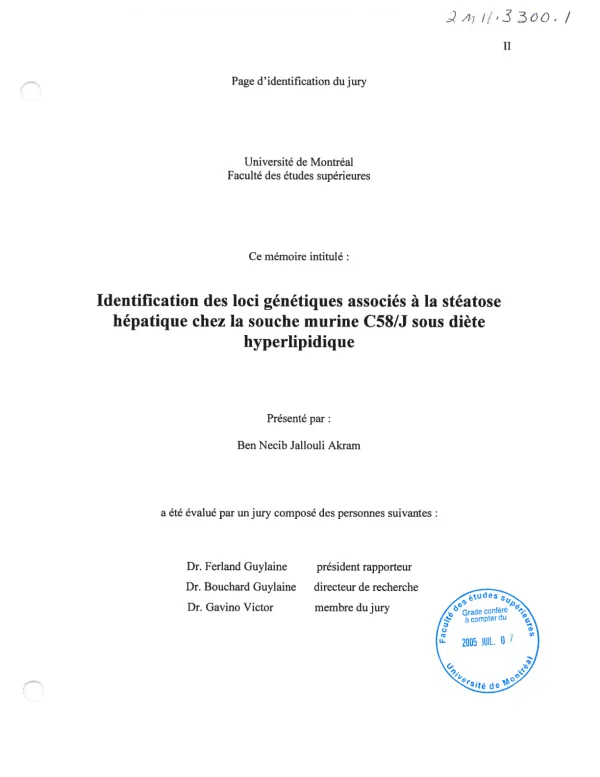
Stéatose hépatique: Identification de loci génétiques
Informations sur le document
| Auteur | Ben Necib Jallouli Akram |
| instructor/editor | Dr. Ferland Guylaine |
| École | Université de Montréal, faculté des études supérieures |
| Spécialité | Génétique, Biologie Moléculaire (ou un domaine similaire) |
| Type de document | Mémoire |
| Lieu | Montréal |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 2.75 MB |
Résumé
I.Métabolisme hépatique des acides gras et Stéatose Hépatique
Cette étude explore le rôle du métabolisme des acides gras dans le développement de la stéatose hépatique. Elle détaille les voies métaboliques hépatiques, notamment la biosynthèse et l’oxydation des acides gras, ainsi que le relargage des triglycérides (TG) via les VLDL. L'étude met l'accent sur la voie de Kennedy et la voie de méthylation pour la synthèse de la phosphatidylcholine (PC), essentielle à la formation des VLDL. Une régulation complexe de ces processus est nécessaire pour maintenir l'équilibre physiologique.
1. Définition et Prévalence de la Stéatose Hépatique
La stéatose hépatique est caractérisée par une accumulation de lipides, principalement des triglycérides (TG), dans les hépatocytes. Elle est une anomalie fréquente, avec une prévalence de 10 à 20% dans la population générale, pouvant évoluer vers des complications plus sévères comme la stéatohépatite. Des études, notamment le National Health and Nutrition Evaluation Survey III (NHANES III) aux États-Unis, montrent une prévalence similaire dans plusieurs pays industrialisés (10 à 24%), et même dans les pays en développement, comme au Ghana où elle est observée chez les enfants souffrant du Kwashiorkor. L'étude souligne la rapidité de sa propagation, comparable à celle du diabète de type 2 et de l'obésité. Le modèle 'two hits' de Day explique l'évolution vers la stéatohépatite: une première atteinte (stéatose hépatique) rend le foie vulnérable à d'autres événements (résistance à l'insuline, stress oxydatif), entraînant une seconde atteinte plus grave. Le traitement précoce de la stéatose hépatique est crucial pour prévenir le syndrome métabolique et des lésions hépatiques sévères. Des cas d'abétalipoprotéinémie, une malabsorption des lipides due à une déficience génétique de la protéine de transfert microsomale (MTP), conduisent aussi à une stéatose hépatique par inhibition de l'exportation des TG, affectant les hépatocytes et les entérocytes. Des régimes riches en hydrates de carbone, comme le démontre des études sur des rats Wistar avec des régimes riches en sucrose (31% à 50% des calories), contribuent aussi au développement de la stéatose hépatique, augmentant significativement l'accumulation de TG hépatiques. L'interaction gène-environnement est également un facteur prépondérant dans le développement de cette pathologie, certains stimuli environnementaux pouvant déclencher des réponses génétiques modifiant l'évolution de la maladie.
2. Métabolisme Hépatique des Acides Gras Définition et Voies
Un acide gras est une chaîne d'atomes de carbone et d'hydrogène avec un groupement carboxylique (-COOH), pouvant être saturé ou insaturé, et de longueur variable (2 à 30 atomes de carbone). Les acides gras alimentaires courants comptent de 12 à 22 atomes de carbone. Le texte classe les acides gras en chaînes courtes (2-4 carbones), moyennes (5-12 carbones) et longues (>12 carbones). La biosynthèse hépatique des acides gras est un processus cytosolique, initié par l'addition successive d'unités dicarbonées provenant de l'acétyl-CoA. Chez les animaux, une protéine porteuse de groupement acyle (ACP) intervient, utilisant la pantéthéine pour fixer le malonyl-CoA. L'oxydation des acides gras commence par l'activation en acyl-CoA, suivie d'une désaturation et d'une oxydation du carbone bêta, produisant de l'acétyl-CoA et un acide gras plus court. L'acétyl-CoA peut ensuite entrer dans le cycle de Krebs ou former des corps cétoniques (en faible quantité dans des conditions normales). La voie de Kennedy est la voie principale de synthèse des phosphatidylcholines (PC) dans le foie, représentant plus de 70% de la synthèse totale. Elle utilise la choline, transformée en choline active puis en cytidine diphosphocholine (CDP) grâce à la CTP, qui réagit ensuite avec le diacylglycérol pour former la phosphatidylcholine. Le relargage hépatique des triglycérides (TG) implique leur synthèse pendant la digestion, puis leur association avec du cholestérol, des phospholipides et des apoprotéines (Apo B-100 et Apo C) dans l'appareil de Golgi pour former les VLDL. Ces VLDL-TG sont ensuite relargués par bourgeonnement de vésicules de la membrane de l'appareil de Golgi. Le foie joue un rôle central dans la régulation de la synthèse, de l'oxydation, de l'estérification et du relargage des acides gras, nécessitant une régulation complexe pour maintenir l'équilibre physiologique.
II.Modèles Murins et Susceptibilité à la Stéatose Hépatique
Deux souches de souris, la souche C58/J (hypersensible) et la souche Lp/J (résistante) à la stéatose hépatique, servent de modèles pour identifier les QTL (Quantitative Trait Loci) responsables de la susceptibilité à la maladie sous régime hyperlipidique. L'étude confirme la différence de réponse des deux souches à un régime riche en lipides saturés et en cholestérol, la souche C58/J accumulant significativement plus de TG hépatiques.
1. Choix des Modèles Murins Souches C58 J et Lp J
L'étude utilise deux souches de souris, la C58/J et la Lp/J, comme modèles pour étudier la susceptibilité génétique à la stéatose hépatique. Des études préliminaires du Dr. Bouchard et de ses collaborateurs ont démontré une différence significative de sensibilité à la stéatose hépatique entre ces deux souches lorsqu'elles sont soumises à un régime hyperlipidique. La souche C58/J se montre fortement susceptible à l'accumulation de triglycérides (TG) hépatiques sous un régime riche en cholestérol et en lipides saturés, tandis que la souche Lp/J présente une résistance notable à la même condition. Ce contraste phénotypique entre les deux souches représente le point de départ de la recherche visant à identifier les loci génétiques responsables de cette différence de susceptibilité. L'objectif principal de l'étude est d'utiliser ces modèles animaux pour identifier les QTL (Quantitative Trait Loci) impliqués dans la sensibilité à la stéatose hépatique. Cette approche comparative permet d'isoler les facteurs génétiques contribuant au développement de la maladie, en dissociant les effets génétiques des facteurs environnementaux liés au régime alimentaire. Le choix de ces souches repose donc sur leur différence de réponse à un stimulus environnemental contrôlé (régime hyperlipidique), permettant ainsi une étude ciblée des variations génétiques responsables de la sensibilité à la stéatose.
2. Protocole Expérimental Régime Hyperlipidique et Collecte des Données
Les souris des souches parentales C58/J et Lp/J, ainsi que leurs descendants F1 et F2, ont été soumises à un protocole expérimental rigoureux. Après un sevrage à trois semaines, les souris ont reçu, à partir de 10 semaines, soit un régime de base, soit un régime hyperlipidique composé de 15% de lipides saturés, 1% de cholestérol, 0.5% d'acide cholique, 50% de sucrose, 20% de caséine, et des vitamines et minéraux essentiels. L'accès à l'eau était illimité, le cycle lumière/obscurité était de 14 heures de lumière et 10 heures d'obscurité, et la température ambiante était maintenue à 22°C. À l’âge de 18 semaines, les souris ont été sacrifiées. Des dosages hépatiques des triglycérides (TG) ont été effectués sur un homogénat hépatique à 10% selon la méthode de Folch, utilisant un kit TG-GPO-PAP de Roch Diagnostic Corp. Ce dosage repose sur l'hydrolyse des TG en glycérol, suivi d'une oxydation et d'une réaction colorimétrique mesurée par spectrophotométrie à 500 nm. Des prélèvements sanguins par ponction aortique ont permis d'analyser le sérum pour différents paramètres sériques. La vésicule biliaire a été prélevée pour l'analyse de la bile. Enfin, le foie a été prélevé, pesé et congelé pour des analyses ultérieures. Ce protocole détaillé assure un contrôle rigoureux des facteurs environnementaux et permet une comparaison précise entre les groupes.
3. Analyse des Résultats Comparaison des Souches et des Générations
L'analyse des données phénotypiques a utilisé une analyse de la variance à une voie et le test de Tukey (p<0.05). Après administration du régime hyperlipidique, aucune variation significative des taux sériques de TG et de glucose n'a été observée pour les deux souches parentales. Cependant, la souche C58/J a montré une augmentation significative des niveaux sériques de cholestérol total, de HDL et de NON-HDL cholestérol, sauf chez les femelles pour le NON-HDL et le HDL. Le ratio HDL/NON-HDL a diminué de façon non significative pour les deux souches. Chez les générations F1 (C58LP et LPC58), les concentrations hépatiques de TG étaient significativement plus faibles (p<0.001) que celles des souches parentales, illustrant une protection hétérozygote. Les paramètres sériques (TG, cholestérol total, NON-HDL) étaient similaires à la souche Lp/J et significativement plus faibles que la souche C58/J. Une légère diminution des niveaux sériques de HDL a été observée chez les F1, avec un ratio HDL/NON-HDL similaire à C58/J mais inférieur à Lp/J. Ces résultats indiquent que le genre n'a pas d'effet significatif sur les phénotypes étudiés et que les générations F1 montrent une résistance à la diète hyperlipidique similaire à la souche Lp/J. L’analyse des générations F1 souligne une résistance à la diète hyperlipidique, suggérant une possible interaction génétique influençant la susceptibilité à la stéatose hépatique.
III.Analyse Génétique et Identification de QTL
En croisant les souches C58/J et Lp/J, une génération F2 a été créée pour analyser la variabilité phénotypique de la stéatose hépatique. Des analyses de génotypage utilisant 107 marqueurs microsatellites ont permis d'identifier un QTL sur le chromosome 11 associé à la stéatose hépatique. Trois gènes candidats (Fabp-6, Gfpt-2, et PEMT) situés dans cette région ont été étudiés plus en détail. L'attention s'est particulièrement portée sur le gène PEMT, impliqué dans la voie de méthylation de la phosphatidylcholine.
1. Création de la Génération F2 et Phénotypage
Pour identifier les loci génétiques (QTL) responsables de la susceptibilité à la stéatose hépatique, deux souches parentales avec des sensibilités différentes ont été croisées : la souche C58/J, sensible, et la souche Lp/J, résistante. Ce croisement a permis de générer une génération F2 présentant une variabilité génétique et phénotypique accrue. Le phénotypage de cette génération F2 a consisté en la mesure des niveaux de triglycérides (TG) hépatiques afin de quantifier l'accumulation de lipides dans le foie chez chaque individu. Cette étape est essentielle pour établir une corrélation entre le génotype et le phénotype (accumulation de TG) et identifier les régions du génome associées à la sensibilité à la stéatose hépatique. La diversité phénotypique au sein de la génération F2, résultant du brassage génétique, est une condition préalable à l'identification des QTL. La répartition hétérogène des phénotypes permet de mettre en évidence l'influence des gènes sur la susceptibilité à la maladie. L'utilisation d'une génération F2, issue du croisement de souches parentales aux phénotypes contrastés, permet d’augmenter la probabilité d'identifier les régions chromosomiques associées à la variation de la sensibilité à la stéatose hépatique induite par un régime hyperlipidique.
2. Génotypage et Identification des QTL
Après le phénotypage, un génotypage complet du génome de chaque individu de la génération F2 a été réalisé. L’analyse a utilisé 107 marqueurs microsatellites polymorphiques entre les souches C58/J et Lp/J, distribués sur l'ensemble du génome. Ces marqueurs permettent de déterminer l'origine parentale de chaque allèle à un locus donné. Le génotypage complet est une étape indispensable pour associer les variations génétiques identifiées aux variations phénotypiques observées. L'analyse du déséquilibre de liaison entre le génotype (marqueurs microsatellites) et le phénotype (niveau de TG hépatiques) a permis d'identifier un Quantitative Trait Loci (QTL) sur un chromosome spécifique. Ce QTL est donc une région chromosomique dont les variations génétiques sont associées à la variation du niveau de TG hépatiques, reflétant ainsi la sensibilité à la stéatose hépatique. Le génotypage, entièrement effectué par le laboratoire Jackson, a permis de localiser une région chromosomique (QTL) associée à la variation phénotypique de l'accumulation de TG hépatiques, une étape fondamentale dans l'identification des gènes responsables de la sensibilité à la stéatose hépatique.
3. Analyse des Gènes Candidats
L’identification d’un QTL sur le chromosome 11 a conduit à l’analyse de 519 gènes situés dans cette région, en utilisant la base de données «Mouse genome database». Trois gènes candidats (fabp-6, Gfpt-2 et PEMT) ont été retenus pour une analyse plus approfondie en raison de leurs fonctions potentiellement liées à la stéatose hépatique ou au métabolisme des lipides. Le gène PEMT, particulièrement, a attiré l'attention. L'analyse des données obtenues a permis de sélectionner trois gènes pour une analyse plus approfondie en raison de leurs fonctions potentiellement liées à la pathologie ou au métabolisme lipidique. L'étude a ainsi permis de cibler des gènes candidats pour une analyse plus approfondie, afin de déterminer leur contribution exacte au phénotype de la stéatose hépatique. Les travaux futurs seront axés sur la validation fonctionnelle de ces gènes candidats afin de confirmer leur rôle dans la susceptibilité à la stéatose hépatique et de comprendre les mécanismes moléculaires en jeu. La caractérisation de ces gènes pourrait conduire à de nouvelles cibles thérapeutiques pour cette maladie fréquente.
IV.Rôle du Gène PEMT et Interaction Gène Environnement
L'étude suggère un lien entre le gène PEMT et la susceptibilité à la stéatose hépatique induite par un régime hyperlipidique. Les résultats indiquent que l'activité de la protéine PEMT pourrait être influencée par le régime alimentaire, affectant ainsi la synthèse de la PC et le relargage des TG. L'interaction gène-environnement joue un rôle crucial dans le développement de la pathologie, avec une possible modulation de l'activité de la protéine PEMT en réponse à la diète.
1. Le Gène PEMT comme Candidat Principal
L'analyse génétique a identifié le gène PEMT comme candidat principal impliqué dans la susceptibilité à la stéatose hépatique. Ce gène est impliqué dans la voie de méthylation de la phosphatidylcholine (PC), un composant essentiel des VLDL (lipoprotéines de très basse densité) impliquées dans le transport des triglycérides (TG) hépatiques. Des études antérieures ont montré que des souris Pemt-/- présentaient une accumulation de TG dans le foie due à un blocage de la sécrétion des TG hépatiques dans le plasma. Le gène PEMT est formé de six exons et code pour deux isoformes, PEMT-1 (réticulum endoplasmique) et PEMT-2 (mitochondries), toutes deux capables de catalyser la voie de méthylation de la PC. L'hypothèse émise est que le gène PEMT, situé dans la région du QTL identifié sur le chromosome 11, joue un rôle crucial dans la sensibilité à la stéatose hépatique. Des études préliminaires ayant déjà montré une différence d'accumulation hépatique de TG entre la souche C58/J (sensible) et la souche Lp/J (résistante) sur un régime hyperlipidique, l'étude se concentre sur le rôle du gène PEMT dans cette différence de réponse phénotypique. La relation entre le gène PEMT, la synthèse de la PC, et la sécrétion des VLDL sera examinée plus en détail, afin de comprendre le mécanisme par lequel des variations dans ce gène pourraient influencer la sensibilité à la stéatose hépatique.
2. Analyse d Autres Gènes Candidats et leurs Liens avec la Stéatose Hépatique
Outre le gène PEMT, l'étude a examiné deux autres gènes candidats situés dans la même région chromosomique du QTL identifié : Fabp-6 et Gfpt-2. L’analyse du gène Fabp-6, impliqué dans le métabolisme des acides biliaires, a révélé que sa mutation provoque une augmentation plasmatique des acides biliaires et une hypertriglycéridémie, mais sans impact sur les TG hépatiques. Le gène Gfpt-2, impliqué dans la production de glucosamine et associé à la résistance à l’insuline et au diabète de type 2, n’a pas été retenu pour des analyses plus poussées car la souris C58/J sous diète hyperlipidique montre une légère réduction de sa glycémie. L'étude met en évidence la nécessité d'une analyse fine des différents gènes pour déterminer leur rôle respectif dans le développement de la stéatose hépatique et de comprendre les interactions complexes entre les différents gènes et le régime alimentaire. L'analyse de ces gènes candidats permet de mieux comprendre l'interaction gène-environnement dans le développement de la stéatose hépatique, en mettant en évidence des liens potentiels, mais aussi des voies à exclure en fonction des résultats.
3. Interaction Gène Environnement et Régulation de l Activité de PEMT
L'étude souligne l'importance de l'interaction gène-environnement dans la susceptibilité à la stéatose hépatique. L'activité du gène PEMT, en particulier, est susceptible d'être modulée par le régime alimentaire. Des études antérieures ont montré que l'administration d'une diète déficiente ou enrichie en choline affecte l'activité de la PEMT chez les souris sauvages. Il est donc hypothétisé que la diète hyperlipidique utilisée dans cette étude pourrait influencer l'activité de la PEMT chez la souche C58/J, contribuant ainsi au développement de la stéatose hépatique. Des phénotypes modulés par l'activité de PEMT, tels que les phospholipides biliaires, ont été suivis pour évaluer l'impact de l'interaction gène-environnement. L'analyse des phospholipides biliaires, réduits chez les souris Pemt-/- sous régime riche en gras, a montré une distribution hétérogène dans la colonie F2 C58LP, suggérant un contrôle génétique et confirmant l'interaction gène-environnement. Sous stress hyperlipidique, les besoins en phosphatidylcholine augmentent, la voie de méthylation (PEMT) étant essentielle pour maintenir la synthèse des VLDL et ainsi prévenir l'accumulation des TG dans le foie. Cette interaction complexe entre le génotype (PEMT) et le régime alimentaire met en lumière les mécanismes sous-jacents à la variabilité de la réponse à une diète hyperlipidique.
V.Résultats et Discussion Dissociation des Facteurs du Syndrome Métabolique
L'étude a observé une dissociation entre la stéatose hépatique et certains facteurs du syndrome métabolique tels que l'obésité et l'hyperglycémie. Chez les souris C58/J sous régime hyperlipidique, l'augmentation du cholestérol total sérique a été notable, avec une augmentation du NON-HDL et du HDL chez les mâles, suggérant une complexité dans le métabolisme lipidique associé à la stéatose hépatique. Les générations F1 ont démontré une résistance hétérozygote à la stéatose hépatique, suggérant une protection contre le développement de la maladie.
1. Résultats chez les Souches Parentales Dissociation avec le Syndrome Métabolique
Chez les souris C58/J soumises à un régime hyperlipidique, l'étude n'a pas révélé de changement significatif des taux sériques de triglycérides (TG) et de glucose. Ceci contraste avec les fortes augmentations des TG hépatiques observées, suggérant une dissociation entre les paramètres sériques et l'accumulation hépatique de lipides. Une augmentation significative du cholestérol total sérique a été notée chez la souche C58/J, à l'exception des femelles pour les fractions NON-HDL et HDL. L'absence de lien entre la concentration hépatique des TG et l'IMC confirme les observations de Diehl (31) montrant que la stéatose hépatique n'est pas systématiquement liée à une augmentation du poids corporel. De plus, l'absence de changement significatif des taux de glucose sérique corrobore des études cliniques ayant diagnostiqué la stéatose hépatique sans hyper ou hypoglycémie. Ces résultats suggèrent une dissociation de la stéatose hépatique avec certains facteurs du syndrome métabolique, comme l'obésité et l'hyperglycémie, notamment. Les travaux de Hecht et Chevrel (36) avaient déjà conclu à une possible altération de la synthèse de marqueurs biologiques (TG, glucose, cholestérol, transaminases) en cas d'accumulation hépatique de TG, sans que cela soit systématique. La stéatose hépatique chez les souris C58/J pourrait résulter d'une augmentation de la synthèse des TG hépatiques et d'un blocage modéré de leur utilisation, comme le suggèrent les travaux de Varice et al. (63) sur des souris Pemt-/-, où un taux normal de TG sériques est observé malgré une accumulation hépatique due à une diminution de la synthèse des VLDL-TG.
2. Résultats chez les Générations F1 Résistance à la Diète Hyperlipidique
Chez les générations F1 (C58LP et LPC58), les paramètres anthropométriques et hépatiques montrent une concentration significativement diminuée de TG hépatiques (p<0.001) par rapport aux souches parentales, indiquant une protection hétérozygote. Le poids hépatique et le pourcentage foie/poids corporel sont similaires à la souche Lp/J et différents de la souche C58/J, sauf pour le poids hépatique de la génération F1 C58LP. Au niveau sérique, les concentrations de TG, de cholestérol total et de NON-HDL cholestérol des générations F1 sont similaires à la souche Lp/J mais significativement plus faibles que la souche C58/J. Une légère diminution du cholestérol HDL est observée chez les F1 par rapport aux souches parentales, tandis que le ratio HDL/NON-HDL est semblable à la souche C58/J mais inférieur à la souche Lp/J. L’absence d'effet significatif du genre sur les phénotypes étudiés permet de combiner les données mâles et femelles pour l’analyse des générations F1. Ces observations suggèrent que le croisement des deux souches induit une résistance à la diète hyperlipidique similaire à celle de la souche Lp/J, indépendamment du genre des souches parentales. La similarité des phénotypes entre les deux générations F1 indique que le genre parental n'influence pas l'expression du phénotype chez les descendants. Le niveau de TG hépatiques largement inférieur à celui des souches parentales suggère une protection hétérozygote contre la stéatose hépatique résultant du croisement.
3. Discussion Dissociation des Facteurs du Syndrome Métabolique et Implications
L'étude met en évidence une dissociation entre la stéatose hépatique et certains paramètres associés au syndrome métabolique, confirmant que la stéatose peut être présente indépendamment de l'obésité et de l'hyperglycémie. L'augmentation significative du cholestérol NON-HDL chez les mâles de la souche C58/J sous diète hyperlipidique est notable, mais compensée par une augmentation concomitante du cholestérol HDL, les protégeant potentiellement d'une altération majeure du métabolisme lipidique. Les résultats sur les générations F1 confirment l’indépendance de la transmission des phénotypes associés à la stéatose hépatique par rapport au genre des parents. L'étude suggère des mécanismes complexes impliquant une interaction entre des facteurs génétiques et environnementaux dans le développement de la stéatose hépatique et sa dissociation avec certains aspects du syndrome métabolique. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour explorer plus en détail les mécanismes moléculaires impliqués et approfondir la compréhension de l'interaction entre les différents facteurs de risque et leur influence sur le développement et l'évolution de la pathologie.
