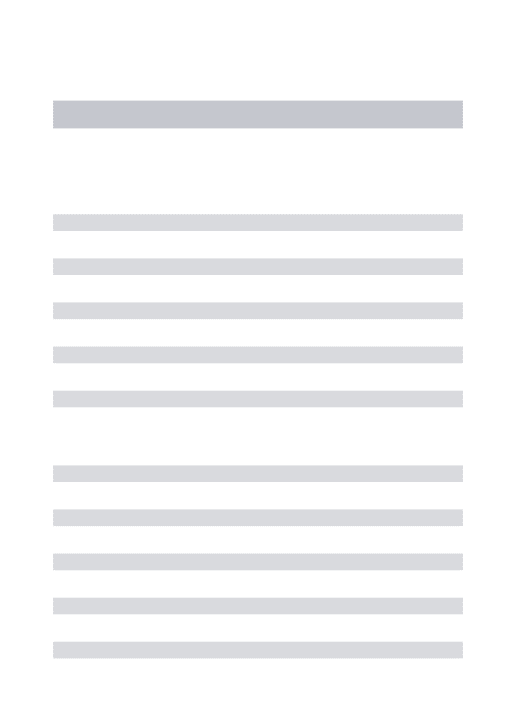
Prévalence des facteurs de risque cardiovasculaires dans une population montagnarde du Haut Atlas
Informations sur le document
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 1.30 MB |
- Épidémiologie
- Risques cardiovasculaires
- Médecine rurale
Résumé
I.Prévalence des Facteurs de Risque Cardiovasculaires chez une Population Amazigh de la Vallée d Azgour Maroc
Cette étude transversale exhaustive, menée en 2004 dans la vallée d'Azgour (province de Tahanaout, région de Marrakech), a évalué la prévalence des principaux facteurs de risque cardiovasculaire chez 451 adultes de 20 ans et plus. L'étude, intégrée au projet PROSTRAS III, a analysé des données sociodémographiques, des antécédents médicaux et des mesures biologiques. Les résultats révèlent une prévalence significative de l'hypertension artérielle (38,6%), du diabète (3,1%), de l'obésité (9,1%) et de l'obésité abdominale (13,7%), avec des différences notables entre les sexes. Le tabagisme concernait 27,2% des hommes. Le comportement sédentaire était plus fréquent chez les femmes (39,1% vs 20,7%). Ces résultats, comparables à ceux d'autres études rurales marocaines et des pays voisins (Algérie, Tunisie), mettent en lumière la nécessité de stratégies de prévention et de contrôle des maladies cardiovasculaires au Maroc. L'étude souligne l'impact croissant des facteurs de risque liés à la transition épidémiologique et à la modification des modes de vie dans cette population rurale.
1. Contexte et Objectifs de l Étude
L'étude s'inscrit dans le projet PROSTRAS III, visant à évaluer la prévalence des principaux facteurs de risque cardiovasculaires au sein d'une population Amazigh de la vallée d'Azgour, au Haut Atlas de Marrakech. Elle a été menée auprès de 451 adultes de 20 ans et plus, durant l'été 2004, utilisant une méthode d'échantillonnage exhaustive. Le recueil de données s'est appuyé sur un questionnaire incluant des rubriques démographiques, socio-économiques, comportementales (tabagisme, activité physique, alimentation) et sanitaires (antécédents d'HTA, diabète, dyslipidémie). La vallée d'Azgour, située à environ 80 km au sud-ouest de Marrakech, est caractérisée par une altitude moyenne entre 1500 et 2000 mètres et un relief montagneux dominant (91,2% de la superficie totale estimée à 1112 km²). L'analyse des données a été effectuée à l'aide du logiciel SPSS version 10, utilisant des analyses univariées et bivariées (test du khi-deux et test t de Student), avec un seuil de signification fixé à 0,05. Les objectifs incluaient l'évaluation de la prévalence des facteurs de risque, leur distribution selon l'âge et le sexe, et l'analyse de leur interaction avec l'environnement socio-économique et culturel, en comparaison avec d'autres études nationales et internationales.
2. Description de la Population Étudiée et Méthodologie
La population étudiée comprenait 451 personnes résidant dans la vallée d'Azgour, âgées de 20 ans et plus. La commune d'Azgour se situe dans le cercle d'Amezmiz, province de Tahanaout, Wilaya de Marrakech. L'échantillonnage a été exhaustif, incluant tous les sujets répondant aux critères d'âge. Les données ont été collectées à l'été 2004 via un questionnaire comprenant des sections démographiques (sexe, âge, lieu de résidence), socio-économiques, comportementales (habitudes de vie, tabagisme, activité physique, alimentation) et sanitaires (antécédents d'hypertension artérielle, diabète et dyslipidémie). L'analyse statistique a combiné des approches univariées (pourcentages, moyennes, écarts-types) et bivariées (comparaison de proportions avec le test du khi-deux et comparaison de moyennes avec le test t de Student), le seuil de signification statistique étant fixé à 0,05. Les analyses ont été réalisées dans les laboratoires d'écologie humaine de la faculté des sciences Semlalia et le laboratoire d'épidémiologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. La composition de l'échantillon était de 37,5% d'hommes et 62,5% de femmes.
3. Résultats de l Étude Prévalence des Principaux Facteurs de Risque
L'étude a révélé une prévalence de l'hypertension artérielle de 38,6%, alors que seulement 11,3% des participants déclaraient la connaître. La prévalence du diabète était de 3,1%, similaire entre les sexes. Concernant l'obésité, le taux était de 9,1%, et celui de l'obésité abdominale de 13,7%, plus élevés chez les femmes. Le tabagisme a été rapporté chez 27,2% des hommes. Le comportement sédentaire était plus fréquent chez les femmes (39,1% contre 20,7% chez les hommes), avec une prévalence globale de 27,1%. Une hypercholestérolémie a été observée chez un seul individu, et 10 personnes présentaient des taux de triglycérides élevés. Tous les paramètres étudiés, à l'exception du tabagisme, augmentaient avec l'âge. Les résultats de l'enquête, parfois inférieurs à ceux de la population marocaine générale, restent globalement similaires aux données observées dans les populations rurales marocaines. Ces résultats confirment la prévalence importante des facteurs de risque cardiovasculaires au sein de la population étudiée.
4. Comparaison avec d autres Études et Implications
Les résultats de cette étude sont comparables à ceux d'enquêtes antérieures réalisées au Maroc (enquête nationale de 2000) et dans les pays voisins (Algérie, Tunisie). La prévalence de l'hypertension artérielle (HTA) observée (38,6%) est similaire à celle rapportée en Tunisie (36,2%), Algérie (35,3%), Italie (38%) et Espagne (45%). En Afrique, les prévalences sont parmi les plus élevées (Congo 32,5%, Cameroun 25%, Côte d'Ivoire 29,5%, Madagascar 24,3%). Les données suggèrent une transition épidémiologique au Maroc, avec une régression des maladies transmissibles au profit des maladies chroniques, notamment cardiovasculaires. L'étude souligne le fait que la population rurale étudiée est de plus en plus exposée à ces facteurs de risque, notamment l'hypertension artérielle, longtemps plus fréquente dans les classes socio-économiques élevées. L'insuffisance de sensibilisation aux modes de vie sains, l'absence de stratégie préventive nationale et les difficultés de dépistage et de suivi des sujets à risque contribuent à la fréquence de ces facteurs.
II.Facteurs de Risque Cardiovasculaires Hypertension Artérielle
L'hypertension artérielle (HTA), premier facteur de risque identifié, affichait une prévalence de 38,6% dans l'échantillon, alors que seulement 11,3% des participants déclaraient être hypertendus. Des comparaisons avec des données de Tunisie (36%), d'Algérie (35,3%), d'Italie (38%) et d'Espagne (45%) confirment l'importance du problème au Maroc et en Afrique (Congo 32,5%, Cameroun 25%, Côte d'Ivoire 29,5%, Madagascar 24,3%). La prévalence de l'HTA était plus élevée chez les femmes (41% vs 35,8%), en accord avec l'enquête nationale marocaine de 2000. L'étude explore les facteurs contributifs à l'HTA, notamment l'influence de facteurs génétiques, l'obésité, l'alimentation riche en sel, et le rôle du système rénine-angiotensine-aldostérone. La prise en charge de l'HTA est abordée, soulignant l'importance d'une approche multidisciplinaire et les options thérapeutiques disponibles.
1. Prévalence de l Hypertension Artérielle HTA dans la Vallée d Azgour
L'étude a révélé une prévalence élevée de l'hypertension artérielle (HTA) dans la vallée d'Azgour, atteignant 38,6% de la population étudiée. Ce chiffre est significatif, surtout compte tenu du fait que seulement 11,3% des individus interrogés se déclaraient hypertendus. Cette différence souligne l'importance du dépistage systématique de l'HTA. La prévalence de l'HTA était légèrement plus importante chez les femmes (41%) que chez les hommes (35,8%), bien que cette différence n'ait pas été statistiquement significative dans le cadre de cette étude. Ces résultats sont cohérents avec les données de l'enquête nationale marocaine de 2000, qui rapportait des taux similaires (38,9% chez les femmes et 29,5% chez les hommes). De plus, les résultats obtenus se rapprochent de ceux observés dans d'autres pays, notamment la Tunisie (36% chez les femmes et 25% chez les hommes) et confirment la forte prévalence de l'HTA au Maroc, se situant parmi les plus élevées des pays à forte prévalence. L'étude met en lumière le besoin urgent de stratégies de prévention et de prise en charge de cette pathologie au Maroc.
2. Comparaison Internationale et Facteurs de Risque
Les résultats de l'étude concernant la prévalence de l'hypertension artérielle au Maroc ont été comparés à ceux d'autres pays. La prévalence au Maroc est proche de celle observée en Tunisie (36,2%), en Algérie (35,3%), en Italie (38%) et en Espagne (45%). Au niveau continental, l'Afrique affiche des prévalences parmi les plus élevées, avec des taux supérieurs à 25% dans plusieurs pays (Congo 32,5%, Cameroun 25%, Côte d'Ivoire 29,5%, Madagascar 24,3%). Une étude menée en Angleterre a également mis en évidence une prévalence plus importante d'hypertension chez les Afro-Caribéens comparés aux Caucasiens. Cette différence pourrait être expliquée, en partie, par des facteurs génétiques. Dans le contexte de l'étude marocaine, les facteurs contribuant à l'élévation des résistances périphériques et par conséquent à l'hypertension artérielle sont multiples : facteurs vasculaires, stimulation sympathique, système rénine-angiotensine-aldostérone, réduction de la masse néphronique, excès pondéral, et facteurs endocriniens ou alimentaires (l'HTA étant pratiquement inconnue dans les populations consommant peu de sel). Le rôle central du rein dans la régulation de la pression artérielle est souligné, via sa fonction endocrine et le rétrocontrôle pression-diurèse.
3. Prise en Charge et Stratégies de Prévention
La section concernant la prise en charge de l'hypertension artérielle souligne l'importance de considérer l'âge du patient et la présence d'autres pathologies comme l'insuffisance rénale chronique ou le diabète pour adapter le traitement. Le traitement doit être adapté au niveau de risque du patient. Pour les sujets à risque moyen ou modéré, une approche progressive est recommandée, privilégiant le traitement non médicamenteux et la surveillance régulière. Le choix de la monothérapie se fait généralement parmi cinq classes de médicaments, tandis que des bithérapies (par exemple, association de diurétiques et d'épargneurs de potassium) peuvent être utilisées en première intention pour une meilleure efficacité ou une réduction des effets secondaires. Au niveau national, le document met en avant la nécessité de développer une surveillance épidémiologique, un suivi et une évaluation de la stratégie nationale de prévention et de contrôle de l'HTA, ainsi que de stimuler la recherche dans ce domaine. Les stratégies nationales de prévention et de contrôle de l'hypertension artérielle, comme celle du Canada, mettent l'accent sur le traitement des causes sous-jacentes (drogues, néphropathie, troubles endocriniens...). Enfin, l’importance d'une approche intégrant les aspects individuels, familiaux et environnementaux est soulignée pour promouvoir des modes de vie sains.
III.Facteurs de Risque Cardiovasculaires Diabète
La prévalence du diabète dans la vallée d'Azgour était de 3,1%, similaire entre les hommes et les femmes. L'étude fait référence aux estimations mondiales (150 millions en 2000, prévision de 235 millions en 2025), soulignant l'augmentation prévue de la prévalence au Maroc (400 000 diabétiques estimés d'ici 2030). L'étude aborde le rôle de l'hyperglycémie dans l'athérogenèse et la thrombose, ainsi que les risques accrus de macro-angiopathie et de micro-angiopathie chez les patients diabétiques. Les stratégies de prévention et de dépistage du diabète sont discutées, de même que les approches de prise en charge, incluant l'éducation thérapeutique et les options médicamenteuses.
1. Prévalence du Diabète dans la Vallée d Azgour
L'étude a révélé une prévalence du diabète de 3,1% au sein de la population étudiée de la vallée d'Azgour, sans différence significative entre les hommes et les femmes. Ce taux, bien que relativement faible en comparaison avec certaines prévalences mondiales, s'inscrit dans un contexte de transition épidémiologique au Maroc, où la prévalence du diabète est globalement élevée et en constante augmentation. Des études marocaines montrent une tendance à l'aggravation de la situation, avec des prévisions annonçant près de 400 000 diabétiques d'ici 2030 si aucune mesure de prévention primaire n'est mise en place. Au niveau mondial, le nombre de diabétiques était de 150 millions en 2000 et devrait atteindre 235 millions en 2025 en l'absence de mesures préventives adéquates. La similarité des taux de prévalence du diabète entre les hommes et les femmes dans cette étude contraste avec les résultats d'autres études, comme celle menée à Tlemcen en Algérie en 2008, où une proportion significativement plus élevée a été observée chez les femmes (7,5% contre 5,9% chez les hommes).
2. Conséquences du Diabète et Risques Cardiovasculaires
Le diabète, qu'il soit de type 1 ou 2, accroît considérablement le risque cardiovasculaire. L'hyperglycémie favorise l'athérogenèse et la thrombose par différents mécanismes : augmentation de l'oxydation du c-LDL, inflammation chronique, production accrue de VLDL (conduisant à une élévation des triglycérides et une baisse du c-HDL), dysfonction endothéliale et activation de la coagulation. La maladie coronaire est plus grave en présence de diabète, avec une mortalité post-infarctus plus élevée, des lésions plus sévères et une insuffisance cardiaque plus fréquente. Le diabète majore le risque de macro-angiopathie (coronaropathie, AVC, artérite des membres inférieurs) et de micro-angiopathie (rétinopathie et néphropathie). Ces complications cardiovasculaires soulignent l'importance de la prévention et du contrôle du diabète pour réduire la morbidité et la mortalité liées à cette maladie.
3. Dépistage Prévention et Prise en Charge du Diabète
Le document aborde les aspects du dépistage, de la prévention et de la prise en charge du diabète. Plusieurs stratégies de dépistage ont été développées, basées sur la détection de marqueurs sérologiques et/ou génétiques de susceptibilité au diabète de type 1. Cependant, l'efficacité des stratégies de prévention chez les sujets à risque élevé reste débattue, aucune n'ayant jusqu'ici démontré son efficacité. Concernant la prise en charge, l'éducation, l'information et la formation du patient sont essentielles pour améliorer les résultats et réduire les risques métaboliques et vasculaires. Un bon suivi médical, une relation soignant-patient de qualité et un climat de confiance sont indispensables. Au Maroc, des efforts ont été déployés pour harmoniser la prise en charge du diabète, notamment par l'élaboration d'un guide pour les médecins généralistes en 2004 et des évaluations de la prise en charge et du dépistage. Des actions sont en cours pour améliorer la formation médicale continue (FMC) dans ce domaine. Des stratégies de prévention de l'obésité sont également abordées, étant donné que l'obésité est un facteur de risque majeur pour le diabète.
IV.Facteurs de Risque Cardiovasculaires Obésité et Tabagisme
L'étude révèle une prévalence de l'obésité de 9,1% et de l'obésité abdominale de 13,7%, significativement plus élevées chez les femmes. Ces chiffres sont inférieurs à la prévalence nationale marocaine (13,2%), mais similaires aux données rurales. Le tabagisme était rapporté chez 27,2% des hommes, un chiffre inférieur à la prévalence observée dans les pays développés et en développement selon l'OMS. L'étude aborde les stratégies de prévention de l'obésité, en soulignant l'importance d'une approche multisectorielle combinant des mesures environnementales, éducatives, économiques et politiques, ainsi que la prise en charge chirurgicale dans certains cas. Pour le tabagisme, des méthodes de sevrage tabagique (substitution nicotinique, varénicline) sont mentionnées.
1. Prévalence de l Obésité dans la Vallée d Azgour
L'étude a révélé une prévalence de l'obésité de 9,1% chez les habitants de la vallée d'Azgour. Ce chiffre est inférieur à la prévalence nationale marocaine (13,2%), mais reste comparable à celle observée en milieu rural marocain (9,0%). Cette différence entre les zones urbaines et rurales est expliquée par des changements dans les habitudes alimentaires, avec un abandon progressif de l'alimentation traditionnelle à base de légumes locaux au profit d'une alimentation plus occidentalisée, riche en féculents et en viandes, couplée à une diminution de l'activité physique. L'obésité abdominale, quant à elle, présentait une prévalence de 13,7%, nettement plus élevée chez les femmes. La prévention de l'obésité nécessite une modification permanente de la prise et de la dépense énergétique par le biais d'un mode de vie sain. Une approche intégrée et multidisciplinaire est essentielle, incluant des mesures environnementales, éducatives, économiques, techniques, industrielles, législatives et politiques. La responsabilité de la prévention de l'obésité ne repose pas seulement sur les individus, mais également sur l'ensemble des secteurs de la société.
2. Prévention de l Obésité et Interventions
La prévention de l'obésité vise à modifier durablement la balance énergétique (apport et dépense calorique) en promouvant un mode de vie sain. Cela nécessite une approche globale et multidisciplinaire englobant des stratégies environnementales, éducatives, économiques, techniques, industrielles, législatives et politiques, ainsi qu'un système de soins de santé axé sur la détection et la prise en charge précoce. Des exemples de programmes de santé publique, tels que le PNNS en France (Plan National Nutrition Santé) et le programme « Trim et Fit » de Singapour, illustrent des approches intégrées axées sur la prévention primaire, le dépistage et la prise en charge précoce. Le PNNS vise notamment la réduction de la cholestérolémie moyenne et la lutte contre la prévalence croissante de l'obésité et du surpoids. Concernant la prise en charge de l'obésité sévère, la chirurgie peut être envisagée après au moins un an de suivi médical incluant des mesures thérapeutiques. La décision d'intervention est prise par une équipe multidisciplinaire et le soutien familial et social joue un rôle important dans le pronostic.
3. Prévalence du Tabagisme et Stratégies de Cessation
Le tabagisme a été rapporté chez 27,2% des hommes de l'échantillon. Cette prévalence est significativement inférieure à celle observée dans les pays occidentaux (34% à 62% chez les hommes et 2,9% à 52% chez les femmes selon l'étude MONICA), et dans les pays développés et en développement selon l'OMS (35% et 50% des hommes respectivement, et 22% et 9% des femmes). La cessation tabagique est abordée, mentionnant l'utilisation de la substitution nicotinique sur une durée de 6 semaines minimum à 6 mois maximum, avec un sevrage progressif. La varénicline (agoniste partiel des récepteurs nicotiniques) peut également être utilisée, avec une augmentation progressive de la posologie sur une semaine et un arrêt du tabac deux semaines après le début du traitement. La prise de varénicline se fait pendant 12 semaines (avec possibilité de prolongation de 12 semaines supplémentaires), mais est contre-indiquée avant 18 ans et en cas d'insuffisance rénale importante. La Convention-cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac de 2003, qui fixe des normes internationales sur les prix du tabac, la publicité, l’étiquetage et le tabagisme passif, est mentionnée comme un cadre important pour la lutte contre le tabagisme.
V.Facteurs de Risque Cardiovasculaires Dyslipidémies et Activité Physique
L'étude mentionne la prévalence des dyslipidémies, avec une hypercholestérolémie chez un seul individu et des taux élevés de triglycérides chez 10 personnes. L'importance des lipoprotéines LDL et HDL dans l'athérosclérose est discutée, en référence à des études comparatives de populations (étude des 7 pays). L'impact de l'activité physique sur la pression artérielle, les lipides plasmatiques et l'insulinorésistance est mis en évidence. L'étude souligne l'importance d'une activité physique régulière, même modérée, pour la prévention des maladies cardiovasculaires, et propose des recommandations basées sur des modèles 'activité physique - état de santé'. Des programmes de promotion de la santé, tels que le PNNS en France et le programme « Trim et Fit » à Singapour, sont présentés en exemples.
1. Prévalence des Dyslipidémies dans l Étude
Concernant les dyslipidémies, l'étude a révélé une prévalence faible. Seul un individu présentait une hypercholestérolémie, tandis que 10 personnes avaient des taux de triglycérides élevés. Cette faible prévalence pourrait être due à plusieurs facteurs, dont la méthodologie de l'étude ou les limites du dépistage. L'étude souligne cependant l'importance des dyslipidémies comme facteur de risque cardiovasculaire, en rappelant le regain d'intérêt pour ces troubles en raison de l'augmentation des cardiopathies ischémiques. Des études comparatives de populations, comme l'étude des 7 pays (États-Unis, Finlande, Grèce, Hollande, Italie, Japon, Yougoslavie), ont démontré un lien entre les régimes alimentaires riches en graisses saturées et en cholestérol et l'incidence des cardiopathies ischémiques. Le rôle du cholestérol LDL et HDL dans l'athérosclérose est mis en avant : l'augmentation du LDL-cholestérol favorise l'athérosclérose, tandis que le HDL-cholestérol est impliqué dans le transport inverse du cholestérol. Les recommandations de la Canadian Task Force on Periodic Health Examination pour le dépistage du cholestérol chez les hommes âgés de 30 à 59 ans sont mentionnées, en fonction de la présence d'autres facteurs de risque ou d'antécédents familiaux.
2. L Activité Physique et ses Effets Cardiovasculaires
L'étude souligne l'importance de l'activité physique comme facteur protecteur cardiovasculaire indépendant. Ses effets bénéfiques sur la maladie coronarienne sont liés à sa relation avec les facteurs de risque classiques. L'activité physique a des effets positifs sur la pression artérielle (diminution de 6 à 7 mmHg chez les sujets normotendus et hypertendus), les triglycérides plasmatiques (diminution), le HDL-cholestérol (augmentation), et la lipémie postprandiale. Elle améliore l'action de l'insuline, diminue l'insulinorésistance, réduit l'agrégation plaquettaire, et contribue à l'équilibre de la balance énergétique. Il n'est pas nécessaire que l'activité physique soit intense ou structurée pour être bénéfique. Des bénéfices significatifs peuvent être obtenus avec une activité modérée, comme 30 minutes de marche rapide ou 15 minutes de course par jour. La régularité est déterminante. Des conseils personnalisés sont importants pour adapter l'activité physique au mode de vie de chaque individu, avec possibilité de fractionnement de l'activité. Un réentraînement progressif sous contrôle cardiologique est conseillé en cas d'insuffisance coronarienne, et des précautions spécifiques sont nécessaires chez les sujets diabétiques.
3. Modèles et Recommandations pour l Activité Physique
L'étude mentionne que les pouvoirs publics devraient mettre en place des systèmes de surveillance systématique de l'exercice physique pour identifier les personnes actives et inactives et évaluer l'impact des politiques de prévention. De tels systèmes existent principalement dans les pays industrialisés. Les recommandations actuelles conseillent aux adultes de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée par jour, idéalement tous les jours de la semaine. La marche rapide est citée en exemple. Ces recommandations, basées sur le modèle « activité physique - état de santé », visent la prévention des maladies chroniques, notamment cardiovasculaires, fréquentes dans les pays industrialisés. Le rôle des particules HDL dans le transport inverse du cholestérol et son recaptage au niveau des cellules, notamment la paroi artérielle, est également mentionné. Le document ne fournit pas de données spécifiques sur la prévalence de l'activité physique ou de la sédentarité au sein de la population étudiée, mais précise que le comportement sédentaire est plus fréquent chez les femmes (39,1% vs 20,7% chez les hommes).
VI.Conclusion et Recommandations
Les résultats de cette étude confirment la prévalence élevée des principaux facteurs de risque cardiovasculaire dans cette population rurale marocaine. La transition épidémiologique, l'urbanisation, l'occidentalisation des modes de vie, et l'insuffisance de la sensibilisation à la prévention contribuent à cette situation. L'étude recommande la mise en place d'un programme de promotion de la santé cardiovasculaire intégré, incluant des stratégies ciblant la population et l'exposition aux risques. Des actions spécifiques de contrôle des facteurs de risque (hypertension artérielle, diabète, obésité, tabagisme, sédentarité) sont nécessaires pour améliorer la santé cardiovasculaire de cette population.
1. Synthèse des Résultats et Concordance avec les Études Antérieures
Les résultats de cette étude concordent avec ceux d'études antérieures réalisées au Maroc, notamment l'enquête nationale de 2000, et dans les pays voisins (Algérie et Tunisie). Ils mettent en évidence une prévalence significative des facteurs de risque cardiovasculaires au sein de la population étudiée de la vallée d'Azgour. La transition épidémiologique que connaît le Maroc, marquée par le passage des maladies transmissibles aux maladies chroniques (notamment cardiovasculaires), explique en partie ces résultats. L'étude a identifié des besoins de santé spécifiques à cette population rurale, notamment une prévalence importante de l'hypertension artérielle, du diabète, de l'obésité et du tabagisme, avec des variations selon le sexe et l'âge. Bien que certains paramètres présentent des prévalences inférieures à celles de la population marocaine générale, ils restent similaires aux données rapportées pour les populations rurales. Cette étude constitue une étape initiale pour la mise en place de stratégies de prévention adaptées au contexte marocain.
2. Facteurs Contributifs et Défis de la Prévention
La modification des modes de vie dans cette population rurale, soumise à des facteurs de risque auparavant moins présents (notamment l'hypertension artérielle), contribue à la situation actuelle. L'insuffisance de sensibilisation aux modes de vie sains, l'absence de stratégie préventive à l'échelle nationale et les difficultés de dépistage et de suivi des sujets à risque constituent des obstacles majeurs. Au-delà des chiffres, cette étude sert de base à l'identification des besoins de santé de cette population. L'étape suivante consiste à la concrétisation d'un programme de promotion de la santé cardiovasculaire reposant sur une approche intégrée de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles. La mise en œuvre d'un tel programme nécessitera la mise en place de stratégies multiformes, certaines axées sur la population et d'autres sur l'exposition aux risques. Des actions adaptées et ciblées pour contrôler les facteurs de risque identifiés (hypertension, diabète, obésité, tabagisme, sédentarité) sont cruciales pour améliorer la santé cardiovasculaire au Maroc.
3. Résumé des Principaux Résultats et Recommandations
Cette étude transversale exhaustive (PROSTRAS III), réalisée en 2004 auprès de 451 adultes (37,5% hommes, 62,5% femmes), a évalué la prévalence des principaux facteurs de risque cardiovasculaires. La prévalence de l'hypertension artérielle était de 38,6%, le diabète de 3,1%, l'obésité de 9,1% et l'obésité abdominale de 13,7% (plus élevées chez les femmes). Le tabagisme concernait 27,2% des hommes et le comportement sédentaire était plus fréquent chez les femmes (39,1% vs 20,7%). Les résultats soulignent la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaires dans cette population rurale. La réflexion et la mise en œuvre d'actions ciblées pour contrôler ces facteurs de risque sont nécessaires. L'étude, bien que réalisée en 2004, conserve une pertinence pour comprendre les défis de santé publique liés aux maladies cardiovasculaires au Maroc et souligne le besoin de stratégies de prévention et de contrôle appropriées, compte tenu de la transition épidémiologique en cours. Des actions spécifiques pour chaque facteur de risque, combinant des approches populationnelles et individuelles, sont nécessaires.
