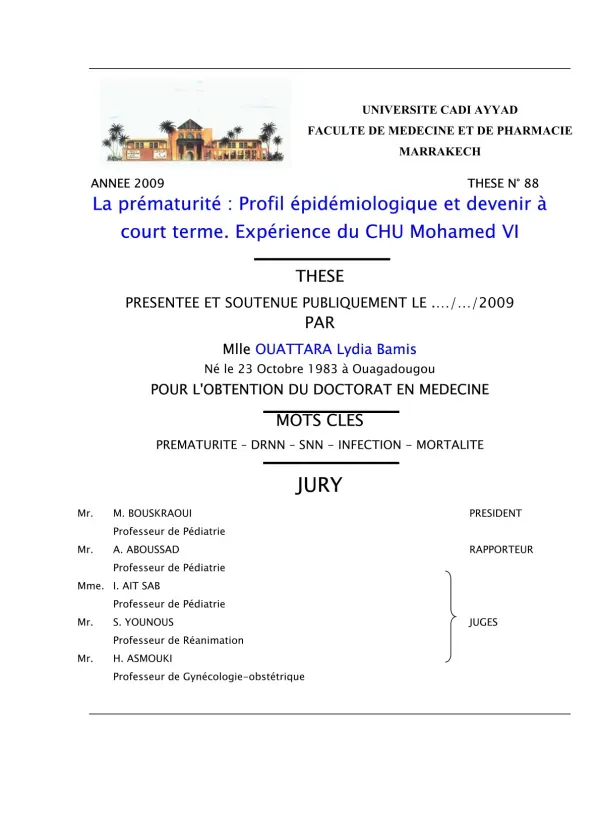
Profil Épidémiologique de la Prématurité et Devenir à Court Terme
Informations sur le document
| Auteur | Ouattara Lydia Bamis |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 1.72 MB |
- prématurité
- épidémiologie
- médecine
Résumé
I.Définition et Épidémiologie de la Prématurité à Marrakech
Cette étude, réalisée au service de néonatologie de l’Hôpital Mohammed VI à Marrakech entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007, porte sur 459 cas de prématurité. La prématurité, définie comme une naissance avant 37 semaines d’aménorrhée, représente un problème majeur de santé publique au Maroc. L'étude a observé une répartition des cas de prématurité en prématurés simples (60,8%), grands prématurés (34,6%) et prématurissimes (4,6%). Le poids moyen à la naissance était de 1714,33g +/- 505g, avec un sex-ratio de 1,04. 22% des prématurités étaient induites, et 78% spontanées. Le taux de mortalité néonatale lié à la prématurité était de 48,8%, fortement corrélé à l'âge gestationnel et au poids de naissance. Ces données soulignent la nécessité d'actions pour améliorer la prise en charge des nouveau-nés prématurés à Marrakech.
1. Définition de la prématurité et contexte de l étude
L'étude définit la prématurité comme une naissance survenant avant la 37ème semaine d'aménorrhée (SA), calculée à partir du premier jour des dernières règles. Elle souligne que la prématurité demeure un sujet de préoccupation majeure pour les équipes obstétricales et néonatalogiques. Le cadre de l'étude est le service de néonatologie de l'hôpital Mohammed VI à Marrakech, au Maroc. La période d'étude s'étend du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, portant sur un échantillon conséquent de 459 cas de prématurité. Cette étude vise à déterminer les aspects épidémiologiques de la prématurité à Marrakech, à évaluer le devenir à court terme des prématurés, et à proposer des mesures préventives pour améliorer leur prise en charge. L'ampleur de l'échantillon et la durée de l'étude suggèrent une analyse approfondie de la situation locale. La prématurité, selon l'OMS, est définie comme une naissance avant 37 semaines d’aménorrhée révolues (au moins 22 semaines et un poids d'au moins 500g), soulignant la complexité de cette condition médicale.
2. Données épidémiologiques sur la prématurité à Marrakech
Les 459 cas de prématurité colligés ont été répartis en trois catégories : prématurés simples (60,8 %), grands prématurés (34,6 %) et prématurissimes (4,6 %). Le poids de naissance variait entre 750 et 3600 g, avec une moyenne de 1714,33 g ± 505 g. Le sex-ratio était de 1,4, indiquant une légère prédominance masculine. L'étude distingue les prématurités induites (22 %) des prématurités spontanées (78 %), avec des causes obstétricales (29,6 %), générales (20 %) et foeto-placentaires (16,4 %) identifiées. Dans 12 % des cas, aucune cause n'a pu être déterminée. Ce détail sur les causes de la prématurité permet une analyse plus précise des facteurs de risque et des interventions possibles. La répartition par catégorie de prématurité et le poids moyen à la naissance offrent des données quantitatives importantes pour comprendre l'étendue du problème à Marrakech. Le sex-ratio et le pourcentage de prématurités induites et spontanées ajoutent des nuances à l'analyse.
3. Morbidité mortalité et conséquences à court terme
Les principales pathologies associées à la prématurité dans l'étude étaient la détresse respiratoire (68,4 %), l'infection (48,1 %) et la souffrance néonatale (9,8 %). Le taux de mortalité était de 48,8 %, significativement corrélé à l'âge gestationnel et au poids de naissance. Ce taux de mortalité élevé souligne la gravité de la situation et l'urgence d'améliorer les soins néonatals. Un taux de réhospitalisation de 15,4 % parmi les survivants met en évidence la nécessité d'un suivi post-hospitalier approprié. La forte corrélation entre la mortalité, l'âge gestationnel et le poids de naissance confirme l'importance de ces facteurs prognostiques. Les pathologies associées permettent d'identifier les axes prioritaires d'intervention pour améliorer la prise en charge et réduire la morbidité et la mortalité. Le taux de réhospitalisation souligne le besoin d'un suivi post-natal efficace pour ces nouveau-nés fragiles.
II.Causes de la Prématurité dans l Étude
Les principales causes de prématurité identifiées dans l'étude marrakchie incluent des facteurs obstétricaux (29,6%), des facteurs généraux (20%) et des facteurs foeto-placentaires (16,4%). Parmi les pathologies associées, la détresse respiratoire (68,4%), les infections (48,1%) et la souffrance néonatale (9,8%) étaient les plus fréquentes. Des facteurs comme les infections cervico-vaginales (36,4%), les infections urinaires (24,4%), les grossesses multiples (22,9%), et un suivi insuffisant de la grossesse ont également été relevés comme contribuant à la prématurité.
1. Causes principales de prématurité
L'étude identifie plusieurs catégories de causes liées à la prématurité. Parmi les causes de prématurité spontanée, on observe des facteurs obstétricaux (29,6%), des facteurs généraux (20%) et des facteurs foeto-placentaires (16,4%). Il est important de noter que dans 12% des cas, aucune cause n'a pu être déterminée, soulignant la complexité des facteurs en jeu et la nécessité de recherches plus approfondies. La distinction entre prématurité induite (22%) et spontanée (78%) est cruciale pour l'analyse, car elle oriente vers des axes d'intervention différents. L'identification des causes permet de cibler les efforts de prévention et d'améliorer les pratiques médicales pour réduire le taux de prématurité. Le pourcentage significatif de cas sans cause déterminée invite à la poursuite de la recherche pour mieux comprendre les mécanismes de la prématurité.
2. Pathologies associées à la prématurité
L'étude met en évidence une forte corrélation entre la prématurité et certaines pathologies néonatales. La détresse respiratoire est la pathologie la plus fréquente, touchant 68,4% des prématurés. Les infections néonatales représentent un autre facteur majeur, affectant 48,1% des cas. La souffrance néonatale est également relevée, avec un taux de 9,8%. Ces pathologies associées sont des conséquences directes ou indirectes de la prématurité, et leur forte prévalence accentue la gravité du problème. L'identification de ces pathologies permet de mieux comprendre les défis liés à la prise en charge des prématurés et d'adapter les protocoles de soins. La forte prévalence de la détresse respiratoire et des infections justifie des efforts importants en termes de prévention et de traitement.
3. Autres facteurs contributifs à la prématurité
Outre les causes principales et les pathologies associées, l'étude mentionne d'autres facteurs contribuant à la prématurité. Les infections cervico-vaginales (36,4%) et les infections urinaires (24,4%) sont des facteurs importants à considérer, leur association n'étant pas rare. Les grossesses multiples représentent un facteur de risque significatif, avec un taux de 22,9% dans la population étudiée. Un suivi insuffisant de la grossesse est également cité comme un facteur contributif, lié à des facteurs socio-économiques et à l'origine rurale des parturientes. Enfin, l'étude mentionne 3,1% d'anomalies gynécologiques contribuant à 2% des cas de prématurité. L'analyse de ces facteurs complémentaires permet une approche multidimensionnelle de la problématique de la prématurité et souligne l'importance d'une prise en charge globale.
III.Conséquences à Court Terme et Recommandations
Le taux de mortalité néonatale élevé (48,8%) met en lumière l’urgence d’améliorer la prise en charge des prématurés à Marrakech. 15,4% des survivants ont nécessité une réhospitalisation. L’étude recommande des actions préventives axées sur l'amélioration du suivi prénatal, le renforcement des structures de soins néonatals, l’augmentation du nombre de personnels qualifiés et l'amélioration des moyens techniques pour réduire le taux de mortalité et améliorer le bien-être des nouveau-nés prématurés au Maroc, plus précisément à Marrakech.
1. Taux de mortalité et morbidité à court terme
L'étude révèle un taux de mortalité néonatale significativement élevé de 48,8% parmi les prématurés. Ce taux est fortement corrélé à l'âge gestationnel et au poids de naissance, soulignant la fragilité de ces nouveau-nés. Ce chiffre alarmant met en évidence l'importance des problèmes liés à la prématurité à Marrakech. Même chez les survivants, 15,4% nécessitent une réhospitalisation au cours de leur première année de vie, témoignant de risques pathologiques multiples (respiratoires, nutritionnels, digestifs) qui persistent après la sortie de l'hôpital. Ce taux de réhospitalisation est inférieur à celui observé en Tunisie (23,5%), suggérant des disparités dans les pratiques de suivi post-natal. L'absence d'un suivi organisé et la faible collaboration des parents sont des facteurs importants à prendre en compte. La haute mortalité et la morbidité persistent mettent en lumière la vulnérabilité des prématurés et la nécessité d'une prise en charge améliorée, et un suivi post-natal renforcé est essentiel pour améliorer le pronostic à long terme.
2. Nécessité d actions et recommandations
Les résultats de l'étude constituent un signal d'alarme sur la nécessité d'actions urgentes pour améliorer le bien-être des nouveau-nés prématurés à Marrakech. Pour réduire le taux de mortalité et améliorer la prise en charge, il est crucial de renforcer le volet préventif de l'accouchement prématuré. Cela implique une amélioration du suivi prénatal, ainsi qu'un renforcement des structures existantes en matière de personnel qualifié et de moyens techniques. L'accent doit être mis sur l'amélioration des infrastructures de soins néonatals, permettant une meilleure prise en charge des pathologies associées à la prématurité, notamment les détresses respiratoires et les infections. Le manque de suivi post-natal est un problème majeur à résoudre, nécessitant une meilleure organisation et une collaboration plus active des parents. En résumé, une action coordonnée et multisectorielle est nécessaire pour améliorer le pronostic vital et la qualité de vie des prématurés.
Référence du document
- Grande prématurité et fragilité associée : état des connaissances. Commentaires sur McCormick, Saigal, et Zelkowitz (Tessier R, Nadeau L)
- LA PRÉMATURITÉ. JE SUIS NÉ TROP TÔT: ANGOISSE POUR MES PARENTS (Vollenweider N, Nicastro N, Sabeh N, Lambiel J, Pala C)
