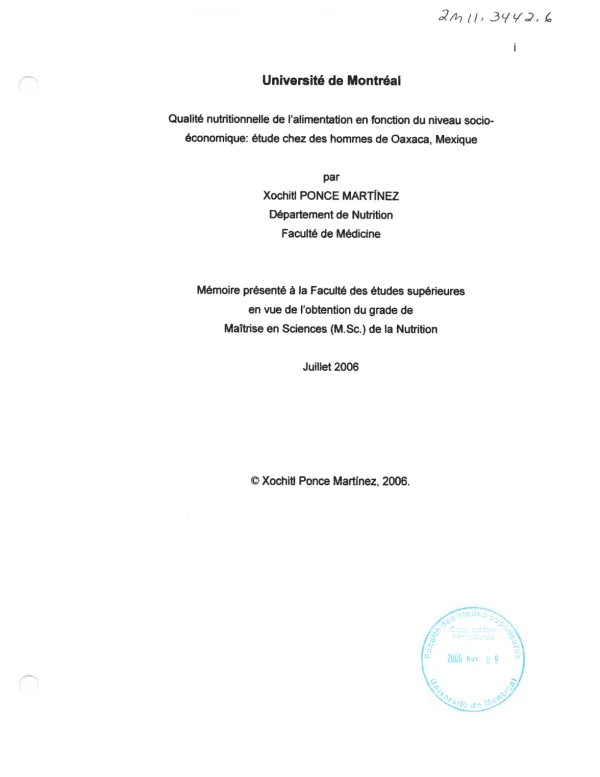
Qualité nutritionnelle et socio-économie au Mexique
Informations sur le document
| Auteur | Xochitl Ponce Martinez |
| instructor/editor | Olivier Receveur (Président-rapporteur) |
| École | Université de Montréal |
| Spécialité | Sciences de la Nutrition |
| Type de document | Mémoire de maîtrise |
| Année de publication | 2006 |
| Lieu | Montréal |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 6.30 MB |
Résumé
I.Qualité de l alimentation masculine au Mexique Impact du statut socio économique et de l environnement urbain rural
Cette étude transversale a évalué la qualité du régime alimentaire de 325 hommes mexicains âgés de 35 à 65 ans, répartis entre zones urbaines (n=249) et rurales (n=76) de Oaxaca. Trois indices de qualité alimentaire ont été utilisés : la prévention des maladies cardiovasculaires, l'adéquation en micronutriments et la diversité alimentaire. L’étude a mis en évidence des différences significatives entre les zones urbaines et rurales, ainsi qu'en fonction du statut socio-économique (SES). Les hommes en milieu urbain présentaient une plus grande diversité alimentaire et une meilleure adéquation en micronutriments, mais un score de prévention des maladies cardiovasculaires inférieur à celui des hommes en milieu rural. Le niveau socio-économique était positivement corrélé à la diversité alimentaire et à l'adéquation en micronutriments en milieu urbain, mais inversement corrélé au score de prévention. L'indice de prévention était inversement lié à l'IMC. Ces résultats soulignent l'impact de l'urbanisation et du statut socio-économique sur la qualité nutritionnelle et les risques de maladies chroniques au Mexique, mettant en lumière la nécessité d'adapter les stratégies de santé publique à ces contextes spécifiques. L'étude utilise les données du WorldFood Dietary Assessment System pour l'analyse nutritionnelle.
1. Objectifs et méthodologie de l étude
L'étude vise à évaluer la qualité de l'alimentation d'hommes mexicains âgés de 35 à 65 ans, en fonction de leur niveau socio-économique (NSE) et de leur indice de masse corporelle (IMC), dans des contextes urbains et ruraux de l'État d'Oaxaca. Un échantillon aléatoire de 325 hommes, apparemment en bonne santé, a été sélectionné après stratification par NSE pour la sous-échantillon urbain et le secteur résidentiel. Trois indices de qualité alimentaire ont été développés : la prévention des maladies cardiovasculaires, l'adéquation en micronutriments et la diversité alimentaire. La collecte de données repose sur deux rappels alimentaires de 24 heures non consécutifs, analysés à l'aide des tables du WorldFood Dietary Assessment System. Cette méthodologie permet une évaluation quantitative et qualitative de la consommation alimentaire, en tenant compte de la variabilité intra-individuelle. L'inclusion uniquement d'hommes dans l'échantillon vise à réduire les effets de confusion liés à la ménopause chez les femmes et à leur plus faible sensibilité aux maladies cardiovasculaires. L'âge des participants (35-65 ans) correspond à une période de vie où les risques de maladies cardiovasculaires sont accrus. Les individus atteints de diabète, d'hypertension ou de maladies cardiovasculaires, ainsi que ceux gravement malades ou handicapés, ont été exclus de l'étude pour éviter les effets de confusion sur le mode de vie.
2. Résultats concernant la diversité alimentaire et l adéquation en micronutriments
Les résultats montrent des différences significatives dans les habitudes alimentaires entre les zones urbaines et rurales, et en fonction du NSE. En milieu urbain, la consommation d'aliments d'origine animale, de graisses et de sucres est plus élevée qu'en milieu rural. La diversité alimentaire et l'adéquation en micronutriments sont également plus importantes en milieu urbain et augmentent avec le NSE. Cependant, l'indice de prévention des maladies cardiovasculaires est meilleur en milieu rural qu'en milieu urbain, montrant une relation inverse avec le NSE. Ceci suggère que, bien que la diversification alimentaire en milieu urbain améliore l'apport en micronutriments, elle est associée à une alimentation plus riche en graisses et sucres, facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. L'étude souligne ainsi le paradoxe d'une alimentation plus diversifiée, mais potentiellement moins saine en milieu urbain, notamment chez les populations à plus haut niveau socio-économique. L'utilisation des données du WorldFood Dietary Assessment System a permis une analyse fine des apports nutritionnels. L'étude met en évidence la nécessité de prendre en compte le contexte épidémiologique, nutritionnel et démographique pour définir la qualité alimentaire.
3. Résultats concernant l indice de prévention et l IMC
L'indice de prévention des maladies cardiovasculaires, basé sur les recommandations de l'OMS, présente une relation inverse avec le niveau socio-économique et l'IMC. Plus le niveau socio-économique est élevé, plus l'IMC est important et plus l'indice de prévention est faible, notamment en milieu urbain. Cette corrélation négative entre l'indice de prévention et la diversité alimentaire souligne que l'augmentation de la variété alimentaire n'est pas synonyme d'amélioration de la santé, car elle peut être associée à une augmentation des apports en graisses et en sucres. L'étude révèle une complexité dans la définition de la qualité alimentaire, démontrant que la simple diversité alimentaire ne suffit pas à garantir une alimentation protectrice contre les maladies chroniques. Il est donc crucial de considérer la composition de l'alimentation et son impact sur la santé, en tenant compte du contexte socio-économique et du niveau d'urbanisation. La relation entre l'IMC, la diversité alimentaire et les indices de qualité alimentaire souligne l'importance de considérer des facteurs au-delà de la simple diversité des aliments consommés pour évaluer la qualité nutritionnelle.
4. Analyse des données et interprétation des résultats
L'analyse des données, effectuée à l'aide du WorldFood Dietary Assessment System, a permis de comparer les apports nutritionnels selon le milieu de résidence (urbain/rural) et le niveau socio-économique. Les résultats confirment l'hypothèse selon laquelle les habitants des zones urbaines à haut niveau socio-économique présentent une plus grande diversité alimentaire et un meilleur apport en micronutriments, mais une alimentation plus athérogène (riche en graisses et sucres). Inversement, les habitants ruraux présentent une alimentation moins diversifiée, avec des apports insuffisants en micronutriments, mais un meilleur score de prévention. Cette situation paradoxale est attribuée à la nature des aliments consommés et à leur disponibilité selon le contexte. L'étude met en lumière la monotonie alimentaire en milieu rural, avec des apports inadéquats en micronutriments, notamment en fer, zinc, vitamines A et C, et folates. L'analyse souligne également la relation directe entre NSE, IMC et diversité alimentaire, et l'influence de facteurs de style de vie (sédentarité) sur l'IMC.
II.Régimes alimentaires urbains et ruraux Comparaison des apports nutritionnels
Les hommes vivant en milieu urbain ont signalé une consommation plus élevée de produits d'origine animale, de graisses et de sucres que ceux vivant en milieu rural. Alors que la diversité alimentaire et l’adéquation en micronutriments étaient supérieures en milieu urbain, le score de prévention était paradoxalement meilleur en milieu rural. Cette différence pourrait être liée au type d'aliments consommés: la plus grande diversité en milieu urbain est associée à une alimentation plus riche en graisses et sucres, tandis que le régime rural, bien que moins diversifié, repose sur des aliments plus protecteurs. La transition nutritionnelle au Mexique, accélérée par l'urbanisation, est mise en évidence par ces disparités.
1. Consommation d aliments d origine animale de graisses et de sucres
L'étude révèle une consommation significativement plus élevée d'aliments d'origine animale, de graisses et de sucres chez les sujets urbains comparés aux sujets ruraux. Cette différence est cohérente avec les observations sur la transition nutritionnelle dans les pays en développement, où l'urbanisation et l'augmentation des revenus rendent les aliments riches en énergie, en graisses et en sucres plus accessibles. L'analyse des données, basée sur deux rappels alimentaires de 24 heures, met en évidence une augmentation de la consommation de ces aliments en milieu urbain. Cette observation est significative et souligne l'impact de l'environnement urbain sur les choix alimentaires et la composition des régimes alimentaires. L'augmentation de la disponibilité et de l'accessibilité de ces aliments en milieu urbain contribue à la modification des habitudes alimentaires, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur la santé, notamment en termes d'augmentation du risque d'obésité et de maladies chroniques. L'utilisation du WorldFood Dietary Assessment System a permis une quantification précise de ces apports.
2. Diversité alimentaire et adéquation en micronutriments
Parallèlement à la plus forte consommation de produits animaux, de graisses et de sucres, les participants urbains montrent une plus grande diversité alimentaire et une meilleure adéquation en micronutriments que leurs homologues ruraux. Cette différence est également liée au niveau socio-économique, les indices de qualité alimentaire augmentant avec le statut socio-économique en milieu urbain. Ceci suggère une relation complexe entre la diversité alimentaire, l'apport en micronutriments, et la qualité nutritionnelle globale. Une alimentation plus diversifiée n’est pas toujours synonyme d’une alimentation plus saine. En effet, une plus grande variété d'aliments peut aussi mener à une plus grande consommation de produits riches en graisses et en sucres, augmentant ainsi le risque de maladies chroniques. La méthode des deux rappels alimentaires de 24 heures, analysés avec le WorldFood Dietary Assessment System, a permis une évaluation précise de la diversité alimentaire et de l'apport en micronutriments, révélant des différences significatives entre les milieux urbains et ruraux et selon le statut socio-économique.
3. Score de prévention des maladies cardiovasculaires
Malgré une meilleure diversité alimentaire et une adéquation plus importante en micronutriments en milieu urbain, le score de prévention des maladies cardiovasculaires est paradoxalement plus élevé en milieu rural. Ce résultat souligne que la simple diversification alimentaire ne suffit pas à garantir une alimentation protectrice pour la santé cardiovasculaire. Le score de prévention, basé sur les recommandations de l'OMS, prend en compte des facteurs spécifiques tels que la consommation de fruits et légumes, les apports en graisses, etc. L'inverse de la corrélation observée entre ce score et le niveau socio-économique suggère que l'amélioration du statut socio-économique, en milieu urbain notamment, est associée à une adoption de modes alimentaires moins favorables à la santé cardiovasculaire. Les données, traitées via le WorldFood Dietary Assessment System, mettent en lumière l'importance de ne pas se limiter à la diversité alimentaire pour évaluer la qualité nutritionnelle, et de considérer la composition des régimes alimentaires pour mieux appréhender les risques pour la santé.
III.Diversité alimentaire IMC et prévention des maladies chroniques
L'étude révèle une corrélation positive entre le statut socio-économique, l'IMC et la diversité alimentaire, notamment en milieu urbain. Cependant, une corrélation négative a été observée entre la diversité alimentaire et le score de prévention des maladies cardiovasculaires. Une alimentation diversifiée ne garantit pas une alimentation saine; au contraire, elle peut être associée à une plus grande consommation de graisses et de sucres, augmentant ainsi les risques d'obésité et de maladies chroniques. L’étude souligne la complexité de la relation entre la diversité alimentaire et la santé, et l'importance de considérer le contexte socio-économique et culturel.
1. Diversité alimentaire et prévention des maladies chroniques une relation complexe
L'étude révèle une corrélation négative inattendue entre la diversité alimentaire et le score de prévention des maladies cardiovasculaires. Alors qu'une plus grande diversité alimentaire est généralement associée à un meilleur apport en micronutriments, les résultats montrent que cette diversité est corrélée à une alimentation plus athérogène en milieu urbain. En effet, une plus grande diversité se traduit par une plus forte consommation de graisses et de sucres, augmentant le risque de maladies chroniques. Cette corrélation négative est plus forte en milieu rural, suggérant une vulnérabilité accrue des populations rurales face à l'amélioration du statut socio-économique, car la diversification de leur alimentation pourrait conduire à une alimentation moins saine. Les données obtenues grâce au WorldFood Dietary Assessment System montrent clairement que la simple diversification alimentaire ne garantit pas une meilleure santé, et que la composition du régime alimentaire est un facteur déterminant. Le concept de qualité alimentaire doit donc intégrer le contexte épidémiologique, nutritionnel et socio-économique des populations.
2. L Indice de Masse Corporelle IMC et son association avec les indices de qualité alimentaire
L'étude met en lumière une relation inverse entre l'IMC et le score de prévention des maladies cardiovasculaires, tandis que l'IMC augmente avec le niveau socio-économique. Ceci suggère que l'augmentation du niveau de vie et de l'accès à une alimentation plus diversifiée, notamment en milieu urbain, est associée à une augmentation de l'IMC et à un risque accru de maladies chroniques. La faible association entre la diversité alimentaire et l'IMC (seulement 6,2% de la variation de l'IMC est expliquée par la diversité alimentaire) suggère que d'autres facteurs, comme le mode de vie sédentaire, jouent un rôle important dans l'obésité. L'analyse des données, réalisée avec le WorldFood Dietary Assessment System, met en évidence la complexité des facteurs influençant l'IMC et la nécessité de considérer l'ensemble du style de vie pour comprendre les risques liés à la santé. L'étude souligne l'importance de considérer des facteurs de risque au-delà de la seule diversité alimentaire pour mieux appréhender les liens entre alimentation et santé.
3. Implications pour la définition et l évaluation de la qualité alimentaire
Les résultats remettent en question la simple notion de diversité alimentaire comme indicateur unique de qualité nutritionnelle. L'étude souligne la nécessité d'adapter le concept et les critères de qualité alimentaire au contexte épidémiologique, nutritionnel et socio-économique des populations. La diversité alimentaire, bien qu'importante pour un apport suffisant en micronutriments, peut être associée à une alimentation moins saine si elle se traduit par une augmentation de la consommation de graisses et de sucres. L'utilisation du WorldFood Dietary Assessment System dans l'analyse des données a permis de quantifier précisément ces aspects, soulignant l'importance d'une approche plus nuancée de la qualité alimentaire. Il est crucial de considérer la composition de l'alimentation, en tenant compte des recommandations de l'OMS pour la prévention des maladies cardiovasculaires, pour une évaluation plus complète et pertinente de la qualité nutritionnelle et de ses conséquences sur la santé.
IV.Méthodologie de l étude et collecte de données
L'étude a utilisé une méthodologie transversale avec un échantillon aléatoire stratifié de 325 hommes mexicains. La collecte de données alimentaires a été effectuée à l'aide de deux rappels alimentaires de 24 heures non consécutifs. Les apports énergétiques et nutritionnels ont été calculés à l'aide du WorldFood Dietary Assessment System. Un score SES a été établi en utilisant l'éducation, le statut professionnel et le type de services de santé utilisés. Cette méthodologie robuste permet une analyse approfondie des facteurs influençant la qualité nutritionnelle.
1. Échantillonnage et stratification
L'étude a été menée sur un échantillon aléatoire de 325 hommes mexicains âgés de 35 à 65 ans, apparemment en bonne santé. L'échantillon a été stratifié selon le niveau socio-économique (NSE) en milieu urbain, et selon la zone de résidence (urbain/rural). Seuls les hommes ont été inclus afin de minimiser les effets de confusion liés à la ménopause et à la différence de susceptibilité aux maladies cardiovasculaires entre les sexes. La sélection des participants entre 35 et 65 ans correspond à une tranche d'âge où le risque de maladies cardiovasculaires est plus élevé. Les sujets atteints de diabète, d'hypertension ou de maladies cardiovasculaires, ainsi que les personnes gravement malades ou handicapées, ont été exclus de l'étude. Cette stratification et les critères d'exclusion ont permis de constituer un échantillon représentatif pour l'analyse des relations entre le statut socio-économique, le mode de vie, et la qualité alimentaire. La taille de l'échantillon a été déterminée sur la base d'une prévalence estimée de 15% du syndrome métabolique et d'une précision de 4%, avec un niveau de confiance de 95%.
2. Collecte des données alimentaires
La collecte des données alimentaires a été réalisée par le biais de deux rappels alimentaires de 24 heures non consécutifs. Cette méthode permet d'estimer à la fois le volume et la nature des aliments et boissons consommés par les participants. Une description détaillée des aliments et boissons consommés la veille de l'entretien a été recueillie, incluant les modes de préparation. L’intervalle entre les deux enquêtes était de 10 à 31 jours. Les quantités de nourriture ont été estimées à l'aide d'ustensiles de cuisine (tasses, assiettes, cuillères, verres) et de modèles d'aliments, en utilisant une conversion en grammes. L'analyse nutritionnelle a été effectuée à l'aide des tables du WorldFood Dietary Assessment System. Une table de valeurs nutritionnelles spécifiques au Mexique a également été utilisée, en fusionnant les données du WorldFood Dietary Assessment System avec celles disponibles au Mexique. Des codes ont été attribués à chaque aliment, permettant une analyse détaillée des nutriments.
3. Évaluation du statut socio économique SES
Un questionnaire a été administré aux participants afin de recueillir des informations démographiques et de confirmer le NSE, basé sur la zone de résidence pour les sujets urbains. Un score de NSE a été créé à partir de trois indicateurs : le niveau d'éducation (0 à 4 points), le statut professionnel (1 à 4 points), et le type de services de santé utilisés (1 à 3 points). Ce score a permis de classer les participants urbains en trois niveaux de NSE : faible (score ≤ 3), moyen (4 ≤ score ≤ 8), et élevé (score ≥ 9). Cette méthode permet de prendre en compte les dimensions économique, sociale et éducative pour une évaluation plus précise et plus complète du statut socio-économique et son impact sur la qualité de l’alimentation. L'utilisation d'un score composite permet une analyse plus fine que la seule considération de la zone de résidence.
