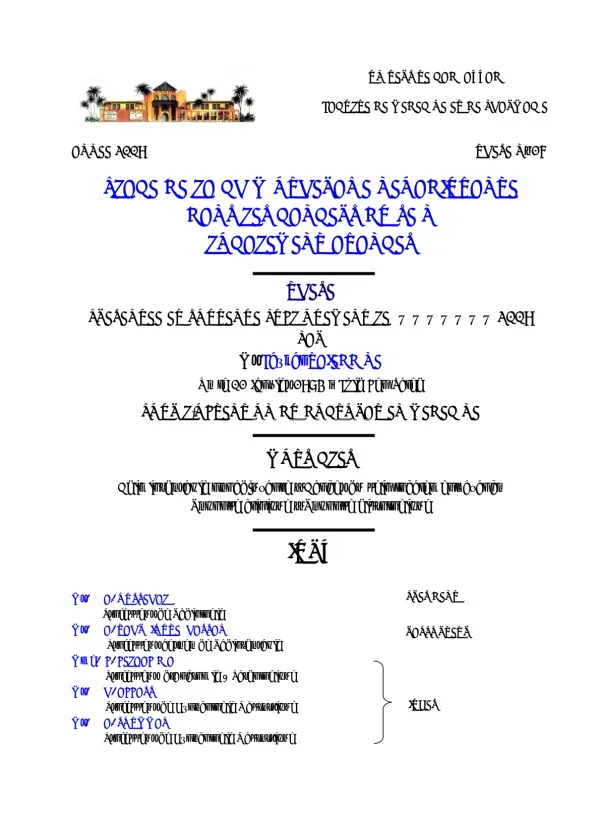
Thèse sur la Chimiothérapie Néoadjuvante dans les Cancers du Sein Localement Avancés
Informations sur le document
| Auteur | Fayçal Tajeddine |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 1.90 MB |
- Chimiothérapie néoadjuvante
- Cancer du sein
- Médecine
Résumé
I.Épidémiologie du cancer du sein au Maroc
Au Maroc, le cancer du sein est un problème de santé publique majeur. Il représente une proportion significative des cancers féminins, devançant d'autres localisations. L'incidence est relativement proche de celle observée dans d'autres pays du Maghreb (Tunisie, Algérie), mais inférieure à celle de la France. Les formes localement avancées sont plus fréquentes qu'en occident, avec un taux de 35,66% des cas diagnostiqués au CHU Mohammed VI de Marrakech entre avril 2007 et avril 2008 (51 cas sur un total de 143). Ce taux élevé est probablement lié à un diagnostic tardif dû à des difficultés économiques, un manque d'information, le recours aux thérapeutes traditionnels, et des facteurs socioculturels. La taille tumorale moyenne au diagnostic est de 6,76 cm.
1. Prévalence du cancer du sein au Maroc et comparaison internationale
Le document établit que le cancer du sein est devenu, depuis l'an 2000, le premier cancer féminin au Maroc, avec une incidence de 27,69 pour 100 000 femmes. Cette incidence est similaire à celle observée dans d'autres pays du Maghreb, la Tunisie affichant un taux de 28/100 000 femmes (2000-2002) et l'Algérie 26/100 000 femmes (1993-1997). Cependant, l'incidence au Maroc reste significativement inférieure à celle de la France, où le taux est de 88,9 pour 100 000 femmes. Cette différence est attribuée à une sous-estimation des cas au Maroc due à l'absence de registre national du cancer et de dépistage systématique. A l'échelle mondiale, le cancer du sein représente 30% des nouveaux cas de cancer féminin dans les pays industrialisés et 14% dans les pays en voie de développement, confirmant son importance comme problème de santé publique, avec plus d'un million de nouveaux cas annuels et 410 000 décès en 2002. L'augmentation de l'incidence au cours des années est mentionnée, potentiellement liée à des facteurs sociodémographiques, mais une analyse précise reste complexe en l'absence d'un registre national.
2. Données spécifiques de l étude Marocaine CHU Mohammed VI
Une étude prospective menée au service d'oncologie du CHU Mohammed VI de Marrakech, entre avril 2007 et avril 2008, a révélé que les cancers du sein localement avancés représentaient 35,66% (51 cas sur 143) des cancers du sein diagnostiqués durant cette période. La taille moyenne initiale des tumeurs était de 6,76 cm, ce qui souligne la prévalence des formes avancées de la maladie. Cette étude, bien que non représentative à l'échelle nationale, corrobore les données épidémiologiques du Maghreb quant à la place du cancer du sein comme premier cancer féminin. Malgré sa première position dans cette étude spécifique, sa fréquence reste bien inférieure à celle observée en France. Ce décalage est imputable, entre autres, à un manque de dépistage systématique et à des facteurs socioculturels affectant le délai de consultation.
3. Facteurs de risque et données controversées
L'étude aborde la question controversée de l'influence des contraceptifs oraux. Une méta-analyse du CGHFBC sur 54 études a démontré une légère augmentation du risque (1,24) chez les utilisatrices, risque qui diminue après l'arrêt et disparaît au bout de 10 ans. Cependant, la Women's Care Study n'a pas montré d'augmentation du risque, quel que soit la durée d'utilisation. Dans l'étude Marocaine, 44% des patientes ont utilisé la pilule pendant une moyenne de 3,84 ans, comparé à 27,5% dans une étude de la Maternité Lalla Meriem de Casablanca. Le traitement hormonal substitutif (THS) à base d'œstrogènes est identifié comme un facteur d'augmentation du risque de cancer du sein, risque corrélé à la durée du traitement; aucune patiente de l'étude Marocaine n'utilisait de THS. L'allaitement maternel, quant à lui, semble présenter un effet protecteur, un constat confirmé par le taux élevé de patientes allaitantes dans l'étude (88%). L'étude mentionne également le rôle encore mal défini des mastopathies bénignes, observées chez 12% des patientes de l'étude Marocaine (contre 9,7% à la Maternité Lalla Meriem de Casablanca).
II. Traitements du cancer du sein localement avancé
La chimiothérapie néoadjuvante, principalement à base d'anthracyclines (protocoles FAC60, FEC100, AT, et CMF), est le traitement standard pour le cancer du sein localement avancé au Maroc. Elle vise à réduire la taille tumorale avant la chirurgie (mastectomie de Patey dans 88% des cas dans l'étude de Marrakech). L'étude prospective du CHU Mohammed VI a montré une réponse clinique objective (cRO) de 48% et une réponse complète histologique (pCR) de 4% chez 25 patientes traitées. La radiothérapie et l'hormonothérapie (ex: tamoxifène) complètent le traitement selon le cas. Des techniques plus récentes comme le Cyberknife sont explorées.
1. Chimiothérapie néoadjuvante Protocoles et résultats
Le document met en avant la chimiothérapie néoadjuvante comme traitement standard du cancer du sein localement avancé. L'étude Marocaine, menée au CHU Mohammed VI de Marrakech, a principalement utilisé des protocoles à base d'anthracyclines. Parmi les 25 patientes, 24 (96%) ont reçu ce type de chimiothérapie, réparties comme suit : 48% selon le protocole FAC60, 40% selon le FEC100, 8% selon le protocole AT, et 4% (une patiente) avec un protocole CMF. En moyenne, les patientes ont reçu 4 cures. Les résultats montrent une réponse clinique objective (cRO) de 48%, dont 24% de réponse clinique complète (cRC). La réponse complète histologique (pCR) était plus faible, à seulement 4% (un seul cas). Le document cite également des études internationales utilisant d'autres protocoles, comme des combinaisons avec du paclitaxel ou du docetaxel, avec des taux de réponse variables selon les protocoles et les doses utilisées. L'efficacité de la chimiothérapie néoadjuvante est jugée sur la réduction de la taille tumorale avant l'intervention chirurgicale, permettant ainsi une meilleure opérabilité et une chirurgie moins invasive. Il est cependant souligné qu'il n'existe pas de protocole unique et incontesté. L’étude mentionne l’intérêt de la chimio-sensibilité pour adapter les traitements en fonction de la réponse tumorale et souligne l'hétérogénéité des tumeurs localement avancées en termes de comportement biologique et clinique.
2. Chirurgie et traitement post chirurgical
Dans l'étude Marocaine, 22 patientes (88%) ont subi une mastectomie avec curage ganglionnaire axillaire selon la technique de Patey après la chimiothérapie néoadjuvante. La taille tumorale moyenne a diminué de 63% après le traitement, passant de 6,76 cm initialement à 2,5 cm en moyenne après chirurgie. L'analyse des prélèvements chirurgicaux a révélé un envahissement ganglionnaire dans 20 cas (90,9%) et des marges d'exérèse saines dans 19 cas (86,3%). Deux patientes (8%) ont présenté une progression tumorale métastatique nécessitant une chimiothérapie de deuxième ligne. Une patiente a été perdue de vue. Le degré moyen de nécrose tumorale était de 40%. Le document évoque l’importance de la séquence thérapeutique et recommande l’administration de la chimiothérapie avant la radiothérapie, généralement trois à cinq mois après la chirurgie, afin de minimiser le risque de récidive locale. Il mentionne également le tamoxifène (20mg/jour pendant 5 ans) comme traitement standard jusqu'en 2005, avec l'émergence des anti-aromatases par la suite.
3. Surveillance post traitement et recommandations
Le suivi des 24 patientes de l'étude Marocaine s'est étalé sur une période moyenne de 14 mois (extrêmes de 8 à 20 mois). À la fin du suivi, 22 patientes étaient en rémission clinique complète, tandis que deux autres ont présenté une évolution métastatique et ont reçu un traitement palliatif. L'étude souligne la fréquence élevée de cancers du sein localement avancés au Maroc (35,66%), et le retard important à la consultation observé chez la majorité des patientes, un retard imputable à des difficultés économiques, un manque d'information, le recours aux thérapeutes traditionnels, et des facteurs socioculturels. L'étude mentionne aussi brièvement le Cyberknife comme une technique de radiothérapie stéréotaxique prometteuse, mais dont l'efficacité doit encore être confirmée. La TEP (Tomographie par émission de positons) est présentée comme un examen performant pour évaluer l'envahissement locorégional et détecter des métastases à distance, ainsi que pour surveiller l'efficacité de la chimiothérapie néoadjuvante. La chimiothérapie néoadjuvante est confirmée comme standard thérapeutique pour améliorer la résécabilité tumorale, la qualité de la chirurgie et, espérer améliorer la survie globale et permettre un traitement conservateur.
III.Diagnostic et Bilan d extension du cancer du sein
Le diagnostic repose sur l'examen clinique, la mammographie (opacité stellaire, désorganisation architecturale, microcalcifications), l'échographie, et surtout la biopsie (biopsie percutanée ou chirurgicale). L'examen anatomo-pathologique est crucial pour déterminer le type histologique (carcinome canalaire infiltrant, carcinome lobulaire infiltrant, etc.), le grade tumoral, le statut des récepteurs hormonaux, et l'expression de HER2. La TEP est un outil d'imagerie utile pour le bilan d'extension locorégionale et la recherche de métastases.
1. Examen clinique et imagerie
Le diagnostic du cancer du sein repose initialement sur l'examen clinique, mettant en évidence des signes tels que la présence d'un nodule, des modifications cutanées, ou une fixité de la tumeur. L'autopalpation d'un nodule constituait 76% des motifs de consultation dans l'étude Marocaine, soulignant un diagnostic souvent tardif, comme le confirment les modifications cutanées présentes dans 32% des cas (contre 28,4% dans l'étude de la Maternité Lalla Meriem de Casablanca). La mammographie est un outil important pour le bilan d'extension locorégional, permettant de détecter des opacités stellaires (60% des cas dans l'étude), des désorganisations architecturales (32%), et des microcalcifications (20%). L'échographie apporte des informations complémentaires, surtout chez les femmes jeunes ou en présence de tumeurs kystiques, mais sa spécificité est limitée dans les seins adipeux. Le document insiste sur la standardisation de la terminologie et des critères de malignité en mammographie (BIRADS) pour améliorer la précision diagnostique.
2. Examen Anatomo pathologique et Biopsie
L'examen anatomo-pathologique est essentiel pour confirmer le diagnostic de malignité et déterminer le type histologique de la tumeur. Il permet également de réaliser le grade histopronostique de Scarff Bloom Richardson (SBR) et d'évaluer les récepteurs hormonaux et HER2, des éléments clés pour le pronostic et la stratégie thérapeutique. La biopsie, qu'elle soit percutanée (Trucut) ou chirurgicale, est indispensable pour l'analyse histologique. La biopsie percutanée, guidée par l'examen clinique ou l'imagerie, est une alternative à la biopsie chirurgicale, permettant de prélever des échantillons de tissu pour le diagnostic. Cependant, cette technique présente des limites liées à l'échantillonnage, la taille, la localisation et l'aspect de la lésion. Le diagnostic de carcinome in situ nécessite une réévaluation par biopsie chirurgicale en raison de la possibilité d'une composante infiltrante. L'étude mentionne que le carcinome canalaire infiltrant est le type histologique le plus fréquent (80% des cas dans la série étudiée), suivi du carcinome lobulaire infiltrant (12%) et du carcinome médullaire (8%).
3. Bilan d extension locorégionale et à distance
Le bilan d'extension locorégional inclut l'examen clinique des ganglions axillaires (adénopathies), avec un taux d'adénopathies palpables cliniquement de 56% dans l'étude Marocaine (supérieur aux taux observés à l'INO, en Tunisie et dans l'étude de Kahlain). La mammographie recherche des signes de multifocalité et/ou de bilatéralité. La TEP (Tomographie par émission de positons) est présentée comme une technique d'imagerie nucléaire de plus en plus utilisée en oncologie pour l'évaluation initiale du cancer du sein localement avancé. Elle permet d'évaluer l'envahissement locorégional, notamment au niveau de la chaîne mammaire interne, et de détecter des métastases à distance, contribuant ainsi à l'évaluation de l'efficacité de la chimiothérapie néoadjuvante. L’étude de Kahlain au COIR a montré un taux de 90,5% d’envahissement ganglionnaire, comparé à 64% dans la série Marocaine.
IV.Facteurs pronostiques et suivi
Plusieurs facteurs influencent le pronostic du cancer du sein, notamment le type histologique, le grade tumoral, le statut des récepteurs hormonaux (œstrogènes, progestérones), l'expression de HER2, et la taille tumorale. L'obtention d'une réponse complète à la chimiothérapie néoadjuvante est un facteur pronostique favorable. Le suivi des patientes est essentiel, avec une surveillance régulière pour détecter d'éventuelles récidives ou métastases.
1. Facteurs pronostiques liés à la tumeur
Le document identifie plusieurs facteurs pronostiques liés aux caractéristiques de la tumeur elle-même. Le type histologique est un facteur important : le carcinome canalaire infiltrant, le plus fréquent, est mentionné, ainsi que le carcinome lobulaire infiltrant et le carcinome médullaire, avec des fréquences et pronostics variables. Le grade histopronostique de Scarff Bloom Richardson (SBR) est un autre facteur déterminant, les grades II et III étant associés à une meilleure réponse à la chimiothérapie. L'expression des récepteurs hormonaux (œstrogènes et progestérones) est également un facteur pronostique, leur positivité étant un élément de bon pronostic et prédictif de la réponse à l'hormonothérapie. Le statut HER2 est crucial, son expression positive influençant le choix du traitement et le pronostic. La taille tumorale initiale est un facteur clinique déterminant, une réduction importante de cette taille grâce à la chimiothérapie néoadjuvante améliorant le pronostic. Enfin, des marqueurs de prolifération cellulaire comme Ki67 et Bcl2 sont mentionnés comme ayant un impact sur la réponse à la chimiothérapie. Les tumeurs avec un Ki67 élevé et un Bcl2 négatif ont un meilleur profil de réponse potentielle à la chimiothérapie.
2. Réponse à la chimiothérapie néoadjuvante et survie
La réponse à la chimiothérapie néoadjuvante, en particulier la réponse complète histologique (pCR), est considérée comme un facteur pronostique majeur. Bien que l'essai B18 du NSABP n'ait pas montré d'amélioration significative de la survie sans rechute (SSR) et de la survie globale (SG) entre les bras adjuvant et néoadjuvant pour 4 cycles d'AC, de nombreuses études mentionnées indiquent que l'obtention d'une pCR est corrélée à une amélioration de la survie. L’étude Marocaine, avec un taux de pCR de 4%, ne permet pas de tirer des conclusions définitives sur ce point, et la taille réduite de l'échantillon limite la portée des résultats. Il est noté qu'une réponse tumorale importante, mesurée par la réduction de la taille tumorale, est elle aussi corrélée à une meilleure survie sans rechute. Des résultats d'études internationales sont cités, avec des taux de réponse clinique complète (cRC) et de réponse complète histologique (pCR) variables selon le protocole utilisé, soulignant l'importance du choix du protocole de chimiothérapie en fonction du type de tumeur et des caractéristiques biologiques.
3. Suivi des patientes et résultats à long terme
L’étude Marocaine a suivi 24 patientes sur une période moyenne de 14 mois (8 à 20 mois). À la fin du suivi, 22 patientes étaient en rémission clinique complète, tandis que 2 patientes ont développé une progression métastatique durant la chimiothérapie et ont reçu un traitement palliatif. Une patiente a été perdue de vue. La durée du suivi relativement courte limite la possibilité d'analyser les résultats à long terme et la survie globale. Le document souligne l'importance d'un suivi régulier après le traitement pour détecter d'éventuelles récidives ou métastases, en précisant que la réponse histologique complète est le principal élément pronostique de l'amélioration de la survie. Le manque de données à long terme dans cette étude spécifique limite l'analyse approfondie de la survie sans rechute et de la survie globale après le traitement.
