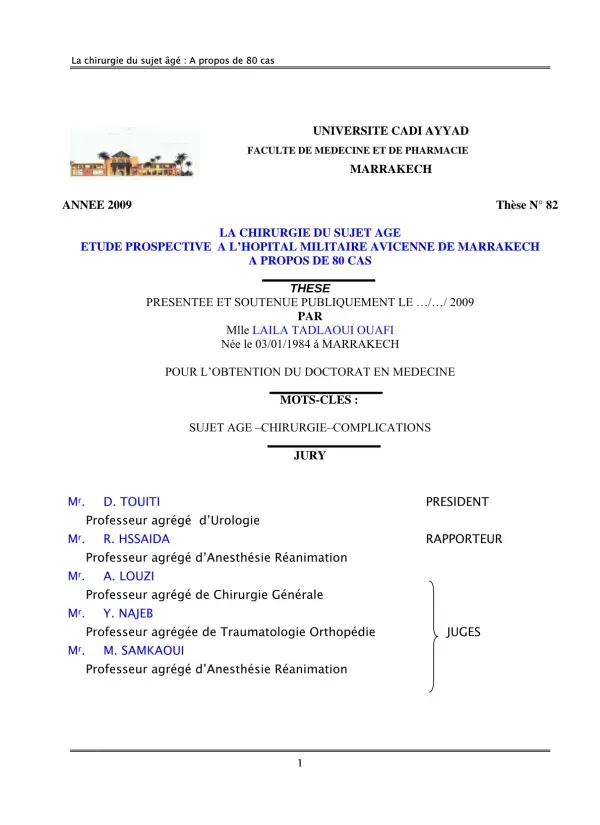
Thèse sur la Chirurgie chez le Sujet Âgé
Informations sur le document
| Auteur | Laila Tadlaoui Ouafi |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 2.28 MB |
- Chirurgie
- Médecine
- Université
Résumé
I.Définition du Vieillissement et Enjeux Sociétaux
Ce document explore les défis liés à la chirurgie chez les personnes âgées, définissant le vieillissement comme une diminution progressive des réserves fonctionnelles. L'OMS fixe l'âge de 65 ans comme seuil d'entrée dans la catégorie des personnes âgées. Le vieillissement de la population pose des enjeux majeurs pour le système de santé, notamment en termes d'adaptation des prises en charge et des principes éthiques, soulignant l'importance de l'amélioration de la qualité des soins apportés aux patients âgés et la nécessité d'adapter les posologies médicamenteuses.
1. Définition du Vieillissement
Le document introduit la notion de vieillissement comme un processus irréversible caractérisé par une diminution progressive des réserves fonctionnelles de l'organisme. Cette diminution varie considérablement d'un individu à l'autre, en fonction de facteurs génétiques et du style de vie. Une distinction importante est établie entre l'âge chronologique (nombre d'années vécues) et l'âge physiologique (état des systèmes homéostatiques). Cette différence souligne la complexité de définir précisément le vieillissement et met l'accent sur la variabilité individuelle. L'étude souligne l'importance de considérer l'âge physiologique, plutôt que l'âge chronologique, pour évaluer l'état de santé d'un individu âgé et pour adapter les traitements médicaux.
2. L âge de 65 ans comme seuil et les enjeux sociétaux
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) utilise l'âge de 65 ans comme repère pour définir la catégorie des personnes âgées. Cependant, le document souligne que, quelle que soit la définition précise choisie, le vieillissement de la population est un défi majeur de notre société. La gestion des conséquences de ce vieillissement représente un enjeu crucial pour le monde médical. Le secteur médical doit adapter ses pratiques, ses prises en charge thérapeutiques et ses principes éthiques pour répondre aux besoins spécifiques de la population âgée croissante. L'amélioration de la qualité des soins aux patients âgés est identifiée comme un aspect essentiel de cette adaptation nécessaire. Ce changement démographique influence profondément les politiques de santé publique et les ressources allouées au secteur médical.
II.Pharmacocinétique et Métabolisme chez le Sujet Agé
L'âge influence la pharmacocinétique des médicaments (absorption, distribution, métabolisme et élimination), augmentant le risque d'effets indésirables chez les personnes âgées, surtout lors d'administrations chroniques. L'adaptation posologique est cruciale pour minimiser la toxicité, bien que la personnalisation de la dose soit complexe en raison des nombreux médicaments associés et des interactions possibles. Des doses plus faibles que chez les jeunes adultes sont généralement recommandées, avec une surveillance des concentrations plasmatiques si nécessaire. Cette adaptation posologique est essentielle dans le cadre de la prise en charge des patients âgés subissant une intervention chirurgicale.
1. Modification de la Pharmacocinétique avec l âge
Le vieillissement affecte profondément la pharmacocinétique des médicaments chez les personnes âgées, même en l'absence de pathologie. Toutes les phases du devenir du médicament dans l'organisme – absorption, distribution, métabolisme et élimination – sont potentiellement modifiées. Ces altérations physiologiques augmentent la vulnérabilité des personnes âgées aux effets indésirables des médicaments, surtout lors de traitements à long terme ou chroniques. Comprendre ces modifications est crucial pour optimiser la prescription médicamenteuse et prévenir les risques liés à une mauvaise gestion pharmacologique chez la population âgée. La complexité de ces interactions médicamenteuses et leurs effets potentiellement néfastes justifient une attention particulière quant à la surveillance de l'état du patient.
2. Adaptation Posologique et Risque de Toxicité
Connaître le comportement pharmacocinétique et métabolique d'un médicament chez le sujet âgé est essentiel pour adapter sa posologie. L'objectif principal est de définir la dose optimale et l'intervalle entre les prises afin de minimiser le risque de toxicité. Cependant, établir une posologie personnalisée pour chaque individu est complexe, car il faut tenir compte à la fois des modifications pharmacocinétiques liées à l'âge et de la prise concomitante de plusieurs médicaments, augmentant le risque d'interactions médicamenteuses. La pratique courante consiste à prescrire des doses plus faibles qu'en population plus jeune, tout en surveillant attentivement les concentrations plasmatiques, en particulier pour les substances ayant un index thérapeutique étroit. Cette surveillance permet d'éviter l'accumulation de médicaments et donc la survenue d'effets secondaires indésirables.
III.Chirurgie chez la Personne Agée Exemples et Fréquence
La chirurgie de la cataracte sénile est l'intervention la plus fréquente chez les personnes âgées, avec plus de 70% des patients récupérant une acuité visuelle supérieure à 7/10. La chirurgie de la lithiase biliaire, bien que moins fréquente, présente un risque accru de mortalité (5 à 16%) en raison de la symptomatologie atypique souvent négligée chez les sujets de plus de 70 ans. Les urgences chirurgicales chez les personnes âgées sont associées à une mortalité globale d'environ 20%, en raison de la diminution des fonctions cognitives, de l'altération des fonctions sensorielles et d'une potentialité de pathologie sous-jacente.
1. Chirurgie de la Cataracte Sénile
La chirurgie de la cataracte sénile est présentée comme l'intervention chirurgicale la plus fréquemment pratiquée chez les personnes âgées. Son succès repose sur d'excellents résultats fonctionnels, notamment une récupération de l'acuité visuelle supérieure à 7/10 pour plus de 70% des patients en l'absence de pathologie oculaire associée. Les progrès techniques, incluant la microchirurgie, la phacoémulsification et les implants intraoculaires souples, ainsi que le développement de la chirurgie ambulatoire et de l'anesthésie locale, ont contribué à réduire le caractère invasif de cette intervention. Malgré ces avancées, le texte rappelle qu'il s'agit d'un acte chirurgical à part entière avec des complications possibles, même si elles restent peu fréquentes. L'information du patient sur ces risques potentiels demeure essentielle.
2. Chirurgie de la Lithiase Biliaire et Urgences Chirurgicales
La chirurgie de la lithiase biliaire est mentionnée comme moins fréquente que la chirurgie de la cataracte chez les personnes âgées, mais avec une prévalence importante (plus de 33% chez les plus de 70 ans). Sa symptomatologie atypique conduit souvent à un retard de diagnostic et à des admissions en urgence, ce qui augmente la mortalité (5 à 16%). Le document met ensuite en lumière l'augmentation de la mortalité liée aux interventions chirurgicales en urgence chez les patients âgés (environ 20%). Divers facteurs contribuent à cette situation: la diminution des fonctions cognitives rendant la communication difficile, l'altération des fonctions sensorielles (diminution de la perception de la douleur), l'atypie de certaines pathologies et parfois un désintérêt du patient pour sa propre santé. La durée de pré-hospitalisation est souvent longue (plus de 72 heures), accentuant les risques. Cette situation souligne les défis posés par la médicalisation des personnes âgées et la nécessité d'un dépistage précoce des pathologies évolutives.
3. Autres Interventions Chirurgicales chez les Personnes Agées
Le texte aborde brièvement d'autres types d'interventions chirurgicales chez les personnes âgées. La chirurgie orthopédique, notamment pour l'ostéoporose, est mentionnée comme une chirurgie programmée. La fragilité osseuse liée à l'ostéoporose (os spongieux, os cortical fin et cassant) augmente le risque de fractures même après un traumatisme léger, rendant les interventions complexes. La chirurgie du cancer de la prostate, particulièrement fréquent chez les hommes de plus de 65 ans, est également citée. Le développement de nouvelles techniques moins invasives (micro-ondes, radiofréquences, ultrasons, laser) vise à réduire la morbidité et les coûts. Enfin, la chirurgie de la vessie est évoquée avec l'augmentation significative de l'incidence du cancer de la vessie à partir de 40 ans, le diagnostic étant plus fréquent entre 50 et 70 ans chez les hommes. La stratégie thérapeutique dépend de l'étendue de la maladie, avec une préférence pour la chirurgie conservatrice pour les petites tumeurs et une néphrectomie radicale pour les cancers localement avancés.
IV.Facteurs de Risque Opératoires et Anesthésie
L'âge, bien qu'indicateur, n'est pas un facteur de risque indépendant en lui-même pour les complications périopératoires. L'état de santé préopératoire et l'âge physiologique sont plus importants. Des facteurs confondants tels que les pathologies préexistantes et la polymédication augmentent significativement le risque de complications. Le choix entre anesthésie générale et anesthésie locorégionale doit être individualisé, l'anesthésie locorégionale présentant des avantages pour les patients âgés porteurs de pathologies associées, en réduisant les effets systémiques. Les complications posturales, telles que les rhabdomyolyses, sont liées à la durée de l'intervention et à la posture chirurgicale.
1. L âge et les risques périopératoires
La morbidité et la mortalité périopératoires augmentent avec l'âge, mais il est crucial de nuancer cette observation. L'étude souligne que l'âge chronologique n'est pas un facteur de risque indépendant. En effet, des octogénaires en bonne condition physique présentent des taux de morbidité et de mortalité comparables à des adultes jeunes subissant la même intervention. C'est l'âge physiologique, reflétant l'état de santé préopératoire, qui est déterminant. Une évaluation préopératoire rigoureuse est donc primordiale. De nombreuses études épidémiologiques confirment que l'âge avancé, pris isolément, est un indicateur peu pertinent. Il est nécessaire d'identifier les facteurs confondants, comme les pathologies préexistantes et la polymédication, pour mieux comprendre la fréquence élevée des complications chez les patients plus âgés. Dans une étude mentionnée, 80,4% des patients avec antécédents pathologiques ont présenté des complications, contre seulement 19,6% des patients sans antécédents. Cette différence souligne la forte variabilité de l'âge physiologique et l'influence des pathologies sous-jacentes.
2. Anesthésie Générale vs Anesthésie Locorégionale
Le choix entre anesthésie générale (AG) et anesthésie locorégionale (ALR) doit être individualisé en fonction du patient. L'étude mentionne un taux d'anesthésie générale de 62,5% contre 35% pour l'anesthésie locorégionale. Ce déséquilibre est expliqué par la facilité de mise en œuvre de l'anesthésie générale peropératoire, et l'absence d'échec pendant l'intervention, contrairement à l'anesthésie locorégionale. Cette dernière présente des difficultés spécifiques chez les personnes âgées, telles que l'absence de coopération et des problèmes de positionnement dûs à la calcification des ligaments et à l'arthrose. La littérature comparant l'anesthésie générale et l'anesthésie locorégionale non rachidienne est limitée. Cependant, l'absence quasi totale d'effets systémiques de l'anesthésie plexique, tronculaire ou locale est considérée comme un avantage majeur chez les sujets âgés, souvent porteurs de pathologies associées graves.
3. Complications liées à la Posture Opératoire
Les complications posturales, favorisées par la position du patient sur la table d'opération, sont conditionnées par la durée de l'intervention, l'état de santé du patient et le type d'anesthésie. Le texte cite l'inhalation comme complication potentiellement létale si elle n'est pas dépistée à temps, notamment en cas d'estomac plein, de reflux gastro-œsophagien (RGO), de grossesse ou de certaines pathologies (gastroparésie diabétique). Des complications pulmonaires, liées à la modification de la capacité résiduelle fonctionnelle pulmonaire (CRF), sont également évoquées. Les rhabdomyolyses, fréquentes lors de positions extrêmes, résultent d'une hypoperfusion, de la pression sur les points d'appui et de l'étirement des muscles. Le risque est proportionnel à la durée de la posture. Ces complications posturales peuvent compromettre le pronostic fonctionnel et vital. Une connaissance approfondie des mécanismes physiopathologiques, une prise en compte de l'état du patient et des effets de l'anesthésie permettent de mettre en place des mesures préventives et une surveillance rigoureuse.
V.Gestion de la Douleur Postopératoire chez la Personne Agée
La gestion de la douleur postopératoire chez les personnes âgées est complexe. L'évaluation de la douleur doit tenir compte des perturbations liées à la sénescence et des troubles cognitifs. Des outils comme l'échelle visuelle analogique (EVA) et l'échelle verbale numérique (EVN) sont utilisés, mais leur adaptation chez les personnes âgées doit être considérée. La pharmacologie des analgésiques est modifiée chez les personnes âgées, nécessitant une adaptation des posologies (opiacés, paracétamol, néfopam, tramadol). L'analgésie locorégionale, comme l'analgésie péridurale, présente des avantages en termes de reprise du transit intestinal et de réduction des effets secondaires des morphiniques.
1. Évaluation de la Douleur chez la Personne Agée
L'évaluation de la douleur postopératoire chez les personnes âgées est complexe. La situation clinique est souvent très complexe, du fait de la sénescence (appauvrissement sémantique, vieillissement du système nociceptif), des handicaps sensoriels variés, des pathologies multiples et intriquées, et des troubles cognitifs. Ces facteurs peuvent masquer ou au contraire exacerber l'expression de la douleur. L'échelle visuelle analogique (EVA) est mentionnée, mais sa pertinence chez les personnes âgées est remise en question; une présentation verticale et l'utilisation de l'échelle EVA pédiatrique pourraient améliorer son efficacité. L'échelle verbale numérique (EVN) est validée pour les patients aux fonctions cognitives intactes ou ayant des troubles cognitifs modérés. Le document précise que malgré la complexité, les personnes âgées sont généralement capables d'identifier la localisation de leur douleur, ce qui facilite le diagnostic et permet une adaptation du traitement.
2. Traitement de la Douleur Analgésiques
La pharmacologie des analgésiques est modifiée chez les personnes âgées. Le document mentionne les opiacés, dont la pharmacocinétique est altérée avec l'âge : le volume de distribution de la morphine est réduit de moitié, la clairance également, entraînant des concentrations plasmatiques plus élevées. La sensibilité cérébrale accrue aux opiacés avec l'âge nécessite une adaptation thérapeutique. Le paracétamol, dont la posologie n'a pas besoin d'être ajustée (1g toutes les six heures), permet de réduire la consommation de morphine postopératoire d'environ 40%. Le néfopam, disponible uniquement par voie parentérale, est équivalent à la morphine (20mg de néfopam = 10mg de morphine) mais son administration doit être lente. Le tramadol, un antalgique central, présente l'avantage de diminuer la dépression respiratoire par rapport aux opioïdes classiques, mais la clairance est diminuée chez les plus de 75 ans et les insuffisants rénaux et hépatiques.
3. Analgésie Locorégionale et Gestion Postopératoire
L'analgésie locorégionale, utilisant les anesthésiques locaux, présente de nombreux avantages chez les personnes âgées en raison de son efficacité. L'analgésie péridurale, utilisant uniquement des anesthésiques locaux, permet une reprise plus rapide du transit intestinal, mais peut entraîner de l'hypotension orthostatique ou une rétention urinaire, complications plus délétères chez les personnes âgées. La combinaison de troubles digestifs et de dénutrition peut compromettre les suites postopératoires. Une alimentation précoce des patients (hors iléus postopératoire) est recommandée. Chez les patients en chirurgie viscérale, l'anesthésie locale par voie rachidienne permet une analgésie puissante tout en évitant les effets négatifs des morphiniques sur le transit intestinal. L'analgésie péridurale favorise ainsi l'alimentation orale précoce. Les données sur l'influence de l'analgésie sur le sommeil postopératoire sont limitées, mais l'analgésie locorégionale et les anesthésiques locaux semblent limiter les troubles du sommeil.
VI.Prévention des Complications Postopératoires
La prévention des complications postopératoires, notamment la thrombose veineuse profonde (TVP), repose sur l'héparinothérapie à faible dose, la contention élastique graduée, et la mobilisation précoce. La surveillance de l'efficacité des traitements anticoagulants (HNF, HBPM, AVK) et la gestion du risque hémorragique sont essentielles. Une prise en charge nutritionnelle adaptée est importante, la nutrition entérale cyclique étant plus efficace que la nutrition continue chez les patients âgés. La réadaptation postopératoire, coordonnée par l'équipe soignante, est un élément crucial pour une récupération optimale des patients âgés.
1. Prévention de la Thrombose Veineuse Profonde TVP
La prévention de la thrombose veineuse profonde (TVP) est abordée comme un élément crucial des soins postopératoires chez les personnes âgées. L'héparinothérapie à faible dose (HBPM ou HNF) et la contention élastique graduée sont présentées comme des méthodes efficaces, réduisant le risque thromboembolique de 50 à 75% individuellement. L'association des deux méthodes semble encore plus efficace. Pour les patients à faible risque thrombotique subissant une résection endoscopique de la prostate, seul le lever précoce est recommandé par l'American College of Chest Physician. La prévention de la TVP est un élément clé de la prise en charge postopératoire, soulignant l’importance de la mobilisation précoce et d’une surveillance médicale adéquate pour prévenir les complications thromboemboliques fréquentes chez les patients immobilisés.
2. Autres Mesures Préventives et Réhabilitation
Le document souligne l'importance de la réhabilitation postopératoire précoce. La mobilisation passive et active, pratiquée par les kinésithérapeutes, ainsi que la surélévation des membres inférieurs et le lever précoce sont des éléments clés de cette réhabilitation. Les moyens mécaniques, comme les dispositifs de compression veineuse, sont recommandés en association avec des traitements antithrombotiques pour une efficacité accrue. L'utilisation des médicaments antithrombotiques doit être évaluée individuellement en fonction du bénéfice antithrombotique attendu et du risque hémorragique. La plupart des anticoagulants agissent sur la thrombine (facteur IIa), soit directement, soit indirectement. Des mécanismes d'action innovants sont en cours d'exploration. Les molécules mentionnées sont HNF, HBPM et AVK. Une surveillance clinique et biologique, incluant des examens obligatoires, est essentielle pour évaluer l'efficacité du traitement et détecter les effets secondaires.
3. Soins Supplémentaires et Prévention des Escarres
Pour éviter les escarres, le document proscrit les applications d'alcool, de chaud, de froid, et de produits colorés qui pourraient masquer une lésion cutanée. Les transferts et les traitements orthopédiques doivent être réalisés avec précaution pour éviter les traumatismes. La réadaptation est coordonnée par l'équipe soignante, en accord avec le patient et sa famille. L'apport d'un psychologue peut être nécessaire pour certains patients. Une approche préventive et éducative est essentielle pour le patient, sa famille, et l'équipe soignante. Une assistance nutritionnelle est souvent nécessaire après une chirurgie majeure, car les patients âgés sont souvent incapables de couvrir leurs besoins métaboliques par l'alimentation orale seule. La nutrition entérale cyclique est privilégiée par rapport à la nutrition continue pour permettre la poursuite des prises alimentaires orales et le maintien d'une activité physique favorable à l'anabolisme.
