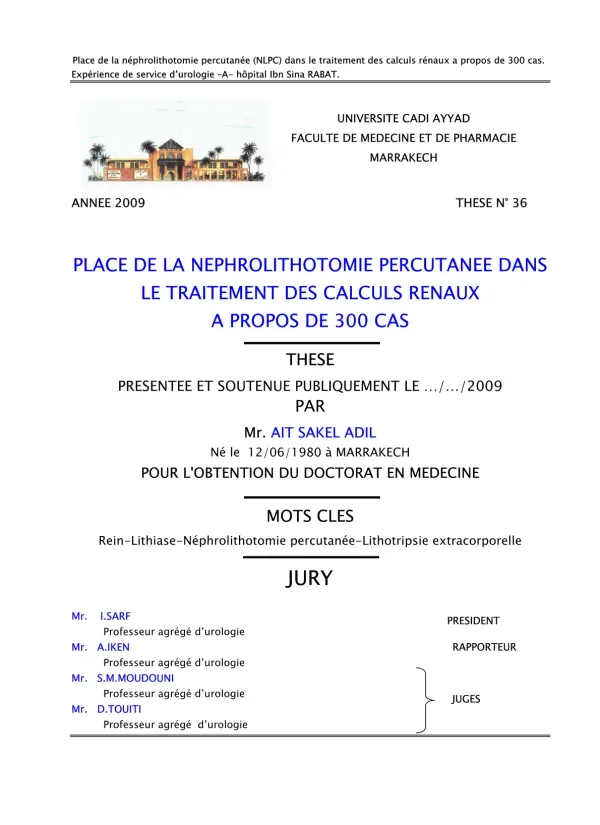
Thèse sur la Néphrolithotomie Percutanée dans le Traitement des Calculs Rénaux
Informations sur le document
| Auteur | Mr. Ait Sakel Adil |
| École | Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Type de document | Thèse |
| Lieu | Marrakech |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 2.06 MB |
- Néphrolithotomie
- Médecine
- Serment d'Hippocrate
Résumé
I.La Néphrolithotomie Percutanée NLPC Une Revue de la Technique
Ce document présente une étude rétrospective de 300 cas de néphrolithotomie percutanée (NLPC) réalisés au service d’urologie - A – du CHU Ibn Sina à Rabat entre 1985 et 2008. L'étude porte sur le traitement de la lithiase rénale par NLPC, comparant différents aspects de cette technique chirurgicale mini-invasive à sa place actuelle en urologie. Les résultats montrent un taux de succès de 68,5% à trois mois (patients 'stone free'). Les principales complications observées étaient d'ordre septique et hémorragique. L’étude explore également l'historique de la NLPC, mentionnant des pionniers comme Sérapion et des développements modernes tels que l'utilisation de la lithotritie endocorporelle et des techniques d'accès percutané assisté par robot. L'étude a impliqué 270 patients (157 hommes, 113 femmes), l'âge moyen étant de 46 ans. Les types de calculs rénaux traités incluent la lithiase pyélique (62,7%), la lithiase calicielle inférieure (17,3%) et les calculs coralliformes (13,3%).
1. Étude Rétrospective de la Néphrolithotomie Percutanée NLPC à Rabat
L'étude principale porte sur une analyse rétrospective de 300 cas de néphrolithotomie percutanée (NLPC) effectués au service d'urologie A du CHU Ibn Sina à Rabat entre 1985 et 2008. Cette étude, basée sur une cohorte de 270 patients (157 hommes et 113 femmes, âge moyen 46 ans), vise à évaluer l'efficacité et les complications de la NLPC dans le traitement de la lithiase rénale. Les types de calculs rénaux traités étaient variés : lithiase pyélique (188 cas, 62,7%), lithiase calicielle inférieure (52 cas, 17,3%) et calculs coralliformes (40 cas, 13,3%). À trois mois post-opératoires, le taux de patients « stone free » (sans calculs) était de 68,5%. Les complications majeures observées étaient principalement d'ordre septique (7 cas) et hémorragique (5 cas). Cette analyse fournit des données précieuses sur les résultats cliniques de la NLPC dans un contexte spécifique, permettant une comparaison avec les données internationales et l’évaluation de la technique dans une population particulière.
2. Historique et Développements de la NLPC
L'étude retrace brièvement l'histoire de la néphrolithotomie percutanée, attribuant une première intervention à Sérapion, un médecin arabe de la fin du Xème siècle, qui a extrait un calcul rénal par une approche trans-lombaire avec un fer rouge. Les développements modernes sont présentés, en commençant par Rupel et Brown en 1941 qui ont rapporté la première extraction d'un calcul rénal par une néphrostomie. Goodwin et al. (1955) ont ensuite utilisé la néphrostomie percutanée pour le drainage rénal. L'essor significatif de la NLPC comme technique d'extraction intentionnelle de calculs rénaux date de 20 ans plus tard, grâce à Fernstrom et Johanson. Le développement subséquent de la technique a intégré l'utilisation du néphroscope pour une extraction sous contrôle visuel direct, un progrès majeur accompli par des équipes urologiques allemandes (Mayence), britanniques et américaines. L'évolution technologique est mentionnée, incluant les améliorations de l’instrumentation et les progrès de la lithotritie, soulignant l'évolution continue de la technique depuis ses origines jusqu'à sa forme moderne.
3. Technique Chirurgicale de la NLPC et Aspects Techniques Avancés
La description de la technique chirurgicale de la néphrolithotomie percutanée (NLPC) détaille les étapes clés du processus. La ponction rénale, souvent réalisée via un calice inférieur sous échographie, est suivie de la dilatation du canal de travail à l'aide de dilatateurs d'Alken sous contrôle radioscopique. Un fibroscope peut être utilisé si nécessaire. La lithotritie endocorporelle, utilisant les ultrasons ou un lithoclast pneumatique ou laser, est employée pour la fragmentation des calculs. L'étude mentionne ensuite des avancées technologiques, notamment l'utilisation de ballons de dilatation considérés comme référence et la gaine Pathway Access Sheath qui combine dilatation et positionnement de la gaine en une seule étape. L'accès percutané robotique avec le système PAKY est également évoqué, montrant une amélioration de la rapidité et une réduction des pertes sanguines par rapport à l'accès manuel. D'autres approches telles que l'abord transrénal rétrograde et la mini-NLPC sont brièvement abordées.
II.Aspects Techniques et Innovations de la NLPC
La procédure de NLPC implique une ponction rénale, généralement par un calice inférieur, sous contrôle échographique et radioscopique. La dilatation du canal de travail se fait avec des dilatateurs d’Alken, et un fibroscope peut être utilisé. La lithotritie fait appel aux ultrasons ou au lithoclast. Différentes techniques d'accès sont décrites, incluant l'accès percutané robotique (système PAKY). La technique de dilatation par ballon est considérée comme la référence, avec des innovations comme la gaine Pathway Access Sheath permettant dilatation et positionnement simultanés. Des techniques alternatives comme l'abord transrénal rétrograde sont également mentionnées, indiquées pour les cas complexes ou les reins mal positionnés. La mini-néphrolithotomie percutanée (miniperc) avec des gaines de 11 à 12 Ch est présentée comme une option pour certains cas.
1. Technique de Base de la NLPC
La description de la technique de néphrolithotomie percutanée (NLPC) commence par la ponction rénale, le plus souvent réalisée sous contrôle échographique au niveau d'un calice inférieur. Cette étape est suivie de la dilatation du canal de travail grâce à des dilatateurs d'Alken, sous contrôle radioscopique. Un fibroscope peut être utilisé si nécessaire pour une meilleure visualisation. La fragmentation des calculs est ensuite effectuée par lithotritie endocorporelle, utilisant des ultrasons ou un lithoclast à énergie pneumatique ou laser. Cette description de la technique met en avant l'importance de l'imagerie (échographie et radioscopie) pour guider l'intervention et assurer la précision du geste. Les instruments utilisés, tels que les dilatateurs d'Alken et le néphroscope, sont mentionnés, soulignant l'importance du matériel pour le succès de la procédure. Enfin, l'étape de nettoyage et d'extraction des fragments lithiasiques est implicitement incluse, même si les détails spécifiques ne sont pas largement développés ici.
2. Innovations et Améliorations de la Technique
Le document explore plusieurs innovations et améliorations apportées à la technique de la NLPC. L'utilisation du ballon de dilatation est mise en avant comme méthode de référence pour la dilatation du canal d'accès, selon la deuxième consultation internationale sur la lithiase urinaire (Paris, 2007). Des progrès techniques, tels que la nouvelle gaine d'accès Pathway Access Sheath, qui combine dilatation et positionnement de la gaine en une seule étape, sont mentionnés. L'accès percutané robotique est également abordé avec le système PAKY de Su et al., démontrant une amélioration de l'efficacité et une réduction des complications dans une étude comparative avec l'accès manuel classique. Ces améliorations mettent en lumière la recherche continue d'optimisation de la technique pour améliorer les résultats et réduire les risques pour le patient. Le texte laisse entendre que d'autres techniques existent, avec l'introduction de l’abord transrénal rétrograde et de la mini-NLPC, mais ne les détaille pas plus avant dans cette section.
3. Approches Alternatives et Techniques Spécialisées
Au-delà des techniques de base, le document évoque plusieurs approches alternatives et techniques plus spécialisées pour la NLPC. L'abord transrénal rétrograde, une technique purement urologique décrite initialement par Lawson en 1983, permet de ponctionner le rein de l'intérieur vers l'extérieur via un cathétérisme rétrograde. Cette technique est particulièrement utile dans le traitement des lithiases complexes, des reins hypermobiles, mal rotés ou mal positionnés. Une autre approche mentionnée est la NLPC en position dorsale modifiée, permettant une meilleure visualisation du calice postérieur. La mini-néphrolithotomie percutanée (miniperc), décrite par Helal et al. en 1997, utilise un matériel de taille réduite (gaines de 11 à 12 Ch) et convient pour certains cas spécifiques. La discussion sur ces techniques alternatives souligne l'adaptabilité de la NLPC face à la diversité des cas cliniques et l'évolution constante des pratiques.
III.Complications de la NLPC et Gestion
Les complications de la NLPC incluent les hémorragies (0,8 à 17%), les infections (jusqu'à 35% de bactériurie), et les lésions des organes voisins (duodénum, plèvre). Les complications infectieuses sont les plus graves, justifiant une antibioprophylaxie. L'obstruction de la voie excrétrice supérieure est une autre complication possible, nécessitant une surveillance et un traitement adapté (dilatation, chirurgie). Le document souligne l'importance de facteurs liés au patient (diabète, obésité, vessie neurologique) sur le risque de complications. La gestion des complications implique des interventions variées selon la nature et la gravité, allant du traitement conservateur à la chirurgie réparatrice ou à la néphrectomie dans les cas extrêmes.
1. Complications Hémorragiques et Vasculaires
L'hémorragie est la complication la plus redoutée de la néphrolithotomie percutanée (NLPC), pouvant aller jusqu'à la perte du rein. Le risque d'hémorragie périopératoire est estimé entre 0,8% et 17%, selon la définition utilisée. Le taux global de transfusions sanguines est évalué à 7,9% dans une étude prospective de 301 cas, avec 2,3% d'hémorragies sévères nécessitant 18 embolisations. Les saignements peuvent provenir de différents vaisseaux, notamment les vaisseaux principaux du pédicule rénal ou la paroi pyélique en cas de ponction ou de dilatation transfixiante. La gestion de ces hémorragies implique des mesures immédiates comme l'arrêt de l'intervention et la mise en place d'une sonde de néphrostomie clampée. En cas de saignement important pendant la fragmentation endocavitaire, une interruption de la procédure et un clampage temporaire sont recommandés. Le texte souligne la possibilité de saignement veineux, nécessitant une gestion adaptée en fonction de son importance.
2. Complications Infectieuses
Les complications infectieuses constituent un risque majeur après une NLPC. Jusqu'à 35% des patients peuvent présenter une bactériurie postopératoire paucisymptomatique, qui peut évoluer vers une infection grave. Une antibioprophylaxie périopératoire est donc recommandée pour prévenir ce risque. Les germes les plus fréquemment impliqués sont Escherichia coli, les streptocoques et les staphylocoques. Environ 10% des patients peuvent développer une fièvre supérieure à 38,5°C, nécessitant une antibiothérapie spécifique. La mortalité liée à des infections sévères ou à des hémorragies graves est faible mais non nulle (0,05 à 0,1%). Une antibioprophylaxie plus précoce (au moins 10 jours avant l'intervention) est recommandée pour les patients diabétiques ou ceux souffrant de vessie neurologique, étant plus sujets aux infections, particulièrement celles liées à des germes uréasiques.
3. Autres Complications et Gestion Générale
Outre les complications hémorragiques et infectieuses, d'autres complications sont mentionnées. L'obstruction de la voie excrétrice supérieure, notamment une sténose pyélo-urétérale, est possible et nécessite une surveillance postopératoire (échographie, tomodensitométrie) avec un traitement adapté (dilatation ou chirurgie). Les lésions du duodénum sont plus rares, pouvant nécessiter un traitement conservateur (dérivation, antibiothérapie) ou chirurgical (suture, drainage). Les lésions pleurales, notamment les fistules néphro-pleurales, peuvent survenir et nécessitent un drainage thoracique, parfois complété par une néphrotomie percutanée. Le document souligne également l'influence de facteurs liés au patient (diabète, infection à germes uréasiques, vessie neurologique, obésité) sur le risque de complications. La gestion des complications est multifactorielle et dépend de la nature et de la gravité de la complication observée. Des interventions variées sont envisagées, du traitement conservateur à la chirurgie ouverte ou même à la néphrectomie dans certains cas extrêmes.
IV. Chirurgie Ouverte Comparaison des Résultats
Le document cite plusieurs études comparant la NLPC à la chirurgie ouverte pour le traitement de la lithiase rénale. Ces études montrent généralement des avantages pour la NLPC en termes de durée opératoire, durée d’hospitalisation, taux de complications (inférieur pour la NLPC), et récupération plus rapide. Le taux de succès ('stone free') est comparable entre les deux méthodes, bien que dépendant de la complexité du calcul. Les données spécifiques varient selon l'étude, mais le consensus favorise la NLPC comme technique moins invasive et plus efficace pour de nombreux cas de calculs rénaux.
1. Étude Comparative NLPC vs. Chirurgie Ouverte Résultats Globaux
Plusieurs études comparatives, dont celle de Elkappany HA (février 2005) sur 79 patients, et celle de Preminger, comparent la néphrolithotomie percutanée (NLPC) à la chirurgie ouverte pour le traitement des calculs rénaux. Ces études montrent systématiquement des résultats plus favorables à la NLPC. L'étude d'Elkappany HA a révélé une nette supériorité de la NLPC concernant la durée opératoire, la durée d'hospitalisation, le taux de complications (7% pour la NLPC contre 40% pour la chirurgie ouverte), et le taux de succès ('stone free'). De plus, certaines complications graves de la chirurgie ouverte (éventration, abcès de paroi) étaient absentes dans le groupe NLPC. L'étude de Preminger confirme ces conclusions, indiquant une différence significative en termes de taux de transfusion (2,4% pour la NLPC contre 22,2% pour la chirurgie ouverte), malgré une différence pré et postopératoire d'hémoglobine similaire entre les deux groupes. Ces résultats soulignent le caractère moins invasif et plus sûr de la NLPC comparée à la chirurgie ouverte.
2. Comparaison Spécifique sur les Calculs Coralliformes
L'étude mentionne également des comparaisons spécifiques concernant le traitement des calculs coralliformes. Constantinides (90) a analysé 61 patients traités par lithotritie extracorporelle (LEC) sur trois ans, notant un taux de succès de 44% pour les calculs coralliformes complets et de 85% pour les calculs coralliformes incomplets, avec l'ajout d'une sonde double J. Lam (91, 92) propose une nouvelle classification des calculs coralliformes basée sur l'analyse d'image assistée par ordinateur, permettant des comparaisons plus standardisées des résultats entre différentes institutions. Il compare ensuite les résultats de la NLPC à la LEC en monothérapie, utilisant cette nouvelle méthode de calcul de surface. Une étude de Carr et al. (1996) a révélé un taux de récidive significativement plus faible après une NLPC comparativement à la LEC, soulignant l'efficacité à long terme de la NLPC même dans des cas complexes de calculs coralliformes.
3. Avantages de la NLPC en termes de Récupération et de Reprise d Activité
En plus des bénéfices en termes de taux de complications et de succès, la NLPC présente des avantages significatifs pour la récupération postopératoire et la reprise d'activité. Une durée de convalescence d'une semaine est signalée pour la NLPC, contre trois semaines pour la chirurgie ouverte. La reprise d'une activité physique importante se fait en deux semaines pour les patients ayant subi une NLPC, contre neuf semaines pour ceux ayant subi une chirurgie ouverte. Ces différences significatives soulignent l'impact moins traumatisant de la NLPC sur le corps du patient. La discussion implique également que la moindre traumatologie de la paroi lors d'une NLPC entraîne une inflammation et une fibrose réduites, rendant toute intervention ultérieure plus facile, un facteur important à considérer pour la gestion des récidives ou des complications à long terme.
