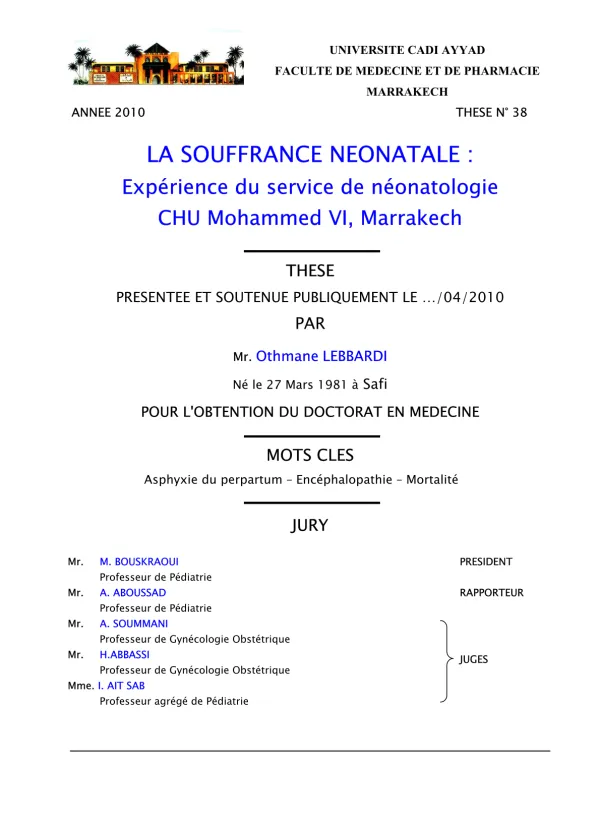
Thèse sur la Souffrance Néonatale au CHU Mohammed VI de Marrakech
Informations sur le document
| Auteur | Othmane Lebbardi |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 5.26 MB |
- Néonatologie
- Asphyxie
- Pédiatrie
Résumé
I.Mortalité et Asphyxie Périnatale Facteurs de Risque et Conséquences
Cette étude rétrospective, menée au CHU Mohammed VI de Marrakech entre 2006 et 2007 sur 280 dossiers de souffrance néonatale, explore les causes et conséquences de l'asphyxie périnatale. L'étude révèle une forte prévalence de l'hypertension artérielle gravidique (26,4%) comme principale étiologie de l'asphyxie, suivie des infections néonatales (18,6%) et de la prématurité (13,6%). Des facteurs de risque importants tels que le tabagisme maternel, la fumigation, et une mauvaise qualité du suivi prénatal (33% des cas sans suivi) sont également mis en évidence. Les conséquences incluent une morbidité néonatale significative, avec 18,2% des cas présentant une encéphalopathie néonatale (Grade III de Sarnat), 32,9% des cas avec des convulsions néonatales, et 17,5% présentant une néphropathie post-asphyxique. Le taux de mortalité périnatale était de 27,2%, soulignant la gravité de ces complications. L'étude souligne l'importance de la prévention de l'hypoxie fœtale pour réduire la mortalité et les risques de handicaps neurologiques.
1. Définition et Incidence de la Mortalité Périnatale
La section commence par définir la mortalité périnatale selon les recommandations de l'OMS, incluant les fœtus de plus de 22 semaines d'aménorrhée (SA) et les nouveau-nés jusqu'à 7 jours de vie. Elle souligne malheureusement le contexte de la pratique obstétricale dans le pays étudié, caractérisé par l'absence de suivi prénatal pour une grande partie des parturientes. Ceci entraine une identification tardive des grossesses à risque, des comportements à risque non détectés, et le recours à des moyens diagnostiques limités (souvent seulement le stéthoscope de Pinard). L'absence de suivi prénatal est directement liée à l'augmentation des risques de mortalité périnatale. La section met en lumière les lacunes importantes du système de santé et leur impact direct sur les taux de mortalité périnatale et les complications néonatales associées.
2. Encéphalopathie Néonatale et Asphyxie Intrapartum
La section aborde ensuite l'encéphalopathie néonatale (EN), définie comme un syndrome clinique de dysfonctionnement neurologique se manifestant dans les premiers jours de vie du nouveau-né à terme. Les symptômes incluent des difficultés respiratoires, des anomalies du tonus et des réflexes, des troubles de conscience et souvent des convulsions. La distinction entre EN et l'encéphalopathie hypoxique-ischémique (EHI) est discutée, l'EHI étant diagnostiquée uniquement en cas de certitude d'une asphyxie intrapartum. L'utilisation synonymique de ces deux termes dans la littérature est soulignée comme une source de confusion. La section mentionne ensuite l'établissement de critères diagnostiques consensuels de l'asphyxie intrapartum, basés sur les critères de l'International Cerebral Palsy Task Force, récemment revisités par l'American College of Obstetricians and Gynecologists et l'American Academy of Pediatrics (ACOG-AAP 2003). Ces critères intègrent des aspects biologiques et cliniques indissociables pour un diagnostic précis.
3. Facteurs Modifiant l Oxygénation Fœtale
Plusieurs facteurs influençant le débit utéro-placentaire et l'oxygénation fœtale sont examinés. L'impact des contractions utérines (CU) est décrit : des anomalies de la CU diminuant le temps de relâchement compromettent la reconstitution de la réserve d'oxygène. Le tabagisme maternel est analysé en détail, mettant en lumière l'effet de la nicotine sur l'augmentation du rythme cardiaque fœtal par vasoconstriction et diminution de la perfusion utérine. L’impact du monoxyde de carbone, présent dans la fumée de cigarette, créant une hypoxie relative et chronique est également abordé. Une corrélation entre l'érythropoïétine fœtale et la nicotine est mentionnée, ainsi qu'un base excess significativement plus important chez les fumeuses. La fumigation, pratique courante dans le pays, est également identifiée comme un facteur d’hypoxie maternelle et fœtale, due à l'inhalation de monoxyde de carbone dans un espace confiné. L'étude met en perspective ces différents facteurs de risque et leur impact sur l'oxygénation fœtale.
4. Conséquences de l Asphyxie Périnatale sur Différents Organes
Les conséquences de l'asphyxie périnatale sur différents organes sont détaillées. Sur le plan cardiaque, le débit cardiaque se maintient initialement mais une anoxie prolongée épuise les réserves myocardiques, conduisant à une baisse de la fréquence et du débit cardiaque. Concernant les reins, la néphropathie post-asphyxique est mentionnée comme la manifestation extra-neurologique la plus fréquente, traduisant la sévérité de l'asphyxie et influençant le pronostic neurologique à long terme. Au niveau pulmonaire, l'hypoxie provoque des mouvements respiratoires anormaux et favorise l'inhalation de liquide amniotique, notamment méconial, augmentant le risque de maladie des membranes hyalines, particulièrement chez les prématurés. L’étude cite des données de l’OMS sur l’impact considérable de l’asphyxie à la naissance: entre 4 et 9 millions de nouveau-nés touchés chaque année, avec 1,2 million de décès et autant de séquelles neurologiques. La section met en avant la complexité et la gravité des conséquences de l'asphyxie sur la santé du nouveau-né.
5. Mortalité Périnatale Hypertension Artérielle Gravidique et Complications
Cette partie explore le lien entre la mortalité périnatale et l'hypertension artérielle gravidique (HTA). Elle mentionne l'objectif du Millénaire pour le développement de réduire la mortalité infantile de deux tiers d'ici 2015, et les données de l'OMS montrant le nombre élevé de décès néonatals. La mauvaise qualité du suivi prénatal, le dépistage tardif de l’HTA et l’absence de prise en charge adéquate expliquent les taux élevés d'HTA et de mortalité périnatale. L'HTA est identifiée comme la troisième cause de mortalité maternelle et la première cause de mortalité périnatale dans plusieurs pays en développement. Le lien entre l'HTA gravidique et l'encéphalopathie néonatale est souligné, ainsi que la fréquence du liquide amniotique méconial (LAM) en rapport avec l'asphyxie périnatale. La section précise que la présence de LAM ne signifie pas obligatoirement une asphyxie périnatale, même si elle augmente le risque statistiquement. Des données sur le taux de césariennes et la relation entre l'asphyxie périnatale et la délivrance instrumentale sont fournies. Enfin, des facteurs de risques supplémentaires, comme le retard de croissance intra-utérin (RCIU), la fragilité des nouveau-nés hypotrophes, et l’importance du portage génital bactérien sont mentionnés.
6. Convulsions Néonatales Lésions Rénales et Infections
La section détaille les convulsions néonatales, fréquentes dans le premier mois de vie et principalement liées à l'EHI, aux accidents vasculaires, ou aux infections. Les états de mal convulsifs sont présentés comme un signe de gravité. Les lésions rénales (IR) sont abordées, avec la mention de leur réversibilité chez les survivants et l'absence de définition consensuelle de l'insuffisance rénale. Les difficultés d'interprétation des dosages de créatininémie en fonction de l'âge et du poids sont soulignées. La prévention des infections nosocomiales est mise en avant, avec la recommandation d'une meilleure application des mesures de prévention dans les salles d'accouchement et de réanimation néonatale, ainsi que la systématisation des prélèvements bactériologiques avant antibiothérapie. L'étude mentionne également le rôle de la procalcitonine comme marqueur innovant d'infection néonatale. La section met en lumière la complexité de la gestion des complications néonatales et l'importance des mesures préventives et diagnostiques appropriées.
7. Étude Rétrospective au CHU Mohammed VI de Marrakech
Cette section présente les résultats d'une étude rétrospective de 280 dossiers de souffrance néonatale au CHU Mohammed VI de Marrakech entre 2006 et 2007. Des données démographiques sur les parturientes (âge, primiparité) et les grossesses (suivi prénatal, type de grossesse, présentation fœtale, liquide amniotique) sont fournies. Les caractéristiques à la naissance des nouveau-nés (terme, poids de naissance) sont précisées, de même que les taux d'encéphalopathie néonatale sévère (Grade III de Sarnat), de convulsions néonatales, et de néphropathie post-asphyxique. L'hypertension artérielle gravidique est identifiée comme la première étiologie, suivie des infections néonatales et de la prématurité. Le taux de survie à court terme (72,7%) et de mortalité (27,2%) est mentionné. L'étude conclut sur l'importance de la prévention de l'hypoxie fœtale pour diminuer la mortalité néonatale et le risque de handicaps neurologiques. Les données spécifiques au CHU Mohammed VI de Marrakech, comme le taux de césariennes (43,2%), sont des éléments importants de l'analyse.
II.Mécanismes Physiopathologiques de l Hypoxie Fœtale
L'étude détaille les mécanismes physiopathologiques de l'hypoxie fœtale, incluant l'impact des contractions utérines anormales, du tabagisme maternel (vasoconstriction, augmentation de la carboxyhémoglobine), et de la fumigation (inhalation de monoxyde de carbone). L'hypoxie entraine une acidose métabolique et des conséquences sur plusieurs organes: le cerveau (lésions cellulaires, encéphalopathie néonatale), le cœur (modification du débit cardiaque), les reins (néphropathie post-asphyxique), et les poumons (maladie des membranes hyalines). La mesure des lactates au niveau du scalp et au cordon ombilical (valeurs pathologiques supérieures à 5 mmol/l et 6 mmol/l respectivement) est présentée comme un marqueur biologique important de l'asphyxie. La variabilité du rythme cardiaque fœtal (RCF) est également analysée comme indicateur de l'intégrité fœtale.
1. Contractions Utérines et Oxygénation Fœtale
La section explique comment les contractions utérines (CU) affectent temporairement la circulation utéro-placentaire, réduisant le flux sanguin pendant 10 à 20 secondes. Cette interruption n'altère pas significativement la captation d'oxygène par le fœtus grâce à une réserve d'oxygène dans la chambre intervilleuse, qui se renouvelle lors du relâchement interphasique. Cependant, des anomalies des CU, réduisant ce temps de relâchement, compromettent la reconstitution de cette réserve d'oxygène, créant un risque d'hypoxie fœtale. Le texte souligne l'importance d'un bon fonctionnement de la dynamique utérine pour une oxygénation fœtale adéquate. Une durée insuffisante de relâchement entre les contractions peut mener à une diminution significative de l'apport en oxygène au fœtus, accentuant ainsi le risque d'hypoxie.
2. Physiopathologie de l Hypoxie Fœtale liée au Tabagisme Maternel
Cette partie explore la physiopathologie de l'hypoxie fœtale chez les femmes enceintes fumeuses. La nicotine est principalement incriminée pour l'augmentation du rythme cardiaque fœtal, causant une vasoconstriction et diminuant la perfusion utérine du côté maternel et fœtal. Le mécanisme exact reste débattu, certains auteurs suggérant une origine maternelle des catécholamines, d'autres une stimulation du système neuro-endocrinien fœtal par la nicotine qui traverse la barrière placentaire. L'association avec le monoxyde de carbone, qui se fixe sur l'hémoglobine fœtale et maternelle, est mise en avant comme un facteur important d'hypoxie fœtale chronique. Le monoxyde de carbone traverse rapidement le placenta, diminuant la capacité du sang à transporter l'oxygène, ce qui amplifie l'hypoxie tissulaire. Des études mentionnées montrent une corrélation entre l'érythropoïétine fœtale et la nicotine, avec un base excess plus important chez les fumeuses, sans toutefois prouver une acidose fœtale systématique. La nicotine et les catécholamines ont une demi-vie courte contrairement à la carboxyhémoglobine fœtale.
3. Hypoxie Fœtale liée à la Fumigation
La fumigation, pratiquée avec de l'encens ou d'autres herbes, est présentée comme une cause possible d'hypoxie maternelle et fœtale. L'inhalation de monoxyde de carbone dégagé par la fumée, particulièrement dans les espaces confinés, est pointée du doigt. La vasoconstriction périphérique résultante redirige le flux sanguin vers les organes vitaux (cerveau, cœur), mais pénalise les autres organes. Le métabolisme énergétique du fœtus bascule vers la voie anaérobie, moins efficace, produisant moins d'ATP et de l'acide lactique. L'hypoxie perturbe le transfert placentaire du glucose, aggravant la situation. Le processus d'autorégulation, mettant en jeu des facteurs vasoactifs comme les ions H+, Ca++, l'adénosine, les prostaglandines et l'osmolarité, est décrit. Certaines régions cérébrales, comme le tronc cérébral, sont plus sensibles à l'hypoxie que d'autres, notamment celles à l'interface des artères cérébrales moyennes et antérieures. Le texte précise également que le cerveau fœtal, malgré une consommation d'oxygène plus élevée, présente une meilleure résistance à l'hypoxie grâce à des mécanismes spécifiques.
4. Conséquences Cellulaires de l Hypoxie et Sensibilité Organique
L'hypoxie entraine des lésions cellulaires en deux phases: une première phase de dépression du métabolisme énergétique cérébral, suivie d'une mort neuronale retardée liée à une cascade métabolique excitotoxique. Les régions cérébrales les plus sensibles à l'anoxie sont les régions cortico-sous-corticales (en particulier les régions rolandiques), les noyaux gris centraux, et le tronc cérébral. Une atteinte bilatérale des noyaux gris centraux conduit presque systématiquement à des séquelles lourdes. L'atteinte des régions cortico-sous-corticales est souvent asymétrique. Sur le plan cardiaque, l'hypoxie entraine une redistribution du débit cardiaque, initially maintaint au niveau cérébral et myocardique mais diminué ailleurs. Si l'anoxie persiste, les réserves myocardiques s'épuisent et l'acidose lactique altère la fonction myocardique. Au niveau rénal, l'hypoperfusion peut causer une insuffisance rénale prérénal, généralement réversible avec une perfusion normale. Enfin, l'hypoxie peut entrainer des difficultés respiratoires, une inhalation de liquide amniotique, et une perturbation de la formation du surfactant pulmonaire, avec un risque accru de maladie des membranes hyalines, surtout chez les prématurés. Le texte détaille les mécanismes physiopathologiques qui mènent à des lésions organiques irréversibles dans les cas les plus graves.
III.Diagnostic et Prise en Charge de la Souffrance Fœtale
Le diagnostic de la souffrance fœtale repose sur la surveillance du RCF, la présence de liquide amniotique méconial, et la mesure des lactates. Des examens complémentaires comme l’échographie néonatale et l’électroencéphalographie (EEG néonatal) sont utilisés pour évaluer l'étendue des lésions. La prise en charge néonatale inclut la réanimation néonatale en salle de naissance (désobstruction des voies aériennes, ventilation assistée, massage cardiaque si nécessaire), l’aspiration des sécrétions méconiales, et dans certains cas, l’hypothermie thérapeutique. L'étude note une prédominance de l'accouchement par césarienne (43,2%) dans la cohorte étudiée au CHU Mohammed VI de Marrakech. La prévention des infections (infections néonatales) via des mesures d'hygiène rigoureuses est également mise en avant.
1. Surveillance et indicateurs de la souffrance fœtale
Le diagnostic de la souffrance fœtale repose sur plusieurs éléments de surveillance. La mesure de la variabilité du rythme cardiaque fœtal (RCF) est primordiale, une variabilité réduite ou absente étant un signe d'alerte. La présence de liquide amniotique méconial est un autre indicateur important, signalant une hypoxie fœtale. L'analyse de la variabilité du RCF permet d’évaluer l'intégrité fœtale. Une variabilité normale se situe entre 6 et 25 bpm, tandis qu'une variabilité absente, inférieure à 2 bpm, est un signe de gravité. La mesure des lactates au niveau du cuir chevelu (scalp) est également abordée. Un taux supérieur à 5 mmol/L est considéré comme pathologique et cette méthode est présentée comme une alternative au pH au scalp, nécessitant moins de sang et pouvant être réalisée plus tôt en travail. L’apparition du méconium in utéro est un reflexe à l’hypoxie, son apparition précoce est un signe d’alerte. Ces différents paramètres permettent une surveillance continue de l’état du fœtus pendant le travail.
2. Marquers Biologiques et Imagerie
L'analyse de la lactacidémie, c'est-à-dire le taux d'acide lactique, est un marqueur biologique important de l'hypoxie. Un taux supérieur à 6 mmol/L au niveau du cordon ombilical est considéré comme pathologique et corrélé à une acidose métabolique. Cependant, le document précise que la lactacidémie n'est pas un marqueur très spécifique de l'asphyxie, même si une valeur supérieure à 7,5 mmol/L est associée à un risque élevé d'encéphalopathie selon certaines études. La cinétique de décroissance du lactate est également importante, une normalisation tardive (plus de 10 heures) étant corrélée à une plus grande gravité. L'échographie néonatale est souvent le premier examen d'imagerie réalisé. Elle permet de détecter des pathologies hémorragiques, mais sa contribution au pronostic est limitée, et son interprétation dépend de l'opérateur. L’électroencéphalographie (EEG) néonatale est aussi un examen important pour l’évaluation de la souffrance fœtale. Un tracé gravement altéré est associé à un pronostic défavorable (décès ou handicap majeur), tandis qu'un tracé normal ou une récupération rapide (entre J3 et J7) permettent d’établir un pronostic favorable.
3. Réanimation Néonatale et Prise en Charge Immédiate
La section détaille les mesures de réanimation néonatale en salle de naissance. En cas de détresse respiratoire, une désobstruction rhinopharyngée douce est effectuée avant toute autre intervention. L'aspiration gastrique est différée pour éviter le réflexe vagal et une possible bradycardie. Pour les nouveau-nés à terme en situation d'asphyxie périnatale, une pression positive d'ouverture des alvéoles importante est parfois nécessaire pour une expansion alvéolaire correcte et une ventilation spontanée autonome. Le massage cardiaque externe est une intervention exceptionnelle, réservé aux cas de bradycardie profonde malgré une ventilation correcte. L'aspiration oropharyngée est systématique à la naissance, et une laryngoscopie directe est nécessaire en cas de détresse respiratoire ou de sécrétions méconiales. L'inhalation de méconium est un risque important, pouvant avoir des conséquences sévères. L'amnio-infusion est mentionnée, bien que son utilité reste débattue. Enfin, l’hypothermie thérapeutique, par refroidissement total ou céphalique, est une technique utilisée, avec une mention de ses effets secondaires possibles (modifications de l’élimination de certains médicaments).
IV.Séquelles Neurologiques à Long Terme
Les séquelles neurologiques à long terme de l'asphyxie périnatale incluent la paralysie cérébrale, qui est souvent utilisée comme marqueur principal de ces conséquences. L’étude souligne cependant que les séquelles ne se limitent pas à la paralysie cérébrale, et peuvent inclure d'autres handicaps neurologiques. Le lien entre asphyxie intrapartum et paralysie cérébrale est complexe et ne représente qu’une partie des cas (moins de 10%). L'étude conclut qu'une prévention efficace de l'hypoxie fœtale est essentielle pour réduire la mortalité néonatale et le risque de handicaps neurologiques à long terme. Une grande majorité (72.7%) des nouveau-nés ont eu une bonne évolution à court terme.
1. Paralysie Cérébrale et Séquelles Neurologiques
La section introduit la paralysie cérébrale comme marqueur principal des séquelles neurologiques à long terme de l'asphyxie périnatale, reconnaissant que ce n'est qu'un aspect parmi d'autres. Elle souligne la relative facilité de recensement de la paralysie cérébrale comparée à d'autres handicaps neurologiques (déficience mentale, surdité...). L'origine périnatale de la paralysie cérébrale est plus fréquente que pour d'autres types de handicaps neurosensoriels. L'incidence de la paralysie cérébrale est restée relativement stable malgré les changements dans les pratiques obstétricales. Les régions cérébrales les plus vulnérables à l'anoxie sont les noyaux gris centraux, le cortex et la substance blanche sous-corticale, ainsi que le tronc cérébral. Les séquelles neurologiques peuvent se présenter sous divers tableaux cliniques, souvent corrélés à la topographie des lésions. L'étude souligne la différence entre l'encéphalopathie néonatale, souvent attribuable à une asphyxie intrapartum, et la paralysie cérébrale, dont le lien avec une asphyxie aiguë est moins fréquent (moins de 10% des cas).
2. Différence entre Encéphalopathie Néonatale et Paralysie Cérébrale
Le texte précise que, contrairement aux encéphalopathies néonatales fréquemment liées à une asphyxie intrapartum (30 à 50%), la paralysie cérébrale n'est associée à cet événement aigu que dans moins de 10% des cas. Pour les enfants nés à terme, le pourcentage attribuable à une asphyxie serait plus élevé (20 à 28%), mais en appliquant des critères stricts (International Cerebral Palsy Task Force ou ACOG-AAP), ce lien est documenté dans moins de 5% des cas pour les enfants à terme et presque jamais pour les prématurés. Ceci met en perspective la complexité des causes de la paralysie cérébrale et souligne la difficulté d'établir un lien direct de causalité avec l'asphyxie intrapartum dans tous les cas. L'origine anténatale des paralysies cérébrales est également mentionnée comme étant prédominante. Les types cliniques de paralysie cérébrale et leurs liens avec les lésions cérébrales sont également expliqués.
3. Types de Paralysie Cérébrale et Conséquences à Long Terme
La section décrit différents types de paralysie cérébrale liés à une asphyxie à terme : l'infirmité motrice cérébrale (IMC), l'infirmité motrice d'origine cérébrale (IMOC), et le polyhandicap. L'atteinte motrice dans le cas d'une paralysie cérébrale suite à une asphyxie à terme est souvent liée à des lésions des noyaux gris centraux et de la capsule interne. D'autres types de lésions, comme l'encéphalomalacie kystique cortico-sous-corticale, peuvent aussi être observés, conduisant souvent à un polyhandicap. Les lésions des noyaux gris centraux sont souvent sévères (quadriplégie, atteinte de la motricité buccofaciale, dystonie-dyskinésie). Ce type de paralysie cérébrale est assez caractéristique d'une origine post-asphyxique. L'étude cite Himmelmann et al. qui retrouvent une anamnèse d'encéphalopathie néonatale post-asphyxique chez 71% des enfants à terme ayant une paralysie cérébrale dyskinétique. Enfin le texte souligne les défis que pose la gestion des séquelles neurologiques à long terme, l’importance de la prévention et la nécessité d’améliorer les conditions de travail des services de pédiatrie.
