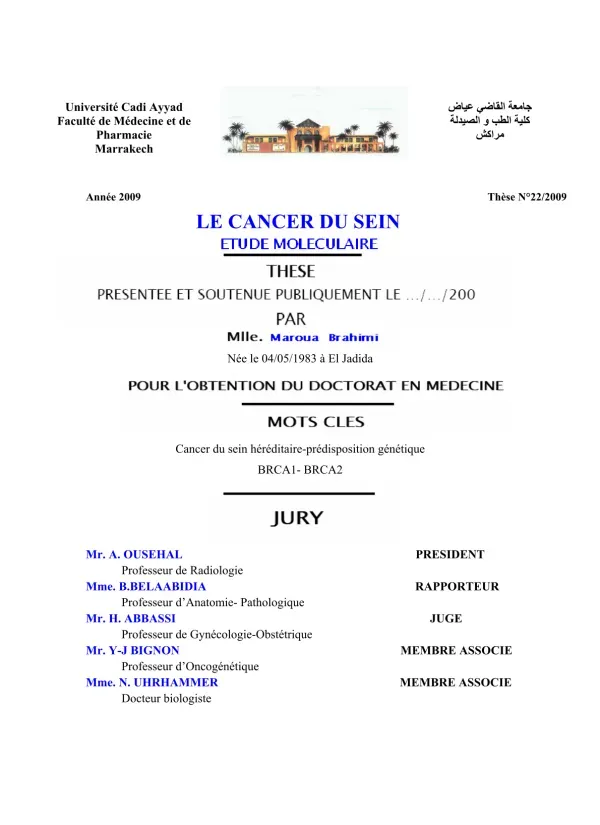
Thèse sur le Cancer du Sein et la Prédisposition Génétique
Informations sur le document
| Auteur | A. Ousehal |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 3.05 MB |
- cancer du sein
- prédisposition génétique
- formation médicale
Résumé
I.Facteurs de Risque du Cancer du Sein
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme, aussi bien au Maroc qu'à l'échelle mondiale. 5 à 10% des cas sont liés à une composante héréditaire, souvent impliquant des mutations des gènes BRCA1 ou BRCA2. Une histoire familiale de cancer du sein et/ou de l'ovaire augmente considérablement le risque. Cependant, le cancer du sein est multifactoriel, avec des facteurs hormonaux et environnementaux influençant la pénétrance de ces mutations génétiques. L'âge joue un rôle crucial: l'incidence augmente avec l'âge, avec un pic entre 50 et 70 ans, mais les cancers diagnostiqués avant 50 ans représentent 15 à 20% des cas, souvent associés à des mutations BRCA1 ou BRCA2. Des études au Maghreb montrent une survenue plus précoce du cancer du sein comparée à l'Europe et l'Amérique du Nord, potentiellement due à des facteurs hormonaux, alimentaires et environnementaux différents. L'hyperœstrogénie, favorisée par une puberté précoce, une ménopause tardive, la nulliparité ou une grossesse tardive, double le risque. L'allaitement prolongé et le nombre d'enfants semblent avoir un effet protecteur. La contraception orale ne semble pas augmenter le risque, contrairement au traitement hormonal substitutif (THS) après la ménopause.
1. Prédisposition Génétique au Cancer du Sein
Le texte souligne l'importance de la composante génétique dans le développement du cancer du sein. Il est spécifié que 5 à 10% des cancers du sein sont dus à une composante héréditaire à transmission autosomique dominante. Une proportion significative des cancers du sein survenant chez des femmes jeunes (moins de 35 ans), estimée entre 60 et 75%, est attribuée à des mutations des gènes BRCA1 ou BRCA2. Une histoire familiale de cancer du sein et/ou d'ovaire accroît la probabilité de la présence d'une mutation génétique. Cependant, il est crucial de noter que le cancer du sein est un cancer multifactoriel, ce qui signifie que des facteurs environnementaux et hormonaux interagissent avec la prédisposition génétique pour influencer le développement de la maladie. L'étude mentionne également le rôle du Breast Cancer Linkage Consortium (BCLC) qui a étudié 237 familles et a trouvé que 52% des cas étaient liés à BRCA1, 32% à BRCA2 et 16% à d'autres gènes. Pour les familles avec cancers du sein et de l'ovaire, 80% sont liés à BRCA1 et 15% à BRCA2.
2. Facteurs Hormonaux et l Âge
L'âge est un facteur de risque majeur, l'incidence du cancer du sein augmentant significativement avec l'âge, le pic de fréquence se situant entre 50 et 70 ans (OMS 1990), avec une moyenne d'apparition à 61 ans. Néanmoins, 15 à 20% des cancers sont diagnostiqués avant 50 ans, et c'est dans cette catégorie d'âge que la fréquence des mutations BRCA1 ou BRCA2 est la plus élevée. Une étude mentionnée dans le document indique un âge moyen de 42,5 ans pour les patientes, cohérent avec la littérature. L’hyperœstrogénie est identifiée comme un facteur aggravant. Ce déséquilibre hormonal est favorisé par une puberté précoce (moins de 12 ans), une ménopause tardive (plus de 55 ans), l'absence de grossesse (nulliparité) ou une première grossesse tardive. L'exposition prolongée aux œstrogènes double le risque de cancer du sein. Il est intéressant de noter que l'allaitement pendant un an au minimum semble réduire significativement le risque chez les femmes porteuses de mutations BRCA1, et que le nombre d'enfants, notamment une grossesse précoce, offre une protection significative (RR de 0.75 à 0.25).
3. Contraception THS et Autres Facteurs de Risque
L'étude aborde le rôle de la contraception et du traitement hormonal substitutif (THS) dans le risque de cancer du sein. Concernant la contraception orale, le document indique qu'il ne semble pas y avoir d'augmentation significative du risque. En revanche, le THS est associé à une augmentation significative du risque, même si les résultats d'études divergent selon les pays (États-Unis vs. France). Trois études sont mentionnées : la CR (augmentation du risque après 5 ans d'utilisation), la MWS (pas d'augmentation un an après l'arrêt), et la WHI (risque relatif de 1,26). La ligature des trompes pourrait réduire le risque de cancer de l'ovaire chez les porteuses de BRCA1, mais pas de BRCA2. D'autres facteurs de risque sont évoqués, notamment l'histoire familiale de cancer du sein (un déterminant majeur dont le risque augmente avec le nombre de personnes atteintes dans la famille et la proximité du lien de parenté), le contexte socioculturel (pudeur, peur du cancer), ainsi que le manque d'éducation sanitaire. L'étude souligne des différences significatives dans l'incidence et les caractéristiques tumorales entre le Maghreb et l'Europe, suggérant un rôle des facteurs hormonaux, nutritionnels et de l'activité physique.
II.Génétique du Cancer du Sein Héréditaire
L'étude génétique du cancer du sein héréditaire se concentre principalement sur les gènes BRCA1 et BRCA2. BRCA1, un gène suppresseur de tumeur, joue un rôle crucial dans la réparation de l'ADN et la régulation de la transcription. Des mutations dans BRCA1 peuvent conduire à une accumulation d'altérations génétiques, favorisant le développement tumoral. Les mutations de BRCA1 et BRCA2 peuvent être ponctuelles ou impliquer de grands réarrangements génomiques, souvent indétectables par les techniques de criblage standard. D'autres gènes, bien que contribuant moins fréquemment, sont également impliqués dans la prédisposition au cancer du sein héréditaire, notamment P53, PTEN, et ATM. L'identification de la mutation initiale et l'étude des haplotypes permettent d'apprécier l'origine commune de la mutation dans une famille et de potentiels effets fondateurs, particulièrement dans des populations isolées comme la population Ashkénaze. Le Breast Cancer Linkage Consortium (BCLC) a estimé la contribution de BRCA1 et BRCA2 dans les familles à risque de cancer du sein, révélant une forte implication de BRCA1 dans les familles avec cancers du sein et de l'ovaire.
1. Rôle des Gènes BRCA1 et BRCA2
L'étude met en lumière le rôle central des gènes BRCA1 et BRCA2 dans le cancer du sein héréditaire. BRCA1 est décrit comme un gène suppresseur de tumeur essentiel à la réparation de l'ADN et à la régulation de la transcription. Le texte explique que BRCA1 agit comme un coordinateur des réponses cellulaires face aux lésions de l'ADN. Des mutations dans ce gène peuvent mener à une accumulation d'altérations génétiques, augmentant le risque de cancer. BRCA1 possède un domaine riche en résidus aminés chargés négativement, impliqué dans l'activation de la transcription, ainsi qu'un deuxième domaine d'activation (AD1) récemment identifié. De plus, BRCA1 interagit avec des complexes remodelant la chromatine et des régulateurs d'acétylation/désacétylation des histones, facilitant l'accès de l'ADN aux complexes de transcription et de réparation. Une interaction entre BRCA1 et l'acétyl-CoA carboxylase α, impliquée dans le métabolisme des lipides, est également évoquée, soulignant le lien potentiel entre facteurs nutritionnels et risque de cancer du sein. Le document note aussi que les mutations de BRCA1 peuvent être ponctuelles ou impliquer de grands réarrangements génomiques, souvent passant inaperçus avec les techniques de criblage standard. Concernant BRCA2, le texte mentionne deux délétions de grande taille identifiées, impliquant les exons 3, 12 et 13, et conduisant à un codon stop prématuré. Une étude du Breast Cancer Linkage Consortium (BCLC) a montré que pour 52% des familles étudiées (avec au moins 4 cas de cancers du sein), la maladie était liée à BRCA1, 32% à BRCA2, et 16% à d'autres gènes. La forte implication de BRCA1 est particulièrement marquée dans les familles avec cancers du sein et de l'ovaire (80% des cas).
2. Autres Gènes et Syndromes Associés
Au-delà de BRCA1 et BRCA2, le texte mentionne l'implication d'autres gènes dans la prédisposition au cancer du sein héréditaire, bien que leur contribution reste plus faible. Le syndrome de Li-Fraumeni, lié à des mutations germinales de P53, est évoqué, associant un risque accru de sarcomes, tumeurs cérébrales, cortico-surrénalomes et cancers du sein. La maladie de Cowden, associée à des mutations du gène PTEN, se caractérise par des lésions hyperplasiques et tumorales touchant plusieurs organes, dont le sein. L'augmentation du risque de cancer du sein chez les porteurs de mutations hétérozygotes du gène ATM, dans le cadre de l'ataxie télangiectasie, est également mentionnée. L'étude souligne cependant que même en considérant tous ces gènes connus, une partie significative des cas familiaux de cancer du sein restent inexpliqués (16% à 28% des familles ne sont pas liés génétiquement à BRCA1 ou BRCA2). L'existence d'autres gènes à haut risque, similaires à BRCA1/2 (BRCA3, BRCA4, etc.), est suggérée, mais leur identification est complexe en raison de l'hétérogénéité des familles étudiées. Deux locus supplémentaires ont été étudiés (chromosome 8 et 13 près de BRCA2), mais leurs résultats restent incertains ou réfutés. Des mutations spécifiques de ATM et CHK2 ont été retrouvées dans quelques familles à cas multiples. L'analyse de ségrégation ne permet pas d'exclure un modèle récessif pour BRCA3. La difficulté d'identifier les gènes impliqués est mise en évidence par la diversité des mutations et leur dispersion sur de grands gènes, sauf dans le cas d’effet fondateur observable plus facilement dans des populations isolées ou des groupes ethniques restreints.
3. Techniques de Détection des Mutations
La détection des mutations génétiques liées au cancer du sein héréditaire est abordée, soulignant les limites des techniques de criblage standard (SSCP, hétéroduplex, séquençage direct). Basées sur la PCR, ces techniques détectent principalement les mutations ponctuelles, laissant passer inaperçues les grandes délétions ou insertions. Le document explique que ces altérations génomiques de grande taille sont rapportées dans d'autres désordres génétiques (gène VHL, APC, MLH1, MLH2, NF1, NF2, FANC-A, récepteur des LDL). À ce jour, une vingtaine de réarrangements génomiques de BRCA1 ont été identifiés, majoritairement de grandes délétions (0,5 à 17 kb) résultant de recombinaisons entre séquences introniques Alu homologues. Ces altérations conduisent souvent à un décalage du cadre de lecture et l'apparition d'un codon stop prématuré. Une délétion de 161 kb délétant presque tout le gène BRCA1 a été rapportée, similaire à des altérations décrites pour d'autres gènes suppresseurs de tumeur (RB1, NF1). Pour BRCA2, l'étude des grands réarrangements est moins systématique, mais deux délétions de grande taille ont été signalées. Les techniques de Southern blot, initialement utilisées, sont considérées comme fastidieuses et sujettes à artéfacts. Le progrès de la biologie moléculaire a permis le développement de techniques plus performantes telles que la PCR multiplex et la PCR quantitative en temps réel pour quantifier les allèles et détecter les réarrangements.
III.Diagnostic du Cancer du Sein Imagerie et Biopsie
Le diagnostic du cancer du sein repose sur un ensemble d'examens. La mammographie est essentielle pour la détection des microcalcifications, bien que les cancers associés à BRCA1 et BRCA2 puissent présenter des aspects mammographiques trompeurs. L’échographie mammaire, plus sensible dans les seins denses, complète la mammographie, mais sa performance dépend de l'opérateur. L’IRM mammaire offre une meilleure sensibilité que la mammographie mais présente un taux plus élevé de faux positifs. La cytologie par ponction, une procédure peu invasive, est utilisée pour le diagnostic de malignité, avec une spécificité supérieure à 95%. L'exérèse du ganglion sentinelle (GS) est une alternative au curage axillaire complet pour le stade ganglionnaire.
1. Mammographie
La mammographie est présentée comme la technique d'exploration principale pour la détection des foyers de microcalcifications et leur ciblage biopsique. Cependant, le texte souligne que l'apparence des cancers liés aux mutations BRCA1 et BRCA2 peut être trompeuse à la mammographie, se présentant parfois avec des contours réguliers sans spiculation, ressemblant à des fibroadénomes dans 30% des cas selon certaines études (Hamilton et al., Kuhl et al.). Pour certains auteurs, les lésions de carcinome in situ (CIS) seraient rarement associées aux lésions invasives dans le cas de BRCA1. Dans l'étude mentionnée, 92,2% des mammographies étaient suspectes, l'opacité stellaire étant l'anomalie la plus fréquente (44,7%). Il est cependant reconnu que le diagnostic mammographique isolé n'est pas toujours exact, avec une marge d'erreur estimée entre 10 et 15% selon la littérature.
2. Échographie Mammaire
L'échographie mammaire est discutée, mentionnant les progrès technologiques (sondes multifréquences haute fréquence 10-17 MHz) qui améliorent le contraste et la résolution. Cependant, la sensibilité de l'échographie est relativement faible (33% à 40%), avec une spécificité de 96% à 90%. Cette faible performance est partiellement attribuée à la méthodologie des études citées (utilisation de sondes de 7,5 MHz ou 13 MHz sans différenciation des résultats). Des études prospectives montrent l'intérêt de l'échographie pour les seins denses. Une étude sur 4897 patientes asymptomatiques avec des seins denses a révélé une détection du cancer par échographie seule dans 37% des cas. Une autre étude sur 1500 femmes asymptomatiques à risque (antécédents familiaux ou personnels) a montré que l'échographie détectait cinq fois plus de cancers que dans la population non à risque. L'expression échographique typique d'un cancer du sein est décrite comme une lésion solide, hypoéchogène, hétérogène, à contours irréguliers et à grand axe vertical. L'échographie dépend de l'opérateur, ne visualise pas les microcalcifications isolées et a une spécificité médiocre dans les seins adipeux, mais elle permet des ponctions écho-guidées.
3. IRM Mammaire et Cytologie
L'IRM est présentée comme supérieure à la mammographie en termes de détection, avec une sensibilité de 70 à 95% contre 30 à 40% pour la mammographie seule. Cependant, l'aspect IRM peut être trompeur, avec des apparences bénignes possibles. Une étude mentionne deux cancers de l'intervalle diagnostiqués cliniquement après des examens IRM ayant initialement décrit des formations bénignes. L'IRM génère plus de faux positifs et de biopsies inutiles que la mammographie. Concernant la taille des tumeurs, l'IRM est plus performante pour la détection des cancers inférieurs à 10 mm et sans envahissement ganglionnaire axillaire. Le taux de cancer de l'intervalle varie de 2 à 7%. La cytologie mammaire, par ponction, est décrite comme faisant partie du bilan sénologique, avec un caractère peu invasif, une rapidité de réponse, un faible coût et une grande spécificité (supérieure à 95%) et une valeur prédictive positive de 99%. Cependant, la négativité du résultat ne permet pas d'exclure le diagnostic (5 à 10% de faux négatifs). L'exérèse du ganglion sentinelle (GS) est présentée comme alternative au curage axillaire complet, permettant d'éviter un curage en l'absence de métastase dans le ganglion, analysé soit en extemporané, soit après fixation.
IV.Traitement du Cancer du Sein
Le traitement du cancer du sein dépend du stade et des caractéristiques de la tumeur. La chirurgie, incluant la tumorectomie ou la quadrantectomie, est souvent le traitement initial. L'ovariectomie prophylactique est discutée chez les femmes porteuses de mutations BRCA1 ou BRCA2, malgré les inconvénients d'une ménopause précoce. La chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante est utilisée pour réduire la taille tumorale et diminuer le risque de récidive. Le tamoxifène est un traitement hormonal utilisé mais son efficacité chez les patientes avec des mutations BRCA est sujet à débat. Les données du SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) aux États-Unis indiquent que 6% des cancers du sein sont métastatiques dès le diagnostic, contre 8 à 12% en France. L'association lalla Salma au Maroc promeut le dépistage et la sensibilisation contre le cancer du sein.
1. Chirurgie
La chirurgie est une composante essentielle du traitement du cancer du sein. Le document mentionne la tumorectomie ou quadrantectomie, consistant à enlever la tumeur et une partie du tissu sain environnant, car les limites effectives de la tumeur ne correspondent pas toujours aux limites macroscopiques. En cas d'écoulement mamelonnaire, une pyramidectomie est indiquée. L'ovariectomie prophylactique est discutée pour les femmes porteuses de mutations BRCA1 ou BRCA2, afin de réduire le risque de cancer de l'ovaire et de cancer du sein controlatéral. Cependant, les inconvénients d'une ménopause précoce doivent être pesés contre les risques du cancer. L'utilisation du THS après ovariectomie est controversée, faute d'études prospectives suffisantes, et l'hyperoestrogénie doit être évitée. Une comparaison histologique d'ovaires « sains » de porteuses de BRCA1 ou BRCA2 et de non-porteuses n'a pas révélé de différences significatives, sans lésions précurseurs identifiables.
2. Chimiothérapie
La chimiothérapie est employée comme traitement adjuvant ou néoadjuvant. La chimiothérapie adjuvante, administrée après la chirurgie, consiste en 4 à 6 cures à intervalles réguliers (généralement toutes les 3 semaines), et vise à réduire la mortalité et le taux de récidive. La chimiothérapie néoadjuvante est utilisée pour les tumeurs avancées ou inflammatoires, afin de réduire la taille tumorale et permettre une chirurgie conservatrice. Elle peut aussi être utilisée à visée palliative pour les métastases à évolution rapide ou résistantes à l'hormonothérapie. Des données américaines (SEER) montrent que 6% des cancers du sein sont métastatiques dès le diagnostic, contre 8 à 12% en France. Le tamoxifène est mentionné, son efficacité chez les femmes porteuses de mutations BRCA étant sujet à débat, avec des résultats contradictoires entre les études.
3. Surveillance et Prévention
Le texte souligne l'importance du dépistage et du suivi régulier pour réduire la mortalité et les récidives, notamment dans les pays développés. L'association lalla Salma au Maroc est mentionnée pour sa contribution à la sensibilisation et au dépistage. La stratégie optimale de prise en charge des femmes à haut risque reste à démontrer, avec des discussions autour de la surveillance, de l'ovariectomie précoce, et de la mastectomie. Une analyse décisionnelle, utilisant un modèle de Markov, conclut que la mastectomie et l'ovariectomie offrent le meilleur gain en années de vie, mais que la surveillance couplée à une ovariectomie avant 40 ans peut être privilégiée en fonction des préférences des patientes. Les recommandations de l'Expertise Collective nécessitent de nouvelles discussions. L’étude mentionne que la proportion de tumeurs de mauvais pronostic (grades II et III) était prédominante dans leur série (III: 51,61%, II: 45,16%).
