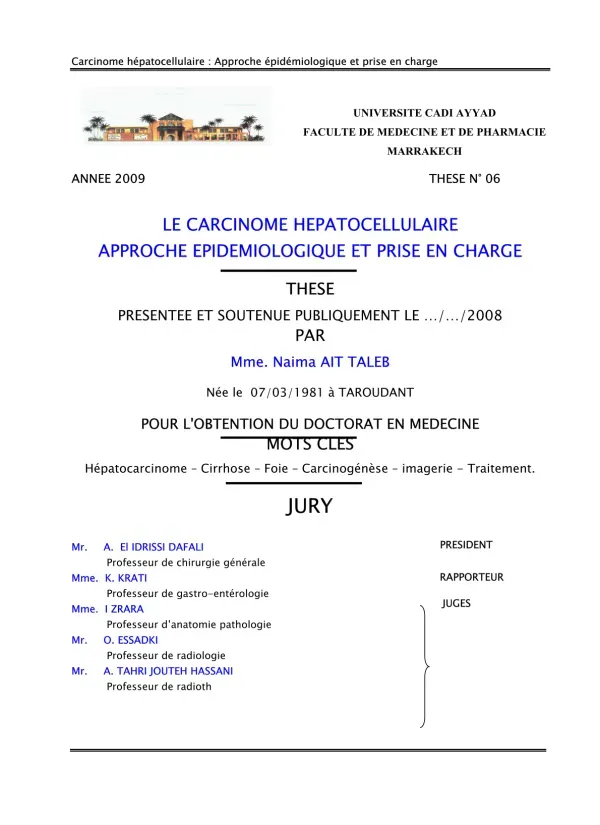
Thèse sur le Carcinome Hépatocellulaire : Approche Épidémiologique et Prise en Charge
Informations sur le document
| Auteur | Mme. Naima Ait Taleb |
| instructor/editor | Mr. A. El Idrissi Dafali (Président) |
| school/university | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Marrakech |
| subject/major | Médecine |
| Type de document | Thèse |
| city_where_the_document_was_published | Marrakech |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 2.75 MB |
- Carcinome hépatocellulaire
- Épidémiologie
- Médecine
Résumé
I.Épidémiologie du Carcinome Hépatocellulaire CHC
Cette étude rétrospective, menée au CHU Mohammed VI de Marrakech entre 2004 et 2007, a analysé 20 cas de CHC, révélant une prédominance masculine (16 hommes, 4 femmes) avec un âge moyen de 60 ans. La cirrhose était l'étiologie principale (75%) avec des origines variées : virale C (20%), virale B (5%), mixte virale C et alcoolique (5%), alcoolique (5%), biliaire primitive (5%) et stéatose hépatique (5%). Des cas de CHC sans cirrhose, liés à une hépatite virale B ou C, ont également été observés (5% chacun). Des disparités géographiques d'incidence sont notées, avec des zones de faible prévalence comme l'Inde, l'Australie, l'Amérique du Sud et du Nord, l'Europe du Nord, les pays occidentaux et le Maroc. À San Francisco, une différence significative d'incidence a été observée entre les hommes chinois et les hommes blancs.
1. Profil des Patients et Étiologies du CHC
L'étude rétrospective menée au CHU Mohammed VI de Marrakech entre janvier 2004 et décembre 2007 a porté sur 20 cas de carcinome hépatocellulaire (CHC). Le groupe était composé de 16 hommes et 4 femmes, avec un âge moyen de 60 ans. La cirrhose était l'étiologie prédominante dans 75% des cas, ses origines étant variées : hépatite virale C (20%), hépatite virale B (5%), association hépatite virale C et éthylisme (5%), éthylisme seul (5%), cirrhose biliaire primitive (5%) et stéatose hépatique (5%). Il est notable que dans 25% des cas (5 cas au total), le CHC est survenu en l'absence de cirrhose. Parmi ces cas, on retrouve un cas d'hépatite virale B sans cirrhose (5%), un cas d'hépatite virale C traitée et guérie cinq ans auparavant (5%), et trois cas restants sans facteur étiologique précis identifié, malgré l'absence de consommation excessive d'alcool, de signes cliniques de cirrhose, ou de marqueurs viraux dans le sang. Un seul de ces trois derniers cas présentait un antécédent de tuberculose pulmonaire dans l'enfance; aucune prise médicamenteuse prolongée n'a été notée. Dans ces cas sans cirrhose, une biopsie hépatique n'a pas été réalisée sur le parenchyme tumoral pour rechercher une cirrhose sous-jacente.
2. Variations Géographiques et de Population de l Incidence du CHC
L'étude souligne des disparités géographiques significatives dans l'incidence du CHC. Certaines régions affichent une faible prévalence, avec moins de 5 cas pour 100 000 habitants par an. Ces zones à faible prévalence incluent l'Inde, l'Australie, l'Amérique du Sud et du Nord, l'Europe du Nord, les pays occidentaux et le Maroc. Ces variations géographiques se retrouvent également au sein d'une même région, entre différentes populations. À titre d'exemple, à San Francisco, l'incidence du CHC chez les hommes chinois est 4,2 fois supérieure à celle observée chez les hommes blancs. Ces différences d'incidence peuvent être attribuées à des facteurs environnementaux tels que l'infection par les virus B et C de l'hépatite, l'éthylisme, le tabagisme, le diabète, l'obésité, l'exposition à l'aflatoxine B1 et d'autres carcinogènes. Des études sur les populations immigrantes ont démontré que l'incidence du CHC tend à se rapprocher de celle des populations d'accueil après une période d'intégration, confirmant le rôle de l'environnement.
II.Facteurs de Risque et Diagnostic du CHC
L'infection chronique par le VHB est le principal facteur de risque de CHC, augmentant de 5 à 15 fois le risque. Le VHC, bien que n'intégrant pas l'ADN cellulaire, peut également conduire au CHC, notamment via des mécanismes indirects. D'autres facteurs de risque incluent l'éthylisme, le tabagisme, le diabète, l'obésité, l'aflatoxine B1, l'hémochromatose héréditaire, et des antécédents familiaux de CHC. Le diagnostic repose sur l'imagerie (échographie, TDM, IRM), la recherche d'une augmentation de l'alpha-fœtoprotéine (AFP) (surtout > 400 ng/mL) et la biopsie hépatique, lorsqu'elle est nécessaire. L'échographie présente une sensibilité de 65% et une spécificité >90% dans le dépistage chez les patients cirrhotiques. La TDM et l'IRM sont utilisées pour le bilan d'extension.
1. Principaux Facteurs de Risque du CHC
L'infection chronique par le virus de l'hépatite B (VHB) est identifiée comme le principal facteur de risque de carcinome hépatocellulaire (CHC). On estime qu'environ 300 000 personnes dans le monde (environ 5%) souffrent d'une infection chronique au VHB. L'incidence du CHC est corrélée au portage de l'antigène de surface de l'hépatite B (AgHBs). Des études cas-témoins ont démontré que les porteurs chroniques du VHB présentent un risque de CHC multiplié par 5 à 15 par rapport à la population générale. Ce risque est accru en cas de forte réplication virale (AgHBe positif et taux d'ADN viral B élevé). D'autres facteurs augmentent également le risque, notamment le sexe masculin, l'âge avancé (ou une longue durée d'infection), la race asiatique ou africaine, la présence d'une cirrhose, des antécédents familiaux de CHC, l'exposition à l'aflatoxine, la consommation d'alcool, le tabagisme et la co-infection avec le virus de l'hépatite C (VHC) ou le virus de l'hépatite D (VHD). Le virus de l'hépatite C (VHC), bien qu'agissant par un mécanisme indirect (absence d'activité de transcription inverse), peut également être impliqué dans la survenue de CHC, même en l'absence de cirrhose, suggérant un possible mécanisme direct via l'interaction de protéines virales avec des protéines cellulaires régulant la croissance cellulaire et le stress oxydatif.
2. Rôle de l Hémochromatose Héréditaire et de l Alpha fœtoprotéine AFP
L'hémochromatose héréditaire, une maladie autosomique récessive, constitue un autre facteur de risque de CHC. La forme la plus courante, l'hémochromatose HFE1, est liée à la mutation C282Y du gène HFE. Le risque relatif de CHC est estimé à environ 20 chez les individus atteints. Le CHC est la principale cause de mortalité précoce liée à l'hémochromatose, qu'elle soit ou non compliquée de cirrhose. L'alpha-fœtoprotéine (AFP) est un marqueur tumoral dont l'élévation peut être observée dans divers contextes, incluant la grossesse, la mucoviscidose, les hépatites aiguës et chroniques, et les cirrhoses. Cependant, son utilisation dans le dépistage précoce du CHC est limitée par sa faible sensibilité (39-64%), sa spécificité (76-91%) et sa faible valeur prédictive positive (9-32%). La sensibilité de l'AFP est corrélée à la taille de la tumeur : elle est de 52% pour les CHC supérieurs à 3cm, mais chute à 25% pour les tumeurs plus petites. Une concentration d'AFP supérieure à 400 ng/mL est fortement suggestive d'un CHC, bien que des valeurs plus faibles puissent être observées dans les hépatites chroniques et les cirrhoses.
3. Méthodes d Imagerie et Biopsie Hépatique pour le Diagnostic du CHC
L'échographie est l'outil de référence pour le dépistage du CHC chez les patients cirrhotiques, offrant une grande acceptabilité, rapidité et faible coût. Elle présente une sensibilité de 65% et une spécificité supérieure à 90%, des performances supérieures aux marqueurs biologiques. Cependant, elle est moins performante pour les lésions de petite taille (<1 cm) et le bilan préthérapeutique. La tomodensitométrie (TDM) permet de visualiser toutes les formes de CHC, le nodule étant l'aspect le plus fréquent, avec une taille moyenne de 4 cm à la découverte. L'aspect typique à la TDM est un nodule iso- ou hypodense en contraste spontané, se rehaussant au temps artériel et présentant un « washout » au temps portal ou tardif. L'IRM est la méthode de référence pour le diagnostic des hémangiomes hépatiques. La biopsie hépatique n'est pas systématique, son indication étant liée à la clarté du diagnostic après évaluation clinique, biologique et morphologique. Elle est essentielle en cas de doute sur la présence d'une cirrhose. La biopsie du foie non tumoral est indispensable si le diagnostic de cirrhose est incertain. Le risque d'essaimage du trajet de ponction doit être pris en compte avant une biopsie si une transplantation est envisagée.
III.Traitements du CHC
Le traitement du CHC dépend du stade de la maladie. Pour les formes limitées, la transplantation hépatique, la résection chirurgicale, l'alcoolisation, et la radiofréquence sont envisagées. La chimioembolisation artérielle (CEA) est utilisée dans les formes intermédiaires ou avancées. La chimiothérapie systémique a une place limitée en raison de sa toxicité. Des traitements ciblés, tels que le sorafenib, montrent une certaine efficacité en termes de survie, ciblant plusieurs voies de signalisation (Raf kinase, PDGFR-B, etc.) et ayant un effet anti-prolifératif et anti-angiogénique. La radiothérapie est peu utilisée sauf dans des cas spécifiques. L'interféron a montré une efficacité limitée dans la prévention du CHC.
1. Traitements pour les Formes Limitée du CHC
Pour les formes de carcinome hépatocellulaire (CHC) limitées, plusieurs options thérapeutiques existent. La transplantation hépatique est une possibilité, tout comme la résection chirurgicale qui requiert une sélection minutieuse des patients (CHC unique ≤ 5 cm ou éventuellement binodulaire, préservant un parenchyme fonctionnellement suffisant, chez des patients Child-Pugh A sans hypertension portale). Des traitements percutanés moins invasifs, tels que l'alcoolisation et la radiofréquence, sont également envisageables. La radiofréquence, en particulier, présente des avantages par rapport à l'alcoolisation : résultats plus reproductibles en termes de nécrose tumorale, volume de destruction plus important et plus prévisible, et réduction du nombre de séances nécessaires. Elle permet également la destruction de tumeurs plus volumineuses (>5cm), contrairement à l'alcoolisation. L'embolisation de la veine porte (PVE) préopératoire peut améliorer la tolérance et la sécurité de la résection hépatique en stimulant l'hypertrophie du foie restant. Cependant, l'absence d'hypertrophie après la PVE peut contre-indiquer la résection.
2. Traitements pour les Formes Évoluées du CHC
Dans les formes de CHC plus évoluées, la chimioembolisation artérielle (CEA) est souvent employée. Il s'agit d'un traitement palliatif indiqué pour les patients en bon état général, avec une fonction hépatique préservée (Child A ou éventuellement B) et un CHC évolué (uninodulaire > 5 cm ou multinodulaire avec plus de 3 nodules > 3 cm). L'indication de la CEA en pré-résection, en attente de greffe, ou en cas de récidive tumorale inopérable peut être discutée, mais n'est pas scientifiquement validée pour toutes ces situations. La CEA peut entraîner une détérioration de la fonction hépatique, des complications ischémiques au niveau des organes voisins (cholécystite, sténose biliaire, pancréatite), et des effets secondaires de la chimiothérapie. Les résultats des études sur la CEA sont discordants, notamment en termes de survie, des différences potentiellement liées à l'état du foie non tumoral et à la cause de la maladie hépatique sous-jacente. Malgré ces résultats mitigés, la CEA reste une option importante en l'absence d'alternatives efficaces.
3. Autres Traitements et Perspectives
La chimiothérapie systémique a une place très limitée dans le traitement du CHC en raison de sa forte toxicité et de la résistance aux antimitotiques. Les essais avec la doxorubicine, le 5-fluorouracile et le cisplatine ont montré des taux de réponse faibles et une toxicité importante, sans amélioration significative de la survie. Le tamoxifène, quant à lui, n'a pas démontré d'amélioration de la survie ou de la qualité de vie. La radiothérapie externe classique est peu efficace et toxique, surtout chez les patients cirrhotiques. Des avancées dans la radiothérapie conformationnelle permettent désormais une meilleure délivrance de la dose, épargnant le foie sain. Les traitements futurs se concentreront sur des thérapies ciblées, exploitant les données de la biologie moléculaire. Le sorafenib, un inhibiteur multi-cibles (Raf kinase, PDGFR-B, VEGF-R, etc.), a démontré une amélioration de la survie globale, même si la réponse tumorale objective reste faible. L'interféron a un effet minime ou nul sur la prévention du CHC, sauf chez les répondeurs à haut risque. La consommation de café semble inversement corrélée au risque de CHC, mais le mécanisme reste à élucider.
