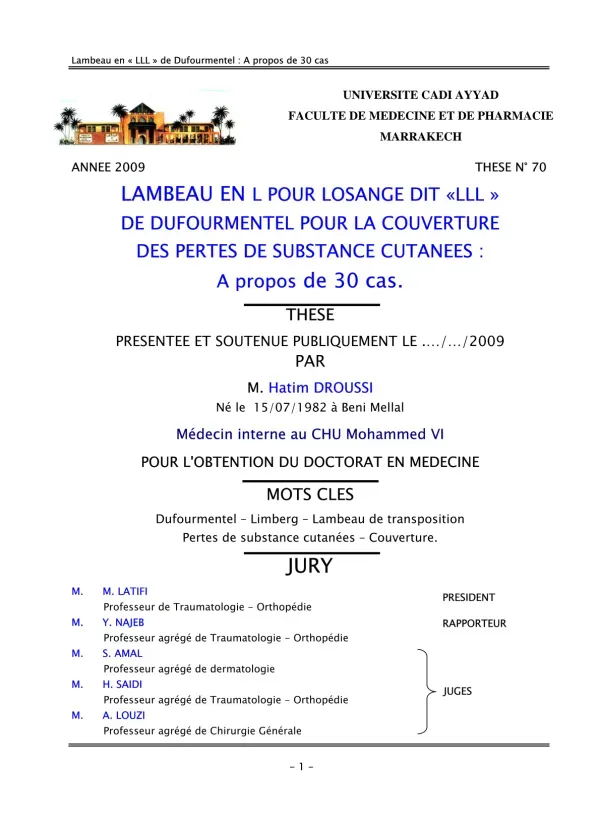
Thèse sur le Lambeau de Dufourmentel pour la Couverture des Pertes de Substance Cutanées
Informations sur le document
| Auteur | Hatim Droussi |
| instructor/editor | M. Latifi, Professeur de Traumatologie - Orthopédie |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Type de document | Thèse |
| Lieu | Marrakech |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 2.01 MB |
- Médecine
- Chirurgie
- Traumatologie
Résumé
I.La Plastie en Triple L LLL de Dufourmentel pour la Couverture des Pertes de Substance Cutanées
Cette étude rétrospective, menée au CHU Mohammed VI de Marrakech entre juin 2006 et janvier 2008, porte sur l’utilisation de la plastie en LLL (ou plastie en triple L, lambeau de Dufourmentel), une technique de chirurgie plastique réparatrice, pour la reconstruction des pertes de substance cutanées. 30 patients ont été traités pour des lésions de diverses localisations et étiologies. La plastie en LLL est particulièrement indiquée pour la fermeture de pertes de substance losangiques, notamment celles résultant de l'exérèse de tumeurs cutanées comme les carcinomes basocellulaires et spinocellulaires. L'étude a évalué la facilité de mise en œuvre, la reproductibilité et l'efficacité de cette technique, même chez les jeunes patients. Elle compare également la plastie en LLL à d'autres méthodes, telles que la greffe cutanée, soulignant ses avantages esthétiques et fonctionnels.
1. Introduction La Plastie en LLL et la Couverture des Pertes de Substance
L'étude se concentre sur la plastie en LLL (lambeau en L pour losange), une technique chirurgicale de réparation des pertes de substance cutanées. Elle souligne le problème majeur que représente la couverture de ces pertes, notamment lorsque la suture directe est impossible. La plastie en LLL, décrite par Dufourmentel en 1962, est présentée comme une solution alternative aux greffes cutanées, offrant des résultats esthétiques et fonctionnels supérieurs grâce à l'utilisation de tissus voisins dont la qualité et la texture se rapprochent de celles des lésions réparées. L’étude vise à démontrer la facilité de mise en œuvre, la reproductibilité de cette technique, même chez les sujets jeunes, et son intérêt particulier dans la reconstruction faciale. La technique permet de court-circuiter un long processus de cicatrisation, offrant ainsi un large champ d'application en chirurgie plastique réparatrice.
2. Étude Rétrospective Patients et Méthodologie
Une étude rétrospective a été menée au service de traumatologie-orthopédie B du CHU Mohammed VI à Marrakech, entre juin 2006 et janvier 2008. 30 patients présentant des pertes de substance cutanées de diverses localisations et étiologies ont été inclus. Tous les patients ont bénéficié d'une biopsie préopératoire avec étude anatomopathologique pour caractériser les lésions. L'étude analyse la technique de plastie en LLL de Dufourmentel utilisée pour reconstruire ces pertes de substance. L'analyse porte sur l’efficacité et la reproductibilité de la technique, mais aussi sur les complications éventuelles. Le choix de l'anesthésie (locale ou générale) est également un point abordé, ainsi que la préparation locale du champ opératoire, qui est différente selon les pathologies (ex: kyste pilonidal, escarre sacrée).
3. Description de la Technique de Plastie en LLL
La technique de plastie en LLL commence par la réduction de la perte de substance à un losange, en respectant les marges d'exérèse pour les pathologies malignes (4 mm pour carcinome basocellulaire, 8 mm pour carcinome spinocellulaire). Le dessin du lambeau en L est ensuite réalisé en suivant des étapes géométriques précises. L’exérèse de la lésion se fait au bistouri froid. La taille du lambeau est cruciale, avec un soin particulier apporté à la coïncidence de sa base avec une zone à basse pression veineuse pour optimiser le drainage. L’incision se fait au bistouri n°15 ou 23 selon la texture des tissus. Le décollement se fait à ras de l'aponévrose. La suture est effectuée en plusieurs étapes: points d'angle, rapprochement du tissu cellulaire sous-cutané, surjet intradermique. Un pansement compressif est appliqué pour éviter les espaces morts et une surveillance postopératoire rigoureuse est mise en place pour évaluer la vitalité du lambeau (couleur, chaleur, pouls capillaire).
4. Résultats Cliniques et Analyse des Complications
L'étude présente plusieurs cas cliniques illustrant l'application de la plastie en LLL pour différentes pathologies (carcinome basocellulaire, escarre sacrée). L'évolution postopératoire est détaillée, notamment la surveillance de la vitalité du lambeau. Des complications mineures comme une légère souffrance veineuse (2 patients) et une nécrose marginale (3 patients) sont rapportées, ainsi que leur prise en charge. Le protocole de surveillance postopératoire et la gestion des complications sont discutés, insistant sur l'importance de la vérification quotidienne de la vitalité du lambeau et l'adaptation des soins (changement de pansement, retrait de points). Le succès de la procédure est corrélé au respect des réseaux vasculaires cutanés, et la nécessité de les préserver est soulignée. La cicatrisation complète est généralement obtenue dans les trois semaines.
II.Technique Chirurgicale de la Plastie en LLL
La technique de plastie en LLL implique le dessin précis d'un lambeau en forme de L sur la peau saine adjacente à la perte de substance, en respectant les marges d'exérèse tumorale (4mm pour les carcinomes basocellulaires, 8mm pour les carcinomes spinocellulaires). Le lambeau est ensuite incisé, disséqué et transposé pour couvrir la zone lésée. Une attention particulière est portée à la vascularisation du lambeau, en privilégiant une base proche des zones à basse pression veineuse (BPV) pour optimiser le drainage veineux et lymphatique. La suture est effectuée avec des points précis pour minimiser les risques de nécrose. La préparation préopératoire peut inclure un rasage et un shampoing antiseptique, l’anesthésie étant locale ou générale selon le cas.
1. Préparation Préopératoire et Anesthésie
La préparation préopératoire comprend un rasage de la région coccygienne la veille de l'intervention pour les cas spécifiques comme le kyste pilonidal et l’escarre sacrée. Le rasage du cuir chevelu est évité pour des raisons esthétiques; un shampoing antiseptique suffit. L'anesthésie utilisée est variable selon le patient : anesthésie générale avec hospitalisation de deux jours pour trois patients (deux nourrissons et un sujet âgé), et anesthésie locale (xylocaïne à 1% avec ou sans adrénaline) pour 23 patients. L'infiltration anesthésique se fait via une seringue intradermique, lentement et en respectant la base du lambeau pour préserver le pédicule vasculaire, afin de minimiser la douleur et la distension tissulaire.
2. Exérèse de la Lésion et Marges de Sécurité
L'exérèse de la lésion est précédée d'un tracé au stylo dermographique, définissant la zone à exciser en forme de losange et le futur lambeau. La résection se fait au bistouri froid, en emportant le quartier cutané et le tissu sous-cutané. Le respect des marges de sécurité est impératif pour les tumeurs malignes : 4 mm pour les carcinomes basocellulaires, 8 mm pour les carcinomes spinocellulaires, et en fonction de l'indice de Breslow pour les mélanomes. Cette étape vise à retirer complètement la lésion tout en minimisant les risques de récidive tumorale. Une hémostase soigneuse est essentielle après l'exérèse de la lésion pour assurer le succès de l'intervention.
3. Taille et Dissection du Lambeau Cutané
La taille du lambeau commence par une incision franche cutanéo-graisseuse, en évitant de léser les structures nobles sous-jacentes. Des lames de bistouri n°15 (régions fines) ou n°23 (tissus épais) sont utilisées. Le décollement se fait à ras de l'aponévrose avec des ciseaux fins courbes, en veillant à préserver la vascularisation du lambeau. La base du lambeau est positionnée de préférence sur une zone à basse pression veineuse pour optimiser le drainage veineux et lymphatique, et sur un axe vasculaire connu. Le chirurgien change de gants et d'instrumentation après l'exérèse de la lésion pour prévenir l'ensemencement de cellules malignes dans le cas de tumeurs. Si une tension importante persiste, l'incision peut être prolongée parallèlement à la grande diagonale.
4. Suture et Pansement
La suture commence par les points d'angle, des points en U ou en cadre prenant uniquement la derme et noués sur la berge opposée pour prévenir la nécrose. Le tissu cellulaire sous-cutané est rapproché par des points au fil résorbable peu serrés. Des points dermiques à nœud inversé sont réalisés avec un fil tressé résorbable (Vicryl®, Dexon®) ou un monofil à résorption lente (Monocryl®). Un surjet intradermique au monofil résorbable 4/0 ou 5/0, renforcé par quelques points superficiels de 6/0, assure le rapprochement des berges sans tension excessive. La même épaisseur de peau est prise sur chaque berge, avec une légère éversion des tranches cutanées. La plaie est recouverte d'un pansement au tulle gras ou à la compresse vaselinée non adhésive, maintenue par une contention élastique avec une légère compression pour éviter les espaces morts et prévenir la compromission de la microcirculation.
III.Résultats et Complications
L’étude rapporte une légère souffrance veineuse chez deux patients et une nécrose marginale chez trois. La surveillance postopératoire est essentielle pour garantir la vitalité du lambeau. La cicatrisation est généralement bonne, avec une cicatrisation complète obtenue dans les trois semaines pour la plupart des patients. Des complications mineures, traitées avec des pansements gras, ont été observées. L'étude met en évidence l'importance du respect des réseaux vasculaires dermiques et sous-dermiques pour le succès de la plastie en LLL.
1. Surveillance Postopératoire et Vitalité du Lambeau
La surveillance postopératoire est cruciale pour assurer la survie du lambeau. Elle inclut une vérification quotidienne de la vitalité du lambeau en observant sa coloration, sa température et son pouls capillaire (test à la vitropression et test par piqûre, non systématique). Le but est de détecter rapidement toute souffrance vasculaire. Dans un cas, le changement de pansement et le retrait de quelques points ont été nécessaires pour diminuer la tension à la base du lambeau. Une légère souffrance veineuse, se manifestant par un aspect bleuté du lambeau, a été observée chez deux patients et a été traitée par quelques piqûres pour désengorger le réseau veineux intradermique. Une surveillance attentive permet une intervention rapide en cas de complication.
2. Complications et Gestion des Néroses
Parmi les complications observées, une nécrose marginale a été constatée chez trois patients. La prise en charge de ces nécroses marginales impliquait une cicatrisation dirigée à l'aide de pansements gras pro-inflammatoires. Ces pansements favorisent la détersion, l’élimination progressive de la partie nécrosée, puis le bourgeonnement et l'épidermisation centripète, conduisant à une cicatrisation complète. La gestion des complications, par conséquent, reposait sur une surveillance rigoureuse et des interventions ciblées pour favoriser la cicatrisation et minimiser les séquelles esthétiques. L’absence de complications plus importantes témoigne de l’efficacité de la technique et de la surveillance.
3. Résultats à Long Terme et Évaluation Globale
Bien que l'étude soit rétrospective et limitée à la période de suivi postopératoire immédiat et à court terme, les résultats montrent un bon taux de succès de la plastie en LLL pour la couverture des pertes de substance cutanées. La majorité des patients ont présenté une cicatrisation complète dans les trois semaines suivant l'intervention. Les complications observées étaient mineures et ont été gérées efficacement. La simplicité et la reproductibilité de la technique, ainsi que la prise en charge efficace des complications, contribuent à la réussite de cette procédure. Des études à plus long terme seraient nécessaires pour évaluer l'impact esthétique et fonctionnel à long terme de cette intervention.
IV.Indications Contre indications et Limites de la Plastie en LLL
La plastie en LLL est indiquée pour la réparation de pertes de substance losangiques de taille variable, notamment dans le traitement des tumeurs cutanées bénignes (kystes, nævi) et malignes (carcinomes basocellulaires, sous réserve). Elle est cependant contre-indiquée en cas d'infection, de mauvaise qualité vasculaire des tissus environnants, ou pour certaines localisations comme le scalp et la plante du pied. Des modifications techniques peuvent être nécessaires pour adapter la procédure à certaines régions spécifiques du corps ou en cas de lambeaux de grande taille, avec la possibilité d’une autonomisation du lambeau sur plusieurs semaines. D'autres techniques, comme les plasties en Z et la greffe cutanée, peuvent être privilégiées dans certaines situations.
1. Indications selon la Pathologie
La plastie en LLL est indiquée pour diverses pathologies. Pour les tumeurs cutanées bénignes (kystes, nævi), l'excision peut être péri-lésionnelle et la réparation immédiate. Pour les lésions étendues, comme les nævi congénitaux géants, la plastie en LLL est une option parmi d'autres (excision itérative, expansion cutanée). Concernant les tumeurs malignes, la réparation immédiate est appropriée pour les carcinomes basocellulaires circonscrits pour un résultat esthétique optimal. Cependant, il est préférable de différer la réparation pour les carcinomes basocellulaires térébrants et sclérodermiformes, et pour les carcinomes spinocellulaires. Dans le cas de pertes de substance post-infectieuses, avec une élasticité et une vascularisation réduites, une greffe cutanée ou un lambeau pédiculé loco-régional est souvent préférable. Les ulcères de jambe sont une contre-indication formelle en raison de l'infection et de la mauvaise vascularisation.
2. Indications selon la Topographie et les Limites Techniques
La plastie en LLL est adaptée aux régions avec une bonne élasticité cutanée. Le cuir chevelu et la plante du pied, en raison de leur rigidité, ainsi que la jambe, en raison de sa pauvreté vasculaire, sont des zones moins indiquées. Cependant, des modifications techniques, comme la scarification de la galéa au niveau du cuir chevelu ou le respect d’un rapport longueur/largeur spécifique au niveau de la jambe, peuvent permettre de réaliser la plastie en LLL dans ces zones. Pour les pertes de substance de grande taille, des précautions sont nécessaires, comme la technique d’'autonomisation' du lambeau, consistant à inciser le lambeau puis à le lever plusieurs semaines plus tard pour optimiser la vascularisation. La rapidité et la fiabilité de la technique en font une option de première intention pour certaines pertes de substance losangiques, envisagée pour l’économie tégumentaire.
3. Comparaison avec d autres Techniques et Contre indications
Dans certains cas, d'autres techniques sont préférées à la plastie en LLL. Pour les pathologies congénitales, comme la maladie amniotique avec des brides commissurales, les plasties en Z et en trident sont souvent privilégiées, bien que la plastie en LLL puisse être utilisée pour la redéfinition commissurale. La plastie en LLL est comparée à la greffe cutanée, dont les indications diffèrent et dont le résultat esthétique est moindre comparé aux autoplasties de voisinage. L’infection représente une contre-indication majeure à la plastie en LLL. L’état vasculaire des tissus environnants est également un facteur critique : un mauvais état vasculaire rend la technique inadéquate. La taille du lambeau, les caractéristiques de la peau, et la localisation de la perte de substance sont autant de facteurs à considérer dans le choix de la technique appropriée.
V.Informations Supplémentaires
L'étude a été menée au CHU Mohammed VI à Marrakech, au Maroc. Elle se base sur une série de 30 patients traités entre 2006 et 2008. La technique de plastie en LLL est décrite par Claude Dufourmentel en 1962. L’étude détaille également des aspects anatomiques et histologiques importants pour la réussite de l’intervention, notamment la vascularisation artérielle et veineuse de la peau.
1. Contexte de l Étude et Lieu de Réalisation
L'étude rétrospective sur la plastie en LLL s'est déroulée au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech, au Maroc. Elle a porté sur une période spécifique, entre juin 2006 et janvier 2008, mettant en lumière l'application de cette technique chirurgicale dans un contexte clinique précis. Le choix de ce centre hospitalier et cette période de temps sont pertinents pour l'analyse des résultats, qui sont directement liés aux conditions de travail et aux ressources disponibles au sein de l'unité de chirurgie plastique et réparatrice du service de traumatologie-orthopédie B. Ces informations contextuelles sont cruciales pour comprendre la portée et les limites de l'étude.
2. Données sur les Patients et la Technique de Dufourmentel
L'étude a inclus un total de 30 patients. La technique chirurgicale étudiée est la plastie en LLL, également connue sous le nom de lambeau de Dufourmentel, décrite initialement en 1962. Cette technique spécifique de chirurgie plastique réparatrice est détaillée dans le document. L'étude a impliqué une analyse rétrospective, ce qui signifie qu'elle s'appuie sur des données déjà collectées. Tous les patients inclus dans cette étude ont bénéficié d'une biopsie préopératoire avec une étude anatomopathologique pour la confirmation du diagnostic. L’étude souligne l’importance de la connaissance des bases vasculaires et hémodynamiques pour un choix judicieux du lambeau.
3. Références et Sources
Le document fait référence à plusieurs sources bibliographiques, indiquées par des numéros entre crochets (ex: [1], [13], [18], [19] etc.). Ces références permettent de contextualiser les informations fournies, de situer les travaux dans un cadre scientifique plus large et de montrer la base bibliographique sur laquelle repose l'étude. Elles fournissent un soutien aux affirmations et aux conclusions présentées dans le document. L’accès à ces références permettrait une compréhension plus approfondie des concepts abordés, notamment sur les aspects anatomiques, histologiques et techniques mentionnés dans l’étude. L’utilisation de sources scientifiques reconnues accroit la crédibilité de l'étude.
