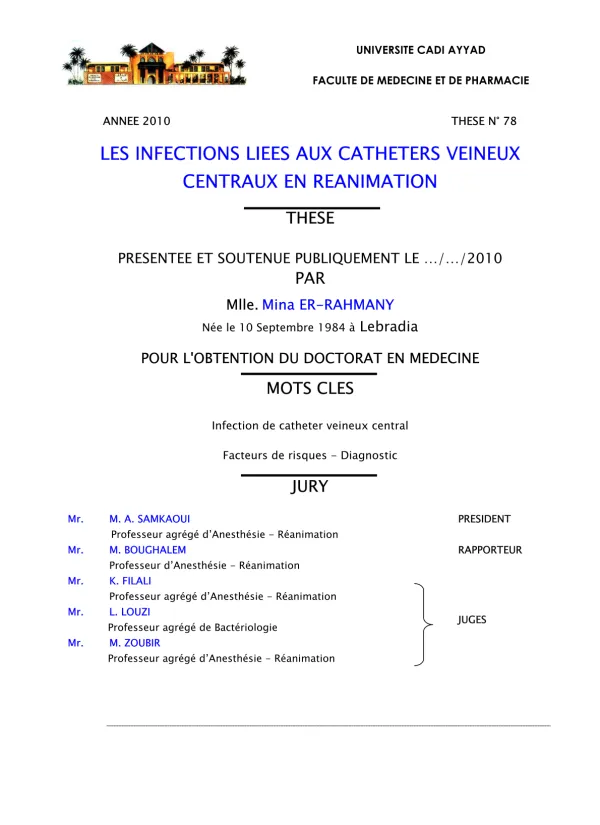
Thèse sur les infections liées aux cathéters veineux centraux en réanimation
Informations sur le document
| Auteur | Mlle. Mina Er-Rahmany |
| instructor/editor | M. A. Samkaoui (Professeur agrégé d’Anesthésie - Réanimation) |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 906.96 KB |
- Infections liées aux cathéters
- Réanimation
- Médecine
Résumé
I.Incidence des Infections Liées aux Cathéters Veineux Centraux ILC
Cette étude, menée au service de réanimation de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech entre 2008 et 2009, a évalué l’incidence des infections nosocomiales liées à la pose de cathéters veineux centraux (CVC). Sur 65 patients, 9 ont présenté une bactériémie liée au cathéter, soit une incidence de 13,9%, supérieure aux données de la littérature (5 à 10%). La densité d’incidence des ILC était de 26,04 pour 1000 journées-cathéter, comparable aux réseaux français de surveillance mais supérieure aux taux américains. L'étude souligne la prévalence élevée des ILC à l'hôpital Avicenne de Marrakech et l'importance de la prévention des infections nosocomiales.
1. Incidence des Infections Liées aux Cathéters Veineux Centraux ILC en Réanimation
L'étude, réalisée au service de réanimation de l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech entre 2008 et 2009, a porté sur 65 patients ayant bénéficié d'un cathétérisme veineux central. L'objectif principal était de déterminer l'incidence des infections liées à ces cathéters. L'étude a révélé une incidence de 13,9% d'infections liées aux cathéters veineux centraux (ILC), soit 9 patients sur 65. Ce taux est significativement plus élevé que l'incidence rapportée dans la littérature, qui varie généralement entre 5 et 10%. La densité d'incidence des ILC, calculée sur 1000 journées-cathéter, était de 26,04 dans cette série. Ce chiffre est comparable aux données des réseaux de surveillance français (C-Clin Paris-Nord et C-Clin Sud-Est), mais sensiblement inférieur aux taux observés aux États-Unis, qui sont quatre à cinq fois plus élevés. Cette différence est attribuée à des disparités dans les définitions cliniques et les méthodes diagnostiques employées entre les pays. Les infections liées aux cathéters représentent la principale complication de la mise en place d'un cathéter veineux central et la troisième cause d'infection nosocomiale en réanimation, après les infections urinaires et les pneumonies. L'étude met donc en évidence un taux significativement plus élevé d'infections liées aux cathéters veineux centraux à l'hôpital Avicenne de Marrakech par rapport aux données de la littérature et soulève la nécessité d'une analyse plus approfondie des facteurs contributifs.
2. Définition et Diagnostic des ILC
Le diagnostic des ILC pose un défi en raison de l'absence de signes cliniques sensibles et spécifiques. Dans de nombreux cas, la suspicion d'ILC n'est pas suffisamment forte pour justifier le retrait systématique du cathéter, une intervention potentiellement inutile ou dangereuse. L'étude souligne la nécessité de techniques microbiologiques fiables pour confirmer ou infirmer le diagnostic sans retirer systématiquement le cathéter. Plusieurs techniques sont décrites : l’écouvillonnage de la zone d’insertion cutanée, la culture quantitative de l’extrémité distale du cathéter (méthode de Brun-Buisson utilisée dans l'étude), et les hémocultures. La méthode de Brun-Buisson, validée en réanimation, offre une sensibilité de 97% et une spécificité de 88%, un meilleur rapport qualité-prix que les autres méthodes. Les critères cliniques d'infection se manifestent par des signes locaux (superficiels ou profonds, avec ou sans écoulement purulent) et/ou systémiques (syndrome infectieux, hémocultures positives, en particulier pour les staphylocoques à coagulase négative, S. aureus ou Candida sp. en l'absence d'autres foyers infectieux). Malgré ces techniques, le retrait systématique des cathéters pour toute suspicion d'infection conduit à des retraits inutiles dans la majorité des cas (80 à 90%). L'étude met l'accent sur l'importance d'un diagnostic précis et efficace pour éviter des interventions inutiles et potentiellement dangereuses.
3. Comparaison des Résultats avec la Littérature
L'incidence des ILC observée dans l'étude (13,9%) est supérieure à celle rapportée dans la littérature (5 à 10%). De même, la densité d'incidence des ILC dans cette étude (26,04 pour 1000 journées-cathéter) se situe dans une fourchette comparable aux résultats des grands réseaux français de surveillance (1,83 pour les infections non bactériémiques et 1 pour les bactériémies), mais est considérablement plus faible que celle observée dans les études américaines, où les taux sont quatre à cinq fois supérieurs. Cette disparité est attribuée à des différences significatives dans les définitions cliniques et les méthodes de diagnostic utilisées. Dans cette étude, Staphylococcus aureus était responsable de 22,3% des ILC, tandis que Staphylococcus epidermidis était impliqué dans seulement 11,2% des cas. La contamination des cathéters peut survenir lors de la pose (évitable par une asepsie rigoureuse), ou par colonisation secondaire du site d'insertion, par migration des germes le long de la surface externe ou interne (contamination endoluminale, prédominante pour les cathéters en place depuis plus de trois semaines). La comparaison met en lumière des variations géographiques importantes dans l'incidence des ILC, liées à des différences méthodologiques et des pratiques cliniques.
II.Diagnostic Microbiologique des ILC
Le diagnostic des ILC repose sur des examens microbiologiques, car les signes cliniques sont peu sensibles et spécifiques. La culture quantitative de l'extrémité distale du cathéter selon la technique de Brun-Buisson, utilisée dans cette étude, s'est avérée efficace, avec une sensibilité de 97% et une spécificité de 88%. Cette méthode, recommandée en France, permet de détecter la présence de bactéries telles que Staphylococcus epidermidis et Staphylococcus aureus. D’autres méthodes, comme la culture semi-quantitative ou l'analyse du délai différentiel de positivité des hémocultures, sont également mentionnées, mais présentent des limites en termes de sensibilité et de spécificité.
1. Difficultés du Diagnostic Clinique des ILC
L'absence de signes cliniques sensibles et spécifiques rend le diagnostic des infections liées aux cathéters (ILC) difficile. La suspicion d'ILC n'est pas toujours évidente, particulièrement en l'absence de signes de gravité. Dans ces situations, le défi consiste à confirmer ou infirmer le diagnostic sans retirer prématurément le cathéter, une action qui pourrait s'avérer inutile voire dangereuse pour le patient. Le recours à des examens microbiologiques est donc essentiel pour un diagnostic précis et fiable des ILC. Le retrait systématique du cathéter pour toute suspicion d'infection est à éviter, car il conduit à un nombre important de retraits inutiles (80 à 90% des cathéters se révélant stériles après culture). L'étude souligne la nécessité de développer des méthodes de diagnostic plus fiables et moins invasives pour guider les décisions thérapeutiques.
2. Méthodes de Diagnostic Microbiologique Approches Directes
Plusieurs techniques microbiologiques sont employées pour diagnostiquer les ILC, notamment l'écouvillonnage de la zone d'insertion cutanée du cathéter, la culture quantitative de l'extrémité distale du cathéter, et les hémocultures. La culture quantitative, particulièrement la méthode de Brun-Buisson, est privilégiée pour les cathéters de longue durée, notamment chez les patients en oncohématologie. La méthode de Brun-Buisson, utilisée dans cette étude, consiste en une culture quantitative après vortexage du cathéter, permettant l'analyse des bactéries adhérant aux surfaces internes et externes. Elle s'est révélée d'une grande sensibilité (97%) et spécificité (88%) dans cette étude, confirmant son utilité diagnostique. Cependant, la méthode semi-quantitative, consistant à rouler le cathéter sur un milieu de culture, présente des limites : elle n'explore que la surface externe, le seuil de positivité est arbitraire, et la corrélation avec les signes systémiques d'infection est faible. Cette méthode est moins performante que la méthode de Brun-Buisson et n’est pas pleinement satisfaisante pour établir le diagnostic d’ILC de façon incontestable.
3. Méthodes de Diagnostic Microbiologique Approches Indirectes Cathéter en Place
Face au défi de diagnostiquer les ILC sans retirer systématiquement le cathéter, des techniques de diagnostic « cathéter en place » ont été développées. Ces méthodes visent à éliminer le diagnostic d’ILC tout en maintenant le cathéter, évitant ainsi des changements inutiles. Parmi elles, la culture du pavillon (raccord) du cathéter explore le mécanisme endoluminal d'infection, prédominant pour les cathétérismes prolongés. Cependant, pour les cathétérismes de courte durée, ce prélèvement n'apporte pas d'information supplémentaire à la culture du site cutané. La mesure du délai différentiel de positivité des hémocultures (prélèvements simultanés sur cathéter et en périphérie) est une autre méthode simple et moins coûteuse. Un délai de positivité d'au moins deux heures en faveur de l'hémoculture prélevée sur cathéter est hautement prédictif d'une bactériémie liée au cathéter. Cette méthode semble prometteuse pour remplacer les hémocultures quantitatives. Enfin, le brossage endoluminal du cathéter associé à des examens microscopiques est mentionné, mais présente un risque théorique d'embolisation ou de bactériémie induite. L'étude souligne le besoin de méthodes de diagnostic plus précises et moins invasives pour améliorer la prise en charge des ILC.
III.Facteurs de Risque des ILC
Plusieurs facteurs augmentent le risque d’ILC: âge avancé, sexe masculin, antécédents de cathétérisme, scores de gravité élevés, présence d’un foyer infectieux annexe, et durée prolongée du cathétérisme (risque accru au-delà de 7 jours). Le type de cathéter (polyuréthane et silicone moins risqués que le PVC et le téflon), le site d’insertion (sous-clavier moins risqué que fémoral ou jugulaire), la technique de pose (respect des conditions d’asepsie chirurgicale crucial), et la fréquence des manipulations du CVC influencent également le risque. L’utilisation de chlorhexidine alcoolique comme antiseptique semble plus efficace que la polyvidone iodée pour la prévention des ILC.
1. Facteurs liés au Cathéter et à sa Pose
La composition physico-chimique du cathéter influence le risque d'infection. Les cathéters en polyuréthane et en élastomère de silicone semblent engendrer moins d'infections liées aux cathéters (ILC) que ceux en chlorure de polyvinyle (PVC) et en téflon, ces derniers étant plus thrombogènes et favorisant l'adhérence bactérienne. Le nombre de lumières sur le cathéter pourrait également jouer un rôle, l'augmentation des manipulations augmentant le risque de contamination endoluminale. Cependant, les études contrôlées n'ont pas confirmé cette hypothèse de manière définitive. Le site d'insertion du cathéter est un autre facteur important. Bien que des études anciennes aient suggéré une préférence pour l'abord sous-clavier, une étude randomisée sur 36 mois n'a pas montré de différence significative entre les sites sous-clavier et fémoral en ce qui concerne les ILC, après exclusion des simples colonisations. Une méta-analyse a également révélé des résultats hétérogènes sur la comparaison voie sous-clavière/voie jugulaire. Dans cette étude, la fréquence des ILC était similaire pour les sites jugulaire et fémoral, mais nettement supérieure au site sous-clavier. Le respect des conditions d'asepsie chirurgicale lors de la pose du cathéter est crucial pour prévenir les infections. L'utilisation d'une solution antiseptique à base de chlorhexidine alcoolique semble plus efficace que la polyvidone iodée, bien que des études aient fourni des résultats contradictoires à ce sujet.
2. Facteurs liés à l Utilisation et à l Entretien du Cathéter
La durée du cathétérisme est un facteur de risque majeur d'ILC, le risque augmentant de manière linéaire avec le temps, particulièrement au-delà du septième jour. Dans cette étude, la durée de cathétérisme était plus longue dans le groupe des cathéters infectés. La fréquence des manipulations du cathéter (prélèvements sanguins, nutrition parentérale, administration de médicaments) augmente la probabilité de contamination, surtout au niveau des raccords. Une prophylaxie antibiotique systématique lors de la pose n'est pas recommandée, bien que l'utilisation d'antibiotiques intraveineux pendant la durée d'insertion du cathéter puisse réduire le risque. L'entretien régulier du cathéter est essentiel. Un lavage antiseptique des mains avant chaque manipulation est nécessaire. La friction hydro-alcoolique est recommandée pour l'hygiène des mains. Le remplacement des tubulures ayant servi à administrer des dérivés sanguins ou des lipides (dont le propofol) doit être effectué dans les 24 heures. Un changement systématique des cathéters à intervalles réguliers n'est pas recommandé car il peut augmenter le risque d'infection. L'étude souligne l'importance de la formation du personnel et de l'application rigoureuse des protocoles d'hygiène pour limiter les manipulations et les risques d'infection.
3. Autres Facteurs de Risque et Conclusion
L'analyse comparative des patients avec et sans ILC révèle que l'âge avancé, le sexe masculin, les scores de gravité élevés, la présence d'un foyer infectieux annexe, et les antécédents de cathétérisme sont associés à une fréquence plus élevée d'infections. Dans cette étude, 22,3% des patients avec ILC avaient un antécédent de cathétérisme, contre seulement 7,2% dans le groupe des cathéters stériles, bien que cette différence ne soit pas statistiquement significative. La durée de séjour était plus longue chez les patients avec des cathéters infectés, ce qui peut influencer la surmortalité observée dans ce groupe (33,4% vs 4% dans le groupe des cathéters stériles). Cependant, la surmortalité ne peut être attribuée uniquement à l'infection, d'autres facteurs contribuant au pronostic des patients. L'étude met en évidence la multifactorialité des risques d'ILC et souligne la nécessité d'une approche globale de prévention, incluant une meilleure hygiène des mains, une asepsie rigoureuse lors de la pose et de l'entretien du cathéter, un choix judicieux du type de cathéter et du site d'insertion, ainsi qu'une durée de cathétérisme la plus courte possible.
IV.Traitement et Prévention des ILC
Le traitement empirique des ILC doit tenir compte de la fréquence des infections à staphylocoques (résistance à la méticilline), et inclure des antibiotiques tels que la vancomycine, une béta-lactamine et un aminoside selon la gravité. L'ablation du cathéter est souvent suffisante en l’absence de signes de gravité. Des stratégies de prévention incluent le respect strict de l’asepsie lors de la pose et de l'entretien du CVC, l'utilisation de chlorhexidine alcoolique, le choix de cathéters en matériaux moins thrombogènes, la limitation des manipulations, et une durée de cathétérisme la plus courte possible. L’étude souligne l’importance de protocoles écrits et de formations pour le personnel soignant afin de réduire l’incidence des ILC.
1. Traitement Empirique des ILC
Le traitement empirique des infections liées aux cathéters (ILC) doit prendre en compte la fréquence des infections à staphylocoques à coagulase négative (résistants à la méthicilline dans plus de 50% des cas) et à Staphylococcus aureus (35% de résistance à la méthicilline). Il doit inclure la vancomycine, une béta-lactamine active sur les bacilles à Gram négatif (BGN), et un aminoside (gentamicine plutôt qu'amikacine) en cas de choc septique ou d'aplasie. Un antifongique peut être envisagé chez les patients colonisés par des levures ou à haut risque. L'antibiothérapie doit être ajustée en fonction des résultats bactériologiques. En l'absence de signes généraux de gravité, de bactériémie ou de complications, et si le changement ou le retrait du cathéter entraîne l'apyrexie, une antibiothérapie n'est généralement pas nécessaire. Les recommandations françaises diffèrent des pratiques américaines, ces dernières privilégiant des approches plus systématiques, notamment en cas d'épisode fébrile chez un porteur de cathéter. Pour une bactériémie, le retrait du cathéter et un traitement antibiotique par voie parentérale sont systématiquement recommandés aux États-Unis. Les recommandations françaises quant à elles préconisent une antibiothérapie seulement en cas de bactériémie et de persistance des signes cliniques malgré le retrait du cathéter. La durée du traitement varie selon le germe impliqué et la présence de complications.
2. Traitement selon le Germe Impliqué
Le traitement des ILC varie en fonction du germe impliqué. Pour les infections à Staphylococcus coagulase négative, l'ablation du cathéter est souvent suffisante en cas de régression rapide des signes cliniques, sans nécessité d'antibiothérapie selon les recommandations françaises. En revanche, les recommandations américaines proposent un traitement de 5 à 7 jours par vancomycine, au moins en probabilité. Les infections à Staphylococcus aureus nécessitent un traitement plus long (14 à 21 jours), en raison du risque d'endocardite infectieuse. Une échocardiographie transoesophagienne est nécessaire pour évaluer ce risque en cas d'hémoculture positive. Une endocardite infectieuse nécessite une antibiothérapie prolongée (4 à 6 semaines). Le « verrou antibiotique », consistant à laisser le cathéter en contact avec de fortes concentrations d'antibiotiques, a été décrit mais n'est pas recommandé en réanimation en raison de l'absence d'expérience dans ce contexte et de la difficulté d'application. Les divergences entre les recommandations françaises et américaines reflètent les différences de pratiques et d'approches thérapeutiques.
3. Prévention des ILC
La prévention des ILC est un enjeu majeur. La connaissance des facteurs de risque est primordiale. Des mesures de prévention sont décrites, incluant le respect de l'asepsie chirurgicale lors de la pose du cathéter (lavage chirurgical des mains, port de gants et de champs stériles, désinfection cutanée avec un antiseptique), le choix de l'antiseptique (chlorhexidine alcoolique semble supérieure à la polyvidone iodée, bien que des études montrent des résultats contradictoires), l'utilisation de cathéters en polyuréthane ou en élastomère de silicone (moins thrombogènes), la limitation des manipulations de la ligne veineuse, un remplacement régulier des tubulures (2-3 jours), le remplacement des tubulures utilisées pour les dérivés sanguins ou les lipides dans les 24h et la durée du cathétérisme la plus courte possible. Le changement systématique des cathéters à intervalles prédéfinis n'est plus recommandé car il augmente le risque infectieux. L'utilisation de cathéters imprégnés d'antibiotiques ou d'antiseptiques est déconseillée en première intention en raison du risque d'émergence de bactéries résistantes. La tunnelisation des cathéters jugulaires et fémoraux peut diminuer le risque d'ILC, mais son intérêt est limité pour les cathéters sous-claviers et disparaît quand la prise en charge est assurée par une équipe spécialisée. Des protocoles écrits, la formation du personnel et des programmes d'éducation sont essentiels pour une prévention efficace.
