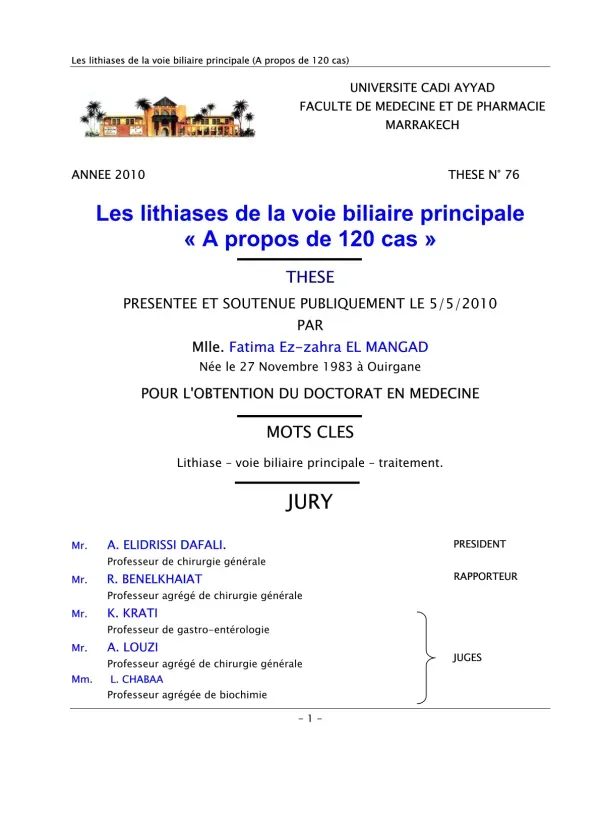
Thèse sur les lithiases de la voie biliaire principale
Informations sur le document
| Auteur | Mlle. Fatima Ez-zahra El Mangad |
| instructor/editor | Mr. A. Elidrissi Dafali, Professeur de chirurgie générale |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Type de document | Thèse |
| Lieu | Marrakech |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 4.24 MB |
- lithiase biliaire
- médecine
- chirurgie
Résumé
I.Diagnostic de la Lithiase de la Voie Biliaire Principale LVBP
Le diagnostic de la LVBP repose principalement sur la cholangiographie per-opératoire, examen de référence. Des techniques moins invasives comme l’écho-endoscopie et la bili-IRM permettent des progrès significatifs. L’échographie est utilisée en première intention, mais sa sensibilité est limitée, notamment pour les micro-calculs. Le scanner est réservé aux cas particuliers (obésité, aérocolie, hyperlipasémie). L'IRM cholangiographie offre une sensibilité et une spécificité élevées (80-100% et 90-100% respectivement), notamment pour détecter les calculs plus grands que 3mm et les calculs non-impactés, mais peut présenter des faux négatifs liés à la présence de bulles d'air ou de caillots. L’écho-endoscopie, semi-invasive, détecte même les micro-calculs grâce à sa résolution spatiale exceptionnelle.
1. Cholangiographie per opératoire et techniques moins invasives
La cholangiographie per-opératoire demeure l'examen de référence pour le diagnostic de la lithiase de la voie biliaire principale (LVBP), offrant une précision inégalée pour la visualisation directe des calculs. Cependant, l'écho-endoscopie et la bili-IRM sont présentées comme des alternatives moins invasives, permettant des progrès significatifs dans le diagnostic positif. Ces techniques permettent une meilleure visualisation des voies biliaires, facilitant ainsi la détection des calculs. L'utilisation de ces méthodes moins invasives est encouragée pour réduire le recours à la chirurgie exploratrice plus invasive. Toutefois, l'exactitude et la fiabilité de la cholangiographie per-opératoire restent essentielles pour confirmer le diagnostic et guider le traitement chirurgical.
2. Rôle de l échographie et du scanner
L'échographie est mentionnée comme un examen initial dans la stratégie diagnostique de la LVBP. Cependant, ses performances sont jugées médiocres et peu reproductibles, avec une sensibilité variable selon les études, allant de 20% à 75%. La difficulté de visualisation est accrue en présence de patients obèses ou d'une importante aérocolie. Les calculs sont plus facilement visibles lorsqu'ils sont volumineux, nombreux, et avec un cône d'ombre. Malgré sa faible sensibilité, la spécificité de l'échographie est excellente. La tomodensitométrie (TDM ou scanner), malgré son coût plus élevé, est considérée comme un examen complémentaire utile dans des situations spécifiques. Elle est notamment recommandée chez les patients obèses, ceux présentant une aéroiléocolie importante, en cas d'hyperlipasémie, ou lorsque la clinique évoque une pathologie néoplasique du carrefour biliopancréatique. La sensibilité du scanner, même avec des coupes épaisses (2-3mm), reste limitée (inférieure à 80%), car une partie des calculs est isodense à la bile.
3. Cholangiographie par IRM et Écho endoscopie Performances et Applications
La cholangiographie par IRM est décrite comme une technique non invasive produisant des images similaires à la cholangiographie directe, sans injection de produit de contraste. L'utilisation de coupes fines et d'acquisitions 3D améliore la qualité des images et permet d'éviter les faux négatifs. Des erreurs de diagnostic sont toutefois possibles, notamment avec la présence de bulles d'air ou de caillots simulant des calculs. Les performances de l'IRM pour le diagnostic de lithiase cholédocienne sont élevées, avec une sensibilité variant entre 80 et 100% et une spécificité excellente (90-100%). Les faux négatifs concernent principalement les micro-calculs (inférieurs à 3 mm) ou les calculs impactés. L'écho-endoscopie, quant à elle, est une technique semi-invasive très efficace dans le diagnostic des lésions de la tête du pancréas et l'exploration des obstacles biliaires extra-hépatiques, permettant la détection de micro-calculs invisibles aux autres techniques d'imagerie grâce à sa résolution spatiale exceptionnelle. Elle est particulièrement indiquée avant une cholécystectomie coelioscopique, en l'absence de cholangiographie per-opératoire, pour diminuer le risque de lithiase résiduelle. Une étude mentionnée (Carlo F et al) préconise le traitement immédiat de toute LVBP détectée par écho-endoscopie, suivi d’une cholangiographie rétrograde endoscopique et d’une sphinctérotomie endoscopique.
II.Traitement de la LVBP
Le traitement de la LVBP est principalement chirurgical, majoritairement réalisé par chirurgie laparoscopique. La cholécystectomie peut être réalisée simultanément si une lithiase vésiculaire est présente. Le drainage biliaire endoscopique est indiqué dans les cas graves d’angiocholite et certaines pancréatites aiguës sévères. L’extraction des calculs peut se faire par différentes voies chirurgicales : extraction trans-cystique, sphinctérotomie Oddienne chirurgicale, ou voie combinée. Un drainage biliaire externe (DK) est souvent utilisé post-opératoirement. Des anastomoses bilio-digestives (anastomose cholédoco-duodénale) peuvent être nécessaires dans certains cas complexes. La sphinctérotomie endoscopique est une alternative thérapeutique importante.
1. Chirurgie Laparoscopique vs. Endoscopique
Le traitement de la lithiase de la voie biliaire principale (LVBP) est majoritairement chirurgical depuis une dizaine d'années, privilégiant l'approche laparoscopique. Cette technique, nécessitant une expertise chirurgicale particulière, est préférée au traitement endoscopique dans la plupart des situations. Cependant, les formes graves d'angiocholite et certaines pancréatites aiguës sévères justifient un drainage biliaire endoscopique, soulignant l'importance d'une approche thérapeutique adaptée à la gravité de la situation clinique. La chirurgie laparoscopique permet de traiter simultanément la LVBP et une éventuelle lithiase vésiculaire, optimisant la prise en charge du patient. Le choix entre chirurgie et traitement endoscopique dépend donc fortement du contexte clinique et de la sévérité de l'affection.
2. Voies Chirurgicales d Extraction des Calculs
L'extraction des calculs de la voie biliaire principale peut être réalisée par différentes voies chirurgicales. L'extraction trans-cystique, consistant à extraire les calculs par le canal cystique, est envisagée lorsque cela est anatomiquement possible. Cette technique dépend de la disposition anatomique du canal cystique et du type de lithiase. Différents niveaux d'incision canaliculaire sont possibles, avec des implications sur les risques de lésion vasculaire (vaisseaux pancréatico-duodénaux supérieurs). Des incisions horizontales ou obliques sont préférées en cas de dilatation importante du canal, pouvant mener à une anastomose bilio-digestive. La sphinctérotomie Oddienne chirurgicale (SOC), par voie trans-duodénale, est une autre technique décrite. Elle implique une duodénotomie horizontale, la cathétérisation du canal de Wirsung et une sphinctérotomie contrôlée. Des voies combinées peuvent également être utilisées pour optimiser l'extraction des calculs selon les circonstances.
3. Drainage Biliaire Externe et Anastomoses
Le drainage biliaire externe, souvent réalisé à l'aide d'un drain de Kehr (DK), joue un rôle crucial après la chirurgie de la VBP. Il permet de soulager la zone de suture, d'assurer une soupape de sécurité en cas d'oddite, et surtout de contrôler la vacuité de la VBP postopératoirement. C'est une méthode sécuritaire pour terminer l'intervention. Dans certains cas, notamment en cas de calculs inextirpables, d'empierrement cholédocien ou de circonstances particulières (âge avancé, dilatation importante de la voie biliaire), une anastomose bilio-digestive, telle qu'une anastomose cholédoco-duodénale (ACD), peut être réalisée. Il existe deux types d'ACD : latéro-latérale (ACDLL) et termino-latérale (ACDTL). L'ACDLL, plus fréquemment utilisée, présente un risque, bien que faible, de lithiase résiduelle ou d'angiocholite. Le choix du drainage ou de l'anastomose dépend de nombreux facteurs, incluant la complexité de l'intervention et l'état du patient.
III.Complications et Lithiase Résiduelle
Les complications post-opératoires incluent les fuites biliaires, les péritonites et les infections. L'antibioprophylaxie est systématique. La lithiase résiduelle reste un problème majeur, même avec les progrès techniques. Son incidence est difficile à estimer, augmentant avec le temps postopératoire. La cholangiographie per-opératoire (CPO), selon certaines études, devrait être systématique pour réduire le risque de lithiase résiduelle et faciliter la prise en charge immédiate d'éventuelles lésions iatrogènes de la voie biliaire principale.
1. Complications liées au drain de Kehr DK
Le document mentionne des complications liées à l'utilisation du drain de Kehr (DK), un drain en T utilisé pour le drainage biliaire externe. Dans la série étudiée, 4 cas (27%) de complications ont été observés, tous liés à une fuite biliaire cholédocienne due à une mauvaise étanchéité de la cholédocotomie. Dans un cas, l'évolution a été favorable, tandis que les autres cas ont nécessité une réintervention en raison d'une péritonite biliaire. Ces complications soulignent l'importance d'une technique chirurgicale rigoureuse lors de la pose du DK et de la vérification minutieuse de l'étanchéité de la suture pour prévenir de telles complications potentiellement graves. La prévention des fuites biliaires et des complications infectieuses associées reste un objectif primordial dans la prise en charge post-opératoire des patients ayant subi une intervention chirurgicale sur les voies biliaires.
2. Lithiase Résiduelle Problématique et Prévention
La lithiase résiduelle (LR) représente une complication majeure de la chirurgie de la lithiase de la voie biliaire principale (LVBP). Sa fréquence est difficile à évaluer précisément, car les LR asymptomatiques restent souvent non détectées. De plus, certaines LR ne se manifestent que plusieurs années après l'intervention initiale. La fréquence de la LR augmente donc avec le recul postopératoire. Les améliorations techniques de l'exploration pré- et peropératoire ont permis de réduire l'incidence de la LR, mais elle reste un défi majeur. L'étude de Sammama G (58) et la réponse du Professeur Bertrand Millat (59) plaident en faveur de la réalisation systématique de la cholangiographie peropératoire (CPO) lors de toute cholécystectomie. La CPO permettrait d'économiser des moyens diagnostiques et de reconnaître immédiatement une lésion accidentelle de la voie biliaire principale, améliorant la prise en charge et diminuant le taux de LR.
3. Rôle de la Cholangiographie Peropératoire CPO
L’absence de CPO dans la série étudiée est mentionnée comme un point important. L'étude souligne l’importance de la réalisation systématique de la CPO au cours de toute cholécystectomie. Plusieurs auteurs, dont Sammama G et le Professeur Bertrand Millat, soutiennent cette pratique. La CPO est présentée comme une mesure essentielle pour réduire le taux de lithiase résiduelle. Bien que ne prévenant pas les lésions accidentelles de la voie biliaire principale, la CPO permet leur reconnaissance immédiate, évitant une aggravation et permettant une prise en charge appropriée. Son absence ou sa mauvaise qualité peut avoir des conséquences judiciaires défavorables. La CPO est considérée comme un examen facile à réaliser dans la plupart des cas, contribuant à réduire le taux de lithiase résiduelle à environ 2% avec sa généralisation.
IV.Aspects Epidémiologiques et Cliniques
La LVBP est moins fréquente que la lithiase vésiculaire, mais souvent associée. Une prédominance féminine est observée, plus marquée chez les jeunes adultes. Les formes anictériques sont symptomatiques, avec des douleurs épigastriques et un signe de Murphy positif. La dilatation des voies biliaires est un signe échographique d'angiocholite, mais peut être absente en cas d'obstruction aiguë. Le passage spontané des calculs dans le tube digestif est un phénomène observé dans 30 à 50% des cas.
1. Fréquence et Prévalence de la Lithiase Biliaire
La lithiase de la voie biliaire principale (LVBP) est moins fréquente que la lithiase vésiculaire, bien qu'elle lui soit souvent associée. Le texte souligne que les calculs migrent généralement vers la voie biliaire principale via le canal cystique, mais il existe des cas exceptionnels de calculs primitifs, naissant directement dans la voie biliaire principale ou les voies biliaires intra-hépatiques. Une étude épidémiologique de Framingham aux États-Unis est citée, montrant une prévalence plus élevée de lithiase biliaire chez les femmes que chez les hommes, avec un risque relatif de 1,7 à 4 fois supérieur selon les études. Cette différence est plus marquée entre 20 et 30 ans, s'atténuant avec l'âge pour s'annuler après 60 à 70 ans. Le sex-ratio de 0,27 observé dans la série étudiée est conforme à d'autres séries, confirmant cette prédominance féminine.
2. Manifestations Cliniques Formes Anictériques et Cholécystite Aigue
Le document décrit les formes anictériques de la LVBP associée à une cholécystite aiguë. Cette condition se caractérise par des douleurs brutales, localisées à l'épigastre ou dans l'hypochondre droit, pouvant irradier vers l'omoplate, accompagnées d'une fièvre modérée (autour de 38,5°C). L'examen clinique révèle une douleur provoquée à la palpation de l'hypochondre droit (signe de Murphy), parfois une grosse vésicule palpable. Il est précisé que ces critères ne doivent pas être considérés comme stricts, en raison de variations anatomiques courantes. La dilatation des voies biliaires, signe échographique facile à repérer en cas d'angiocholite, peut être absente en cas d'obstruction aiguë ; elle indique plutôt la durée de l'obstruction que sa sévérité. Le passage spontané des calculs dans le tube digestif est mentionné comme un phénomène non négligeable, observé dans 30 à 50% des cas sans complications.
3. Étude de la Bile et de la Vésicule Biliaire
Concernant l'analyse de la bile, le texte indique qu'elle est parfois normale, mais le plus souvent épaisse, favorisant l'agglomération des calculs. Dans la lithiase pigmentaire, la bile est visqueuse et fortement pigmentée. Dans 50% des cas, la bile est stérile ; lorsqu'elle est infectée, les germes les plus fréquents sont les entérobactéries et les entérocoques, les anaérobies étant plus rares. La localisation vésiculaire des calculs est la plus fréquente. L'étude de la vésicule biliaire est également importante, notamment la palpation du canal cystique pour la recherche de calculs enclavés. La taille et la souplesse du canal cystique renseignent sur le choix de la voie d'extraction des calculs. Pour la voie biliaire principale (VBP), son calibre n'est pas proportionnel au nombre de calculs ; une dilatation peut se produire même en présence d'un seul calcul. Une inflammation de la paroi de la VBP, pouvant s'étendre au pédicule hépatique (pédiculite), peut également être observée.
