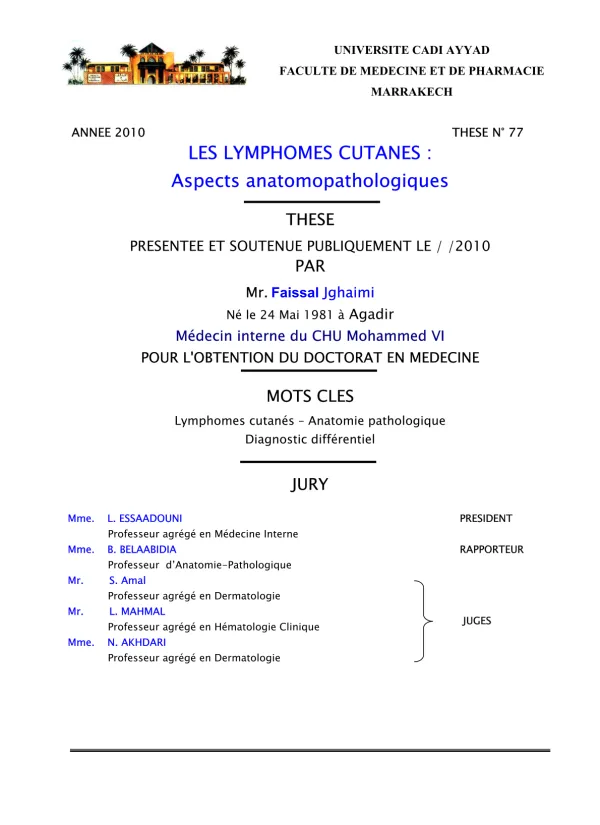
Thèse sur les Lymphomes Cutans et leur Anatomie Pathologique
Informations sur le document
| Auteur | Faissal Jghaimi |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 4.83 MB |
- Lymphomes cutanés
- Anatomie pathologique
- Médecine interne
Résumé
I.Définition et Historique des Lymphomes Cutanés
Ce document explore les lymphomes cutanés primitifs (LCP), notamment le mycosis fongoïde, une maladie caractérisée par des lésions squameuses et violacées évoluant en tumeurs. Alibert, dermatologue français, a décrit le premier cas en 1806. L'étude porte sur le diagnostic différentiel et l'anatomopathologie des LCP, distinguant les lymphomes T cutanés primitifs (LCTP) et les lymphomes B cutanés primitifs (LCBP).
1. Introduction aux Lymphomes Cutanés
Cette section introduit la notion de lymphomes cutanés primitifs (LCP), soulignant leur localisation spécifique à la peau sans atteinte extra-cutanée au diagnostic. Le texte établit une distinction entre les lymphomes à cellules T et à cellules B, deux catégories principales de LCP. Il s'agit d'une introduction générale à la problématique, posant les bases de la classification et de la distinction entre les différents types de lymphomes cutanés. La rareté de la maladie est évoquée, son incidence étant estimée à 1/100 000 par an. Le document annonce son intention d'analyser le profil anatomopathologique de ces lymphomes et d'explorer les difficultés du diagnostic différentiel, en s'appuyant sur une revue de la littérature. Une étude rétrospective menée au centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Marrakech sur 8 ans et incluant 20 patients est mentionnée.
2. Le Mycosis Fongoïde Définition et Premier Cas Documentaire
Le document introduit le mycosis fongoïde, un type spécifique de lymphome cutané. Il met en lumière la contribution d'Alibert, dermatologue français, qui en 1806 fut le premier à utiliser ce terme pour décrire un cas clinique. Le texte détaille brièvement ce cas initial, décrivant le patient (Lucas, 56 ans) et l'évolution de sa maladie, marquée par une éruption cutanée desquamative, l'apparition de tumeurs sur le corps et le visage, et une issue fatale après cinq années de maladie. Cette description historique permet de contextualiser la compréhension du mycosis fongoïde, en soulignant son évolution depuis sa première description clinique jusqu'à la recherche actuelle sur sa pathogénèse. L'étude du cas initial par Alibert constitue un jalon important dans la compréhension de cette maladie spécifique des lymphomes cutanés.
3. Anatomie de la Peau et Aspects Cellulaires
Une brève description de l'anatomie de la peau est fournie, mentionnant ses quatre couches (épiderme, jonction dermo-épidermique, derme, hypoderme) et ses annexes (follicules pilo-sébacés). Ceci est important pour contextualiser la localisation des lymphomes cutanés au sein de la structure cutanée. Bien que cette partie ne soit pas exhaustive, elle établit un lien entre l’environnement physique où se développe la maladie et les éléments cellulaires qui seront ensuite détaillés. La description des différentes couches sert à contextualiser la discussion sur l'infiltration lymphocytaire et le développement des lymphomes dans les tissus cutanés. L'inclusion de cette section souligne l'importance de la compréhension de l'anatomie pour l'analyse des processus pathologiques dans la peau.
II.Physiopathologie des Lymphomes Cutanés T
L'analyse se concentre sur les lymphocytes T cutanés, leur phénotype (CD4+, CD8+), et leur rôle dans la pathogenèse des LCTP. Des facteurs génétiques (aberrations chromosomiques, mutations de p53 et c-myc), infectieux (implication possible du virus HTLV-1, bien que non confirmée de manière définitive), et environnementaux (rayons UV) sont discutés. L'antigène lymphocytaire cutané (CLA) joue un rôle clé dans le tropisme cutané des lymphocytes T.
1. Population Lymphocytaire Cutanée et Activation Cellulaire
Cette section décrit la population lymphocytaire normale de la peau, composée principalement de lymphocytes T CD8+ (suppresseurs/cytotoxiques) et CD4+ (auxiliaires/inducteurs), présents en proportions à peu près égales. Les lymphocytes CD4+ cutanés présentent un phénotype particulier (CD45RA–, CDw29+) suggérant une activation permanente. Seuls 5% des lymphocytes cutanés sont des cellules naïves (CD4+, CD45RA+, CDw29–), contrairement aux lymphocytes sanguins où elles représentent 50% des cellules T CD4+. La majorité des lymphocytes se concentrent dans le derme papillaire, autour des veinules post-capillaires, tandis que les rares cellules T épidermiques appartiennent à la sous-classe CD8+. La plupart des lymphocytes cutanés expriment le dimère α du récepteur à l'antigène du lymphocyte T (TCR), sauf un petit nombre de cellules épidermiques exprimant le récepteur γ, suggérant une appartenance à la classe des cellules NK (Natural Killer). Le texte explique le rôle des cytokines, certaines stimulant l'activation lymphocytaire (IL1, IL2, IL8, TNF-alpha, GM-CSF, IL6) et d'autres l'inhibant (KLIF, ELDIF, acide urocanique, prostaglandine E2), produites par les kératinocytes activés ou d'autres sources. L'équilibre de ces cytokines est crucial dans le maintien de l'homéostasie immunitaire cutanée.
2. Antigène Lymphocytaire Cutané CLA et Tropisme Cutané
L’antigène lymphocytaire cutané (CLA) et l’antigène Lewis X sont présentés comme des molécules exprimées à la surface des lymphocytes T. Alors que le rôle de l'antigène Lewis X dans le tropisme cutané reste inconnu, le CLA confère un tropisme sélectif pour la peau. Son expression est observée dans la peau normale et inflammatoire, ainsi que dans la plupart des lymphomes T cutanés primitifs, mais son absence est notée dans les lymphomes d'autres localisations. Cette spécificité du CLA pour les lymphomes T cutanés en fait un marqueur important dans le diagnostic et la compréhension de la pathogenèse de ces lymphomes. La présence de CLA souligne un mécanisme clé dans la localisation préférentielle des lymphocytes T impliqués dans le développement des lymphomes cutanés.
3. Facteurs Génétiques Infectieux et Environnementaux dans la Pathogenèse des LCTP
Plusieurs facteurs contribuent à la pathogenèse des lymphomes T cutanés primitifs (LCTP). Des aberrations génétiques fréquentes sont mises en évidence sur les chromosomes 1, 6 et 11. Des mutations des gènes suppresseur p53 (chromosome 17) et oncogène c-myc (chromosome 8) semblent jouer un rôle important. De plus, des mutations de gènes impliqués dans l'apoptose (protéine Fas) et une activité élevée de la télomérase sont impliquées. Concernant les facteurs infectieux, une possible association avec le virus HTLV-1 a été évoquée, notamment en raison de similitudes cliniques avec des lymphomes leucémiques. Des études initiales ont montré une sérologie positive dans 10 à 15% des cas de mycosis fongoïde, mais ces résultats n'ont pas été confirmés. Des techniques plus récentes (hybridation moléculaire, mesure de l'activité reverse transcriptase) n'ont pas permis de confirmer une implication directe du HTLV-1, bien que des observations isolées suggèrent une possible implication de virus HTLV-1 défectueux ou d'autres rétrovirus. Enfin, l'exposition aux rayons UV est mentionnée comme un facteur environnemental pouvant intervenir dans la progression de la maladie, notamment vers le stade tumoral, malgré des observations contradictoires quant à son influence sur l'incidence. L'exposition à des substances radioactives comme le plutonium et le tritium a également été associée à des cas de mycosis fongoïde et de parapsoriasis.
III.Lymphomes Cutanés B et Lésions Précurseurs
Les lymphomes cutanés B sont moins fréquents que les lymphomes T dans la peau. Le document aborde leur migration et leur affinité pour la peau, ainsi que les anomalies génétiques associées (mutations de p15, p16, et p53, surexpression de BCL2). Le parapsoriasis, une lésion précurseur, est détaillé, distinguant les formes bénignes et malignes, avec une possibilité de transformation en mycosis fongoïde dans certains cas. L'importance d'une biopsie cutanée adéquate est soulignée.
1. Rareté des Lymphomes B Cutanés et Questions sur leur Migration
Contrairement aux lymphomes humains, majoritairement de type B, la peau présente une prédominance de lymphomes T. Cette inversion est expliquée par la rareté des lymphocytes B dans la peau, sauf en cas d'infection (ex: borréliose). Le document soulève des questions concernant la migration des lymphocytes B vers la peau et leur affinité pour ce tissu. L'absence d'équivalent cutané aux plaques de Peyer (intestin) ou à l'anneau de Waldeyer (pharynx) est mentionnée. Seules les glandes sudoripares et sébacées sont productrices d'IgA. Cependant, le derme et le système de drainage lymphatique forment un système intégré permettant une réponse lymphoproliférative aux stimuli antigéniques. Certains lymphomes cutanés B primitifs pourraient représenter une amplification néoplasique de ce processus, suggérant un dysfonctionnement du système immunitaire cutané (SALT - Skin Associated Lymphoid Tissue). La compréhension de ces mécanismes de migration et d'affinité est essentielle pour une meilleure appréhension des lymphomes B cutanés primitifs.
2. Anomalies Génétiques dans les Lymphomes Cutanés B
L'inactivation et la mutation des gènes suppresseurs p15, p16 et p53, par délétion ou hyperméthylation de la région du promoteur, sont mises en évidence dans un certain nombre de lymphomes cutanés B. Ces gènes régulent normalement le cycle cellulaire: p53 empêche l'entrée en cycle via p21, inhibiteur de kinases cycline-dépendantes; p16INK4a inhibe la transition G1-S. Une étude danoise (1999) a trouvé des mutations du gène p53 dans 21% des lymphomes cutanés B primitifs étudiés (21 cas). D'autres anomalies génétiques, notamment des facteurs de transcription et des oncogènes (BCL2, BCL6, MYC, JUNB), sont impliquées. L'amplification et la surexpression du gène BCL2 (protéine mitochondriale anti-apoptotique), liées à des gains sur le chromosome 18q, ont été identifiées dans un sous-groupe de lymphomes cutanés B à grandes cellules de type membre inférieur. Ces anomalies génétiques jouent un rôle crucial dans la pathogenèse des lymphomes cutanés B primitifs.
3. Le Parapsoriasis Lésion Précurseur des Lymphomes Cutanés
Le parapsoriasis est décrit comme une lésion précurseur des lymphomes cutanés, regroupant des pathologies diverses se manifestant par des lésions érythémato-squameuses chroniques. Deux types sont distingués : les formes bénignes (petites plaques, maladie de Brocq), ne se transformant jamais en lymphome malin, et les formes à grandes plaques (avec ou sans poïkilodermie), pouvant évoluer vers un mycosis fongoïde après plusieurs décennies (10 à 50% des cas). Histologiquement, les lésions des parapsoriasis à grandes plaques diffèrent du mycosis fongoïde. On observe une parakératose focale, une légère atrophie de l'épiderme, une organisation lymphocytaire en bande dans le derme superficiel, épargnant le derme papillaire, et une absence d'épidermotropisme significatif. La variante poikilodermique présente une dilatation vasculaire au niveau du derme superficiel. Des réarrangements clonaux du gène TCR sont possibles dans la moitié des cas, sans signification pronostique. La réalisation d'une biopsie cutanée (au moins 1cm, de préférence en fuseau) est recommandée, avec une manipulation soigneuse des tissus pour éviter les artefacts.
IV.Classification et Stadification des Lymphomes Cutanés
La classification des lymphomes cutanés a évolué, passant d'une approche limitée à une classification OMS-EORTC plus pragmatique. Le document mentionne la classification EORTC qui distingue les lymphomes indolents, agressifs et d'incertitude pronostique. La stadification TNM est décrite pour guider la prise en charge thérapeutique, incluant le mycosis fongoïde et le syndrome de Sézary.
1. Évolution des Classifications des Lymphomes Cutanés
La classification des lymphomes cutanés a considérablement évolué au cours des dernières décennies. Initialement limitée à quelques sous-catégories de lymphomes extra-ganglionnaires, elle est devenue plus pragmatique et adaptée à la pratique clinique grâce à une collaboration entre l'EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) et l'OMS (Organisation mondiale de la santé), ainsi qu'entre cliniciens et pathologistes. Les nombreuses classifications publiées dans les années 70 ont engendré une certaine confusion. La classification de Kiel, notamment sa version de 1988, a été prédominante. La classification EORTC de 1997, appliquée aux lymphomes cutanés primitifs uniquement (excluant les localisations secondaires), distingue des sous-groupes avec des profils cliniques et pronostiques différents, même pour un même type histologique que les lymphomes ganglionnaires. Elle différencie les lymphomes indolents des lymphomes agressifs, et inclut une catégorie provisoire pour les entités mal établies (environ 5%). L'aspect serpigineux ou 'gyrata' de certaines lésions souligne la variabilité de l'infiltration, variable d'une lésion à l'autre et même au sein d'une même lésion.
2. Classification EORTC et Aspects Cliniques
La classification EORTC, axée sur les lymphomes cutanés primitifs, souligne l'importance de leur distinction des lymphomes secondaires en raison de leurs profils cliniques et pronostiques différents, nécessitant des traitements distincts. Elle catégorise les lymphomes en indolents, agressifs, et à pronostic incertain. Certaines entités, moins établies, sont classées provisoirement. La description des aspects cliniques précise une distribution asymétrique des lésions, avec prédilection pour les hanches, fesses, lombes, aisselles, aines et poitrine. Une atteinte des paumes et des plantes, avec hyperkératose et fissuration, est possible, ainsi qu'une alopécie dans les zones atteintes du cuir chevelu. L'évolution peut s'accélérer à un certain stade, mais l'état général du patient reste généralement bien préservé. Le document mentionne un stade tumoral caractérisé par l'apparition de nodules tumoraux, de taille variable, pouvant s'ulcérer. La topographie des lésions est décrite comme une infiltration dermique superficielle formant une bande continue sous-épidermique, avec une exocytose dans le corps muqueux, parfois présentant l'aspect classique des 'microabcès' de Pautrier. Des aspects de lymphadénopathie dermatopathique ('réticulose lipomélanique de Pautrier-Woringer') peuvent aussi être observés.
3. Stadification TNM et Facteurs Pronostiques
La stadification des lymphomes cutanés primitifs se fait selon une classification TNM, visant à établir un pronostic et à orienter le traitement. La prise en charge diffère selon le type de lymphome (mycosis fongoïde, lymphomes T érythrodermiques, autres lymphomes cutanés). Si la classification du mycosis fongoïde et des lymphomes érythrodermiques est bien établie, celle des autres lymphomes est plus récente. Dans le syndrome de Sézary, l'âge, le stade TNM, et l'envahissement sanguin sont des facteurs pronostiques importants (les patients de moins de 65 ans ont un pronostic plus favorable). Un délai prolongé avant le diagnostic est associé à un meilleur pronostic. Une étude multivariée a identifié la localisation aux jambes, la dissémination des lésions cutanées et une forte expression de bcl-2 comme facteurs indépendants de mauvais pronostic. Le document mentionne la nécessité d'étudier la survenue ultérieure de cancers, chez les patients atteints de lymphomes cutanés, questionnant le rôle carcinogène ou immunosuppresseur des traitements, avec une incidence accrue des cancers épithéliaux (10%) et une possible association avec les mélanomes, bien que des études épidémiologiques complémentaires soient nécessaires.
V.Diagnostic Différentiel et Aspects Cliniques
Le document aborde les problèmes de diagnostic différentiel des lymphomes cutanés, en particulier pour le mycosis fongoïde, avec des maladies comme le pseudomycosis fongoïde médicamenteux, la mucinose folliculaire, la papulose lymphomatoïde, et les pseudolymphomes. Des aspects cliniques et histopathologiques (présence de microabcès de Pautrier, épidermotropisme) sont décrits pour chaque entité.
1. Diagnostic Différentiel du Mycosis Fongoïde
Le diagnostic différentiel du mycosis fongoïde est complexe. Le document souligne la nécessité d'une confrontation anatomo-clinique. Le pseudomycosis fongoïde médicamenteux peut imiter un véritable mycosis fongoïde. Cliniquement, un faible nombre de lésions ou la présence de lésions infiltrées, nodulo-tumorales, peuvent évoquer un pseudolymphome, alors qu'il pourrait s'agir d'un mycosis fongoïde débutant. Histologiquement, l'absence de microabcès de Pautrier et un épidermotropisme faible suggèrent un pseudolymphome. Cependant, une disposition en bandes de l'infiltrat, un épidermotropisme, et/ou des cellules atypiques peuvent faussement orienter vers un mycosis fongoïde. La perte d'antigènes communs et des réarrangements dominants ont été observés dans des pseudolymphomes T cutanés. Des études génotypiques ont démontré la présence de populations lymphocytaires monoclonales dans de nombreux cas de pseudolymphomes médicamenteux. Le texte met en avant la difficulté de diagnostiquer les formes atypiques de mycosis fongoïde, telles que les formes avec hyperplasie psoriasiforme (notamment palmo-plantaires) ou neutrophilique, où le faible nombre de lymphocytes atypiques est masqué par les polynucléaires. Des biopsies répétées peuvent être nécessaires.
2. Autres Diagnostics Différentiels Mucineuse Folliculaire Papulose Lymphomatoïde et Pseudolymphomes
Le diagnostic différentiel du mycosis fongoïde inclut la mucinose folliculaire. Bien qu'une surveillance soit nécessaire car elle peut précéder un mycosis fongoïde, aucun signe histologique ne permet de distinguer formellement une forme bénigne d'une forme associée à un mycosis fongoïde. L'absence d'atypie lymphocytaire et de clonalité T, ainsi que la présence d'un granulome avec macrophages, éosinophiles et lymphocytes B, peuvent être observés dans les deux cas. Le diagnostic de mycosis fongoïde repose sur la présence de plaques cutanées avec épidermotropisme de lymphocytes atypiques. La papulose lymphomatoïde (A ou B) et le pityriasis lichénoïde posent aussi un problème de diagnostic différentiel, partageant un terrain commun (sujets jeunes et enfants), avec des lésions papuleuses pouvant régresser spontanément. Le diagnostic différentiel repose sur la présence d'une parakératose continue, d'un épidermotropisme avec apoptose kératinocytaire, d'infiltrats lymphocytaires péri-vasculaires et péri-annexielles, et d'une extravasation érythrocytaire dans le pityriasis lichénoïde. Les lymphocytes ne sont pas atypiques et n'expriment pas majoritairement CD30. Les pseudolymphomes, liés à des piqûres d'insectes, une gale ou une virose, peuvent contenir des cellules CD30 non anaplasiques et en nombre réduit, évitant une confusion avec une lymphoprolifération CD30+. Un taux de cellules CD30+ supérieur à 75% est requis pour diagnostiquer un lymphome cutané CD30.
3. Aspects Histopathologiques Différentiels
L'histologie permet une différenciation plus fine. Pour le mycosis fongoïde pilotrope sans mucine, on observe un infiltrat lymphocytaire pilotrope, plus ou moins abondant selon le stade. Ce pilotropisme n'altère pas le mur folliculaire. L'infiltrat est monotone et sans polynucléaires neutrophiles. La confrontation anatomo-clinique et des biopsies répétées sont utiles. Dans les lymphomes à grandes cellules pagétoïdes, l'épidermotropisme de l'infiltrat est massif, avec acanthose et désagrégation des couches basales de l'épiderme. Les cellules sont de taille moyenne à grande, avec un noyau hyperchromatique et convoluté, et un cytoplasme abondant et vacuolisé. L'infiltrat dermique est plus polymorphe que dans le mycosis fongoïde. La chalazodermie granulomateuse, qui atteint principalement les hommes, se caractérise par des plaques rouge violacé devenant atrophiques au centre. Des études comparant le mycosis fongoïde et le syndrome de Sézary montrent des résultats discordants concernant la présence de microabcès de Pautrier, d'acanthose, et d'œdème du derme superficiel.
VI.Bilan d Extension et Pronostic
Le bilan d'extension des lymphomes cutanés, adapté au type de lymphome et à son degré d'extension, est discuté. Le document souligne l'importance de la classification TNM pour déterminer le pronostic. Des facteurs pronostiques sont mentionnés, notamment l'âge, le stade de la maladie, l'implication ganglionnaire, et la présence de BCL2. L'association possible entre les lymphomes cutanés et d'autres cancers (notamment pulmonaires et coliques) est également abordée.
1. Difficultés du Diagnostic Différentiel
Le diagnostic différentiel des lymphomes cutanés est complexe et repose sur une analyse combinée des aspects cliniques et histopathologiques. Le document souligne les difficultés liées à la ressemblance entre certaines affections bénignes et les lymphomes, rendant nécessaire une approche rigoureuse. Le pseudomycosis fongoïde médicamenteux est mentionné comme une source majeure de confusion avec un véritable mycosis fongoïde. La confrontation anatomo-clinique est essentielle pour différencier ces affections. L'évaluation du nombre de lésions, de leur aspect (infiltrées, nodulo-tumorales), ainsi que la présence ou l'absence de microabcès de Pautrier et d'épidermotropisme sont des éléments clés du diagnostic différentiel. Des situations cliniques peuvent être trompeuses, avec des présentations atypiques de mycosis fongoïde masquant les lymphocytes atypiques par un infiltrat polynucléaire important. Des biopsies répétées sont parfois nécessaires pour établir un diagnostic fiable. La distinction entre les lymphomes cutanés et les pseudolymphomes, notamment ceux induits par des médicaments, est un point critique, nécessitant des investigations plus poussées comme des études génotypiques pour détecter d'éventuelles populations lymphocytaires monoclonales.
2. Diagnostics Différentiels avec d Autres Affections Cutanées
Le document détaille plusieurs diagnostics différentiels avec d’autres dermatoses. La mucinose folliculaire, qui peut précéder un mycosis fongoïde, pose un défi diagnostic. Malgré l'absence d'atypie lymphocytaire et de clonalité T, un diagnostic de mycosis fongoïde peut être posé en présence de plaques cutanées avec épidermotropisme de lymphocytes atypiques. Le pityriasis lichénoïde et la papulose lymphomatoïde partagent des caractéristiques cliniques (sujets jeunes, lésions papuleuses régressives), mais se distinguent histologiquement par la présence d'une parakératose, d'un épidermotropisme avec apoptose kératinocytaire, d'infiltrats lymphocytaires péri-vasculaires et péri-annexielles, et d'extravasation érythrocytaire dans le pityriasis lichénoïde. Les lymphocytes dans le pityriasis lichénoïde ne sont pas atypiques et n'expriment pas majoritairement CD30, contrairement à certains lymphomes. La distinction avec les pseudolymphomes est aussi abordée. La présence de cellules CD30 dans les pseudolymphomes liés à des piqûres d'insectes, une gale ou une virose est discutée, soulignant l'importance du nombre et de la morphologie des cellules CD30 pour le diagnostic différentiel.
3. Comparaison Histopathologique et Aspects Cliniques de Maladies Similaires
L'analyse histopathologique joue un rôle crucial dans le diagnostic différentiel, notamment pour distinguer le mycosis fongoïde de maladies présentant des similitudes cliniques. Des comparaisons histopathologiques entre le mycosis fongoïde et le syndrome de Sézary sont présentées, soulignant l’absence de consensus. Certains auteurs insistent sur la présence de microabcès de Pautrier comme critère distinctif du mycosis fongoïde, tandis que d'autres études mettent en avant la présence de ces microabcès et d'un œdème du derme superficiel dans le syndrome de Sézary. Une acanthose est mentionnée comme un élément différentiel, plus souvent observé dans le syndrome de Sézary. L'épidermotropisme, l'acanthose et l'hyperkératose seraient plus fréquents dans le mycosis fongoïde. L’analyse histopathologique du mycosis fongoïde pilotrope sans mucine souligne l’absence de modifications du mur folliculaire et un infiltrat lymphocytaire monotone, à distinguer d'une folliculite. De même, l’analyse histopathologique du lymphome pagétoïde décrit un épidermotropisme massif avec acanthose et désagrégation des couches basales, des cellules de taille moyenne à grande, et un infiltrat dermique plus polymorphe que dans le mycosis fongoïde. La chalazodermie granulomateuse, quant à elle, se présente cliniquement par des plaques rouge violacé.
VII.Étude Rétrospective à Marrakech
L'étude rétrospective, menée sur une période de 8 ans au centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Marrakech, a porté sur 20 patients atteints de LCP. (Note: No further specific details about the patients or the study's findings beyond this are provided in the original text).
1. Description de l Étude Rétrospective
La section décrit une étude rétrospective menée au Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI de Marrakech sur une période de 8 ans. Cette étude a porté sur 20 patients présentant un lymphome cutané primitif (LCP). L'objectif principal était de déterminer le profil anatomopathologique des LCP et d'analyser les problèmes de diagnostic différentiel en se référant à la littérature existante. Le texte précise qu'il s'agit d'une étude rétrospective, ce qui implique une analyse de données déjà collectées. L’étude est localisée géographiquement au Maroc, à Marrakech, et dans un contexte spécifique: le Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI. La durée de l’étude (8 ans) suggère une analyse sur une période significative, permettant une observation d'un nombre conséquent de cas. Le nombre de patients (20) constitue l'échantillon de cette étude rétrospective. L'absence d'informations supplémentaires sur les caractéristiques spécifiques de l'échantillon de patients (âge, sexe, types de lymphomes, etc.) limite l'analyse du contexte de l'étude.
