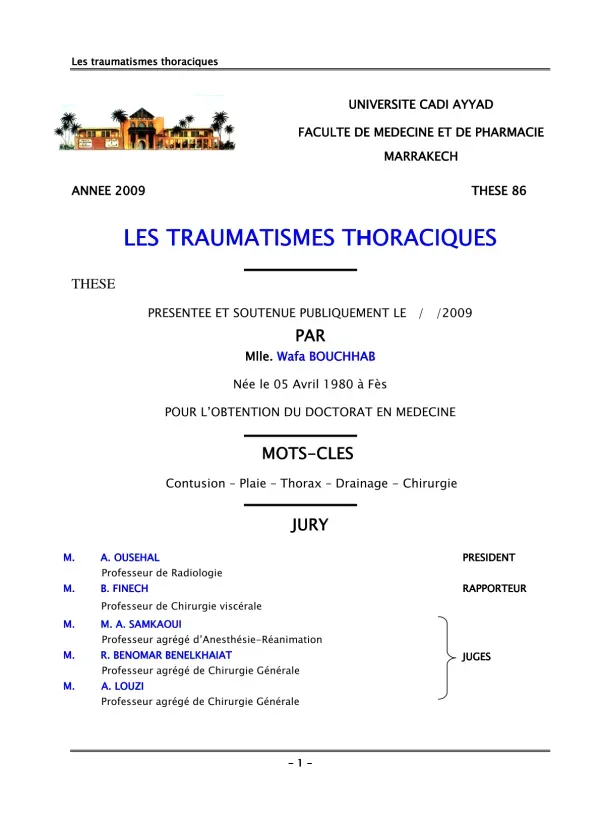
Thèse sur les Traumatismes Thoraciques
Informations sur le document
| Auteur | Wafa Bouchhab |
| instructor/editor | A. Ousehal, Professeur de Radiologie |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 2.00 MB |
- Traumatismes thoraciques
- Médecine
- Université Cadi Ayyad
Résumé
I.Diagnostic et prise en charge des traumatismes thoraciques
Cette étude rétrospective, menée au service de chirurgie viscérale du CHU Mohammed VI de Marrakech sur 120 cas de traumatismes thoraciques (septembre 2007 - août 2008), analyse les facteurs épidémiologiques, les caractéristiques cliniques et anatomo-pathologiques, ainsi que les méthodes thérapeutiques. Les accidents de la voie publique constituent la cause la plus fréquente de traumatisme thoracique fermé (79,6%). Le diagnostic repose sur l'examen clinique (douleur thoracique, dyspnée, tachypnée, signes de choc), la radiographie thoracique, et surtout la tomodensitométrie thoracique (TDM), essentielle pour l'évaluation de la contusion pulmonaire, des ruptures diaphragmatiques, des pneumothorax, et des hémothorax. La gestion des cas inclut le drainage thoracique, la vidéothoracoscopie, et la chirurgie thoracique (thoracotomie, sternotomie) en fonction de la sévérité des lésions et de l'état hémodynamique du patient. L'analgésie joue un rôle crucial dans la prise en charge de la douleur et l'amélioration de la mécanique respiratoire.
1. Épidémiologie et présentation clinique des traumatismes thoraciques
L'étude rétrospective, réalisée au CHU Mohammed VI de Marrakech entre septembre 2007 et août 2008, a porté sur 120 patients victimes de traumatismes thoraciques. La population étudiée comprenait 104 hommes et 16 femmes, avec un âge moyen de 39 ans (14 à 64 ans). Un point clé ressort de l'analyse épidémiologique : les accidents de la voie publique sont la cause principale des traumatismes thoraciques fermés, représentant 79,6% des cas. La symptomatologie des patients varie, mais inclut des signes de détresse respiratoire (polypnée, tirage, cyanose) et des signes de choc hémorragique (pâleur, sueurs, froideur des extrémités, anxiété). Des signes de choc cardiogénique peuvent également être présents, suggérant une atteinte myocardique sévère ou une tamponnade. Une asymétrie des pouls périphériques suggère une atteinte des gros vaisseaux, tandis qu'un emphysème cervical peut indiquer une rupture trachéo-bronchique. La douleur, signe fonctionnel majeur chez les patients conscients, doit être précisément localisée et caractérisée pour différencier une atteinte pariétale d'une atteinte organique. La douleur thoracique est constante mais difficile à évaluer objectivement. La tachypnée et l'hypoxémie sont des signes capitaux, l'hypoxémie devant être systématiquement recherchée par oxymétrie de pouls et gazométrie sanguine. Une mesure du degré de restriction ventilatoire par spirométrie est idéale, mais souvent impossible en phase initiale chez les polytraumatisés graves. Le diagnostic précoce et précis des lésions thoraciques est crucial, en particulier chez les patients présentant des lésions multiples qui peuvent fausser le bilan initial.
2. Méthodes de diagnostic des traumatismes thoraciques
Le diagnostic des traumatismes thoraciques repose sur une approche combinée. La radiographie thoracique constitue le point de départ de l’investigation, permettant une première évaluation des lésions. Cependant, la tomodensitométrie thoracique (TDM) s'est imposée comme un examen indispensable, voire obligatoire, pour le diagnostic précis et complet des lésions. Plusieurs études ont démontré la supériorité de la TDM par rapport à la radiographie standard pour le diagnostic de lésions telles que la contusion pulmonaire, les ruptures diaphragmatiques, et l'évaluation de l'étendue des lésions parenchymateuses. La TDM permet une meilleure visualisation des lésions, améliorant ainsi la prise de décision thérapeutique. L'échographie transthoracique (ETT) peut être utilisée pour l'exploration de l'épanchement péricardique et de l'atteinte cardiaque, tandis que la thoracoscopie exploratrice représente un outil diagnostique et thérapeutique de choix, notamment pour les plaies diaphragmatiques, permettant à la fois le diagnostic et la réparation de certaines lésions. D'autres examens complémentaires peuvent être utilisés, tels que la gazométrie sanguine et l'oxymétrie de pouls, pour l'évaluation de l'hypoxémie et de la fonction respiratoire.
3. Prise en charge thérapeutique des traumatismes thoraciques
La prise en charge thérapeutique des traumatismes thoraciques est adaptée à la gravité des lésions et à l'état hémodynamique du patient. Dans les cas de traumatismes sévères avec instabilité hémodynamique, une intervention chirurgicale immédiate est souvent nécessaire, sans attendre de bilan complémentaire. Le drainage thoracique est un geste courant pour la prise en charge des hémothorax et pneumothorax. Une surveillance rigoureuse du drainage est essentielle, l'indication d'un geste d'hémostase urgent étant posée en cas de saignement abondant (plus de 1500 ml d'emblée ou plus de 200 ml/heure pendant plus de deux heures) ou d'instabilité hémodynamique. La vidéothoracoscopie, technique mini-invasive, joue un rôle croissant dans la prise en charge des hémothorax et pneumothorax, permettant de réduire la durée d'hospitalisation et les séquelles postopératoires. Les différentes voies d'abord chirurgicales (thoracotomie, sternotomie, voies combinées) sont choisies en fonction de la localisation et de l'étendue des lésions. L'analgésie joue un rôle essentiel dans la prise en charge de la douleur post-traumatique et pour améliorer la mécanique respiratoire. La morphine est souvent utilisée, et une analgésie péridurale thoracique peut être envisagée, malgré un risque de complications non négligeable. Le remplissage vasculaire doit être adapté à l'importance de l'hypovolémie et à ses conséquences hémodynamiques, avec une attention particulière aux effets secondaires sur l'hémostase.
II.Lésions spécifiques du thorax
L'étude détaille plusieurs types de lésions thoraciques : la contusion pulmonaire, souvent associée à une insuffisance respiratoire aiguë ; les ruptures diaphragmatiques, pouvant entraîner une hernie diaphragmatique avec des conséquences respiratoires et digestives ; les fractures costales, limitant la mécanique ventilatoire ; les lésions cardiaques (plaies cardiaques, commotion myocardique, contusion myocardique), représentant une urgence chirurgicale ; les lésions vasculaires (ruptures de veines pulmonaires, hémothorax), nécessitant un drainage et une hémostase rapide ; et enfin, les lésions œsophagiennes (ruptures de l'œsophage), souvent associées à des polytraumatismes. La TDM est déterminante dans le diagnostic de ces lésions.
1. Contusion pulmonaire
La contusion pulmonaire est une lésion fréquente après un traumatisme thoracique fermé, souvent secondaire à un accident de la voie publique. Dans la littérature, sa fréquence varie entre 35,2% et 50%, tandis que l'étude de Marrakech rapporte une fréquence de 25%, une différence expliquée par le recours moins systématique à la tomodensitométrie thoracique (TDM) dans cette étude. La TDM est supérieure à la radiographie thoracique pour l'exploration du parenchyme pulmonaire. La contusion pulmonaire est une cause majeure d'insuffisance respiratoire aiguë, et sa gravité est augmentée par les lésions associées et le syndrome inflammatoire réactionnel systémique qui peut survenir après un traumatisme majeur. Des études ont mis en évidence une corrélation entre le volume pulmonaire lésé, mesuré par TDM, et les modalités de traitement. Le diagnostic précoce est crucial pour adapter la ventilation et la prise en charge des fractures associées, réduisant ainsi les complications. Un pneumothorax occulte, souvent non détecté à la radiographie, peut être mis en évidence par la TDM et nécessite un drainage. La TDM permet également une évaluation de l'importance de la lésion et une meilleure prédiction du risque de SDRA.
2. Ruptures diaphragmatiques
Les ruptures diaphragmatiques sont abordées avec la présentation d'un cas de rupture diagnostiquée précocement (0,8%). Le patient, victime d'un accident de la voie publique, présentait une douleur abdominale et une dyspnée. La radiographie pulmonaire a montré une opacité basale gauche et des clartés digestives, tandis que la TDM a révélé une importante hernie diaphragmatique gauche. Cette hernie causait un effet de masse avec atélectasie passive du lobe inférieur gauche et un refoulement du médiastin. L'ascension intrathoracique d'organes abdominaux, fréquente mais inconstante, surtout chez les patients ventilés, rend le diagnostic difficile. Les organes les plus fréquemment engagés à gauche sont l'estomac, la rate (contuse dans la moitié des cas), l'intestin grêle, le grand épiploon et le côlon. À droite, il s'agit le plus souvent du lobe droit du foie, plus rarement du côlon. Une hernie diaphragmatique peut engendrer une compression du médiastin, gênant le retour veineux. Le diagnostic de rupture diaphragmatique peut être tardif, parfois révélé par des complications digestives (hémorragie digestive, volvulus, occlusion).
3. Lésions cardiaques et vasculaires
Les lésions cardiaques, souvent dues à des traumatismes pénétrants par arme blanche ou à feu, ou à des fractures costales et sternales, constituent une urgence chirurgicale avec un pronostic sombre et une mortalité élevée. La physiopathologie des arrêts cardiocirculatoires liés à ces traumatismes est détaillée, avec la description de mécanismes impliquant la fibrillation ventriculaire ou un bloc auriculo-ventriculaire complet, en fonction du moment de l'impact thoracique par rapport à l'activité électrique cardiaque. Les lésions myocardiques sont divisées en commotion myocardique (sans lésion visible à l'imagerie ou à l'histologie) et contusion myocardique. La commotion myocardique peut conduire à un arrêt cardiaque, notamment lors d'accidents sportifs. Une atteinte de la veine cave peut entraîner un décès inévitable. Les ruptures des veines pulmonaires sont exceptionnelles, généralement liées à des mécanismes de décélération brutale avec rotation. Les survivants présentent souvent une limitation du saignement par le péricarde, causant une tamponnade. Des hémoptysies graves ou des fistules artério-veineuses pulmonaires peuvent également survenir.
4. Lésions œsophagiennes et autres lésions thoraciques
Les plaies pénétrantes de l'œsophage sont rares et exceptionnellement isolées, le plus souvent causées par une arme blanche. Les ruptures de l'œsophage par traumatisme fermé thoracique sont également rares et surviennent chez les polytraumatisés. L'élévation brutale de la pression intra-œsophagienne est la cause probable de la rupture, principalement au niveau thoracique. Des lésions provoquées par un souffle d'air ou un blast peuvent entraîner des ruptures œsophagiennes étendues. Les désinsertions diaphragmatiques, décrites par Moreaux, sont des lésions irréversibles où le diaphragme se décolle de ses attaches périphériques. Elles sont plus fréquentes à droite. Le texte mentionne également d'autres lésions associées dans le contexte de polytraumatismes: plaies du scalp, fractures multiples des membres, lésions médullaires hautes, traumatismes abdominaux (fractures du foie, de la rate). Ces lésions associées contribuent à l'instabilité hémodynamique, nécessitant des techniques de réanimation.
III.Approches thérapeutiques et choix de la voie d abord
Le choix de la méthode thérapeutique dépend de la sévérité des lésions et de l’état du patient. Pour les patients en état de choc, une thoracotomie immédiate peut être nécessaire. Pour les lésions moins sévères, le drainage thoracique avec des valves d'aspiration est souvent suffisant, particulièrement pour le transport des blessés. La vidéothoracoscopie représente une alternative mini-invasive à la chirurgie à ciel ouvert pour le diagnostic et le traitement de certains hémothorax et pneumothorax. Différentes voies chirurgicales sont décrites, incluant la thoracotomie antérolatérale, la sternotomie médiane, et des voies combinées, en fonction de la localisation et de l'étendue des lésions. L'importance du remplissage vasculaire et de l'analgésie, notamment la morphine et les techniques de péridurales thoraciques, sont également discutées.
1. Drainage thoracique et indications chirurgicales
Le drainage thoracique est une intervention courante pour le traitement des hémothorax et des pneumothorax. Une surveillance rigoureuse du drainage est essentielle : un saignement abondant (plus de 1500 ml initialement ou plus de 200 ml par heure pendant plus de deux heures) ou une instabilité hémodynamique justifient un geste d'hémostase urgent. Pour les patients admis en état de choc, voire agoniques, mais présentant des signes de vie (pouls, pression artérielle mesurable, signes neurologiques), une thoracotomie immédiate, dite de réanimation, est indiquée. Dans les cas de traumatismes fermés, un bilan lésionnel complet et une réanimation sont presque toujours nécessaires avant toute intervention chirurgicale. Cependant, pour les traumatismes ouverts (plaie par balle, arme blanche, amputation traumatique) où l'état hémodynamique est critique malgré la réanimation pré-hospitalière, une intervention directe au bloc opératoire est prioritaire, sans attendre de bilan supplémentaire.
2. Vidéothoracoscopie une approche mini invasive
La vidéothoracoscopie est présentée comme une méthode diagnostique et thérapeutique essentielle dans la prise en charge des traumatismes thoraciques. Elle offre une alternative peu invasive entre le drainage thoracique simple et l'abord chirurgical classique à ciel ouvert. Elle est particulièrement utile pour explorer et traiter les hémothorax persistants répondant à des critères spécifiques de saignement. Une boîte de thoracotomie doit toujours être prête en salle d'opération car une conversion à une chirurgie à ciel ouvert peut être nécessaire à tout moment. La vidéothoracoscopie permet de réduire la durée d'hospitalisation et de limiter les traumatismes chirurgicaux et les séquelles douloureuses postopératoires. Cependant, une bonne maîtrise de la technique et le respect des contre-indications sont impératifs pour éviter des complications peropératoires potentiellement fatales. Elle est mentionnée comme alternative à la fenêtre péricardique pour l'exploration des plaies dans la « cardiac air box » chez les patients hémodynamiquement stables.
3. Choix de la voie d abord chirurgicale
Le choix de la voie d'abord chirurgicale dépend de la localisation et de la nature des lésions. La thoracotomie antérolatérale, décrite avec précision, est une approche courante, permettant un accès au thorax par une incision cutanée débutant au bord du sternum et contournant le mamelon. L'incision est prolongée vers l'arrière jusqu'à la ligne axillaire moyenne. La sternotomie médiane verticale, réalisée en décubitus dorsal avec les bras en abduction, permet d'accéder au médiastin antérieur et de contrôler plus aisément les blessures intrapéricardiques après péricardotomie. Cette approche est détaillée, mentionnant des éléments techniques importants comme la désinfection, le drapage, et l'utilisation d'écarteurs. Une sternotomie transversale est également envisageable. Des voies combinées (thoracotomie antérolatérale + sternotomie) sont possibles pour étendre l'accès chirurgical. Dans les cas de délabrements pariétaux importants, des abords non spécifiques et atypiques peuvent être nécessaires, utilisant les orifices préexistants et adaptés à la situation.
IV.Données épidémiologiques de l étude de Marrakech
L'étude a été menée à l'hôpital universitaire Mohammed VI de Marrakech sur une période d'un an. Elle a inclus 120 patients, dont 104 hommes et 16 femmes (sex-ratio de 6,5), âgés de 14 à 64 ans (âge moyen de 39 ans). Les accidents de la route étaient la cause la plus fréquente des traumatismes thoraciques.
1. Caractéristiques de la population étudiée
L'étude, menée au service de chirurgie viscérale du CHU Mohammed VI de Marrakech, a porté sur 120 cas de traumatismes thoraciques recueillis sur une période d'un an, de septembre 2007 à août 2008. L'échantillon comprenait une majorité d'hommes (104 hommes et 16 femmes), soit un sex-ratio de 6,5. L'âge des patients variait de 14 à 64 ans, avec un âge moyen de 39 ans. Ces données démographiques fournissent un contexte important pour l'interprétation des résultats de l'étude et permettent de situer la population étudiée dans un cadre précis. La collecte des données s'est déroulée sur une période spécifique, ce qui permet d'analyser les tendances dans un laps de temps relativement court et de limiter les biais liés à l'évolution des pratiques médicales sur une période plus longue. La répartition par sexe est significative, soulignant la prédominance masculine dans les cas de traumatismes thoraciques.
2. Étiologie des traumatismes thoraciques
L'analyse épidémiologique de l'étude de Marrakech met en lumière la cause principale des traumatismes thoraciques fermés : les accidents de la voie publique. Ces accidents représentent 79,6% des cas dans cette série. Cette forte proportion souligne l'impact significatif des accidents de la route sur la fréquence des traumatismes thoraciques et l'importance de la prévention routière. L'étude se concentre sur les traumatismes thoraciques fermés, excluant donc les traumatismes pénétrants d'autres origines. La précision sur le type de traumatisme permet une analyse plus ciblée des facteurs de risque et des conséquences spécifiques de ce type de lésion. L'importance des accidents de la route comme facteur étiologique principal est une information clé pour les politiques de santé publique et les stratégies de prévention.
