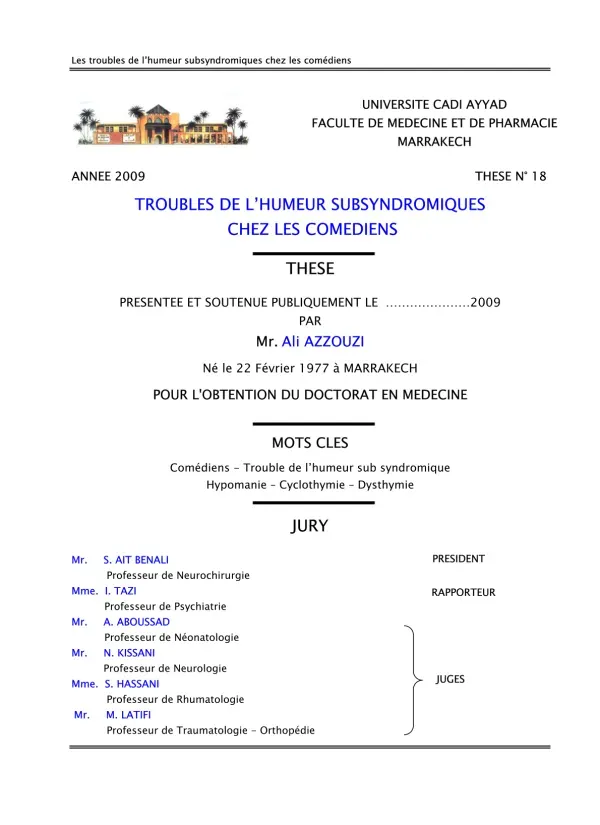
Thèse sur les Troubles de l'Humeur Subsyndromiques chez les Comédiens
Informations sur le document
| Auteur | Ali Azzouzi |
| instructor/editor | S. Ait Benali, Professeur de Neurochirurgie |
| school/university | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| subject/major | Médecine |
| Type de document | Thèse |
| academic_year/year_document_was_written | 2009 |
| city_where_the_document_was_published | Marrakech |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 660.45 KB |
- Troubles de l'humeur
- Médecine
- Comédiens
Résumé
I.Troubles de l humeur subsyndromiques chez les comédiens marocains
Cette étude explore la prévalence des troubles de l'humeur subsyndromiques, notamment l'hypomanie et la dysthymie, chez un échantillon de comédiens marocains. L'analyse se base sur le système diagnostique ICD-10. Les résultats montrent une forte prévalence de la cyclothymie (44,4%) et de l'hypomanie (52%). Une corrélation significative (p=0.040) est observée entre l'hypomanie et la présence d'un artiste dans la famille. L'étude examine également la consommation d'alcool et de haschisch, ainsi que l'automédication par anxiolytiques chez ce groupe professionnel. Les données sociodémographiques révèlent que la majorité des participants sont des hommes de moins de 25 ans, avec des revenus mensuels souvent inférieurs à 1500 dhs pour la moitié d'entre eux. Des comparaisons avec des données publiées antérieurement sur les troubles bipolaires et la prévalence des troubles de l'humeur subsyndromiques dans la population générale marocaine (dysthymie à 11,4% et hypomanie à 4,8% en 2003) sont effectuées. Des études américaines sur le lien entre troubles de l'humeur et célébrités sont également mentionnées.
1. Prévalence des troubles de l humeur subsyndromiques
Cette section détaille les résultats de l'étude concernant la prévalence de l'hypomanie et de la dysthymie chez les comédiens marocains. L'étude a utilisé l'ICD-10 pour le diagnostic. Les résultats principaux montrent une prévalence significative de la cyclothymie (44.4%) et de l'hypomanie (52%). Il est important de noter que ces chiffres sont bien supérieurs aux taux observés dans la population générale marocaine en 2003 (11.4% pour la dysthymie et 4.8% pour l'hypomanie). L'analyse bivariée a mis en évidence une corrélation significative (p=0.040) entre la présence d'un artiste dans la famille et l'hypomanie chez les comédiens. Cette découverte suggère un possible facteur génétique dans le développement de ces troubles chez ce groupe professionnel. L'étude souligne également l'importance de prendre en compte les facteurs socio-économiques, étant donné que les revenus mensuels de la moitié des participants étaient inférieurs à 1500 dhs. La comparaison avec des données d'études françaises sur les comédiens, qui révèlent des profils sociodémographiques différents, enrichit l'analyse de ce facteur.
2. Définition et caractéristiques cliniques de l hypomanie et de la dysthymie
Cette partie fournit des définitions cliniques de l'hypomanie et de la dysthymie selon les critères de l'ICD-10. L'hypomanie est décrite comme une forme atténuée de manie, caractérisée par une élévation légère mais persistante de l'humeur, de l'énergie et de l'activité, sans hallucinations ni idées délirantes. Des symptômes tels qu'une augmentation de la sociabilité, du désir de parler, et de l'énergie sexuelle, ainsi qu'une réduction du besoin de sommeil, sont mentionnés. Il est souligné que ces symptômes ne sont pas assez marqués pour entraver le fonctionnement professionnel ou social, contrairement à la manie. La dysthymie est définie comme une dépression chronique de l'humeur, moins sévère ou de plus courte durée qu'un trouble dépressif récurrent. Les sujets présentent des périodes de bien-être, mais sont majoritairement fatigués et déprimés, avec des troubles du sommeil et une baisse de la confiance en soi. Malgré ces symptômes, ils sont généralement capables de mener une vie quotidienne normale. Le texte établit un parallèle entre la dysthymie et des concepts comme la névrose dépressive. L'étude mentionne également le rôle du tempérament dans le choix professionnel, en citant les travaux d'Aristote et de psychiatres américains comme Akiskal, Ludwig, Andreasen et Menger.
3. Consommation de substances et automédication
Cette section présente les données concernant la consommation de substances et l'automédication chez les comédiens participants. L'étude révèle une consommation de haschich (11.9%) et d'alcool (79.3%), tandis qu'aucune consommation de drogues dures n'a été rapportée. Ce faible taux de consommation de drogues dures est attribué aux prix élevés de ces substances et aux faibles revenus des comédiens interrogés. Il est observé qu'un quart des comédiens (25%) prennent occasionnellement des anxiolytiques au cours de leur carrière. Le texte mentionne l'absence d'études similaires dans la littérature et cite l'exemple tragique de la mort de Heath Ledger par intoxication aux somnifères. La corrélation entre la créativité artistique et les périodes d'hypomanie est évoquée, avec l'idée que certaines périodes d'euphorie et d'expansivité favorisent la création artistique. Cependant, l'étude ne se prononce pas sur un lien de causalité entre la consommation de substances, l'automédication et les troubles de l'humeur observés. L'étude conclut en mentionnant l'absence d'études spécifiques sur ces facteurs chez les comédiens.
4. Facteurs sociodémographiques et antécédents familiaux
Cette section analyse les facteurs sociodémographiques et les antécédents familiaux des comédiens participants. L'analyse statistique montre que la majorité des participants (75%) sont des hommes de moins de 25 ans. Concernant les antécédents familiaux, l'étude mentionne des cas de célébrités (Marlon Brando, Marilyn Monroe, Nicolas Gogol) ayant des antécédents familiaux de troubles bipolaires, suggérant un potentiel facteur génétique. Cependant, l'étude souligne qu'aucun lien significatif n'a été trouvé entre le sexe et les troubles de l'humeur subsyndromiques chez les comédiens marocains, bien que le faible nombre de femmes participantes puisse expliquer cette absence de corrélation. L'étude compare l'âge de début des troubles bipolaires dans la population générale (95% avant 25 ans) sans conclure sur un lien direct avec l'âge de diagnostic chez les célébrités mentionnées. Le rapport aborde également l'influence socio-économique, observant que dans la population générale, les troubles de l'humeur subsyndromiques sont plus fréquents dans les milieux défavorisés, tout en précisant que ce n'est pas un facteur déterminant pour tous, citant l'exemple de comédiens riches atteints de troubles bipolaires.
II.Formation et conditions de travail des comédiens marocains
L'étude aborde les différentes voies de formation des comédiens marocains, distinguant l'autoformation et la formation formelle. Elle souligne la précarité économique du métier, avec des revenus modestes et la nécessité pour de nombreux comédiens d'exercer des activités parallèles pour subvenir à leurs besoins. Le théâtre, la télévision et le cinéma sont présentés comme des secteurs d'emploi, avec des conditions de travail spécifiques et des trajectoires professionnelles variables. Les rôles du scénariste, du réalisateur et du régisseur sont brièvement décrits, soulignant la diversité des métiers liés à la production cinématographique et télévisuelle. Des données statistiques françaises sur l'âge et les revenus des comédiens (enquêtes de 1997 et 2005) sont mentionnées à titre comparatif.
1. Voies de formation des comédiens marocains
Cette partie explore les différentes manières dont les comédiens marocains acquièrent leurs compétences. Elle distingue deux voies principales : l’autoformation et la formation formelle. L’autoformation, souvent motivée par la passion et l’ambition, implique une formation pratique sur le tas, au sein même du théâtre ou du cinéma. Certains comédiens acquièrent ainsi des compétences techniques comparables à celles des professionnels issus d’écoles spécialisées. En revanche, la formation formelle se déroule au sein d'écoles et d'instituts spécialisés. L’étude ne détaille pas les spécificités de ces institutions ni le contenu de leurs programmes. La précarité économique du métier est un facteur expliquant la diversification des activités des comédiens, certains combinant des emplois dans des secteurs artistiques différents (peinture, photographie, musique, décoration) ou exerçant des emplois hors du champ artistique pour compléter leurs revenus. Cette réalité économique influence largement la trajectoire et le développement des carrières de ces artistes.
2. Conditions de travail et précarité économique
Cette section souligne les conditions de travail spécifiques au métier de comédien au Maroc et la précarité économique qui le caractérise. Les revenus des jeunes artistes sont décrits comme généralement modestes, une situation qui s'améliore parfois avec l'ancienneté et l'expérience. Le métier est présenté comme risqué, avec une réussite économique incertaine, une forte concurrence et des difficultés de recrutement. La recherche permanente d'autres engagements professionnels est présentée comme la règle plutôt que l'exception. Le théâtre est reconnu comme un tremplin vers la professionnalisation pour la majorité des comédiens, mais ses conditions de travail sont particulières (durée des contrats, intensité des répétitions, organisation moins hiérarchisée). Le fort développement de la production télévisuelle est mentionné comme une source de débouchés supplémentaires pour les comédiens de cinéma, participant à la dispersion du travail sur un nombre important de comédiens. L'étude cite des exemples de rôles comme scénariste, réalisateur et régisseur, qui illustrent la diversité des métiers liés à la production audiovisuelle.
3. Données comparatives sur la profession de comédien
Cette partie intègre des données statistiques comparatives provenant d’études françaises pour enrichir l’analyse des conditions de travail des comédiens. Une enquête de 1997 auprès de comédiens français indique une large majorité de personnes de moins de 40 ans, et une enquête de 2005 menée par l'ISL auprès de 737 comédiens révèle que 80 % des participants sont âgés entre 26 et 35 ans. Ces chiffres offrent un point de comparaison avec la situation des comédiens marocains étudiés, même si l'absence d'études statistiques similaires au Maroc empêche une comparaison approfondie. L’étude aborde la question de la dépendance à certaines substances chez les comédiens, en mentionnant des cas d'accoutumance aux États-Unis (Jean-Claude Van Damme, Britney Spears) relevés dans des autobiographies. Au Maroc, l'étude a révélé un taux de consommation de haschich de 11,9 % et d'alcool de 79,3 % parmi les comédiens interrogés, sans consommation de drogues dures signalée. Cette dernière donnée est expliquée par les prix élevés de ces drogues et les faibles revenus des artistes marocains.
III.Prise en charge des troubles de l humeur
La section sur la prise en charge des troubles de l'humeur explore les options thérapeutiques pour la cyclothymie, l'hypomanie et la dysthymie. Elle mentionne différents médicaments, tels que le lithium, l'acide valproïque, la carbamazépine, la lamotrigine, la paroxétine, et la fluvoxamine, ainsi que le rôle de la psychothérapie. Les avantages et inconvénients de ces traitements sont brièvement discutés. La section souligne également l'importance de la surveillance médicale et de la sensibilisation à ces troubles.
1. Prise en charge de la cyclothymie et de l hypomanie
Cette section détaille les options thérapeutiques pour la cyclothymie et l'hypomanie. Le lithium, un stabilisateur de l'humeur, est présenté comme une option médicale efficace pour réduire la fréquence des perturbations de l'humeur et maîtriser les symptômes hypomaniaques. L'acide valproïque à faibles doses est également mentionné comme utile. La carbamazépine est décrite comme ayant des effets antimaniaques et antidépressifs, utilisable seule ou en combinaison avec le lithium ou des antidépresseurs. Une étude citée indique que 53 % des patients déprimés ont répondu positivement à l'ajout de lithium à la carbamazépine. Cependant, la thérapie au lithium est jugée plus efficace que la carbamazépine seule, le traitement combiné étant le plus efficace, notamment pour les patients à cycles rapides. La lamotrigine, un anticonvulsivant, est présentée comme efficace pour traiter la dépression et les cycles rapides du trouble bipolaire. Ses effets indésirables sont similaires à ceux des autres anticonvulsivants, avec une incidence légèrement plus élevée de maux de tête. Le valproate, fréquemment prescrit aux États-Unis, est mentionné comme plus efficace pour traiter la manie que la dépression, tout en possédant des propriétés antidépressives modérées. L’étude ne présente pas de données sur l’efficacité de ces traitements sur la population étudiée de comédiens marocains.
2. Prise en charge de la dysthymie
Pour la dysthymie, le texte propose une approche combinant médicaments et psychothérapie. Les antidépresseurs, en particulier les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS, comme la fluoxétine), sont recommandés, surtout en cas d'antécédents familiaux de troubles de l'humeur. Les androgènes sont également mentionnés comme efficaces pour la dysthymie d'apparition tardive. Les anxiolytiques, tels que les benzodiazépines, sont jugés moins efficaces et déconseillés pour un traitement à long terme. La section mentionne également l'interaction entre certains médicaments : une augmentation lente des doses de lamotrigine est recommandée pour éviter les effets secondaires, tandis qu'une augmentation plus rapide est conseillée lors d'une administration conjointe avec la carbamazépine. La lamotrigine est considérée comme potentiellement utile, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer son efficacité dans le traitement du trouble bipolaire. Enfin, le texte fournit des informations pharmacocinétiques sur la paroxétine et la fluvoxamine, deux ISRS.
3. Considérations sur le traitement et le diagnostic
Cette section aborde des aspects plus généraux du diagnostic et du traitement des troubles de l'humeur mentionnés précédemment. Elle souligne que les symptômes de la cyclothymie peuvent être légers, menant à un diagnostic tardif ou à l'absence de traitement. Un certain degré d'hypomanie est même considéré comme pouvant contribuer au succès dans certains domaines professionnels, y compris celui de comédien. Cependant, le texte prévient que pour les personnes à risque d'épisode dépressif ou ayant des antécédents familiaux de troubles bipolaires, les symptômes peuvent être plus intenses et nécessiter un traitement. L'importance de la sensibilisation et de la surveillance médicale est mise en avant pour permettre un traitement rapide et efficace. La section mentionne également les critères diagnostiques de la cyclothymie selon l'ICD-10, insistant sur l'instabilité persistante de l'humeur et les périodes de dépression ou d'élation légère, sans atteindre la sévérité d'un trouble affectif bipolaire ou d'un trouble dépressif récurrent. Le document ne fournit pas de données spécifiques sur les traitements suivis par la population de comédiens étudiée.
