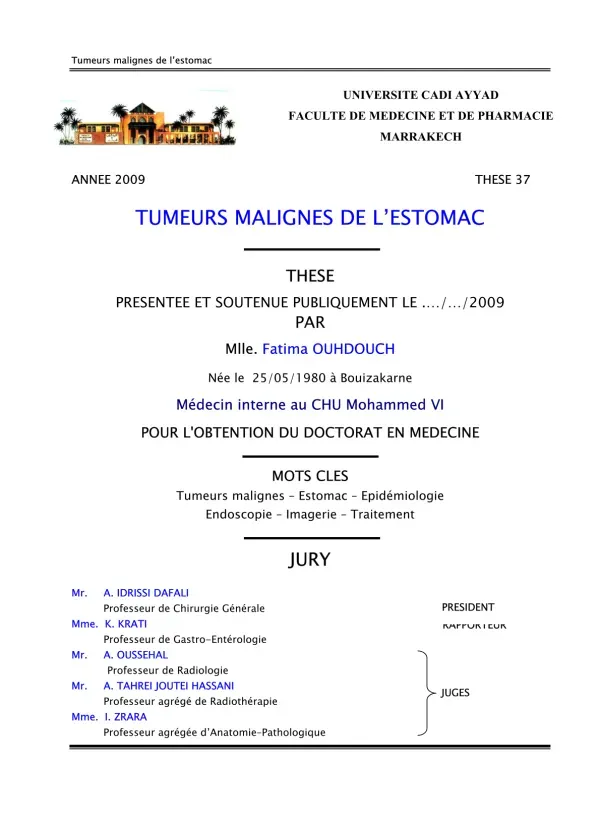
Thèse sur les Tumeurs Malignes de l'Estomac
Informations sur le document
| Auteur | Mlle. Fatima Ouhadouch |
| instructor/editor | Mr. A. Idrissi Dafali (Professeur de Chirurgie Générale) |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Type de document | thèse |
| Lieu | Marrakech |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 2.96 MB |
- Tumeurs malignes
- Médecine
- Endoscopie
Résumé
I.Épidémiologie du cancer de l estomac au Maroc
Cette étude rétrospective, menée de 2003 à 2007 au CHU Mohamed VI de Marrakech, a analysé 93 cas de cancer gastrique. Le cancer de l'estomac représentait 35,7% des cancers digestifs. Le sex-ratio était de 1,38, avec un âge moyen de 56 ans (extrêmes: 20-87 ans). Les symptômes dominants étaient les épigastralgies (90,3%), la perte de poids (77,4%), les vomissements (53,8%) et les hémorragies digestives (47,3%). L'absence de registre national des cancers au Maroc rend difficile l'évaluation précise de l'incidence et de l'évolution de cette pathologie.
1. Contexte et Méthodologie de l étude sur le cancer gastrique au Maroc
L'étude porte sur l'épidémiologie du cancer de l'estomac au Maroc, un pays où l'absence de registre national des cancers rend difficile la surveillance précise de cette pathologie. Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive menée sur une période de quatre ans, entre 2003 et 2007, au sein du service de gastroentérologie du CHU Mohamed VI à Marrakech. L'étude s'appuie sur l'analyse de 93 dossiers de patients hospitalisés pour un cancer gastrique. Cette approche rétrospective permet d'analyser les données disponibles, mais les limites inhérentes à ce type d'étude doivent être prises en compte, notamment la possibilité de biais de sélection et l'absence de données complètes pour certains patients. Malgré ces limitations, l'analyse des données recueillies apporte un éclairage précieux sur les caractéristiques du cancer de l'estomac au sein de ce CHU marocain. L’objectif principal est de décrire le profil épidémiologique, anatomopathologique, clinique et thérapeutique des tumeurs gastriques malignes traitées dans ce service.
2. Fréquence et Caractéristiques démographiques du cancer gastrique à Marrakech
Le cancer gastrique occupait la première place parmi les cancers digestifs au sein de l'échantillon étudié, représentant 35,7 % des cas. Le sex-ratio était de 1,38, indiquant une prédominance masculine légèrement plus élevée. L'âge moyen des patients était de 56 ans, avec une fourchette d'âge s'étendant de 20 à 87 ans. Ces données suggèrent que le cancer de l'estomac affecte une population variée en termes d'âge et de sexe, mais avec une possible surreprésentation masculine. Cette observation concernant le sex-ratio mérite d'être approfondie dans des études plus vastes à l'échelle nationale afin de déterminer si cette tendance est générale au Maroc ou spécifique à la population prise en charge dans ce CHU. L’absence de données nationales comparables rend difficile l’interprétation de ces chiffres dans le contexte marocain global.
3. Manifestations cliniques et diagnostic du cancer gastrique
La symptomatologie clinique du cancer gastrique dans cette étude était dominée par des symptômes gastro-intestinaux. Les épigastralgies étaient le symptôme le plus fréquemment rapporté, observées chez 90,3 % des patients. L'amaigrissement a été constaté chez 77,4 % des patients, soulignant l'impact significatif de la maladie sur leur état général. Des vomissements étaient présents chez 53,8 % des patients, tandis que les hémorragies digestives ont été observées chez 47,3 %. L'examen physique a révélé une pâleur chez 35,5 % des patients, une masse épigastrique palpable chez 22,6 %, et une ascite chez 11,8 %. Le diagnostic a été confirmé chez tous les patients par endoscopie et biopsie, ce qui souligne l'importance de ces examens dans le diagnostic du cancer gastrique. La diversité des manifestations cliniques souligne la nécessité d'une approche diagnostique complète et multidisciplinaire.
4. Localisation tumorale et données spécifiques au Maroc Casablanca et Nord Tunisie
Concernant la localisation de la tumeur, la région antro-pylorique était le siège le plus fréquent (48,4 %), suivi des localisations fundique et de la petite courbure (18 % chacune). Cette observation est importante pour guider les stratégies diagnostiques et thérapeutiques. Des données limitées provenant d'études dans d'autres régions du Maroc (Casablanca) et en Tunisie (Nord Tunisie) sont incluses pour comparaison. À Casablanca, l’incidence est estimée à 4,1 pour 100 000 habitants avec un taux de mortalité de 2,5 pour 100 000 habitants, alors qu’en Tunisie (Nord), ces taux sont plus importants (respectivement 6,6 et 3,7). Cependant, le nombre de cas et la méthodologie employés dans ces comparaisons ne sont pas détaillées, limitant l'interprétation de ces données. L'absence d'information détaillée concernant ces autres sites géo-graphiques empêche une analyse approfondie et une comparaison robuste.
II.Caractéristiques anatomopathologiques du cancer gastrique
L'adénocarcinome était le type histologique le plus fréquent (83,8%), avec une prédominance des formes peu différenciées (41,9%). La localisation la plus courante était la région antro-pylorique (48,4%). Différents aspects macroscopiques ont été observés : bourgeonnante, ulcérante et infiltrante, incluant la linite gastrique. L'étude mentionne également la présence de cellules en bague à chaton, caractéristique de certains adénocarcinomes.
1. Type histologique et différenciation cellulaire
L'étude révèle que l'adénocarcinome est de loin le type histologique le plus fréquent de cancer gastrique, représentant 83,8% des cas. Un point notable est la prédominance des adénocarcinomes peu différenciés, qui constituent 41,9% de l'ensemble des adénocarcinomes. Cette observation souligne l'agressivité potentielle de la maladie dans cette cohorte de patients. La faible différenciation cellulaire est souvent associée à un pronostic moins favorable, et cette information est cruciale pour la prise en charge thérapeutique et la stratification du risque. Des analyses plus approfondies pourraient explorer les corrélations entre le degré de différenciation cellulaire, les facteurs de risque et le pronostic à long terme chez ces patients. La description précise du type histologique est essentielle pour la planification du traitement et l'évaluation du pronostic.
2. Aspects macroscopiques du cancer gastrique
Macroscopiquement, les adénocarcinomes gastriques présentaient trois aspects principaux : bourgeonnant (tumeur polypoïde), ulcéreux (avec ulcération) et infiltrant (au sein de la paroi gastrique, la linite gastrique étant l'aspect le plus caractéristique). Souvent, ces trois aspects sont combinés, formant le carcinome en « lobe d'oreille ». Cette description macroscopique est importante pour l'orientation diagnostique et pour la planification chirurgicale. La présence de formes macroscopiques variées souligne la complexité du cancer gastrique et la nécessité d'une évaluation visuelle complète lors de l'endoscopie. L’aspect macroscopique, observable lors de l'endoscopie, permet une première appréciation de l’extension tumorale avant les examens complémentaires.
3. Cancers gastriques superficiels et autres types de tumeurs
Le document mentionne le cancer gastrique superficiel, dont la fréquence est significativement différente entre l'Occident et le Japon (16-20% vs 50%), probablement due aux différences dans les programmes de dépistage et les critères histologiques de malignité. Des types rares de cancer gastrique sont également évoqués, notamment le carcinome hépatoïde (adénocarcinome associé à une différenciation hépatocytaire et une possible production d'AFP), le cancer gastrique à stroma lymphoïde (souvent associé au virus Epstein-Barr), et les tumeurs stromales (souvent bien limitées, mais non encapsulées). L’étude souligne la variabilité des présentations anatomopathologiques du cancer gastrique, nécessitant une approche diagnostique rigoureuse incluant l'analyse histologique et la recherche de marqueurs spécifiques. La description de ces types rares permet une meilleure compréhension de la diversité des cancers gastriques et l’importance du diagnostic précis.
4. Cellules en bague à chaton et implications
La présence de cellules en bague à chaton est mentionnée, décrivant un type de cellules mucosécrétantes dans les formes peu différenciées du cancer gastrique. Cette caractéristique histologique particulière permet une meilleure classification des tumeurs, et elle peut avoir des implications pronostiques, même si cela n’est pas explicitement développé dans le document. Ce type cellulaire est souvent associé à un aspect macroscopique spécifique. L'identification précise des caractéristiques histologiques, comme les cellules en bague à chaton, est donc importante pour le diagnostic et la classification du cancer de l'estomac.
III. Helicobacter pylori facteurs de risque et traitements du cancer gastrique
Le rôle de Helicobacter pylori (HP) dans la cancérogenèse gastrique est souligné. L'infection à HP est un facteur de risque majeur, bien que des exceptions existent. D'autres facteurs de risque incluent une alimentation riche en sel, la consommation d'aliments riches en hydrocarbures, et des facteurs génétiques. Les traitements dépendent du stade du cancer. Les options comprennent la gastrectomie (totale ou partielle), la chimiothérapie, la radiothérapie, et la radio-chimiothérapie (néoadjuvante ou adjuvante), ainsi que la mucosectomie endoscopique pour les cancers superficiels. Le rôle de l'Imatinib dans le traitement des tumeurs stromales est également mentionné.
1. Rôle de Helicobacter pylori HP dans le cancer gastrique
L'étude met en évidence le lien entre l'infection à Helicobacter pylori (HP) et le développement du cancer gastrique. HP est classée comme carcinogène par l'OMS, et des arguments épidémiologiques, histologiques et expérimentaux supportent ce lien, notamment avec l'adénocarcinome gastrique non cardial et le lymphome MALT. Un parallélisme est observé entre la séroprévalence de l'infection à HP et l'incidence du cancer gastrique, bien que des exceptions existent dans certaines régions d'Asie et d'Afrique. L'infection à HP pendant l'enfance est considérée comme un facteur de risque important. La prévalence de l'infection est plus élevée dans les pays en voie de développement. La gastrite chronique liée à HP, notamment une atrophie pangastrique ou prédominant sur le corps gastrique, est un facteur de risque significatif de cancer gastrique, contrairement à une gastrite antrale isolée. Cependant, l’éradication de HP ne constitue pas actuellement une stratégie de prévention majeure à cause de la résistance aux antibiotiques et de la forte prévalence de l’infection.
2. Facteurs de risque alimentaires et génétiques
Des facteurs alimentaires jouent un rôle important dans la carcinogenèse gastrique, notamment une alimentation riche en sel, associée à une hypochlorydrie et une gastrite chronique atrophique favorisant la colonisation par HP et la formation de composés cancérigènes. La consommation excessive d'aliments riches en sel, de viandes ou de poissons fumés augmente le risque. Une diète riche en hydrocarbures, notamment dans le riz et les nouilles, est également associée à un risque accru, bien que le mécanisme ne soit pas entièrement compris (irritation de la muqueuse, diminution de la sécrétion de mucine et du pH gastrique). Des facteurs génétiques influencent également le risque, comme le montre le risque multiplié par 2 ou 3 chez les apparentés de premier degré de sujets atteints. Le polymorphisme génétique des cytokines impliquées dans la réponse inflammatoire secondaire à l'infection par HP est également impliqué. Les syndromes HNPCC, Li-Fraumeni, Peutz-Jeghers et la polypose adénomateuse familiale sont associés à un risque accru, mais ces cas restent rares. Une pénétrance élevée des cancers gastriques (70-80%) justifie une gastrectomie totale prophylactique dans certaines familles.
3. Options thérapeutiques du cancer gastrique
Le traitement du cancer gastrique est adapté au stade de la maladie. Pour les cancers superficiels, la mucosectomie endoscopique est une option de première intention, mais nécessite une évaluation par échoendoscopie et une discussion multidisciplinaire. Pour les cancers invasifs, la chirurgie (gastrectomie totale ou partielle, avec lymphadénectomie) est le traitement principal, pouvant être complétée par une chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante. La chimiothérapie, incluant des associations comme cisplatine/5-FU et de nouveaux agents comme les taxanes, l'irinotecan et l'oxaliplatin, est utilisée. La radiothérapie, souvent associée à la chimiothérapie, joue un rôle important dans la gestion des récidives locorégionales. Une radio-chimiothérapie postopératoire est recommandée dans certains cas (curage ganglionnaire insuffisant, patients jeunes, tumeur T3 ou N+). La chimiothérapie palliative est utilisée pour les cancers non résécables, avec un éventuel « second look » chirurgical après une réponse objective. L'Imatinib est efficace dans le traitement des tumeurs stromales métastatiques ou non opérables, mais son rôle adjuvant ou néoadjuvant n'est pas encore totalement établi.
IV.Pronostic et dépistage du cancer de l estomac
Le pronostic est influencé par plusieurs facteurs, notamment la localisation de la tumeur, l'extension ganglionnaire (classification TNM), et l'invasion périnerveuse. Le dépistage, particulièrement chez les populations à haut risque (comme les hommes âgés de plus de 40 ans, et les apparentés de premier degré de patients atteints), est discuté, soulignant les résultats positifs observés au Japon grâce à des programmes de dépistage de masse. La prévention reste un défi majeur, malgré la diminution de l'incidence dans certains pays développés grâce à l'amélioration de l'alimentation et de l'hygiène.
1. Facteurs pronostiques du cancer de l estomac
Le pronostic du cancer de l'estomac dépend de plusieurs facteurs. La localisation de la tumeur est un facteur pronostique indépendant : les cancers du cardia et du fundus, ainsi que les lésions étendues, ont un pronostic moins favorable que les tumeurs de l’antre et du corps. Le nombre de ganglions envahis est également crucial ; selon l’étude d’Hermanek, la survie à 5 ans chute de 44% (moins de 6 ganglions) à 22% (7 à 15 ganglions) puis à 11% (plus de 15 ganglions). Le pourcentage de ganglions envahis par rapport au nombre total examiné (N ratio) est aussi un indicateur important : selon Siewert, un pourcentage inférieur à 20% correspond à un risque relatif de 1,8 et une survie à 5 ans de 35%, contre un risque relatif de 2,8 et une survie à 5 ans de 10% pour un pourcentage supérieur à 20%. D’autres facteurs comme l’invasion périnerveuse et l’invasion endocapillaire influencent aussi le pronostic, étant plus fréquents dans les cancers de l’estomac proximal.
2. Dépistage du cancer de l estomac controverses et pratiques
Le dépistage du cancer de l'estomac, notamment le dépistage de masse, reste controversé. Des études en Asie suggèrent que le dépistage ciblé des populations à haut risque (par exemple, les Chinois âgés de 50 à 70 ans) est plus bénéfique qu’un dépistage de masse. Au Japon, le dépistage de masse a été associé à une diminution de 40 à 60% de la mortalité par cancer gastrique. Cependant, le document souligne que l’incidence est généralement plus importante chez les hommes et augmente avec l’âge (après 40 ans), ce qui rend le dépistage plus pertinent chez les hommes âgés de plus de 40 ans (40 ans au Japon et en Corée). Il est également recommandé de dépister les apparentés du premier degré des personnes atteintes de cancer gastrique. La stratégie de prévention idéale et l’âge optimal pour l’éradication de Helicobacter pylori restent à définir, malgré le bénéfice avéré de cette éradication, même chez les sujets âgés.
