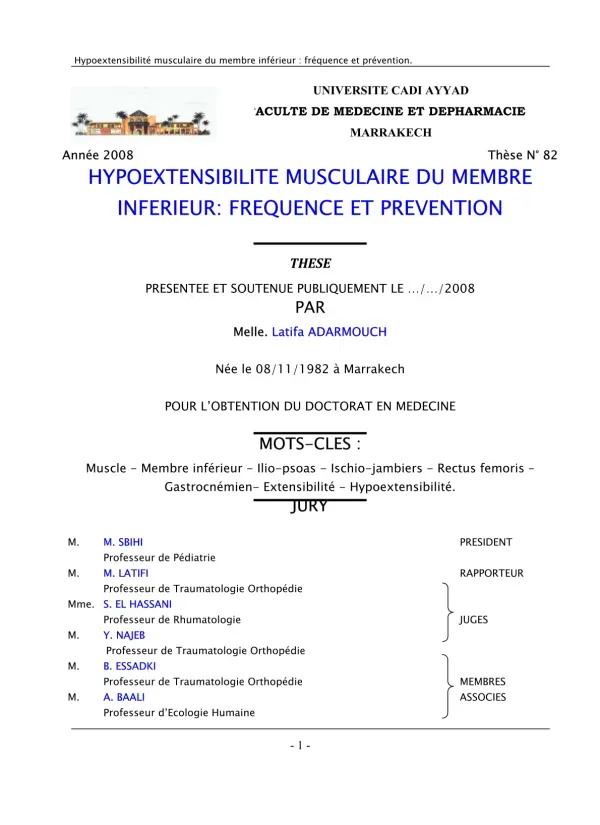
Thèse sur l'Hypoextensibilité Musculaire du Membre Inférieur
Informations sur le document
| Auteur | Melle. Latifa Adarmouch |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 1.08 MB |
- Hypoextensibilité musculaire
- Médecine
- Prévention des blessures
Résumé
I.Évaluation de l extensibilité musculaire des muscles bi articulaires du membre inférieur
Cette étude transversale a évalué l'extensibilité musculaire de 200 jeunes adultes (18-30 ans) afin d'établir des valeurs normales et la prévalence de l'hypoextensibilité des muscles bi-articulaires du membre inférieur. Quatre muscles ont été étudiés : l'ilio-psoas, les ischio-jambiers, le rectus femoris et le gastrocnémien. Des tests goniométriques (test de Thomas, élévation de jambe tendue, test de Thomas modifié, dorsiflexion active de la cheville) ont été utilisés pour mesurer la longueur musculaire. L'analyse a révélé une prévalence élevée de l'hypoextensibilité du gastrocnémien (plus de 50%), soulignant l'importance clinique de ce paramètre. Des différences significatives ont été observées entre les sexes pour les ischio-jambiers et le gastrocnémien gauche, et entre les groupes d'activité sportive pour l'ilio-psoas. Ces résultats fournissent des données normatives cruciales pour les cliniciens concernant l'extensibilité musculaire du membre inférieur et les déséquilibres musculaires associés.
1. Introduction Importance de l évaluation de l extensibilité musculaire
L'étude porte sur l'évaluation de l'extensibilité musculaire au niveau du membre inférieur, un aspect crucial pour la fonction de charge et de locomotion. L'intérêt est particulièrement marqué pour les muscles bi-articulaires, c'est-à-dire ceux qui traversent deux articulations: l'ilio-psoas, les ischio-jambiers, le rectus femoris et le gastrocnémien. Alors que l'extensibilité de ces muscles est largement étudiée en médecine du sport, en raison des performances athlétiques et des risques de blessures élevés, peu d'études se sont penchées sur ces paramètres chez la population générale. L'hypoextensibilité musculaire, ou raideur musculaire, a des répercussions statiques et dynamiques multiples au niveau du membre inférieur, souvent compensées par le rachis, le genou ou le pied, conduisant à des douleurs ou un inconfort à long terme. Le gastrocnémien est un exemple notable, avec une hypoextensibilité touchant 40% des individus normaux, selon Kowalski et coll. (8), justifiant des études épidémiologiques plus approfondies et la recherche d'actions thérapeutiques et préventives.
2. Méthodologie Tests et mesures
L'étude a utilisé une méthodologie rigoureuse basée sur des tests goniométriques pour évaluer l'extensibilité des muscles bi-articulaires. L'extensibilité de l'ilio-psoas a été mesurée avec le test de Thomas, une méthode reconnue mais limitée par la position initiale qui ne permet pas une extension de hanche au-delà de 0°. Des précautions spécifiques ont été prises pour éviter la compensation lombo-pelvienne. L'extensibilité des ischio-jambiers a été évaluée par l'élévation de la jambe étendue, en maintenant le genou en extension et le bassin plaqué contre le plan d'examen. Pour le rectus femoris, le test de Thomas modifié a été employé, mesurant l'amplitude de flexion du genou. Enfin, la dorsiflexion active de la cheville a permis d'évaluer l'extensibilité des gastrocnémiens. L'étude a reconnu la possibilité d'erreurs inhérentes à la goniométrie, mentionnant une précision de 3 à 10° selon différents auteurs (4, 19, 33). Pour minimiser ces erreurs, les mesures ont été effectuées par paliers de 5°, et les mesures ont été comparées pour tenir compte des variations individuelles. La standardisation des procédures d'évaluation visait à assurer l'objectivité et la reproductibilité des résultats.
3. Résultats Valeurs normales et prévalence de l hypoextensibilité
Les données recueillies ont été analysées à l'aide du logiciel SPSS version 10fr, utilisant des techniques d'analyse univariée et bivariée. Les valeurs normales de l'extensibilité musculaire ont été déterminées à partir des moyennes de chaque groupe musculaire. Une différence statistiquement significative a été observée pour l'ilio-psoas entre les sujets pratiquant une activité sportive régulière et ceux ayant une pratique occasionnelle, les sportifs réguliers ayant un ilio-psoas moins extensible. Aucune différence statistiquement significative n'a été trouvée pour les autres muscles en fonction de l'activité sportive. Par contre, des différences statistiquement significatives ont été observées entre les sexes pour les ischio-jambiers et le gastrocnémien gauche (p<0.05). La prévalence de l'hypoextensibilité du gastrocnémien s'est révélée supérieure à 50% des participants, un résultat marquant. Une comparaison avec les études de Krivkkas et Feinberg (4) et Kowalski et coll. (8) a mis en évidence des différences entre les populations étudiées, soulignant notamment une prévalence plus élevée de l'hypoextensibilité dans cette étude, par rapport aux études portant sur les athlètes.
II.Méthodes de mesure de la longueur musculaire
L'étude a utilisé des techniques goniométriques standardisées pour mesurer la longueur musculaire. Le test de Thomas a évalué l'ilio-psoas, l'élévation de jambe tendue les ischio-jambiers, le test de Thomas modifié le rectus femoris, et la dorsiflexion active de la cheville le gastrocnémien. La précision de la goniométrie a été discutée, avec une marge d'erreur estimée autour de 5°. L'objectif était de minimiser les erreurs de mesure grâce à la standardisation des protocoles et à l'utilisation de mesures par paliers de 5°.
1. Choix des tests et justification
L'étude a privilégié des tests goniométriques reconnus et largement utilisés par les praticiens pour mesurer la longueur musculaire. Le choix des tests s'est basé sur plusieurs critères : la qualité de l'examen, la recommandation par plusieurs auteurs (1, 17, 33) et leur utilisation courante en pratique clinique. Ces tests permettaient d'évaluer trois concepts importants : la souplesse articulaire (mesure directe), l'extensibilité tissulaire (déduite de la précédente), et la sensation subjective de tension ou d'inconfort. L'étude s'est focalisée sur l'extensibilité musculaire. Pour l'ilio-psoas, le test de Thomas, malgré son inconvénient de ne pas permettre l'extension de la hanche au-delà de 0°, a été retenu en raison de son utilisation par plusieurs auteurs (4, 7). Des précautions ont été prises pour garantir la fiabilité du test, notamment en évitant la compensation lombo-pelvienne et en veillant au maintien du membre controlatéral contre la table d'examen. L'élévation de la jambe tendue a permis l'évaluation des ischio-jambiers, le test de Thomas modifié l'extensibilité du rectus femoris, et la dorsiflexion active de la cheville celle des gastrocnémiens. La prise en compte d'une hypoextensibilité de l'ilio-psoas, impactant la mesure de la longueur des ischio-jambiers, a été soulignée.
2. Protocole de mesure et gestion des erreurs
La mesure de la longueur musculaire a été réalisée de façon bilatérale pour chaque muscle à l'aide d'un goniomètre. La standardisation de la séquence d'examen a été cruciale pour minimiser les erreurs de mesure, une pratique essentielle dans le bilan diagnostic kinésithérapique afin d'obtenir des résultats objectifs, fiables et reproductibles (19). L’étude a reconnu l'incertitude inhérente aux mesures goniométriques, avec une marge d'erreur mentionnée entre 3 et 10° selon la littérature (4, 19, 33). Pour réduire ces erreurs, le protocole a intégré des mesures par paliers de 5°, une pratique conforme à la réalité clinique. De plus, l'importance de la comparaison des mesures pour tenir compte des variations individuelles a été soulignée (31), une approche essentielle pour s'affranchir des variations propres à chaque sujet et améliorer la précision des données. Cette approche comparative permet d'obtenir une évaluation plus précise et plus pertinente de l'extensibilité musculaire chez chaque participant.
III.Valeurs normales et prévalence de l hypoextensibilité
Les valeurs normales de l'extensibilité musculaire ont été calculées à partir de la moyenne de chaque groupe musculaire. Des seuils d'hypoextensibilité ont été définis pour chaque muscle en fonction de la littérature. L'étude a mis en évidence une prévalence importante d'hypoextensibilité, particulièrement pour le gastrocnémien (plus de 50%), mais aussi pour l'ilio-psoas (plus d'un participant sur cinq). Ces résultats ont été comparés aux données disponibles dans la littérature, notamment celles concernant les athlètes, révélant des différences significatives en termes de prévalence de l'hypoextensibilité.
1. Détermination des valeurs normales d extensibilité
L'étude a calculé les valeurs normales d'extensibilité pour chaque muscle bi-articulaire étudié (ilio-psoas, ischio-jambiers, rectus femoris, gastrocnémien) en utilisant la moyenne obtenue pour chaque groupe. Ces valeurs servent de référence pour l'interprétation des résultats et l'identification de l'hypoextensibilité. Il est important de noter que les valeurs normales rapportées dans la littérature sont variables selon les méthodes utilisées (tests actifs vs. passifs, types de tests employés). L'étude souligne ces variations, expliquant les écarts potentiels avec les moyennes publiées par d'autres auteurs (1, 33). Pour les ischio-jambiers, la variabilité des valeurs normales dans la littérature est également mise en avant, la validité de nombreuses études étant compromise par des biais de sélection et des tailles d'échantillons réduits (18). Les ischio-jambiers permettent normalement de lever la jambe à 70° (8) ou 80° (1) selon les auteurs. La méthode active utilisée dans cette étude diffère des méthodes passives de certaines études de la littérature et cela doit être pris en compte lors de la comparaison des résultats. La définition des valeurs limites pour l'hypoextensibilité s'est appuyée sur les données existantes dans la littérature et les résultats obtenus par les tests effectués.
2. Définition des seuils d hypoextensibilité
L'étude a établi des seuils pour définir l'hypoextensibilité de chaque muscle, en se référant aux données de la littérature. Pour l'ilio-psoas, en l'absence de données précises, un seuil arbitraire a été fixé : une extension de hanche supérieure à 5° lors du test de Thomas est considérée comme indicative d'hypoextensibilité (1, 4). Pour le rectus femoris, une flexion du genou inférieure à 50° a été définie comme seuil d'hypoextensibilité (7). Concernant le gastrocnémien, considérant que les études précédentes (1, 8) rapportaient une dorsiflexion passive de 10 à 15°, l'étude, utilisant un test actif, a établi un seuil d'hypoextensibilité à une dorsiflexion de la cheville inférieure à 5° (4). Ces seuils permettent de catégoriser les participants en fonction du niveau d'extensibilité de leurs muscles et d'identifier ceux présentant une hypoextensibilité. L'étude note des différences importantes entre les résultats obtenus et ceux des études réalisées sur les athlètes (4), notamment une prévalence plus élevée de l'hypoextensibilité dans la population générale étudiée.
3. Prévalence de l hypoextensibilité et comparaison avec d autres études
Un résultat majeur de l'étude est la prévalence élevée de l'hypoextensibilité musculaire, notamment pour le gastrocnémien, qui dépasse la moitié des participants. Plus d'un participant sur cinq présentait également une hypoextensibilité de l'ilio-psoas. La comparaison des résultats avec d'autres études s'est avérée difficile en raison du manque d'études similaires sur des sujets sains. Néanmoins, une comparaison a été effectuée avec les travaux de Krivkkas et Feinberg (4) sur des athlètes, et ceux de Kowalski et coll. (8) sur un échantillon de la population générale (gastrocnémien uniquement). La prévalence d'hypoextensibilité observée dans cette étude est supérieure à celle trouvée par Kowalski et coll. (8) (40%), qui ont utilisé un test passif et un échantillon plus diversifié en termes d'âge. La prévalence est également nettement plus élevée que celle rapportée par Krivkkas et Feinberg (4) pour les athlètes, tant chez les hommes que chez les femmes. Ces différences soulignent l'importance de considérer le type de population étudiée et la méthodologie utilisée lors de l'interprétation des données sur la prévalence de l'hypoextensibilité musculaire.
IV.Conséquences pathologiques de l hypoextensibilité musculaire
L'hypoextensibilité musculaire est liée à des déséquilibres musculaires, des problèmes posturaux et des douleurs (notamment des lombalgies). Des exemples de conséquences pathologiques, telles que la triade pied-genou-colonne (métatarsalgies, douleurs rotuliennes, syndrome vertébral), ont été présentés. L'hypoextensibilité peut également augmenter le risque de lésions sportives, comme les entorses de la cheville. Le lien entre la longueur des muscles du membre inférieur (ischio-jambiers, ilio-psoas, rectus femoris) et les problèmes de marche a également été abordé.
1. Anomalies Biomécaniques et Déséquilibres Musculaires
L'hypoextensibilité musculaire, conséquence d'un déséquilibre musculaire, engendre des anomalies biomécaniques et des défauts d'alignement. Ces déséquilibres, très fréquents, peuvent être liés à diverses activités (professionnelles, sportives) ou à des affections de l'appareil locomoteur. Ils provoquent des tensions et des contraintes anormales sur les articulations, ligaments et muscles, contribuant à de nombreux syndromes douloureux d'origine posturale (1). Le texte souligne l'importance d'une évaluation et d'une prise en charge globales de toute anomalie, car un dysfonctionnement à un niveau (ex: ischio-jambiers courts) peut affecter d'autres niveaux (ex: raccourcissement du gastrocnémien) (8). Des altérations de la marche ont été décrites en relation avec les changements de longueur des muscles du membre inférieur, notamment les ischio-jambiers (16), ou avec la réduction de l'amplitude d'extension de la hanche chez les sujets âgés (43). Une bonne posture dépend d'un bon équilibre musculaire, évalué par la force et l'extensibilité (1, 25).
2. Douleurs Posturales et leurs Localisations
L'hypoextensibilité musculaire contribue aux douleurs posturales à long terme, dues à la surcharge des éléments osseux, particulièrement articulaires. Les lombalgies sont les douleurs les plus fréquentes et les plus problématiques à prendre en charge (1, 44). L'étude cite la prévalence élevée des lombalgies en France (plus de la moitié de la population de 30 à 64 ans ayant souffert de lombalgies au moins un jour sur les 12 derniers mois, et 17% pendant plus de 30 jours) (45), ainsi que des données similaires aux États-Unis et en Scandinavie (15 à 45% de prévalence chez les adultes) (46). Ces lombalgies s'inscrivent parfois dans le cadre du syndrome de déconditionnement (12), associant perte de mobilité rachidienne, diminution des capacités musculaires et cardio-vasculaires. Au niveau du pied, un gastrocnémien court peut causer des métatarsalgies et avoir des répercussions sur les articulations supérieures (8). D'autres conséquences possibles d'un gastrocnémien court incluent la tendinite d'Achille, la rupture du tendon d'Achille, l'instabilité de la cheville, et l'arthrose à long terme. Une amplitude réduite de dorsiflexion augmente le risque d'entorses de la cheville (55, 56, 57).
3. Risques de Lésions Sportives et Facteurs de Risque
L'hypoextensibilité musculaire augmente le risque de lésions chez les sportifs. La mesure de la flexibilité des ischio-jambiers et du quadriceps est préconisée en début de saison pour identifier les sportifs à risque (5). La flexibilité du rectus femoris, mesurée par le test de Thomas modifié, pourrait prédire le risque de lésions des ischio-jambiers, en particulier pour une flexion du genou ≤ 51° (7). Chez les footballeurs, l'âge, le poids et l'extensibilité de l'ilio-psoas ont été identifiés comme facteurs de risque de lésions des ischio-jambiers (13). Ces données soulignent l'importance d'intégrer ces paramètres dans les programmes de prévention des lésions sportives. La corrélation entre l'hypoextensibilité et certaines pathologies est également abordée : l'hypoextensibilité des gastrocnémiens est liée à la « triade pied-genou-colonne », caractérisée par des douleurs au niveau du pied, du genou et de la colonne vertébrale, et plus fréquente chez les femmes adultes (8).
V.Traitement de l hypoextensibilité musculaire
Le traitement principal de l'hypoextensibilité musculaire repose sur la kinésithérapie, notamment les techniques d'étirements. Différentes méthodes, telles que les étirements proprioceptifs et la mobilisation tissulaire dynamique, ont été mentionnées. L'efficacité de la kinésithérapie a été soulignée pour restaurer l'équilibre musculaire et prévenir les conséquences de l'hypoextensibilité, quel que soit l'âge du patient. L'importance du travail sur la condition physique (force, souplesse, endurance) a été mise en avant pour la prévention, notamment chez les jeunes.
1. La Kinésithérapie Traitement principal de l hypoextensibilité
Le traitement de l'hypoextensibilité musculaire repose principalement sur la kinésithérapie (8, 58, 59, 60), visant à allonger les muscles hypoextensibles pour restaurer l'équilibre musculaire. Son intérêt est souligné quel que soit le stade d'évolution de l'anomalie et l'âge du patient. Les méthodes kinésithérapiques sont multiples et variées. Pour les gastrocnémiens, Kowalski et coll. (8) proposent une méthode d'allongement par kinésithérapie proprioceptive, utilisant un plateau de Freeman. Des séances de massage et de crochetages doux sont inclus dans le protocole. Pour les ischio-jambiers, des techniques de massage comme la mobilisation tissulaire dynamique (78) ou la technique de libération active (53) sont évoquées pour améliorer l'extensibilité. Chez les enfants, la kinésithérapie proprioceptive est privilégiée, suite aux récidives fréquentes observées après interventions chirurgicales d'allongement du gastrocnémien (8). Un traitement kinésithérapique d'entretien est préconisé jusqu'à la fin de la croissance, et les récidives ont également été constatées chez certains adultes, principalement des femmes.
2. Mécanismes d action des étirements et effets à long terme
Les mécanismes d'action des étirements sont discutés. Les gains de longueur musculaire pourraient résulter d'une augmentation de la tolérance à l'étirement sans changement des propriétés mécaniques ou visco-élastiques du muscle (14, 22, 66, 67). Des résultats similaires ont été observés pour les ischio-jambiers (68, 69, 70). Cependant, d'autres études suggèrent que les étirements agissent aussi sur les caractéristiques tissulaires (61). Un programme d'étirements de six semaines entraîne des changements significatifs de l'amplitude d'extension du genou, avec une augmentation de la raideur musculaire, suggérant des changements structuraux. Les étirements ont des effets à long terme, prévenant les lésions de surcharge de l'appareil locomoteur (21). Pour les ischio-jambiers, les étirements augmentent l'amplitude articulaire, quel que soit la technique, la position ou la durée (58), améliorant la mobilité de la hanche (65) et les performances musculaires (63). La contribution des structures nerveuses à la flexibilité musculaire est également soulignée, devant être prise en compte dans les programmes de réhabilitation et de prévention (72). L'augmentation d'amplitude articulaire après étirements est immédiate mais de courte durée, l'effet à long terme étant lié à l'augmentation de la tolérance à l'étirement (21).
3. Prévention par le travail sur la condition physique
L'étude met en lumière l'importance de la condition physique, résultant de la force, de la souplesse et de l'endurance musculaire, pour prévenir les problèmes liés à l'hypoextensibilité, notamment les lombalgies. La fréquence croissante des lombalgies à un âge jeune et leur coût social sont soulignés. L'étude aborde le syndrome de déconditionnement physique, avec ses composantes (perte de mobilité rachidienne, diminution des capacités musculaires et cardio-vasculaires) (12), relevant l'importance d'une prise en charge globale des patients lombalgiques (46). Chez les adolescents, les sujets sédentaires présentent des déficits de condition physique, de souplesse et de force (12). Les sportifs de haut niveau, bien que forts et endurants, montrent souvent un manque de souplesse. Seuls ceux pratiquant un sport de détente, sans esprit compétitif et de faible durée, présentent un bon équilibre entre force et souplesse (12). L'étude conclut sur la nécessité d'un travail accru sur la condition physique à des fins thérapeutiques et préventives dans le milieu scolaire et sportif.
