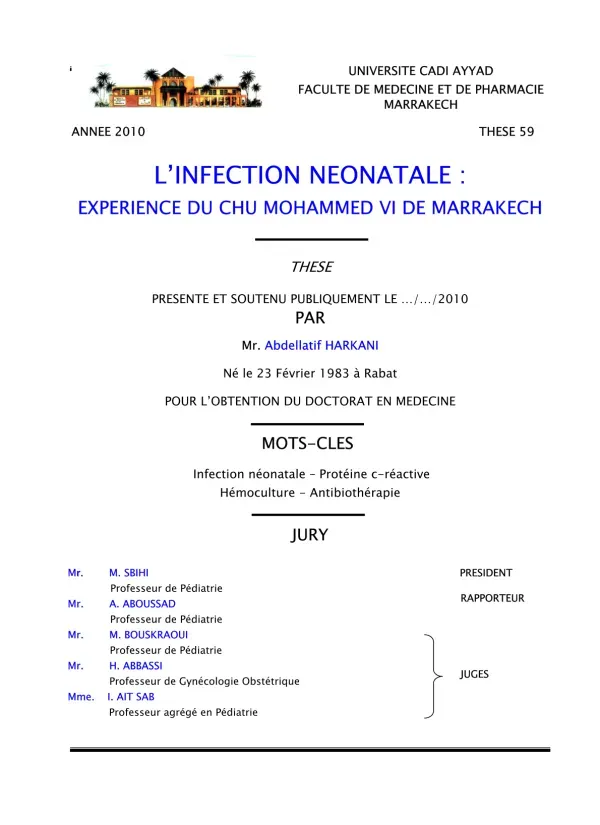
Thèse sur l'Infection Néonatale au CHU Mohammed VI de Marrakech
Informations sur le document
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 2.67 MB |
- Infection néonatale
- Pédiatrie
- Antibiothérapie
Résumé
I.Épidémiologie des Infections Néo natales au Maroc
Cette étude rétrospective, menée au CHU Mohammed VI de Marrakech sur 200 nouveau-nés suspectés d’infection néonatale, explore l'épidémiologie au Maroc. Contrairement aux données occidentales montrant une prédominance du streptocoque du groupe B (GBS) dans les infections materno-fœtales, les résultats suggèrent une prédominance des bacilles Gram négatif (BGN). Une étude de Benomar et coll. [16] rapporte seulement 6,9% de bactériémies à GBS, tandis qu'une étude tunisienne de Guédiche et coll. [77,78] indique 9,5%. Ces données mettent en évidence des différences géographiques significatives dans l'écologie bactérienne des infections néonatales.
1. Prédominance des agents infectieux au Maroc vs. données occidentales
L'étude souligne une différence majeure entre l'épidémiologie des infections néonatales au Maroc et celle observée en Europe et en Amérique du Nord. Alors que dans les pays occidentaux, le streptocoque du groupe B (Streptococcus agalactiae ou SGB) est la principale cause d'infection bactérienne néonatale, représentant 30 à 40% des cas, la situation au Maroc semble différente. Des études rétrospectives menées au Maroc, notamment à l'hôpital d'enfants de Casablanca en 1996, indiquent une prédominance des bacilles Gram négatif (BGN) dans les infections néonatales bactériennes. Le SGB ne représente que 6,9% des confirmations bactériologiques selon cette étude. Cette différence est également confirmée par des études maghrébines et d'Amérique Latine qui mettent en avant la relative rareté du SGB et la prédominance des BGN dans leur contexte. Le contraste est saisissant, illustrant la variabilité géographique des agents infectieux impliqués dans les infections néonatales. L'étude insiste sur la nécessité de prendre en compte ces différences régionales pour adapter les stratégies de diagnostic et de traitement.
2. Streptocoque du groupe B SGB au Maroc faible prévalence et caractéristiques
Bien que le streptocoque du groupe B (SGB) soit une cause majeure d’infections néonatales dans les pays occidentaux, son importance au Maroc semble beaucoup plus limitée. Une étude rétrospective casablancaise de 1996 révèle que le SGB ne représente que 6,9% des confirmations bactériologiques d'infections néonatales. Plusieurs sérotypes existent, les plus fréquents étant I, II et III, tandis que les sérotypes IV et V sont plus rares. Certains streptocoques restent non groupables. Le réservoir principal du SGB est le portage chronique asymptomatique, principalement au niveau digestif, avec une propagation secondaire vers le vagin. La bactérie est détectée chez 10 à 30% des femmes lors de prélèvements génitaux. Des stratégies de traitement sélectif des femmes colonisées et la prise en charge des ruptures prématurées des membranes pourraient contribuer à réduire la transmission materno-fœtale du SGB. Cependant, l'étude souligne la nécessité de recherches supplémentaires pour mieux comprendre l'épidémiologie du SGB au Maroc et son impact sur la santé néonatale.
3. Autres bactéries impliquées dans les infections materno fœtales au Maroc
Outre le streptocoque du groupe B, d'autres bactéries contribuent aux infections materno-fœtales au Maroc. Les bacilles Gram négatif (BGN) sont identifiés comme les agents pathogènes prédominants dans plusieurs études maghrébines. Escherichia coli, notamment, est impliquée dans un nombre significatif de septicémies néonatales. Sa transmission verticale est fréquente en raison d'un taux élevé de portage vaginal maternel au troisième trimestre. Le rapport colonisation/infection est comparable à celui du SGB (1/40). Escherichia coli est responsable d'une proportion importante des méningites tardives (65%) et des infections urinaires (90%) dans les troisième et quatrième semaines de vie. La résistance à l'ampicilline varie selon les régions, nécessitant l'emploi de céphalosporines. Haemophilus influenzae et Haemophilus parainfluenzae contribuent également aux infections materno-fœtales, souvent associées à des atteintes cutanées bulleuses, un sepsis et des infections pulmonaires. La colonisation vaginale par ces bactéries est liée à un risque accru d'accouchement prématuré. Les staphylocoques, dont Staphylococcus aureus, sont aussi impliqués, bien qu'ils soient moins fréquents. Les données sur la prévalence de ces autres bactéries au Maroc nécessitent une analyse plus approfondie.
4. Comparaison des données marocaines avec les études internationales
L'étude met en lumière des différences significatives entre l'épidémiologie des infections néonatales au Maroc et celles rapportées en Europe et aux États-Unis. Alors que le streptocoque du groupe B domine largement le tableau dans les pays occidentaux, les études maghrébines, y compris celle de Benomar et coll. [16], indiquent une prédominance des bacilles Gram négatif (BGN). L'étude de Benomar et coll. montre que les BGN représentent une part considérable des confirmations bactériologiques, tandis que le streptocoque du groupe B ne représente que 6,9%. Des résultats similaires sont observés dans une étude tunisienne de Guédiche et coll. [77,78] avec 90,5% de BGN. Cependant, il est important de noter que d’autres études, comme celle de Benhadj et coll. [77] à Mahdia (Tunisie), rapportent une prédominance du streptocoque du groupe B (55,4%), illustrant la variabilité des résultats selon les régions et les méthodologies. Cette disparité souligne la nécessité d'études épidémiologiques plus approfondies au sein du Maghreb pour affiner notre compréhension de la distribution des agents infectieux et adapter les stratégies de prévention et de traitement.
II.Diagnostic des Infections Néo natales Marquers Biologiques et Examens
Le diagnostic repose sur des arguments cliniques, anamnestiques et biologiques. Les anomalies de l’hémogramme (51% des cas) et l’élévation de la protéine C-réactive (CRP) (71% des cas) sont des indicateurs importants. L'hémoculture, réalisée chez seulement 3% des nouveau-nés, s'est avérée positive dans un seul cas (Klebsiella multirésistante). La ponction lombaire, effectuée chez 8,5% des patients, a révélé 2 cas de méningite néonatale. L'étude souligne la nécessité d'améliorer la sensibilité du diagnostic précoce des infections néonatales, explorant le potentiel de marqueurs comme la pro-calcitonine (PCT) et les cytokines.
1. Hémogramme et anomalies leucocytaires
L'interprétation de l'hémogramme joue un rôle crucial dans le diagnostic des infections néonatales. La réponse leucocytaire classique à une infection suit une séquence : neutropénie (baisse des neutrophiles), myélémie (apparition de formes jeunes de leucocytes), puis polynucléose neutrophile (augmentation des neutrophiles). La neutropénie, phénomène précoce et de courte durée, résulte du piégeage des neutrophiles au site infectieux. La myélémie traduit une forte stimulation médullaire. Cependant, la fiabilité de ces marqueurs est limitée par l'évolution physiologique du nombre de leucocytes durant les premiers jours de vie et la variabilité liée à l'âge gestationnel. L'interprétation des taux de leucocytes doit donc tenir compte de l'âge gestationnel et de l'âge postnatal, selon des normes établies. Dans l’étude, des anomalies de l’hémogramme ont été observées chez 51% des nouveau-nés. La recherche de nouveaux marqueurs, notamment les cytokines et la pro-calcitonine, est en cours pour améliorer la précision du diagnostic.
2. Protéine C réactive CRP comme marqueur biologique principal
La protéine C-réactive (CRP) est le marqueur biologique le plus utilisé pour le diagnostic d'infection bactérienne néonatale. Synthétisée et libérée par le foie en réponse à l'interleukine 6, elle ne traverse pas la barrière placentaire. Son dosage est simple, rapide et sa cinétique est plus rapide que celle du fibrinogène et de l'orosomucoïde. Son taux sérique augmente entre 6 et 12 heures après le début de l'infection, culmine après 24-48 heures, puis décroît. Des faux positifs (inhalation méconiale, contusions…) et négatifs (stade précoce de la maladie) existent. L'intérêt de la CRP dans la prise en charge des nouveau-nés suspects d'infection remonte aux années 1980. Des études ont montré une sensibilité de près de 78% et une spécificité de 94% pour une CRP à 24 heures. Dans l'étude actuelle, la CRP était positive chez 71% des 183 nouveau-nés testés, reflétant son utilité diagnostique, même si la variabilité des seuils de positivité entre laboratoires est à noter.
3. Pro calcitonine PCT et autres marqueurs émergents
La pro-calcitonine (PCT) est une pro-hormone dont le rôle dans les phénomènes anti-infectieux reste inconnu. Son taux sérique augmente lors d'infections bactériennes, mais pas virales. Elle peut être élevée en cas de détresse respiratoire ou après administration de surfactant exogène. Sa cinétique est intermédiaire entre celle des cytokines et de la CRP. Plusieurs études ont comparé la cinétique de la CRP et de la PCT comme marqueurs d'infection néonatale. Des résultats variables ont été obtenus concernant la sensibilité et la spécificité de la PCT, avec des valeurs allant jusqu'à 85,7% de sensibilité selon l'étude de Chiesa et coll. [68], soulignant l'importance de la prise en compte des variations horaires. Malgré cela, l'étude actuelle ne s'est pas focalisée sur le dosage de la PCT, se concentrant sur l'hémogramme et la CRP. La recherche future devrait explorer davantage le potentiel diagnostique de la PCT et des cytokines (IL-6, TNF-alpha) pour un diagnostic plus précoce et fiable des infections néonatales.
4. Hémoculture Ponction lombaire et Prélèvements Périphériques
L’hémoculture, idéalement réalisée avant toute antibiothérapie, est un examen essentiel pour l’identification des bactéries responsables de la bactériémie. Dans cette étude, elle a été pratiquée chez seulement 3% des nouveau-nés, avec un seul cas positif (Klebsiella multirésistante). La ponction lombaire, examen invasif, est réservée aux cas suspects de méningite, avec signes cliniques et/ou hémoculture positive. Dans cette étude, elle a été réalisée chez 8,5% des patients, révélant 2 cas de méningite. L'interprétation des prélèvements périphériques (liquide gastrique, prélèvements superficiels) est complexe et source de variabilité dans la littérature, en raison d'une éventuelle surcolonisation à la naissance. L’étude souligne l’importance de la qualité des prélèvements et la nécessité d'une interprétation prudente des résultats compte tenu de la flore polymicrobienne possible, avec une valeur prédictive négative (VPN) relativement bonne du liquide gastrique pour la plupart des auteurs. Dans cette série, seulement 10 cas avaient des prélèvements périphériques positifs.
III.Traitement Antibiotique des Infections Néo natales
L’antibiothérapie est la pierre angulaire du traitement. L'association opticilline-gentamicine a été utilisée chez 64,5% des nouveau-nés, tandis que l'association céphalosporines de 3ème génération (C3G)-gentamicine a été administrée à 31,5%. Dans 4% des cas, des antibiotiques à large spectre ont été nécessaires. La durée moyenne du traitement était de huit jours. L'étude discute les choix thérapeutiques en fonction de l'épidémiologie locale, des résistances bactériennes et des données pharmacocinétiques néonatales, soulignant l'importance d'adapter le traitement en fonction du germe identifié. La résistance à la méthicilline chez les Staphylococcus est également abordée.
1. Antibiothérapie de première intention choix et considérations
Le choix de l'antibiothérapie de première intention repose sur le contexte clinique et biologique, l'épidémiologie locale, les résistances bactériennes et les premiers résultats bactériologiques. L'association de deux antibiotiques synergiques (bêtalactamine et aminoside) est souvent privilégiée pour élargir le spectre d'action, diminuer les résistances et accélérer la bactéricidie. Cette approche est particulièrement efficace contre le streptocoque du groupe B, Escherichia coli et Listeria. Les posologies sont adaptées à l'âge gestationnel et à la localisation de l'infection. Dans l'étude, l'association opticilline-gentamicine a été utilisée chez 64,5% des nouveau-nés, tandis que l'association céphalosporine de 3ème génération (C3G)-gentamicine a été employée chez 31,5% des patients. La substitution de l'opticilline par des C3G a été réalisée dans 20,5% des cas en cas d'absence d'amélioration clinique. Des antibiotiques à large spectre ont été utilisés dans 4% des cas (suspicion d'infection nosocomiale).
2. Classes d antibiotiques utilisées et leurs propriétés
Les céphalosporines (céfotaxime, ceftriaxone) sont actives sur les streptocoques B et les entérobactéries, mais pas sur Listeria, les anaérobies, ou les streptocoques D. La ceftriaxone, facile à administrer en dose unique, peut présenter des effets toxiques (hémolyse, précipitations biliaires). L'ampicilline, active sur les streptocoques B, E. coli et Listeria, peut être administrée par voie intraveineuse ou orale. L'association avec l'acide clavulanique n'apporte pas d'avantage et présente des risques de toxicité. Les fluoroquinolones ont une activité variable selon les espèces bactériennes, étant efficaces contre les bacilles Gram négatif mais présentant des résistances variables et étant contre-indiquées chez l'enfant, malgré une utilisation rapportée dans certaines publications pour les infections nosocomiales à germes multirésistants ou des méningites à germes spécifiques. Le choix des antibiotiques doit être guidé par l'identification du germe et les données de résistance locale.
3. Stratégies antibiotiques et adaptation du traitement
Chez les nouveau-nés symptomatiques, une antibiothérapie probabiliste intraveineuse est administrée en urgence après bilan clinique, bactériologique et biologique. Après 48 heures, le traitement est réévalué en fonction de l'état clinique et des résultats. L'approche préconisée vise une association anti-infectieuse à spectre étroit, optimisant le mode d'administration. Langhendries et coll. [85] proposent un « pari raisonné », associant une bêtalactamine (à bactéricidie temps-dépendante) et un aminoside (à bactéricidie concentration-dépendante). Dans cette étude, l'association opticilline-gentamicine a été administrée dans 64,5% des cas, l'association C3G-gentamicine dans 31,5%, et des antibiotiques à large spectre dans 4%. La durée moyenne du traitement était de 8 jours, sauf pour les méningites (3 semaines). L'adaptation du traitement est cruciale en fonction du germe identifié, avec une prise en charge spécifique des infections à Staphylococcus résistant à la méthicilline.
4. Revue de la littérature et comparaison des pratiques
Une revue de la littérature confirme l'utilisation fréquente des associations bêtalactamines-aminosides ou céphalosporines-aminosides en première intention. Benomar et coll. [16] ont utilisé l'association C3G-nétilmicine (43,3%), amoxicilline-aminoside (33%) et une triple association (20%). Aboussad et coll. [5] ont montré une meilleure sensibilité des germes aux C3G qu'aux bêtalactamines, la nétilmicine étant l'aminoside de référence. Reyna-Figueroa et coll. [86] ont démontré que l’ampicilline n'est pas forcément l'option la plus économique. L'antibiothérapie initiale doit être active contre les staphylocoques résistants à la méthicilline, les entérobactéries et Pseudomonas. Dans les infections liées à un cathéter, le Staphylococcus est souvent impliqué, le recours à la fosfomycine étant réservé aux formes graves et aux méningites. L'ablation du cathéter dépend de la gravité et de la réponse au traitement.
IV.Evolution et Mortalité
L'étude a évalué l’évolution à court terme (moyenne de 4,6 nuits d’hospitalisation). Le taux de mortalité était de 9,5%. L'évolution clinique a été jugée favorable dans 83% des cas, mais compliquée chez 6,5%. L'étude souligne le besoin de surveillance à moyen et long terme pour évaluer les séquelles neurologiques et pulmonaires, fréquemment rapportées dans la littérature (8 à 33%). La prévention, impliquant une coordination obstétrique-pédiatrique et une surveillance rigoureuse des grossesses, est essentielle pour réduire la mortalité néonatale liée aux infections néonatales.
1. Évolution à court terme et mortalité
Cette étude rétrospective a évalué l'évolution des 200 nouveau-nés hospitalisés pour suspicion d'infection néonatale uniquement pendant leur séjour hospitalier (4,6 nuits en moyenne). Le manque de suivi à moyen et long terme limite l'analyse des séquelles possibles. Le taux de mortalité observé est de 9,5%. L'évolution clinique a été jugée favorable dans 83% des cas, compliquée dans 6,5% des cas. Il est important de noter que la littérature mentionne une fréquence des séquelles entre 8 et 33% selon les études, les séquelles précoces étant majoritairement neurologiques et pulmonaires, tandis que les séquelles tardives sont principalement neurologiques, avec parfois des complications orthopédiques.
2. Conséquences des infections néonatales et nécessité de la prévention
Les infections néonatales représentent un problème majeur de santé publique, constituant une préoccupation constante en néonatologie. Leurs conséquences médicales et économiques importantes justifient des mesures de surveillance et de prévention rigoureuses. La prise en charge optimale nécessite une collaboration étroite entre pédiatres et obstétriciens pour obtenir des antécédents précis et identifier les nouveau-nés à risque. La présence d'un pédiatre en salle d'accouchement est donc essentielle pour une intervention rapide et efficace. L’étude actuelle, bien que fournissant des données sur l’évolution à court terme et la mortalité, souligne la nécessité de recherches plus approfondies sur les séquelles à long terme des infections néonatales pour mieux orienter les stratégies de prévention et d'amélioration de la prise en charge.
