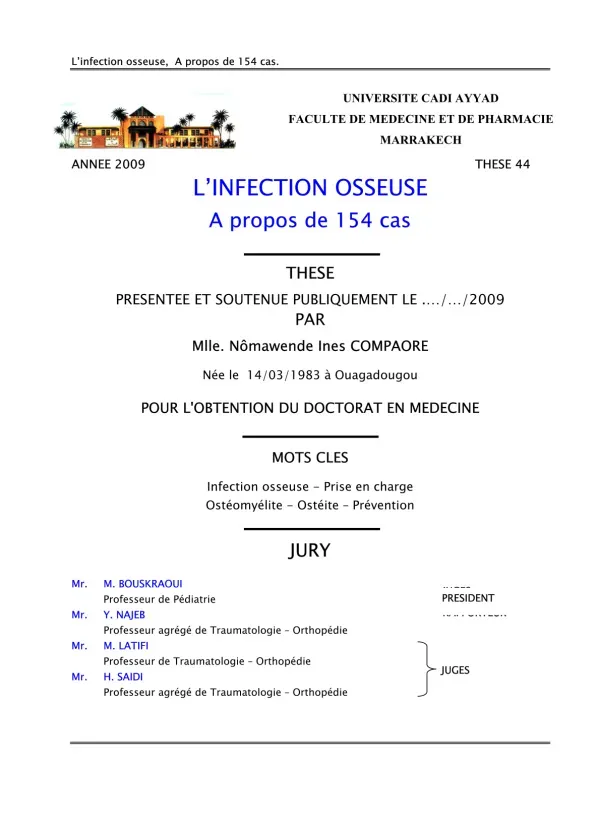
Thèse sur l'Infection Osseuse et sa Prise en Charge
Informations sur le document
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 4.28 MB |
- Infection osseuse
- Médecine
- Ostéomyélite
Résumé
I.Lutte contre l ostéomyélite et l ostéite en chirurgie orthopédique
Cette étude porte sur la prise en charge de l'ostéomyélite et de l'ostéite, des infections osseuses fréquentes en chirurgie orthopédique, notamment les infections postopératoires. L'accent est mis sur la prévention et le traitement de ces infections osseuses, soulignant le rôle crucial de la prévention des infections nosocomiales. L'étude analyse les facteurs de risque, les signes cliniques (douleur, fistule, abcès), et les approches thérapeutiques, incluant la chirurgie (séquestrectomie) et l'antibiothérapie. Le contexte socio-économique et les ressources limitées influencent la prise en charge dans certains cas, impactant les taux de succès et le suivi des patients.
1. Prévention des Infections Ostéo articulaires
La lutte contre les infections nosocomiales, particulièrement en chirurgie orthopédique, est primordiale. L'infection postopératoire est considérée comme une catastrophe à éviter absolument, nécessitant une prise en charge médico-chirurgicale rigoureuse. La prévention est la clé, impliquant tous les acteurs sociaux : décideurs politiques, éducateurs, personnel médical et paramédical. L'étude souligne l'importance d'une implication collective pour prévenir et gérer efficacement ces infections, soulignant la nécessité d'une hygiène hospitalière irréprochable, d'une asepsie périopératoire stricte et d'une antibioprophylaxie appropriée. L'étude met en évidence le besoin de mieux comprendre la propagation des agents infectieux, comme le staphylocoque doré, pour améliorer les stratégies préventives. La prévention des infections d'origine communautaire (ostéite d'inoculation) passe par un traitement précoce et adéquat des plaies, fractures et infections des tissus mous.
2. Diagnostic et Étude des Facteurs de Risque
Le diagnostic repose sur une anamnèse complète (âge, sexe, antécédents médicaux), un examen clinique détaillé (signes locaux et généraux, durée de la symptomatologie, localisation de l'infection), et des examens complémentaires. L'imagerie médicale, en particulier l'IRM, est cruciale pour évaluer l'étendue de l'infection et la différencier d'autres affections osseuses. Les analyses bactériologiques (hémocultures, prélèvements directs au site de l'infection) permettent d'identifier le germe responsable et d'adapter le traitement antibiotique. L'étude souligne les difficultés d'accès aux analyses bactériologiques pour certains patients, notamment en raison de contraintes financières. Divers facteurs de risque augmentent la probabilité d'ostéomyélite et d'ostéite, notamment le diabète (une forte prévalence de 29 cas sur 50 patients présentant des facteurs de risque dans l'étude), les fractures ouvertes, la présence d'implants, et l'âge avancé. Le document note une absence de cas de maladie maligne dans l'échantillon de l'étude, contrairement à la littérature. L’étude mentionne un retard de consultation significatif chez 71% des patients, impactant l’efficacité des traitements.
3. Traitement et Complications
Le traitement de l'ostéomyélite et de l'ostéite est une approche médico-chirurgicale. L'antibiothérapie est fondamentale, avec des durées de traitement pouvant atteindre plusieurs mois, particulièrement dans les cas chroniques et en présence d'implants. La voie d'administration (parentérale puis orale) est ajustée en fonction de l'évolution clinique et biologique. La chirurgie est souvent nécessaire, notamment la séquestrectomie pour retirer les tissus nécrosés et les séquestres osseux. Différentes techniques chirurgicales sont abordées, telles que le drainage d'abcès, le lavage-drainage continu, l'utilisation de fixateurs externes, et la greffe osseuse. Le choix de la stratégie opératoire dépend de multiples facteurs (âge, localisation, état vasculaire). Les complications potentielles sont sévères et peuvent engager le pronostic vital (choc septique, sepsis). Des séquelles orthopédiques significatives (troubles de croissance, raccourcissement osseux, fistules chroniques) peuvent survenir en cas de diagnostic tardif ou de traitement inadéquat. L'étude mentionne des taux de succès variables selon les interventions chirurgicales. Les méthodes utilisées ont été choisies pour leur facilité d'application chez les patients démunis. L'étude relève un nombre important (21%) de patients perdus de vue, nécessitant des recherches supplémentaires.
II.Diagnostic de l Ostéomyélite et de l Ostéite
Le diagnostic repose sur l'anamnèse (âge, sexe, antécédents), l'examen clinique (signes locaux et généraux), et des examens complémentaires. L'imagerie médicale, notamment l'IRM, joue un rôle essentiel pour visualiser l'étendue de l'infection et différencier l'ostéomyélite de l'ostéite et des tumeurs osseuses. Les analyses bactériologiques (hémocultures, prélèvements au site de l'infection) sont cruciales pour identifier le germe responsable, notamment Staphylococcus aureus, et guider le choix de l'antibiothérapie. Des difficultés d'accès aux examens bactériologiques ont été rapportées.
1. Anamnèse et Examen Clinique
Le diagnostic commence par une anamnèse détaillée, recueillant des informations sur l'âge, le sexe du patient et ses antécédents médicaux, notamment son statut physiologique. Les informations de contact (nom, prénom, adresse) sont également enregistrées pour le suivi. L'examen clinique est crucial pour évaluer le mode d'infection (ostéomyélite par contamination hématogène ou ostéite par contamination directe), en utilisant une classification francophone. L'évaluation inclut les signes généraux et locaux, la durée de la symptomatologie (actuelle et totale), la localisation et la latéralité de l'infection. La présence de complications est notée, incluant des informations sur les types de complications (sepsis, fistulisation, etc.) ainsi que le nombre d'interventions chirurgicales répétées. Pour les formes subaiguës, le début est insidieux, avec une symptomatologie discrète (douleurs) et peu de signes locaux ou généraux. Une discrète élévation de la VS peut être observée. L'interprétation des radiographies peut être difficile, à cause de similitudes avec des tumeurs bénignes ou malignes et des dystrophies osseuses bénignes.
2. Examens Complémentaires
Des examens complémentaires sont essentiels pour confirmer le diagnostic et déterminer l'étendue de l'infection. La biopsie du foyer infectieux avec mise en culture est recommandée, surtout en cas de doute diagnostique, pour préciser la forme de l'infection (aiguë ou chronique). Les hémocultures et les prélèvements directs au site de l'infection (à l'aiguille ou per-opératoire) sont également importants, bien que les prélèvements sur drains aient moins de valeur, sauf pour le Staphylococcus aureus. La recherche d'une porte d'entrée est conduite à travers des examens comme l'ECBU, des prélèvements ORL ou cutanés, et l'électrophorèse de l'hémoglobine. L'IRM est un examen crucial pour évaluer la présence et l'étendue de l'infection musculosquelettique, permettant de distinguer l'infection osseuse de celle des tissus mous. L'IRM permet de visualiser les trajets fistuleux, les abcès et les cellulites infectieuses, bien que la distinction avec des tumeurs puisse être difficile. L'étude souligne des difficultés d'accès aux analyses bactériologiques, attribuées à des problèmes financiers des patients ou à l'indisponibilité de laboratoires.
3. Signes Cliniques et Localisation de l Infection
Plusieurs signes cliniques orientent vers un diagnostic d'ostéomyélite ou d'ostéite. Les fistules cutanées (présentes dans 54% des cas de l'étude) sont un signe important, nécessitant une recherche d'ostéite chronique et/ou de séquestres. La douleur est un symptôme constant (100% des patients dans l'étude), même si son intensité peut varier avec la durée de l'infection. D'autres signes cliniques incluent la tuméfaction cutanée, l'inflammation de la peau, et les abcès sous-cutanés. Une impotence fonctionnelle totale ou relative peut survenir dans certains cas. Les principaux motifs de consultation sont la fistule, la douleur, les abcès et la tuméfaction inflammatoire. L'étude note une prédominance des infections au membre inférieur, ce qui est expliqué par la fréquence des fractures ouvertes dans cette région, confirmant l'adage que « l'ostéomyélite est loin du coude et près du genou ». La recherche des germes infectieux était limitée dans cette étude et pour certains patients elle n'a même pas été jugé utile.
III.Traitement de l Ostéomyélite et de l Ostéite
La prise en charge de l'ostéomyélite et de l'ostéite est médico-chirurgicale. Le traitement antibiotique, souvent prolongé (plusieurs mois), est adapté en fonction de l'antibiogramme et de la gravité de l'infection. La chirurgie, notamment la séquestrectomie, est souvent nécessaire pour éliminer le tissu nécrosé et les séquestres osseux. Des techniques chirurgicales variées sont utilisées, y compris le drainage, le lavage-drainage continu, le fixateur externe, et la greffe osseuse. Le choix de la stratégie thérapeutique dépend de multiples facteurs, dont l'âge du patient, la localisation de l'infection, et la présence d'implants. L'étude mentionne l'utilisation d'amoxicilline/acide clavulanique et de fluoroquinolones, ainsi que d'autres antibiotiques en fonction des cas.
1. Traitement Antibiotique
Le traitement de l’ostéomyélite et de l’ostéite repose sur une approche combinant antibiothérapie et chirurgie. L’antibiothérapie est essentielle, sa durée variant de plusieurs mois, particulièrement pour les cas chroniques où le matériel chirurgical doit rester en place. Pour les formes aiguës, une administration parentérale est initialement privilégiée, suivie d'un relais oral après 3 à 4 semaines, sous réserve d’une bonne réponse clinico-biologique, d'une biodisponibilité efficace par voie orale et d'une excellente observance du patient. Le choix des antibiotiques repose principalement sur l’expérience du praticien, le coût du traitement et les précautions liées à une utilisation prolongée, sauf si un antibiogramme est disponible. L’amoxicilline est utilisée en association avec l'acide clavulanique en raison de l’augmentation des taux d'échecs lorsqu'elle est utilisée seule. Le document mentionne l'utilisation d'autres molécules comme la méticilline-aminosides avec un relais oral par les fluoroquinolones, ainsi que des nouvelles molécules (daptomycine, tigécycline, linézolide, moxifloxacine) et la possibilité de raccourcir la durée du traitement. Des traitements complémentaires, comme la corticothérapie orale, les biphosphonates ou la sulfasalazine, peuvent être envisagés dans certains cas.
2. Traitement Chirurgical
La chirurgie joue un rôle important dans le traitement de l'ostéomyélite et de l'ostéite. En cas de matériel infecté, son ablation est souvent nécessaire, avec possibilité de remplacement après 6 à 8 semaines d'antibiothérapie (80-90% de succès). Un sauvetage du matériel est envisageable si l'infection est aiguë (moins de 2-4 semaines), sans descellement, avec un germe identifié et sensible aux antibiotiques, bien que le taux de succès soit inférieur (70%) avec un traitement antibiotique prolongé (3-6 mois). Plusieurs techniques chirurgicales sont mentionnées : le drainage d’abcès sous-périosté ou intra-médullaire pour les cas résistants à l’antibiothérapie ou sur os fragilisé; le lavage-drainage continu comme adjuvant après l'excision de tissus nécrosés; l'utilisation de fixateurs externes pour des montages stables, permettant la surveillance locale et la mobilisation des articulations; et la couverture osseuse pour l’ostéite sur os non couvert avec perte de substance osseuse (technique d’Ilizarov ou greffe osseuse). La séquestrectomie est pratiquée pour l'ablation des séquestres, mais n’est pas toujours possible en cas de décalcification osseuse trop étendue ou dans le cadre d'une amputation. La correction osseuse (fixateur, orthèse, attelle) est essentielle pour éviter les fractures pathologiques secondaires.
3. Soins Postopératoires et Suivi
En postopératoire, les pansements à plat sont préférés aux irrigations en raison de leur coût inférieur et de leur facilité d'application. Dans certains cas, un plâtre peut suffire à guérir les fractures pathologiques. L'étude note un taux élevé de patients perdus de vue (21%), soulignant la nécessité d'études supplémentaires pour comprendre les raisons de ce phénomène. La restitution ad integrum est possible si le traitement est commencé suffisamment tôt, permettant la consolidation des lésions et le retour progressif à un aspect radiologique normal. La gestion du traitement et du suivi posent des défis liés aux ressources, en particulier l'accès aux antibiotiques et à certains types d'intervention chirurgicale. La simplicité des méthodes utilisées dans l'étude était dictée par la situation socio-économique des patients, souvent démunis.
IV.Facteurs de risque et pronostic de l Ostéomyélite
Plusieurs facteurs de risque aggravent le pronostic de l'ostéomyélite : le diabète (29 patients diabétiques sur 50 présentant des facteurs de risque dans l'étude), les fractures ouvertes (13 cas), la présence d'implants (92 cas), et l'âge avancé (20 patients de plus de 65 ans). La chronicité de l'infection, les retards de consultation (71% des patients ont consulté après un mois), et les ressources limitées des services de santé contribuent également à une évolution défavorable. Des complications sévères, telles que les fistules cutanées (54% des cas), l’amputation (25%), et les séquelles orthopédiques, sont fréquentes. Le taux de patients perdus de vue était de 21%.
1. Facteurs de Risque Majeurs
Plusieurs facteurs augmentent le risque d'ostéomyélite. L'étude identifie le diabète comme un facteur majeur, avec une prévalence importante parmi les patients (29 sur 50 présentant des facteurs de risque). La présence d'implants (prothèses ou matériel d'ostéosynthèse) constitue un facteur de risque indépendant, affectant 92 cas sur l'échantillon étudié. Les fractures ouvertes représentent également un risque significatif, avec 13 cas dans l'étude. L'âge avancé est un autre facteur aggravant, comme le montre la présence de 20 patients âgés de plus de 65 ans. Cette vulnérabilité est liée à une immunodépression relative et à une augmentation de la fréquence des pathologies chroniques, notamment vasculaires. L'insuffisance vasculaire, la neuropathie et l'artériopathie, particulièrement associées au diabète, augmentent le risque d'infection osseuse, même si les ostéites sur pied diabétique ne sont pas inclus dans cette série. L'étude ne relève aucun cas de maladie maligne, contrairement à certaines observations dans la littérature, ce qui est probablement dû à la taille limitée de l'échantillon (patients hospitalisés en orthopédie).
2. Influence du Contexte Socio économique
Le contexte socio-économique influence significativement le pronostic de l'ostéomyélite. Un retard important dans les consultations médicales est observé (71% des patients consultent après un mois), en partie expliqué par le sous-développement, les traditions culturelles et le recours fréquent à la médecine traditionnelle. Ce retard de prise en charge contribue à une évolution plus défavorable de la maladie. De plus, l'accès limité aux soins et aux examens bactériologiques pour des raisons financières impacte la qualité du diagnostic et du traitement, car la recherche bactériologique n'a pas été jugée utile pour une majorité de patients déjà sous antibiothérapie. Les difficultés d'accès aux analyses sont mises en avant, influençant la capacité à identifier le germe responsable et à adapter le traitement au mieux. La prédominance de l'infection au membre inférieur est liée à la fréquence des fractures ouvertes dans cette zone.
3. Manifestations Cliniques et Pronostic
Les signes cliniques de l'ostéomyélite sont variables, la fièvre étant modérée ou absente dans les cas chroniques (seulement 11% des patients présentaient de la fièvre dans cette étude). Les fistules cutanées sont fréquentes (54% des cas), souvent associées à une ostéite chronique et/ou à la présence de séquestres. La douleur est un symptôme constant (100% des patients) mais sa persistance varie (38,5%). L’étude mentionne également la tuméfaction cutanée, l’inflammation cutanée, et les abcès sous-cutanés comme signes cliniques importants. Une impotence fonctionnelle, liée à une arthrite associée, aux séquelles de la pathologie, ou à l’hyperalgie, est présente chez 11 % des patients. Le pronostic est souvent défavorable, avec une forte prévalence d'évolution chronique (81%), récidivante (23%), et des complications sévères (28%). Après un an, seulement 51% des cas montrent une stabilisation, avec des taux d'amputation élevés (25%). Le document souligne le profil des patients atteints d'ostéomyélite chronique dans les pays en développement : malades chroniques, diminués physiquement et intellectuellement, avec des conséquences psychologiques importantes liées aux fistules persistantes et aux hospitalisations répétées.
V.Prévention des infections nosocomiales en chirurgie orthopédique
La prévention des infections nosocomiales, particulièrement dangereuses en chirurgie orthopédique, est essentielle. Les mesures d'hygiène hospitalière, l'asepsie périopératoire, et l'antibioprophylaxie sont cruciales pour réduire le risque d'infection postopératoire. L'étude souligne l'importance de l'implication de tous les acteurs (personnel médical, décideurs politiques) pour améliorer la prise en charge globale des infections osseuses, notamment dans le contexte du sous-développement qui influence les délais de consultation et l'accès aux soins.
1. L Infection Postopératoire Une Catastrophe à Prévenir
L'infection postopératoire en chirurgie orthopédique est présentée comme une catastrophe majeure, nécessitant une prévention rigoureuse. Sa prise en charge est complexe, impliquant des traitements médico-chirurgicaux. La prévention de ces infections, cependant, est essentielle et commence par une implication de tous les acteurs sociaux : les décideurs politiques, les éducateurs, et le personnel médical et paramédical. L’infection postopératoire conduit à des réinterventions, augmentant la morbidité, allongeant la durée d’hospitalisation et entraînant des coûts supplémentaires. La prévention repose sur des mesures d’hygiène hospitalière strictes, une asepsie périopératoire rigoureuse, et l’antibioprophylaxie. Le texte souligne le besoin de recherches supplémentaires pour approfondir la compréhension de la propagation d'agents infectieux, comme le staphylocoque doré, afin d'améliorer les stratégies de prévention.
2. Mesures de Prévention et Contrôle des Infections
La prévention des infections nosocomiales, c’est-à-dire les infections contractées à l'hôpital et absentes à l'admission, est un enjeu majeur de santé publique. Les services de chirurgie, de réanimation et de médecine sont particulièrement touchés. Pour différencier une infection communautaire d’une infection nosocomiale, un délai d'au moins 48 heures après l'admission (ou un délai supérieur à la période d'incubation si connue) est généralement considéré. La prévention des infections postopératoires repose sur l’hygiène hospitalière, l’asepsie périopératoire et l’antibioprophylaxie. Concernant les fractures ouvertes, une antibiothérapie intraveineuse dans les six heures suivant la blessure et pendant 24h est recommandée pour minimiser le risque d’infection osseuse. L'étude mentionne les infections urinaires comme les infections nosocomiales les plus fréquentes, suivies des infections de plaies opératoires, des bactériémies, des pneumonies et des infections sur cathéter. La classification du CDC (Centers for Disease Control and Prevention) distingue trois types d’infection du site opératoire.
3. Amélioration des Pratiques et de la Prise en Charge
L'étude met en évidence la nécessité d'améliorer plusieurs aspects de la prise en charge pour optimiser la prévention et le traitement des infections osseuses. L'amélioration de la qualité de l'accueil et de l'information des patients et de leurs familles pourrait contribuer à réduire le nombre de patients perdus de vue. Un entretien rigoureux des dossiers médicaux, avec une notation précise des décisions prises, des dates, des raisons et des résultats, est essentiel pour améliorer la qualité des études futures et le suivi des patients. Le document insiste sur l'importance de sensibiliser toute la communauté à la lutte contre les infections nosocomiales, car l'implication de tous les acteurs sociaux est indispensable pour améliorer la prise en charge de l'infection osseuse. L'utilisation d'implants en chirurgie orthopédique représente un facteur de risque d'infection. Une bonne préparation préopératoire, une stérilisation efficace des salles opératoires, et l’antibioprophylaxie sont nécessaires pour réduire ce risque (0,5 à 2%).
